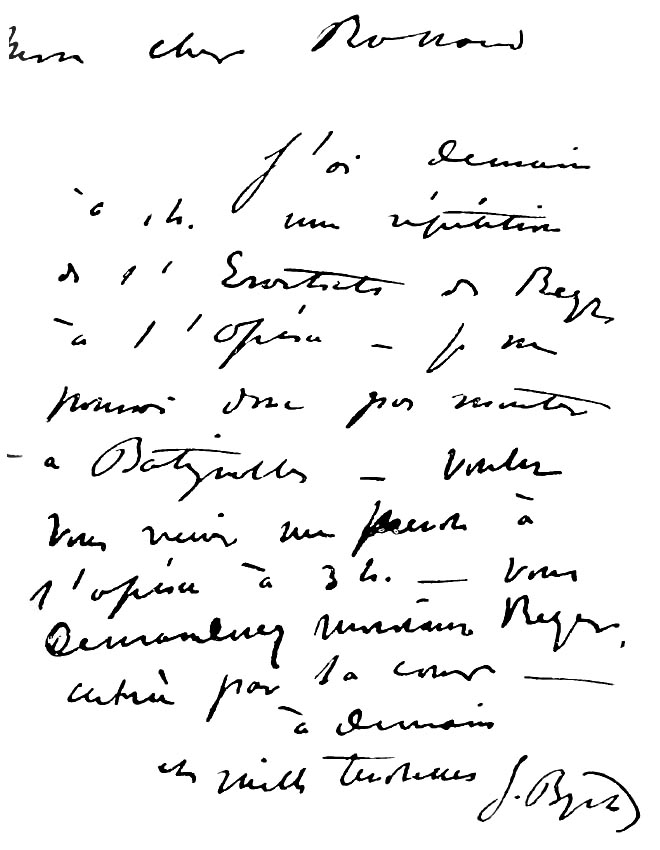
CHARLES PIGOT
Georges BIZET
et son œuvre
préface par Adolphe Boschot
Librairie Ch. Delagrave
15 rue Soufflot
Paris
1912
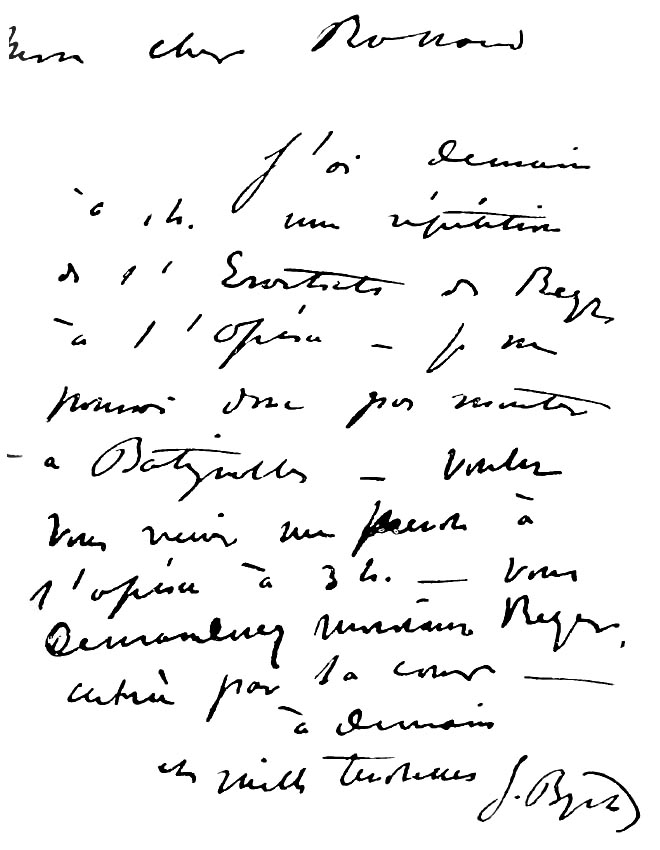
Une lettre de Georges Bizet
TABLE DES MATIÈRES
I. Les premières années. — Le Conservatoire.
II. Rome. — Les Envois. — Don Procopio.
III. Le Retour. — Les premiers travaux. — Bizet wagnérien.
V. Ivan le Terrible. — Période fiévreuse. — Nouvelle incursion au pays de l'Opérette.
VII. Bizet critique. — Noé. — Musique de piano. — Concours de la Coupe du Roi de Thulé.
XI. De 1873 à 1875. « Patrie ! » Ouverture.
XVIII. Œuvres diverses. — Œuvres posthumes.
Lorsqu'un livre s'est acquis l'estime des meilleurs lecteurs, il peut se passer de préface. Depuis plus de vingt-cinq ans, le Bizet de M. Charles Pigot est tenu pour un excellent livre d'histoire, exact et amplement documenté.
Il connut même une fortune bien rare dans l'histoire des livres. Conçu presque au lendemain de Carmen, il sembla tout de suite si près d'être définitif qu'il ouvrit la « littérature sur Bizet » et tout ensemble la ferma. Certes on publia de pénétrants ou de brillants articles, au premier rang desquels j'ai plaisir à trouver ceux de deux amis, MM. Camille Bellaigue et Henry Gauthier Villars. Mais ces confrères éminents reconnaîtront, comme moi, que la biographie écrite par M. Pigot continuait à jouir de sa faveur incontestée et méritée.
Chose curieuse, ce livre, connu, classé, — ce Bizet en quelque sorte classique, — n'existait plus en librairie. Et plus sa réputation s'affirmait et s'étendait, plus il devenait introuvable.
Après une longue disparition, cet ouvrage, enrichi encore par les documents les plus récents, revient devant le public : il peut vraiment se passer de toute présentation.
Depuis la mort de Bizet, combien de choses ont changé dans le monde artistique et musical ! On le constate dans ce livre, où l'auteur s'est effacé pour ne laisser paraître que son modèle.
La formation de Bizet, ce travail mystérieux pendant lequel les forces inconnues, les nécessités intérieures du musicien, fermentent et cherchent les expressions qui seront leurs aboutissements naturels, — cette genèse du génie de Bizet semble dominée par un mot, qui nous surprend aujourd'hui : l'éclectisme.
Élève de Fromental Halévy (auteur de la Juive), Bizet, adolescent, grandit comme sous l'étoile de l'éclectique Jakob-Liebmann-Meyerbeer. A l'âge où l'artiste, plus que jamais, est exclusif, partial, intolérant, — Bizet est disposé à tout accueillir et à tout aimer. Dans l'ardente injustice de la vingtième année, il reste clairvoyant et pondéré. Avisé, ingénieux, plein de cette précoce facilité qui fait les bons élèves, il est prêt à demander à tous les maîtres les initiations diverses qu'il saura utiliser et transmuer : voici Rossini, Schumann, Meyerbeer, Mozart, Berlioz, Verdi, Wagner (?), Gounod, Beethoven, Halévy, — tous, dans un pêle-mêle apparent, mais où l'intelligence du jeune prix de Rome met l'ordonnance qui lui sera le plus utile.
— « Tu peux faire autre chose que du théâtre (avouait-il à Saint-Saëns) ; moi, je ne peux pas ».
En effet, les multiples éléments que lui fournirent tant de maîtres divers, Bizet les employa, par la nécessité de son génie, à « faire du théâtre ».
Avec quelle sûreté, avec quel art impeccable, c'est ce qu'affirme le long succès de Carmen et de l'Arlésienne. Elles vivent, ces deux œuvres frémissantes, elles sont et elles demeurent telles que l'auteur les a voulues ; en elles, brillent les qualités les mieux appropriées à leur sujet, et aussi à la race, au goût de leurs spectateurs habituels. Une existence leur semble assurée, longue et glorieuse...
A peine écrites, et âprement discutées encore, Bizet mourut.
Destinée émouvante, brusque éclosion et mort soudaine, — l'historien de Bizet en a fait le récit avec la fidélité la plus scrupuleuse.
Adolphe BOSCHOT.
LES PREMIÈRES ANNÉES. — LE CONSERVATOIRE.
Georges Bizet est né à Paris le 25 octobre 1838, d'une famille depuis longtemps vouée au culte de la musique. Son père donnait des leçons de chant ; sa mère était sœur de Mme Delsarte, pianiste de grand talent, premier prix du Conservatoire, belle-sœur par conséquent de l'excellent professeur A. Delsarte.
Il fut inscrit à l'état civil sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold (*), mais son parrain, vieil ami de la famille, lui donna le nom de Georges, et c'est ce nom qu'il a gardé dans le monde et dans l'affection de tous ceux qui l'ont connu, tandis que sur les papiers officiels, sur les registres d'inscriptions du Conservatoire, sur les listes des lauréats, il est partout désigné sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold.
(*) L'acte de naissance de Bizet, comme tous ceux antérieurs à l'année 1860, a été détruit par les incendies de la Commune. Notre ami M. Marcel Dourgnon, maire du IXe arrondissement, a vainement fait rechercher une copie de cet acte afin d'essayer de le reconstituer.
Véritablement, il semble qu'une fée bienfaisante ait présidé à la naissance de l'enfant et l'ait comblé de ses dons. Jamais intelligence plus précoce ne s'était si prématurément éveillée, jamais nature privilégiée n'avait été si abondamment pourvue de ces précieux dons naturels qui, plus tard, fécondés par l'Art, produisent les grands maîtres.
A quatre ans, il reçut les premières notions de la musique sa mère lui apprit les notes en même temps qu'elle lui montrait les lettres. Un enfant ordinaire eût été rebuté par cette initiation prématurée, le petit Georges apprit avec avidité et son goût pour la musique se développa rapidement.
Dans l'intervalle des leçons maternelles, l'enfant, au lieu de jouer, écoutait à travers la porte les leçons que donnait son père. Au moyen du fil conducteur que sa mère avait mis dans sa main, il se dirigeait seul au milieu de l'inextricable labyrinthe, analysant, comparant, apprenant à distinguer les différentes intonations, à leur donner leurs noms respectifs, si bien que quatre ans après, lorsque son père voulut commencer d'une façon sérieuse son éducation musicale, ce fut avec une stupéfaction profonde, mêlée d'une joie bien grande, qu'il s'aperçut que l'enfant, aidé de sa seule intelligence et de sa prodigieuse mémoire, avait franchi bien des obstacles.
La façon dont M. Bizet fit la découverte du précoce génie musical de son fils est vraiment curieuse.
Un jour qu'il lui faisait chanter une leçon de solfège très ardue, hérissée d'intervalles difficiles, il fut frappé de la justesse avec laquelle il attaquait les différentes intonations, sans la moindre défaillance. Il lève les yeux et s'aperçoit que ceux du jeune lecteur sont égarés loin du cahier ouvert sur le pupitre. L'enfant, qui ne se doutait pas d'avoir éveillé l'attention de son maître, continuait à solfier, sans lire, la leçon commencée.
Il avait entendu, souvent, cette leçon à travers la porte, et il l'avait retenue, et il la répétait sans broncher.
M. Bizet qui aimait la musique et la cultivait, autant peut-être par goût que par profession, fut très heureux de la découverte, et il résolut de pousser hardiment son fils dans la carrière pour laquelle il manifestait une si précoce vocation. Il lui apprit donc le piano, ainsi que les premiers éléments de l'harmonie.
Les progrès furent tels, qu'un beau jour le professeur se trouva à court ; il n'avait plus rien à apprendre à son élève. Le petit Georges avait neuf ans.
Le père résolut alors de le faire admettre au Conservatoire. Bien que l'enfant n'eût pas encore l'âge exigé par le règlement, il pensait, avec raison, qu'une exception devait être faite en faveur de ses qualités vraiment extraordinaires. Il alla donc trouver Alizard, de l'Opéra, avec qui il était depuis longtemps lié, pour prendre son avis et se concerter avec lui sur les moyens à employer pour faire fléchir le règlement.
« Après une courte conférence (*), les deux amis, remorquant notre aspirant au Conservatoire, se rendirent tout droit chez Meifred qui était alors membre du Comité des études. — « Votre enfant est bien jeune, dit Meifred en toisant le petit bonhomme avec une moue dédaigneuse. — C'est vrai, répliqua le père sans se laisser déconcerter, mais, s'il est petit par la taille, il est grand par le savoir. — Ah, vraiment ! et que sait-il faire ? — Placez-vous devant le clavier, frappez des accords, et il vous les nommera sans faire une erreur. » — L'épreuve fut tentée sur-le-champ. Le dos tourné vers l'instrument, l'enfant nomma sans hésiter tous les accords qu'on lui fit entendre et qu'on choisissait, à dessein, dans les tonalités les plus éloignées ; en même temps, avec une facilité surprenante, il énumérait rapidement les diverses fonctions de ces accords dans l'ordre où elles se présentaient sous les doigts. Meifred ne peut retenir l'élan de son admiration : « Toi, mon garçon, s'écria-t-il, tu vas tout droit à l'Institut. » — Il s'en est fallu de peu, vraiment, que la prédiction ne se soit réalisée ; la catastrophe la plus lamentable et la plus imprévue pouvait seule donner un démenti au professeur. »
(*) Nous empruntons le récit charmant de cette anecdote à l'étude que Victor Wilder publia dans le Ménestrel en juin 1875, quelques jours après la mort du Maître.
Les cadres du Conservatoire se trouvaient pour le moment au grand complet ; l'enfant fut donc admis à fréquenter la classe de piano de Marmontel, en attendant qu'une place vacante permît de le recevoir régulièrement.
Six mois après son admission définitive, il remportait le premier prix de solfège. C'est alors qu'il fut présenté à Zimmermann.
Le vieux maître avait entendu parler de l'enfant et avait manifesté le désir de le connaître.
Presque retiré de l'enseignement officiel, ayant renoncé depuis longtemps à son cours de contre-point et de fugue, au Conservatoire, pour conserver seulement sa classe de piano, Zimmermann, que de longues années de professorat avaient fatigué, avait eu un instant le désir, bien légitime après une aussi laborieuse et brillante carrière, de passer dans un demi-repos les dernières années de sa vie. Mais il avait compté sans le démon de l'enseignement qui était en lui.
Le vieil artiste était professeur-né ; enseigner était une fonction essentielle de son être, un besoin impérieux, que son cours public de l'étude du clavier ne suffisait pas à satisfaire ; il avait donc pris chez lui quelques élèves de choix.
Dès qu'il vit le jeune Bizet, il fut enchanté de sa tournure, de sa physionomie vive et intelligente ; mais ce fut bien autre chose quand il l'eut mis à l'épreuve, et qu'il eut pu, avec sa vieille expérience, juger d'un seul coup d'œil cette nature privilégiée. Il réclama Georges pour élève, et voulut lui donner, sans plus tarder, des leçons de contre-point.
C'est donc sous Zimmermann, ce grand éducateur de toute une génération d'artistes, que le jeune Bizet fit ses premières armes ; ce fut par ce maître expérimenté entre tous, qu'il fut initié au style du contre-point suivant les données si pures de Cherubini, dont Zimmermann avait recueilli les traditions.
Cependant Zimmermann était souvent malade, parfois, aussi, accablé de besogne ; il renvoyait alors son jeune élève à Charles Gounod, bien heureux de suppléer le professeur, surtout auprès de Bizet pour qui il s'était épris bien vite d'une grande affection. C'est de cette époque que date la sympathie profonde qui s'établit entre les deux artistes (*) qui devaient être plus tard deux Maîtres.
(*) Gounod avait trente-deux ans à cette époque ; il venait de donner sa première œuvre dramatique, Sapho, à l'Opéra.
Tout en travaillant ainsi chez Zimmermann, le jeune artiste ne négligeait cependant pas ses études de piano, au Conservatoire, à la classe de Marmontel. En 1851, à son premier concours, il remportait le second prix de cet instrument ; l'année suivante, il partageait le premier prix avec son camarade Savary. Il avait alors quatorze ans.
C'était déjà, à cette époque, un des maîtres du clavier. Son jeu fougueux et brillant, plein de souplesse et d'éclat, reflétait les généreuses qualités de sa nature. Plus tard, à Rome, il se modifia sensiblement. A son retour, ses amis les plus intimes eurent peine à reconnaître le brillant virtuose de jadis dans cet artiste ému, au toucher exquis et moelleux (*). Il s'acquit bien vite aussi une grande réputation de lecteur intrépide. Nul ne s'entendait comme lui à réduire au piano, à première vue, les partitions d'orchestre les plus broussailleuses, les plus hérissées de difficultés.
(*) Voici ce que, dans son livre Symphonistes et Virtuoses, son maître Marmontel dit du talent de pianiste de Bizet : « Bizet était resté virtuose habile, intrépide lecteur, accompagnateur modèle. Son exécution toujours ferme et brillante avait acquis une sonorité ample, une variété de timbres et de nuances qui donnait à son jeu un charme inimitable... Il excellait dans l'art de moduler le son, de le rendre fluide sous la pression délicate ou intense des doigts. Il savait, en virtuose consommé, faire saillir le chant bien en lumière, tout en lui laissant l'enveloppe d'une harmonie transparente, dont le rythme ondulé ou cadencé s'identifiait avec la partie récitante. On subissait sans résistance la séduction de ce toucher suave et persuasif. »
Berlioz qui, l'un des premiers, salua le génie musical du jeune artiste, s'exprimait ainsi : « M. Bizet, lauréat de l'Institut, a fait le voyage de Rome ; il en est revenu sans avoir oublié la musique. A son retour à Paris, il s'est bien vite acquis une réputation spéciale et fort rare, celle d'un incomparable lecteur de partitions. Son talent de pianiste est assez grand d'ailleurs pour que, dans ses réductions d'orchestre qu'il fait ainsi à première vue, aucune difficulté de mécanisme ne puisse l'arrêter. Depuis Liszt et Mendelssohn, on a vu peu de lecteurs de sa force. (*) »
(*) Les Débats, 8 octobre 1863.
Au cours de l'année 1854, notre jeune artiste qui, au sortir de chez Marmontel, avait assidûment fréquenté la classe d'orgue de Benoît, remportait un second prix d'orgue et de fugue ; l'année suivante, à l'âge de dix-sept ans, il obtenait les deux premières récompenses.
Sans avoir pu jouir des derniers succès de son élève préféré, Zimmermann était mort à la fin de l'année 1853 ; Bizet était alors entré à la classe de composition d'Halévy.
L'auteur de la Juive l'accueillit à bras ouverts, et, après avoir examiné ses premiers travaux, déclara que, d'ores et déjà, il était en mesure de concourir pour le grand prix. Bizet, plus sévère pour lui-même que ne l'était son maître, s'abstint prudemment. Il ne se crut prêt à la lutte qu'en 1856.
Cette année-là, l'Institut avait primé (*) et imposé pour sujet du grand concours une cantate de Gaston d'Albano (**) : David.
(*) On sait en effet que, chaque année, la scène lyrique, sur laquelle devront s'exercer les concurrents au prix de Rome, est mise au concours.
(**) Gaston d'Albano était le pseudonyme de Mlle de Montréal.
Après de longues hésitations, la section de musique déclara qu'il n'y avait pas lieu de décerner un premier grand prix et accorda seulement, au jeune Bizet, un second grand prix. L'Académie des Beaux-Arts ratifia cette décision.
Ainsi donc, dès son premier concours, notre jeune homme était classé à la tête des concurrents, et si l'Académie ne lui avait pas d'emblée décerné la première récompense, c'était surtout à cause de son âge : la section de musique pensait qu'une année supplémentaire, passée à la classe d'Halévy, assouplirait encore le talent du jeune artiste et le mûrirait. L'Académie a de ces tendresses pour ses enfants trop précoces ! Quelques années plus tard, le jeune Paladilhe, à son premier concours, eût subi le même sort, sans l'intervention de Berlioz, qui fit comprendre à ses collègues que ce n'était pas à l'âge, mais bien au talent, que devait être décerné le prix.
Sans tenir rigueur à ses juges, Bizet s'était remis au travail.
Mais, au commencement de cette année 1857 qui devait voir l'éclatante consécration de son précoce génie, un incident, qui heureusement n'eut pas de suites fâcheuses, vint jeter une petite diversion dans sa vie laborieuse.
Offenbach, alors directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens, venait d'organiser un concours d'opérette. La pièce imposée aux concurrents était de Léon Battu et Ludovic Halévy et avait nom le Docteur Miracle. La partition couronnée devait être montée avec soin et représentée sur la scène du théâtre du passage Choiseul.
Le jeune Bizet vit, dans ce concours, une excellente occasion d'essayer ses qualités scéniques en même temps qu'un délassement des travaux plus sérieux de l'école ; il fit donc le concours et envoya une partition facile, élégante, mais sans prétention et écrite presque au courant de la plume.
Il obtint le premier prix ex æquo avec Lecocq, son camarade de la classe d'Halévy. Les deux partitions couronnées furent apprises, la pièce montée et jouée, à partir du 8 avril, alternativement avec la musique de l'un et de l'autre des deux lauréats. Ce fut Lecocq qui ouvrit le feu...
Bizet, malgré son succès, n'eut garde de persister dans la voie dangereuse où sa fantaisie l'avait un instant égaré ; quant à Lecocq, il avait trouvé dans le Docteur Miracle son chemin de Damas... (*)
(*) Lecocq avait vingt-cinq ans, étant né en 1832. Bizet n'en avait pas encore dix-neuf.
Au mois de juin de la même année, Bizet entrait pour la seconde fois en loge. La scène lyrique, couronnée et imposée aux candidats, était de M. Burion et avait pour titre Clovis et Clotilde. L'Académie, n'ayant pas décerné de premier prix l'année précédente, devait en décerner deux cette année-là. Le premier lauréat désigné, réputé lauréat de l'année, devait jouir de la totalité de la pension, tandis que le second, à qui était attribué le prix de l'année précédente, ne devait bénéficier de ladite pension que pendant les quatre années de l'exercice qui restaient à courir.
La section de musique, dans son jugement préparatoire, désigna MM. Charles Colin (*) et Georges Bizet, et le lendemain, l'Académie des Beaux-Arts ratifiait son choix ; mais, faisant preuve d'une clairvoyance dont Berlioz dut s'émerveiller, elle désigna le premier : Georges Bizet, qui fut proclamé lauréat de l'année 1857, tandis qu'à Charles Colin, nommé second, échut la pension vacante...
(*) Charles Colin, à son retour de Rome, se voua à l'enseignement et fut nommé professeur de hautbois au Conservatoire. Il est mort le 27 juillet 1881.
Le troisième samedi d'octobre, suivant l'antique usage, à l'Institut, en séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts, en présence de MM. les Académiciens pour la circonstance enguirlandés de palmes vertes, et du public spécial, toujours le même, composé de parents et d'amis des lauréats, de journalistes, d'artistes, et de la fine fleur des ateliers de l'École des Beaux-Arts et des classes du Conservatoire, la Cantate de notre vainqueur fut exécutée à grand orchestre : Jourdan, Bonnehée et Mlle Henrion l'interprétaient.
Le succès fut grand, très grand. Le public ratifia par de longs applaudissements le verdict de l'Académie, témoignant, à plusieurs reprises, sa grande sympathie pour le talent si souple et si en dehors du jeune musicien.
ROME. — LES ENVOIS. — DON PROCOPIO.
Dans les derniers jours de cette année 1857, le jeune lauréat s'acheminait vers la Ville Éternelle.
Voir le monde des Arts s'ouvrir tout à coup devant soi par un succès, le premier de tous, mais aussi le plus grand, le plus beau, parce qu'il peut contenir en germe tous les autres, quel rêve pour une imagination de vingt ans ! Bizet subissait l'enivrante griserie du succès ; il partait pour Rome à la conquête de l'Avenir. Comme une ombre au riant tableau, il entrevoyait bien les difficultés à vaincre, les luttes à soutenir ; mais il sentait en lui la force pour surmonter tous les obstacles (*), et, plein d'espérance, il quittait Paris. Il emportait une lettre de Carafa, une lettre de recommandation pour Mercadante.
(*) Il écrivait plus tard de Rome, à la date du 11 janvier 1859 : « Je ne e vous cache pas que je m'attends à beaucoup d'ennuis à mon retour à Paris. Les prix de Rome ne sont pas gâtés, mais j'ai une petite volonté qui surmontera bien des obstacles, et c'est sur elle que je compte. »
Quoiqu'il ne fût pas son maître, l'auteur de Masaniello avait été séduit par la nature généreuse et expansive, par la franche et loyale figure de Bizet. « Vous irez sans doute à Naples, jeune homme ; allez voir mon vieil ami Mercadante et présentez-lui ceci. C'est le Sésame qui vous ouvrira toutes les portes. » Et Bizet avait pris la lettre du vieux Napolitain...
La Villa Médicis est située sur la partie du Monte-Pincio qui domine la ville. Bâtie en 1540 par Annibal Lippi pour le cardinal Ricci, elle devint la propriété du cardinal Alexandre de Médicis, plus tard Léon XI, qui la fit reconstruire et y ajouta une admirable façade sur les dessins de Michel-Ange (*). D'un côté la Villa fait face à la Ville, à la promenade du Pincio, à la place Trinita del Monte ; de l'autre, elle est entourée de magnifiques jardins qui s'étendent jusqu'aux remparts de Rome. Le panorama qui se déroule est unique au monde : Rome, la Ville Éternelle ; au loin, les montagnes de la Sabine et la triste Campagne romaine.
(*) Ce n'est qu'en 1803 que le palais Médicis fut acquis par la France pour y installer l'Académie trop à l'étroit dans le palais Boncompagni. Sous la Villa, à travers le Monte-Pincio, passe un ancien aqueduc romain qui amène l'acqua Virgine à la fontaine della Barcaccia du Bernini, place d'Espagne.
C'est dans ce merveilleux palais, où la poésie du souvenir vient mêler son parfum subtil à la réalité des choses, dans cette ville qui fut la Ville, la tête et le cœur d'un monde écroulé, puis la mère généreuse et féconde d'un monde nouveau, Rome des Empereurs, Rome des Papes, déchue, bien déchue, à cette époque surtout, de sa splendeur passée, dans cette patrie des Arts, sous ce beau ciel, « ce ciel inspirateur », comme on disait, jadis, en style académique, que les jeunes lauréats de notre Institut vont faire leur stage officiel. Comme on le voit, le gouvernement français fait bien les choses ; et cependant beaucoup de lauréats musiciens se montrent réfractaires. Berlioz, l'imagination la plus ardente, le cœur le plus épris de rêve et de poésie, fit l'impossible pour être dispensé de ce voyage d'Italie qu'il considérait comme inutile, funeste même, puisqu'il le forçait à l'inaction et le détournait, pour un temps beaucoup trop long, de l'idéal poursuivi avec tant de fougue et de passion. Ses démarches, ses sollicitations furent vaines. Point de séjour à Rome, point de pension ! Telle est la terrible menace qui fait hâter le pas aux récalcitrants (*). L'Institut s'est toujours montré intraitable sur la question du séjour en Italie ; pour le voyage en Allemagne, qui à cette époque était encore de règle, il était beaucoup plus coulant. Il semblerait, au premier aspect, qu'il eût dû en être autrement. L'Allemagne, la terre nourricière des Grands Maîtres, devait, à cette époque surtout où les concerts symphoniques étaient peu répandus en France (**), offrir un vaste champ d'études à nos jeunes lauréats.
(*) A cette époque, les peintres sculpteurs et graveurs devaient rester cinq ans à Rome ; les architectes trois ans à Rome, deux ans à Athènes ; les musiciens deux ans à Rome, un an en Allemagne et les deux dernières années à Paris.
(**) Habeneck avait fondé la Société des Concerts du Conservatoire en 1828 ; Pasdeloup, la Société des jeunes artistes en 1851 ; mais ce ne fut guère qu'en 1861, lors de la fondation des Concerts populaires de musique classique au Cirque d'hiver, que la musique instrumentale des grands symphonistes allemands commença à s'acclimater en France.
Il n'était guère possible alors de connaître les grands Allemands sans aller chez eux surprendre l'étincelle de leur génie, et voilà pourquoi on envoyait nos musiciens sur la terre classique de l'harmonie, au milieu de cette atmosphère vraiment musicale, s'imprégner des effluves qui flottaient dans l'air.
Quant au séjour de deux ans à Rome, tout le monde, dès cette époque même, était convaincu de sa parfaite inutilité.
A l'origine, lors de sa fondation (*), l'institution du prix de Rome pour les musiciens était justifiée par le but à atteindre ; nous ne possédions pas, alors, d'école véritablement musicale en France ; l'art des Maîtres allemands, confiné au delà du Rhin, nous était inconnu ; restait l'Italie, nous y envoyâmes nos musiciens en même temps que nos peintres et nos sculpteurs. On croyait, à cette époque, à l'influence du milieu, à l'action du climat et du « ciel inspirateur ». Aujourd'hui que ces préjugés ont fait leur temps, que la grande Ecole symphonique allemande nous a pénétrés, infusant à notre jeune musique française, nourrie longtemps aux sources italiennes, un sang généreux, aujourd'hui que notre art musical français grand et fort n'a plus besoin de lisières, je me demande ce que l'on envoie faire à nos jeunes musiciens dans l'une des villes les moins musicales de l'Univers ?...
(*) Le prix de Rome pour les musiciens fut créé en 1805.
« Ne serait-il pas préférable pour la France et pour vous, — disait le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur, aux prix de Rome de l'année 1863 qu'il recevait en audience de congé, — de remettre à chacun de vous les 15.000 francs qu'il a si bien gagnés, sans lui imposer l'obligation de séjourner là plutôt qu'ailleurs ? Libre à vous de faire ce que bon vous semblerait. Plusieurs, peut-être, dépenseraient maladroitement cet argent. Qu'importe ? s'il en est un, un seul, auquel cela permettra de rester lui-même et de devenir un homme de génie. — Du talent ? Depuis trente ans, tout le monde en a en France ; on n'a qu'à étendre la main, on en prendra par poignée. Chaque génération en sème pour la suivante. Lorsque la graine a germé, on la met en pot, dans la serre la plus convenable, puis vienne une fleur, comptant sur ce premier succès, on se hasarde à la transplanter ; la fleur meurt, mais, après tant de soins et de sacrifices, on se croit dans l'obligation de l'arroser toute sa vie.
« Défiez-vous, Messieurs, des fétiches et des admirations convenues. L'artiste n'est grand que quand il est original. »
Qu'ajouter à ces paroles si sages et qu'on s'est bien gardé de mettre en pratique ? Le voyage en Allemagne a été supprimé comme inutile, désormais. Quant au séjour en Italie, consacré par la tradition, il est indéracinable. On s'est contenté d'en diminuer la durée. On a enfin compris qu'il était injuste d'arracher les jeunes musiciens, pour un temps aussi long, au courant artistique où seul leur activité peut se manifester et qu'il était ridicule de les exiler sur une terre qui n'avait plus rien à leur apprendre. Aujourd'hui le séjour à Rome ne peut guère être considéré que comme un temps de repos, de recueillement après les durs travaux de l'École. A côté des peintres, des sculpteurs, des architectes et des graveurs qui trouvent en Italie d'admirables sujets d'étude, le complément nécessaire de leur éducation artistique, le musicien ne voit autour de lui rien qui lui parle de son art ; c'est un véritable exil qu'il subit.
Bizet n'envisageait pas les choses d'une aussi sombre façon. Ce voyage en Italie, au contraire, le séduisait beaucoup (*). Ce pays de la lumière, où tout rayonne, où la vie débordant dans la rue et sur la place publique semble si facile, ce peuple exubérant, plein de grâce et de souplesse, plaisaient à sa nature expansive. Il avait à peine vingt ans, la vie s'ouvrait devant lui souriante, l'avenir semblait lui réserver une longue et glorieuse carrière ; il n'avait donc pas hâte d'escompter ses succès et voulait jouir à loisir de l'heure présente.
(*) Avant même d'entrer en Italie, à Toulon, où il arrive le 29 décembre 1857, il écrit à sa mère pour lui faire part de sa joie, de son voyage délicieux, du temps « merveilleux », de la mer qu'il voit pour la première fois : « Je ne me doutais nullement de l'effet grandiose et original de la mer », et il termine par ce cri d'allégresse : « Quant à moi, ne me souhaitez rien ; je suis si heureux que je crains toujours de voir finir ma chance et je n'ose rien demander. » Plus tard, il revient plusieurs fois sur ce sujet et se déclare toujours très satisfait : « La vie ici est très heureuse, la nourriture excellente. Un jardin splendide... Enfin on ne peut avoir plus de bien-être que nous n'en avons. » (Lettres de Georges Bizet, Calmann-Lévy, édit.)
Il quitta Paris le 21 décembre avec ses camarades lauréats de l'Institut. Trois jours après, il écrivait à sa mère : « Nous avons déjà visité depuis lundi soir Lyon, Vienne, Valence, Orange et nous sommes actuellement à Avignon. Nous avons fait des promenades splendides. Montagnes, fleuves, rien ne nous arrête... Nous sommes en plein printemps ; nous avons du soleil et du ciel bleu comme à Paris en juillet !... C'est un beau voyage... (*) » La petite caravane visite encore Nîmes, Arles, Marseille, Toulon, découvre la mer qui l'émerveille, et pénètre enfin en Italie le 4 janvier 1858 (**). Quelle désillusion ! « J'ai été bien désabusé, en entrant en Italie, d'y trouver une architecture horrible, des églises peintes comme des monuments de carton. Heim (***) et nous tous sommes épatés. Il est vrai qu'en Toscane et à Rome nous serons bien dédommagés. » Nos jeunes artistes voyagent dès lors à petites journées, visitent les villes et les villages piémontais, puis s'embarquent à Gênes pour Livourne. Huit heures de traversée ; le temps est splendide ; personne n'a le mal de mer. Mais « quels voleurs que ces Toscans ! Tout leur est bon pour voler : impôts sur les passeports, sur les malles, c'est une forêt de Bondy ». Heureusement qu'ils sont cinq gaillards, le verbe haut, les poings solides !... De Livourne ils vont à Pise, à Pistoia et arrivent enfin à Florence. Alors, c'est l'admiration complète, absolue. « C'est superbe, écrit-il (****). La cathédrale de Florence, les musées, qui renferment des centaines de chefs-d'œuvre, les palais, les jardins, c'est féerique. » Malheureusement pour lui, il va au théâtre entendre I Lombardi et son enthousiasme tombe. Disposé à tout trouver beau dans cette ville « splendide » où il a admiré avec ferveur Raphaël, André del Sarto, Léonard de Vinci, Titien, il ne peut que s'écrier : « C'est très mauvais ! » et quelques jours après, il écrit : « Nous sommes retournés au théâtre ; c'est infect ! on jouerait mieux à « Lazari !... » Et on l'envoyait en Italie pour entendre de la musique et se perfectionner dans son art !...
(*) Lettres de Georges Bizet (24 décembre 1857).
(**) « Nous sommes maintenant en Italie. Nous avons quitté Nice avant-hier, en voiturin, et nous ferons demain notre entrée à Gênes. » (Lettres de Georges Bizet, 13 janvier 1858.)
(***) Heim (Eugène), Architecte prix de Rome de l'année 1857.
(****) Lettres de Georges Bizet (14 janvier 1858).
Mais il faut se hâter pour être à la villa Médicis avant la fin du mois de janvier (*). Nos jeunes gens prennent le voiturin qui les conduit à Rome en six jours et ils arrivent, enfin, le 27 janvier. Ils sont reçus à bras ouverts par le directeur, le bon Schnetz (**) et par les pensionnaires qui n'oublient pas les « charges charmantes, les lits en portefeuille », les tintamarres et autres amabilités traditionnelles.
(*) Les pensionnaires doivent être rendus à Rome le 30 janvier au plus tard, sous peine de perdre le montant de leur premier mois de pension.
(**) Schnetz fut directeur de l'Académie de France à Rome, d'abord de 1840 à 1847. Il fut nommé une seconde fois ace poste important en 1852 et il l'occupait depuis cette époque, sans interruption, pendant le séjour de Bizet à la villa Médicis. Il était membre de l'Institut depuis l'année 1837 (il avait été nommé en remplacement de Gérard), et officier de la Légion d'honneur.
Quelques jours après Bizet écrivait à son maître Marmontel : « Je savoure à longs traits les délices de Rome qui valent mieux maintenant que celles de Capoue. Quelle vie ! Et penser que dans deux ans ce sera fini ! cela me désole ; mais je reviendrai, je le jure ; nous y reviendrons, peut-être ensemble. (*) » Comme on le voit, Bizet était loin de partager les idées de son aîné Berlioz sur ce séjour en Italie imposé au musicien. Il est vrai qu'il était gâté, adulé, choyé : « M. Schnetz m'a pris en affection, — écrit-il à sa mère, et il date sa lettre : lunedi 8 febbrario 1858, — j'ai joué chez lui, j'ai eu un grand succès. C'est la première fois, depuis que M. Schnetz est directeur, qu'on écoute et applaudit un musicien à l'Académie. » Il joue merveilleusement du piano et on se le dispute dans la société Romaine, on se l'arrache : « J'ai des invitations par-dessus la tête, mais j'en accepte peu, car je ne suis pas ici pour m'amuser... (**) » Et en effet, il songeait tout de suite à ses travaux.
(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses.
(**) Plus tard, cependant, il écrira : « Tu as raison de me recommander de n'être pas paresseux, mais je vais presque tous les soirs dans le monde. » Lettres de Georges Bizet.
Il s'occupe d'abord du Concours Rodrigues, un prix ide quinze cents francs décerné par l'Institut, sur lequel il a peu de renseignements, puisqu'il essaye d'en obtenir d'Halévy, d'abord, de Pingard, ensuite. Il veut décrocher ce prix, pour arrondir sa bourse et aller voir Naples et la Sicile. Il compose un Te Deum, l'orchestre, et ne sait trop qu'en penser : « Tantôt je le trouve bon, tantôt je le trouve détestable ; ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse. (*) »
(*) Dans quelques années, il dira à Saint-Saëns : « Tu peux faire autre chose que du théâtre, moi, je ne le puis pas. » (C. Saint-Saëns : Écho de Paris, 19 février 1911.)
Mais quels seront les concurrents ? Il se préoccupe de le savoir. Il n'y avait, alors, comme aujourd'hui, que cinq pensionnaires musiciens (*). L'un d'eux, Galibert, venait de mourir ; Colin, à Rome en même temps que Bizet, ne concourait pas ; Comte, qui venait de quitter la Villa Médicis, n'était pas en règle, ayant pas fait son envoi, et était, par conséquent, exclu. Restait Barthe ; Barthe sur lequel notre jeune Bizet n'avait pas de renseignements ; Barthe qui l'inquiétait : « Il aurait des chances, écrivait-il à sa mère, il a du talent et il est à la fin de sa pension. J'espère en sa paresse. Dans ce cas, je serai le seul concurrent. (**) » Mais, quelques jours plus tard, il est fixé : « A propos, Barthe concourt. C'est dangereux. Enfin, au petit bonheur ! » En effet, Barthe concourt... et Barthe a le prix !... Adieu les quinze cents francs ! adieu le voyage à Naples, la Sicile ! « Voilà qui me dérange fort !!! Enfin, je n'en mourrai pas ! »... Et, bravement, sans y plus songer, il se met tout de suite à ses Envois.
(*) Les pensionnaires musiciens pouvaient, seuls, concourir pour le prix Rodrigues.
(**) Lettres de Georges Bizet (1° Settembre 1858 Roma).
Il avait d'abord choisi pour le premier, dès son arrivée à Rome, le livret de Parisina, « opéra oublié de Donizetti » mais il s'aperçoit bientôt que ce sujet ne lui convient pas, il l'abandonne et se met en quête d'un nouveau. Ce n'est pas chose facile à Rome ; il cherche chez les libraires, chez les bouquinistes, enfin, après maints tâtonnements, il fixe son choix sur une farce italienne « dans le genre de Don Pasquale ».
« Je travaille beaucoup, écrit-il le 11 janvier 1859, je termine un opéra-bouffe italien ; je ne suis pas trop mécontent et j'espère que l'Académie trouvera beaucoup de progrès dans mon style. Sur des paroles italiennes, il faut faire italien ; je n'ai pas cherché à me dérober à cette influence. J'ai fait tous mes efforts pour être compris et distingué, espérons que j'aurai réussi. J'enverrai pour la 2e année : la Esmeralda de Victor Hugo, et pour la 3e une Symphonie. Je n'élude point les difficultés, je veux mesurer mes forces pendant que le public n'a rien à y voir. (*) »
(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses.
Cet opéra-bouffe italien qui fut, en effet, envoyé comme premier envoi avait nom Don Procopio, opéra-bouffe en deux actes. Bizet en avait acheté le livret à l'étalage d'un bouquiniste. Voici comment le jugeait le rapporteur des travaux envoyés de Rome, dans le compte rendu de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts de l'année 1859 « Cet ouvrage se distingue par une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi, qualités précieuses pour le genre comique, vers lequel l'auteur nous montre une propension marquée. (*) »
(*) Mais il y a le revers de la médaille ! Indépendamment du rapport officiel, imprimé, l'Académie fait un rapport écrit adressé à chaque pensionnaire. Voici celui de Bizet : « Nous devons blâmer M. Bizet, écrit le rapporteur, d'avoir fait un opéra quand le règlement demandait une messe. Nous lui rappelons que les natures les plus enjouées trouvent, dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes, un style indispensable même dans les productions légères et sans lequel une œuvre ne saurait être durable. » Auteur du rapport : Ambroise Thomas.
Qu'est devenue cette œuvre que le rapporteur, le sévère Ambroise Thomas, jugeait d'une façon si favorable ? A cette époque, les Envois de Rome n'étaient pas, comme aujourd'hui, conservés à la bibliothèque du Conservatoire ; le rapport terminé, on les reléguait dans les combles du palais de l'Institut, où ils s'accumulaient depuis de longues années. Ce dépôt, dans la poussière, ne s'effectuait même pas régulièrement, sans doute, car un envoi de Gounod, recherché dans cet amas, était resté introuvable ; il en avait été de même du Don Procopio de Bizet.
On le croyait donc perdu. Il n'en était rien, heureusement ! Dans le Figaro du 17 février 1895, M. Charles Malherbe, l'érudit bibliothécaire de l'Opéra, nous apprit que cette première œuvre de Bizet, enfouie dans les papiers qu'avait laissés Auber et que gardait sa famille, venait d'être retrouvée ; que l'Etat, représenté par Weckerlin, bibliothécaire du Conservatoire, l'avait réclamée et que les héritiers de l'ancien directeur s'étaient empressés de la rendre (*). L'enfouissement avait duré trente-cinq ans !...
(*) La Partition autographe forme un volume de 235 pages d'orchestre, grand format in-4° oblong, papier fort, rayé à 24 portées. Sur la première page on lit : Don Procopio opera buffa in due atti, et sur la seconde est donnée la liste des personnages : Don Andronico : secondo basso — Donna Eufemia sua moglie : seconda Donna — Donna Bettina una nepote : Prima donna — Don Ernesto fratello di donna Bettina : Baritono — Odoardo colonello, amante di Bettina : Tenore — Don Procopio vecchio avaro : Primo basso — Pasquino servo di Andronico : Terzo basso — Vient ensuite l'Index des douze numéros qui composent la partition.
Don Procopio, sorti des limbes où l'avait plongé la négligence de l'auteur de la Muette, attendit onze ans encore sa résurrection triomphale, c'est-à-dire la vie de la scène qui, seule, permettait de le juger. La famille de Bizet hésitait à donner l'autorisation nécessaire, craignant que l'épreuve, si elle était défavorable, fît tort à sa mémoire. Mais, sur le territoire neutre de Monaco, nul danger n'était à craindre ; le succès est toujours garanti, et, cette fois, hâtons-nous de le dire, il fut grandement mérité.
« Sur des paroles italiennes, il faut faire italien », avait écrit Bizet ; conformément à ce programme, le chant proprement dit garde dans Don Procopio une place prépondérante ; les traits en fioriture abondent, même dans les rôles d'hommes ; l'action musicale est menée avec une grande verve ; des ensembles, à sept et huit parties réelles, aboutissent parfois à une véritable polyphonie vocale combinée avec science et toujours réalisée avec esprit. Quant au livret, — qui n'est que la mise en œuvre d'une vieille histoire ayant déjà servi à maint librettiste, — écrit par Cambiaggio vers 1842, il avait été, avant Bizet, mis en musique par Vincenzo Fioravanti : Un vieil avare désire épouser une jeune fille qui aime un brillant officier. Pour le faire renoncer à son projet un complot s'organise ; la jeune fille feint de consentir au mariage avec le vieillard et lui dépeint la joie qu'elle éprouve, d'avance, à la pensée de pouvoir semer l'or, autour d'elle, sans prudence ni mesure. Pris de peur, l'avare renonce à son projet, et tout se termine au gré des amoureux.
Pour mettre à la scène française une pareille farce, il fallait en régler la gaîté un peu grosse ; de plus, Bizet n'ayant mis en musique que quelques épisodes, il convenait de les relier entre eux. MM. Paul Bérel et Paul Collin se chargèrent de la première partie de cette tâche et rédigèrent une traduction aussi fidèle qu'élégante et M. Charles Malherbe écrivit, avec un réel talent, les paroles et la musique des récitatifs. Ainsi mis au point, Don Procopio fut représenté, sur la scène du théâtre de Monte-Carlo, le 6 mars 1906, avec la distribution suivante : Jean Périer (Don Procopio), Rousselière (Odoardo), Bouvet (Ernesto), Chalmin (Andronico), Ananian (Pasquino) ; Mlle Angèle Pornot (Bettina), Jeanne Morlet (Eufemia). Léon Jehin dirigeait l'orchestre, et le succès fut complet. La Sérénade (n° 8) replacée, plus tard, par Bizet, dans la Jolie fille de Perth, produisit, en sa version première, avec accompagnement de mandolines, le plus charmant effet, et le trio du premier acte (n° 4) fut bissé par une salle enthousiaste. Pourquoi cette épreuve ne se renouvellerait-elle pas à Paris ? A condition d'avoir des chanteurs qui sachent vocaliser, elle montrerait ce que peut la muse italienne traitée avec le goût et la science du génie français...
A peine Don Procopio était-il envoyé à l'Institut que notre jeune artiste se préoccupait de son second envoi. Samuel David venait d'avoir le prix de Rome et se disposait à quitter Paris. « Je viens d'écrire à David, disait Bizet à sa mère dans sa lettre du 3 octobre 1858, pour lui donner une foule de renseignements sur son voyage. Je lui ai donné une commission, celle de m'apporter la Esmeralda, opéra en quatre actes de Victor Hugo, duquel je ferai certainement mon second envoi. » Puis, dans sa lettre suivante (*), ses projets se sont modifiés. Parlant encore de Don Procopio, il écrit : « Mon envoi va bien. Il est furieusement long. Deux actes énormes — que sera-ce donc l'année prochaine ? Je veux en faire trois ! » Pas plus que la Esmeralda il ne devait écrire cette œuvre en trois actes annoncée...
(*) Lettres de Georges Bizet, 13 novembre 1858.
Cependant, le travail n'absorbait pas notre jeune homme au point de le rendre insensible aux merveilles qui l'entouraient. Les longues heures oisives que lui laissait l'élaboration de ses envois, il les passait en causeries amicales, ou en promenades, visitant Rome et ses églises incomparables et ses musées, enfin cette triste campagne Romaine si pleine de souvenirs. Depuis longtemps il avait des projets de grand voyage, il voulait voir Naples, la Sicile, mais les quinze cents francs envolés du prix Rodrigues l'avaient retenu à la Villa. Il avait passé l'été de 1858 à Rome. Au cours de l'année 1859 sa bourse s'arrondit ; il s'entraîne ; enfin, il part.
« J'ai été en voyage et j'ai fait un magnifique tour de montagnes, écrit-il à Marmontel (*). Quel pays, cher Maître, et quels compagnons de route. A Astura, Cicéron ; au Cap Circé, Homère et son Ulysse ; à Terracine, Fra Diavolo. Ceci est du Scribe tout pur et quand je pense que d'Homère à M. Scribe il n'y a que trois lieues, cela m'amuse. Je pars demain pour Naples et j'irai passer quelques heures avec Tibère et Néron. Cela tourne mal comme vous voyez, mais Virgile et Horace me consoleront des tyrans ! » C'était le voyage à Naples, si ardemment désiré, le voyage à Naples qu'avait prévu Carafa.
(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses. Lettre du 3 août 1859.
A cette époque, Rome était sous la domination pontificale ; avec la permission du directeur de l'Académie les pensionnaires étaient libres d'entreprendre de voyages, à la condition, toutefois, de ne pas sortir de États Romains ; ce n'était qu'à une époque déterminé par le règlement qu'ils pouvaient être autorisés à visiter les autres parties de l'Italie. Ils s'envolaient alors par groupes joyeux ; les uns allaient à Venise, d'autres à Florence, à Palerme, etc. Bizet se hâta de profiter de la liberté que lui octroyaient le règlement et la bienveillante autorisation de M. Schnetz, directeur de l'Académie. Il quitta Rome le 4 août 1859, sans oublier la fameuse lettre de Carafa, cette lettre qui doit ouvrir toutes les portes !
Cependant, en route, il a de la méfiance ; il décachète adroitement et lit. Ah ! quelle stupeur, mais bientôt quel long et joyeux éclat de rire ! La lettre circule ; ses compagnons de voyage partagent son hilarité. Voici ce qu'il vient de lire : « Le jeune homme qui te remettra cette lettre a fait d'excellentes études. Il a eu les premières récompenses de notre Conservatoire. Mais, à mon humble avis, il ne sera jamais un compositeur dramatique parce qu'il n'a pas d'enthousiasme pour... » (ici un mot trivial intraduisible en français)... mettons... « pour un sou », si vous voulez ! (*)
(*) « Il giovanne che ti rimetterà questa lettera ha fatto ottimi studii. Ha avuto le prime ricompense al nostro Conservatorio. Ma, secondo la mia debole opinione, non sarà mai un compositore teatrale, perche non ha estro per un ... » « Vieux crétin, va ! Je te promets, ô père Carafa, d'écrire un jour ta biographie et de donner cette lettre, à la fin du volume, en guise d'autographe ! Ce sera édifiant ! » (Lettre du 19 janvier 1860.)
Ah ! comme il se félicitait de son indiscrétion ! « J'ai pris le parti, écrira-t-il plus tard, de ne jamais remettre de lettre de recommandation cachetée. Celle que le père Carafa m'avait donnée me sert de leçon. J'ai eu assez bon nez en la décachetant sans la porter. » Car, enfin, on a beau tenir peu à l'estime artistique de deux mauvais musiciens italiens, il n'en est pas moins désagréable d'être si chaudement recommandé. Et, songeur, il se demandait ce que « le père Carafa » entendait par enthousiasme dramatique. Etait-ce sa pauvre petite manière ? sa banale fécondité ?...
Certains artistes, encore vivants, se rappellent avoir vu Carafa, au Conservatoire, où il professait la composition... dans le désert. Ancien écuyer de Murat, roi de Naples (*), noble Napolitain, dilettante distingué (amateur, dirions-nous aujourd'hui), les révolutions lui avaient pris sa fortune et l'avaient chassé. Il fit alors de la musique par nécessité comme jadis par goût et par passe-temps. C'était la belle époque des œuvres faciles en Italie ; chaque capitale voyait éclore par douzaines les partitions des pâles imitateurs de Rossini. Carafa fit comme les autres ; il parcourut la péninsule, produisant à la hâte des œuvres aussi pauvres de forme que d'idées. Enfin, il vint en France, à Paris, où l'amitié et la puissante protection de Rossini lui ouvrirent l'Opéra-Comique. Il donna alors, presque coup sur coup, un assez grand nombre d'ouvrages aussi ternes que leurs aînés : la Violette, Masaniello, Jenny, l'Auberge d'Auray (**) en société avec Herold, puis la Prison d'Edimbourg, etc. (***) La grande influence de son protecteur aidant, il fut nommé professeur au Conservatoire, à la mort de Lesueur qu'il remplaça.
(*) Michel-Henri-François-Vincent-Paul Carafa de Colobrano, de famille princière. Il était né à Naples en 1785. Il n'était pas encore majeur quand il s'engagea dans l'armée Napolitaine ; il fut fait prisonnier par les Français au combat de Campo-Tenese. Ayant plu à Murat, il devint son écuyer et fit, comme lieutenant de hussards de son nouveau roi, l'expédition de Sicile où il passa capitaine. Il le suivit en 1812 comme officier d'ordonnance dans la campagne de Russie et gagna, là-bas, les galons de chef d'escadrons avec la croix. Les événements de 1814 le rendirent à la vie civile.
(**) L'Auberge d'Auray, de d'Epagny et Moreau, opéra-comique en un acte représenté en avril 1830 à l'Opéra-Comique, salle Ventadour, pour les représentations de la célèbre tragédienne anglaise miss Smithson. Miss Henriette, incapable de prononcer un mot de français, mima le rôle muet de Cecilia spécialement composé pour elle. La partie musicale était confiée à Mlle Jenny Colon et à Ferréol. L'introduction, un air chanté par Mlle Colon, des couplets dits par Ferréol, furent très applaudis ; c'était la part d'Herold dans la collaboration. Le reste était de Carafa.
(***) Il collabora aussi à la Marquise de Brinvilliers de Scribe et Castil-Blaze, avec Boieldieu, Berton, Batton, Auber, Herold, Blangini, Paer et Cherubini. La partition contenait dix morceaux, chacun en fit un ; Blangini seul en eut deux en partage, et Carafa, en sus de son finale du deuxième acte, écrivit l'ouverture. — Les partitions tant italiennes que françaises de Carafa sont innombrables ; pas une n'a survécu.
Un mot de Rossini indique bien le rôle familier et modeste que ce bon Carafa remplissait auprès de lui. Comme il s'agissait de l'importante reprise d'une de ses œuvres à l'Opéra, on priait l'illustre maître d'ajouter un Air à sa partition, pour lui donner un nouvel attrait, l'attrait de l'inédit si puissant sur le public parisien : « Oui, oui, répondit-il en clignant de l'œil avec malice, nous ajouterons un air, nous le ferons composer par Carafa... »
Au Conservatoire, où il se rendait régulièrement pour faire son cours, il s'asseyait imperturbablement à son piano au milieu de la salle vide, et il se mettait à jouer des airs de Masaniello, s'absorbant dans la contemplation de son œuvre, laissant la porte ouverte pour inviter à entrer, attendant, avec une calme indifférence, l'élève qui ne venait pas. Dans le couloir passaient et repassaient les jeunes gens qui se rendaient à la classe d'Halévy.
Parfois un égaré franchissait le seuil ; Carafa, interrompant le petit concert qu'il se donnait à lui-même, faisait alors son cours avec une grâce parfaite et une bonhomie charmante. Et c'est ce musicien inoffensif qui jugeait si légèrement ce jeune homme ; le passé mort condamnant l'avenir plein de sève et de jeunesse ! Et Bizet, qui venait d'évoquer, en un instant, l'étrange carrière artistique de l'ex-écuyer napolitain, riait de bon cœur, relisant la fameuse lettre, n'en voulant nullement « au père Carafa », se promettant, toutefois, de faire mentir son décourageant pronostic, décourageant pour tout autre, peut-être, stimulant pour cette nature pleine de verdeur et d'exubérance...
Il arrive à Naples avec Didier, graveur, Maniglier, statuaire, de Conninck, peintre, et Paul Dubois, « un jeune sculpteur qui n'est pas de l'Académie ». Mais Naples est loin de le séduire : « Quand on a vu Rome, écrit-il, on devient difficile ! Le golfe de Naples est une chose merveilleuse, mais la ville est affreuse. Aussi la quitterai-je demain pour aller passer un mois à Ischia, Procida, Capri, Pœstum, Pompéi, Sorrente et tous les environs. (*) » Pompéi surtout le séduit, et la mer, la douce Méditerranée (*). « Aussi avons-nous loué un bateau et allons-nous nous baigner et faire pleine eau deux fois par jour. »
(*) Lettre du 17 août 1859.
Et cela dure du 4 août au 24 octobre. Tout à coup, au moment de regagner la Villa, le mal dont il s'est déjà plaint à plusieurs reprises, l'année précédente, dans ses lettres, vient de nouveau le surprendre. Déjà, le 17 août, à son arrivée à Naples, il avait écrit à sa mère : « Je ne t'ai pas parlé de ma maladie du mois de mai, mais j'ai eu à la gorge une ulcération très douloureuse quoique sans gravité. J'ai été malade huit jours. Au mois de mai prochain j'aurai peut-être encore quelque gonflement d'amygdales et ce sera tout, car cette maladie, chez moi, tient à la croissance. » Le 24 octobre, il est de nouveau frappé : « Donc, au moment où je comptais quitter Naples, j'ai été collé au lit par un magnifique rhume accompagné de grippe, mal de gorge, douleurs, etc., etc., le diable, quoi !!... » C'est ce mal, dont il souffrait périodiquement depuis son enfance, qui devait le terrasser quinze ans plus tard, à Bougival, quelques jours après la première représentation de Carmen...
Douze jours de lit et de diète le remettent sur pied. Il quitte Naples « un peu maigri » mais ayant recouvré sa gaîté avec la santé et l'appétit. « Je fais une guerre mortelle aux côtelettes du pays. Il faut bien se remettre un peu !... »
De retour à l'Académie, il songea à prolonger son séjour en Italie et à éviter le voyage en Allemagne (*). Ernest Guiraud, son camarade de la classe de Marmontel, son ami, son frère d'armes de la classe de composition d'Halévy, venait de remporter, à son tour, le grand prix de l'Institut ; il allait venir à Rome, au moment où il devrait, lui-même, quitter la Villa. Il entama donc, pour obtenir la faveur qu'il sollicitait, des démarches qui devaient être couronnées de succès. A quoi bon ce voyage en Allemagne ? se disait-il pour se confirmer dans son dessein. Trouverait-il, là-bas, au milieu des hasards d'une existence nécessairement errante et « pénible », la vie calme et heureuse de la Villa, qu'il aimait tant ? Ces grands maîtres qu'il devait aller étudier chez eux, n'avait-il pas pénétré leur génie depuis qu'il vivait dans l'admiration de leurs chefs-d'œuvre ? Bach, Beethoven n'étaient-ils pas les dieux qu'il avait toujours adorés ? Et puis, depuis deux ans qu'il était privé des longues causeries sur son art, ces bonnes causeries qu'il aimait tant, il voyait arriver avec joie le moment où il pourrait enfin être compris par un véritable artiste. « Je suis enchanté du prix de Guiraud, écrivait-il à Marmontel, dès le 3 août, c'est un véritable musicien » ; et, plus tard, quand il eut obtenu de passer à Rome la troisième année de sa pension : « J'attends Guiraud de jour en jour ; j'aurai d'autant plus de plaisir à le voir qu'il y a deux ans que je n'ai causé avec un musicien intelligent. Mon collègue Z... est ennuyeux ; il me parle Donizetti, Fesca, et je lui réponds Mozart, Mendelssohn, Gounod. (**) »
(*) Les pensionnaires musiciens devaient, à cette époque, voyager pendant trois mois, au moins, en Allemagne.
(**) Marmontel : Symphonistes et virtuoses.
Il s'était d'abord adressé au directeur de l'Académie pour obtenir la prolongation de séjour qu'il désirait. Cet excellent Schnetz, avec son bon visage bistré et ses petits yeux malicieux, homme de cœur et d'esprit, malgré ses allures hirsutes de bourru bienfaisant, n'osa prendre sur lui de donner la permission qu'il aurait bien désiré accorder, mais qui dérogeait, d'une façon trop manifeste, à tous les usages établis. Il fallut s'adresser directement au ministre. Le Ministre d'État Fould ne se fit pas prier et octroya gracieusement, à notre jeune artiste, l'autorisation qu'il sollicitait.
Voilà donc Bizet — libre de disposer à son gré de sa troisième année de pension — débouclant ses malles déjà préparées et reprenant sa vie heureuse, insouciante, ses promenades à travers cette Rome qui l'attirait, recommençant, en compagnie de son ami Guiraud, ses longues stations dans les galeries et les musées. Il comptait rester à Rome jusqu'au mois de juillet, afin de finir son second envoi et de commencer le troisième, puis aller passer trois ou quatre mois dans le nord de l'Italie, à Florence, Venise, Milan, etc., revenir passer la fin de l'année à Rome, et rentrer à Paris, sa troisième année de pension terminée, le 1er janvier 1861. Pour rester dans les termes du petit programme qu'il s'était ainsi tracé, il se mit résolument à la composition de son second envoi. Depuis longtemps, il désirait écrire une grande symphonie avec chœurs dont la Lusiade de Camões fournirait le sujet. Mais il s'agissait de trouver un poète. A Paris, c'est chose facile ; les faiseurs de cantates pullulent, mais à Rome ?... Impossible de le trouver ; aussi, désespérant de pouvoir mener son projet à bonne fin, travaillait-il, depuis « près de deux mois, sur deux symphonies », quand le hasard le met en présence d'un « poète français, homme très savant, sachant et parlant vingt-cinq langues, mais écrivant la sienne d'une façon peu intelligente ». Malgré cela, il jette vivement au feu ses ébauches de Symphonies et fait rimer, au « poète », la Lusiade, sur le scenario qu'il avait longtemps médité et préparé à l'avance et qu'il commençait à désespérer de pouvoir réaliser. « J'ai mis la main, écrivait-il à Marmontel (*), sur un certain D..., Français très savant, mais dépourvu de goût. Je suis obligé de refaire une partie de ses vers, ce qui ne m'amuse pas, d'autant plus que je m'aperçois avec terreur que ma poésie est infiniment supérieure à la sienne. » Mais, quoique les vers du collaborateur improvisé « ne soient pas remarquables », qu'ils soient même « absurdes » parfois, la beauté du sujet, la grande variété des situations, suffisent à notre jeune musicien et il travaille avec ardeur, avec enthousiasme, et Vasco de Gama, Symphonie descriptive avec chœurs, voit le jour et est envoyé à l'Institut (**).
(*) Marmontel : Symphonistes et virtuoses.
(**) Il est aussi question dans ses lettres à sa mère, d'un finale de Symphonie, d'un opéra-comique : l'Amour peintre de Molière, qu'il se rime lui-même (décidément Vasco de Gama l'a mis en goût de poésie) et du Carmen sæculare d'Horace. Ces œuvres qu'il avait sur le chantier ou qu'il préparait n'ont laissé aucune trace.
Cette Symphonie fut exécutée, quelques années plus tard, aux Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts. Elle a été gravée après la mort du Maître et publiée avec ses Œuvres posthumes.
Vasco de Gama terminé, il travailla à la Suite d'orchestre de son troisième envoi qui fut exécutée à l'Institut en séance solennelle de distribution des prix de l'année 1861. L'Institut n'exigeait pas, alors, comme aujourd'hui, une ouverture ; il demandait seulement une page de musique instrumentale. Bizet envoya donc sa suite d'orchestre : Scherzo et Andante Marche funèbre. Le succès qu'elle obtint lors de cette première audition académique fut considérable. On remarqua surtout le Scherzo si délicat, d'un tour si original. Ce Scherzo fut, quelque temps après, exécuté au Cercle des Mirlitons, où il reçut un accueil des plus flatteurs, enfin donné aux Concerts populaires le 11 janvier 1863. Il est devenu, plus tard, le Scherzo de la symphonie Souvenirs de Rome exécutée aux Concerts populaires pendant l'hiver de 1869 (*). Quant à la Marche funèbre, on a cru qu'elle avait été détruite par Bizet ; c'est une erreur. Le manuscrit est resté entre les mains du vieux père de l'artiste, jusqu'à sa mort. Qu'est-il devenu, depuis ?... Il porte cette mention : « Le motif principal de cette marche est reproduit dans les Pêcheurs de perles (3e acte) »...
(*) On verra plus loin, au chapitre VIII, comment le Scherzo qui devait primitivement faire partie de la Symphonie, fut supprimé, et comment il reprit ensuite sa place, après l'unique audition qui fut donnée pendant l'hiver de 1869.
Enfin sonna l'heure du voyage dans le Nord de l'Italie, ce voyage à Florence, Venise, Milan, etc., qui faisait partie du programme qu'il s'était tracé. « Aurai-je fait en ces trois années, se demandait-il, en quittant Rome, assez de progrès pour prendre dans l'art musical la place que je voudrais y tenir ?... C'est ce que je n'ose encore espérer... » Il partit le 1er août avec son ami Guiraud. Le voyage commencé gaiement ne devait pas se terminer. Arrivé à Venise, le jeune homme trouva d'inquiétantes nouvelles ; sa mère, qu'il aimait tendrement, était au plus mal. On craignait pour ses jours. Il embrassa à la hâte son compagnon de route et s'empressa de rentrer en France.
La vue du fils bien-aimé améliora sensiblement l'état de la malade ; la pauvre femme sembla vouloir se rattacher à l'existence, elle retrouva des forces. Mais l'amélioration ne fut que passagère. Le mal reprit sa marche que les baisers du fils avaient un instant enrayée ; la malade languit quelques jours, puis s'éteignit doucement, presque sans souffrances.
Après trois ans de séparation, revoir sa mère sur son lit d'agonie et la perdre à jamais ! On comprend sans peine la douleur du pauvre garçon qui, au seuil de sa carrière, alors que tout semblait lui sourire, qu'il pouvait se croire complètement heureux, avait le cœur brisé par la catastrophe la plus épouvantable et la plus imprévue. Il comprit alors que le bonheur n'est pas de ce monde, que l'homme fort doit savoir compter avec les cruelles surprises de la destinée, et, courageusement, stoïquement, il affermit son âme pour la lutte.
LE RETOUR. — LES PREMIERS TRAVAUX. — BIZET WAGNÉRIEN.
Il se mit au travail avec ardeur, d'autant plus que les préoccupations artistiques allaient bientôt faire place à des réalités d'un ordre bien moins élevé, mais pressantes et inévitables. Bizet, au début de sa carrière, se trouvait dans la situation de tous nos jeunes musiciens sans fortune, qui, en attendant une occasion de se produire, demandent au travail quotidien d'assurer leur existence (*). Leurs anciens camarades de la Villa, peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, que les expositions, de plus en plus nombreuses, font connaître, se voient encore gratifiés de commandes de par la munificence officielle ; eux, doivent péniblement gagner leur vie en donnant des leçons de piano, d'harmonie, parfois , même de chant ou de solfège, ou en faisant des réductions de piano, en orchestrant de la musique de danse pour les éditeurs. Ils doivent attendre patiemment leur tour, qui se fait souvent longtemps attendre ; saisir l'occasion qui se présente, — quand elle se présente — par son unique cheveu, et tâcher d'en profiter, car elle n'a pas de lendemain bien souvent.
(*) Qu'on me permette à ce propos de citer la lettre suivante écrite de Rome à ses parents à l'occasion du jour de l'an : « Ma lettre va vous arriver en plein jour de l'an, mes chers parents. Je vais donc vous envoyer tous mes souhaits. Je commence par désirer pour vous deux la parfaite santé du corps sans laquelle la santé de l'esprit n'est pas possible. Ensuite je demanderai que l'argent, cet affreux métal auquel nous sommes tous soumis, ne vous fasse pas trop défaut. De ce côté-là, j'ai un petit plan : quand j'aurai cent mille francs, c'est-à-dire du pain sur la planche, papa ne donnera plus de leçons, ni moi non plus. Nous commencerons la vie de rentiers et ce ne sera pas dommage. Cent mille francs, ce n'est rien : deux succès à l'Opéra-Comique ! Enfin, je me souhaite de vous aimer toujours de toute mon âme et d'être toujours comme aujourd'hui le plus aimant des fils. »
Bizet fit des transcriptions pour piano. C'est de cette époque que datent la plupart des 150 morceaux transcrits des opéras célèbres Allemands, Français, Italiens publiés en trois séries par la maison Heugel sous le titre de Pianiste Chanteur. En même temps il préparait son début à l'Opéra-Comique, la Guzla de l'Emir, un acte de M. Michel Carré et Jules Barbier. C'était le petit acte réglementaire par lequel débutent, presque toujours, les jeunes prix de Rome, le seul souvent qu'ils parviennent à faire représenter. Fatigués, énervés par une lutte sans issue, la plupart, après cette première épreuve, abandonnent la poursuite de l'Idéal qui prend, peu à peu, à leurs yeux, des profils fantastiques de Chimères ; peu à peu ils s'abandonnent, se vouant à l'enseignement, parfois, même, courant le cachet, non plus pour avoir le loisir de parfaire et de caresser l'œuvre longtemps rêvée, mais uniquement pour vivre. Ils végètent... Plaignez les pauvres prix de Rome musiciens (*) !
(*) Ernest Legouvé, dans le livret de l'Amour Africain, mis en musique par Paladilhe et représenté à l'Opéra-Comique en mai 1875, a chanté, en une complainte fameuse, les infortunes de ces malheureux.
Oyez les tristes contre-temps
D'un mélancolique jeune homme,
D'un jeune homme de soixante ans
Que l'on appelle un prix de Rome.
Bizet eut une chance inespérée. Il ne devait point connaître les amertumes des débuts pénibles et longtemps attendus ; un hasard heureux devait lui permettre de se produire dans les conditions qu'il désirait et qu'il n'aurait certes osé rêver.
Le comte Walewski, sur le point de quitter le ministère des Beaux-Arts, venait de doter le Théâtre-Lyrique d'une subvention de cent mille francs. Ce protecteur éclairé des arts voyait avec peine l'État se désintéresser du sort des jeunes musiciens, tandis que ses faveurs s'égaraient, le plus souvent, sur des artistes déjà favorisés du public ; il s'efforçait donc, dans la mesure de ses moyens, de réparer cette injustice. Le dévouement de Carvalho à la cause des jeunes, l'avait tout naturellement désigné au choix du ministre pour l'œuvre réparatrice qu'il avait à cœur. La subvention lui fut donc accordée, à condition de produire, chaque année, un jeune prix de Rome, non plus dans le petit acte réglementaire que le cahier des charges imposait à l'Opéra-Comique, mais bien dans une œuvre importante, dans un ouvrage en trois actes.
Cent mille francs, c'était bien peu, comparés aux subventions d'aujourd'hui ; ce fut beaucoup entre les mains d'un directeur actif, intelligent et artiste.
Bizet fut le premier qui bénéficia de la générosité ministérielle.
Carvalho, à qui il avait été présenté dès son retour de Rome, avait vite été séduit, comme tous ceux qui approchaient cette nature d'élite ; mais, tandis que ses amis, ses familiers, ne voyaient dans ce brillant jeune homme qu'un prix de Rome, intéressant sans doute, mais au même titre que ces camarades et n'ayant sur eux d'autre avantage que le charme de son heureux caractère, de sa franche et loyale figure, et surtout son admirable talent de pianiste, lui, le directeur avisé, avait deviné le musicien original qui a son mot à dire, sa note lumineuse à donner ; il avait senti l'étoffe d'un maître dans cet exubérant jeune homme et il s'était promis de lui aplanir les voies. Aussi, à peine la subvention lui fut-elle accordée, qu'il s'empressa de l'en faire bénéficier. Il lui confia le poème d'un opéra en trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de perles.
En ce moment la Guzla de l'Émir était en répétitions à l'Opéra-Comique ; notre jeune artiste ne fit qu'un bond du cabinet de Carvalho à la rue Favart et retira sa partition.
Que Bizet ait accueilli avec joie, avec enthousiasme, le livret que lui confiait Carvalho, sans même prendre connaissance de ce livret et juger s'il répondait à ses secrètes aspirations, on le comprend sans peine ; quel est celui de nos jeunes artistes, en quête d'une bonne occasion de frapper un coup retentissant, qui aurait agi autrement ? Mais ce que l'on conçoit malaisément, c'est ce retrait immédiat de la partition de la Guzla de l'Émir.
Il fallait, certes, que le jeune artiste éprouvât un éloignement bien profond pour le genre de l'opéra-comique qu'il croyait incompatible avec le sentiment élevé de l'art, pour consentir ainsi, à l'aurore de sa carrière, alors que l'on est d'ordinaire si pressé de prendre le public pour juge, à ajourner son premier début. La Guzla de l'Émir, représentée à l'Opéra-Comique quelques mois avant les Pêcheurs de perles au Théâtre-Lyrique, eût préparé le public au nom nouveau qui allait surgir et jeter même, dès le début, un certain éclat ; elle eût, peut-être aussi, sensiblement modifié son attitude vis-à-vis des Pêcheurs de perles, en fixant son attention sur des scènes d'une grande beauté qu'il ne prit pas la peine de remarquer dans l'œuvre de début d'un jeune artiste qui lui était inconnu.
Bizet donna en cette circonstance un bel exemple de sincérité artistique.
Il avait pu, tant qu'il désespérait de voir le Théâtre-Lyrique lui confier un grand poème, accepter de débuter à l'Opéra-Comique, selon la formule consacrée pour les prix de Rome, par le petit acte réglementaire, œuvre éphémère dont une même soirée voit souvent la naissance et la mort ; il espérait, ainsi, attirer l'attention, jeter sur son nom, nouveau venu dans la grande famille des Arts, une notoriété professionnelle qui lui permît de solliciter, avec des chances de succès, le grand poème qu'il désirait ; maintenant qu'il voyait Carvalho venir à lui et lui offrir, avant cette première épreuve, le livret des Pêcheurs de perles, la Guzla de l'Émir n'avait plus de raison d'être pour lui ; il retirait donc sa partition et se mettait résolument à la besogne.
Qu'est devenue la partition de la Guzla ?... Brûlée, sans doute, comme fut brûlé Ivan le Terrible, comme ont été brûlés, plus tard, les fragments de Calendal et, certainement aussi, la partition de Griselidis que Bizet, dans une lettre en date du 26 février 1871, déclarait « très avancée ».
Quelque temps avant sa mort, il fit un autodafé général ; il détruisit, d'une main impitoyable, tout ce qui ne lui parut pas digne d'être conservé ; nul doute qu'il se soit montré injuste et que des pages, d'un intérêt incontestable et d'une très grande saveur artistique, ne soient ainsi perdues pour ses admirateurs.
Quant au livret de la Guzla, il fut rendu à ses auteurs qui n'essayèrent pas de faire valoir les droits incontestables que leur avait acquis la collaboration de Bizet. Ils le confièrent, plus tard, à M. Théodore Dubois et, plus heureux cette fois, ils virent leur œuvre représentée à l'Athénée, le 30 avril 1873, avec la musique de leur nouveau collaborateur.
Pendant qu'il travaillait à sa partition des Pêcheurs de perles, le Scherzo de son troisième envoi de Rome fut exécuté au cirque Napoléon. C'est le dimanche 11 janvier 1863 que Bizet obtint l'honneur, très grand à cette époque, de figurer à côté des maîtres sur l'affiche des Concerts populaires de musique classique.
Beethoven, Weber, Haydn, Mozart, Mendelssohn, régnaient alors au Cirque en souverains incontestés. On n'a pour bien s'en convaincre, qu'à feuilleter la collection des programmes de cette période. Jamais ou presque jamais de noms nouveaux. Bizet fut l'un des premiers, sinon le premier, qui franchit le seuil du sanctuaire.
L'histoire est curieuse et grandement à l'honneur du vaillant Pasdeloup, ce brave artiste, cet apôtre à qui notre École Française doit tant et tant ; aussi vais-je la conter.
Le Scherzo de Bizet avait été exécuté au Cercle des Mirlitons et l'accueil qui lui avait été fait avait dépassé les prévisions les plus optimistes. Pasdeloup, qui dirigeait l'orchestre, frappé des qualités de verve et d'inspiration de cette œuvre charmante, résolut de la faire entendre à son public. Il avait longtemps lutté, d'abord à la salle Herz, puis au Cirque, pour imposer les Maîtres, pour faire connaître au public parisien, qui ne paraissait pas s'en soucier, les immortelles Symphonies de Beethoven ; aujourd'hui qu'il avait enfin vaincu l'indifférence, l'apathie, le mauvais vouloir, aujourd'hui que les Concerts populaires du Cirque, véritables vêpres laïques où se rendait en masse la population parisienne, étaient devenus à la mode, il ne considérait pas son œuvre achevée. La première partie de son programme réalisée, restait la partie la plus ardue de sa tâche, celle qu'il avait osé concevoir, dont il n'avait fait part à personne et dont nos musiciens français lui devront une éternelle reconnaissance : produire nos jeunes artistes, leur permettre de s'entendre et de se former en mettant à leur disposition son orchestre, préparer, enfin, la belle éclosion symphonique qui s'épanouit aujourd'hui.
Bizet, Guiraud, Massenet, Saint-Saëns, d'Indy et tant d'autres, ne doivent-ils pas beaucoup à ce vaillant (*) ?
(*) Bizet a dès longtemps acquitté pour eux tous la dette de reconnaissance.
C'est en effet a Jules Pasdeloup qu'est dédié le chef-d'œuvre de l'Ecole moderne
française, la belle, l'admirable partition de Carmen.
Le Scherzo de Bizet, œuvre de petites proportions et bien de nature, par sa forme et son esprit, à séduire le public un peu gourmé du Cirque, fut donc choisi tout d'abord, et exécuté au concert du dimanche 11 janvier, date importante dans la vie de notre artiste et dans les annales des Concerts populaires de musique classique (*).
(*) Voici le programme du Concert de musique classique du Cirque Napoléon du 11 janvier 1863.
1° Symphonie en mi b Mozart.
2° Adagio du quatuor n° 6, exécuté par tous les instruments à cordes Haydn.
3° Scherzo (Fragment de Symphonie) Georges Bizet.
4° Le Comte d'Egmont (tragédie de Goethe), Ouverture. Entractes, mélodrames. Beethoven.
Malheureusement le résultat espéré ne fut pas obtenu. Le Scherzo, qui avait produit un si grand effet au Cercle des Mirlitons, n'en produisit aucun au Cirque. A quoi cela tint-il ?... Sans doute à une mauvaise exécution, peut-être aussi aux dispositions hostiles de l'auditoire.
Toujours est-il que le fait est indéniable et que les meilleurs amis de Bizet, eux-mêmes, durent en convenir. Des sifflets accueillirent cette œuvre charmante et la presse se montra hostile. Mais, ce qui dépasse toute limite, qui paraît du domaine de la charge, c'est la correspondance volumineuse que cette tentative valut à Pasdeloup.
Messieurs les abonnés protestaient ! Ils s'étaient abonnés pour admirer Beethoven, Mozart, Haydn ; ils toléraient bien, aussi, Weber et Mendelssohn ; quelquefois, mais bien rarement, — le moins possible, — Schumann qui était alors presque un inconnu en France ; leurs concessions ne pouvaient aller au delà. Ils s'étaient donné beaucoup de mal pour comprendre, — peut-être ne comprenaient-ils pas du tout, — mais maintenant leur siège était fait. Ils admiraient les classiques, puisque c'était de bon ton de les admirer ; ils ne voulaient pas aller plus loin ; leurs jeunes compatriotes en quête de gloire pouvaient aller s'en pourvoir ailleurs.
Et, en masse, ils menaçaient de se désabonner, si le directeur des concerts renouvelait sa tentative (*).
(*) On a peine à comprendre aujourd'hui cette levée de boucliers ridicule et cet accueil presque tragique quand on entend ce Scherzo si simple, si clair, si limpidement et logiquement développé. Cependant les témoignages des contemporains, les confidences de Pasdeloup, les nombreux articles de critiques sont formels et unanimes. Seul le Ménestrel fait montre d'un indulgent optimisme. Voici, en effet, ce qu'il écrit sur le Scherzo dans son numéro du 18 janvier 1863 : « Dimanche dernier, nous avons eu occasion d'entendre le Scherzo d'une Symphonie de M. Georges Bizet, premier prix de Rome de 1857. C'est un morceau fort agréable, écrit avec une certaine verve, mais dont la péroraison laisse à désirer. L'auteur a néanmoins récolté des bravos de bon aloi ; ils sont d'un bon augure pour le succès qui lui sera réservé au Théâtre-Lyrique, où M. Bizet nous tient une partition en perspective. »
Pasdeloup tint tête à l'orage, il laissa crier et menacer et n'en continua pas moins sa marche en avant. Personne ne se désabonna, mais la guerre des sifflets s'organisa, âpre, ardente, infatigable.
Qu'importait au brave directeur des Concerts ? Il voulait atteindre un but, il le poursuivit sans relâche, au milieu de tous les obstacles, et, lentement, il arriva, avec une persévérance que rien ne réussit à décourager, d'abord a faire entendre complètement, les sifflets ayant fini par se lasser, puis à faire applaudir et acclamer les œuvres de nos jeunes Maîtres Français.
D'autres récoltent aujourd'hui les abondantes moissons qu'il sema, au prix de mille peines et de mille sacrifices, mais lui seul aura la gloire, — gloire bien grande,— d'avoir donné au public français l'amour des belles choses et à nos artistes le désir et les moyens d'en produire...
Le dimanche qui suivit cette malencontreuse exécution du Cirque fut, pour le Scherzo de Bizet, l'occasion d'un commencement de réhabilitation devant le public parisien. Une nouvelle audition de cette œuvre charmante fut donnée au Concert de la Société Nationale des Beaux-Arts, institution dont le but était « d'ouvrir aux jeunes compositeurs une lice fermée jusqu'ici à leurs efforts et à leurs travaux ». Le programme se composait des fragments d'une Symphonie de Saint-Saëns, d'une Marche funèbre de Debillemont, du Scherzo de Bizet, de la Grande marche triomphale composée par Meyerbeer pour l'ouverture de l'Exposition de Londres, enfin, du Désert de Félicien David. L'accueil fait au Scherzo fut tout différent de celui du Cirque, chaleureux et spontané, et la presse, presque unanime, cette fois, la déclara l'œuvre « d'un musicien consommé (*) ».
(*) Jamais la Critique ne s'était déjugée aussi rapidement et aussi complètement. Il y aurait là matière à étude curieuse et à rapprochements suggestifs.
C'est aussi à cette époque que fut exécuté, aux mêmes Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts, son second Envoi de Rome, la Symphonie Vasco de Gama.
La presse est assez discrète sur cette exécution qui est restée unique.
Ne serait-ce pas le moment, avant d'entreprendre l'analyse de sa première œuvre dramatique, de justifier Bizet, une fois pour toutes, d'un reproche qui lui fut particulièrement sensible, qui s'attacha à lui et le poursuivit jusqu'à sa mort ?
Dès son retour de Rome, Bizet fut accusé de Wagnérisme ; il passa pour le plus fervent adepte de ce que l'on appelait alors les idées nouvelles, comme s'il n'était pas possible de vouloir sortir des sentiers éternellement battus, de rechercher la vérité scénique, en s'attachant à approprier la musique aux situations dramatiques qu'elle doit rendre, sans pour cela être enrôlé sous la bannière du novateur génial, certes, mais dont l'esthétique s'accommode mal à la tournure de notre esprit avide de précision et de clarté.
Pour juger la fausseté de cette accusation, il suffira de jeter un coup d'œil sur l'œuvre de Bizet ; on verra que toutes ses partitions sont conçues selon le système de la mélodie absolue, comme les opéras de Mozart et de Weber, ce qui est anti-wagnérien au premier chef, c'est-à-dire contraires aux idées esthétiques du Maître de Bayreuth, celles qui ont servi de règle aux œuvres de la seconde manière, les seules vraiment conçues selon le rite wagnérien. Donc, pas d'influence esthétique, la reprise fréquente des motifs, l'absence de phrases caractéristiques, le prouvent surabondamment, mais, du moins, aurait-il subi une influence de manière, de procédés ?... Encore moins. Dans ses premières œuvres : les Pêcheurs de perles, la Jolie fille de Perth, Bizet, c'est incontestable, a subi, parfois, à son insu, l'influence d'Halévy, de Gounod, de Verdi, mais on chercherait vainement la moindre trace wagnérienne. Avec Djamileh, il s'affranchit, il devient personnel. Il ne doit plus, dès lors, rien à personne ; il puise dans son propre fonds si riche.
Non, non, Bizet ne doit rien à Wagner ; il est de la grande race des Weber et des Mendelssohn, et ses procédés, originaux, ses harmonies, pleines de charme et d'imprévu, mordantes ou délicates, toujours claires et sonores, n'ont rien à démêler avec les entassements harmoniques et les effets rythmiques du Maître de Bayreuth.
Ah ! la critique ! Quelle arme terrible ! Quelle épée à deux tranchants, qui ne devrait être maniée que par des mains expertes et délicates ! Comme les blessures qu'elle fait, maladroitement, sont cruelles ! douloureuses ! mortelles, souvent !
Ce fut au début de la carrière de Bizet, que ce reproche, que rien ne justifie, fut formulé pour la première fois. Le public, séduit par son apparence spécieuse, répéta sans trop comprendre, et bientôt le jeune artiste passa pour le chef avéré des Wagnériens français. Mais ce fut surtout après Djamileh que l'accusation devint générale et affecta particulièrement Bizet. C'est à cette époque que M. Arthur Pougin l'appelait : « farouche Wagnérien ».
Le farouche Wagnérien écrivait à un de ses amis à propos de Djamileh : « La rengaine Wagner recommence... » et plus loin, dans la même lettre : « Saint‑Victor, Jouvin, etc., etc., ont été bons en ce qu'ils constatent inspiration et talent, le tout gâté par l'influence Wagnérienne ?... » On le voit, c'est la tunique de Nessus que le pauvre grand artiste ne peut parvenir à arracher de ses épaules.
Après Carmen, quelques semaines avant sa mort, rencontrant J. Weber, il lui disait, en souriant tristement : « Sont-ils drôles vos confrères avec leur rengaine Wagner ? » — « Laissez-les dire ! » répondait le critique du Temps en haussant philosophiquement les épaules.
Il ne faudrait pas induire de tout ceci que Bizet ne rendit pas justice à Wagner et qu'il n'admira pas, sans réserve, ses conceptions géniales. Il était loin de penser, comme Offenbach, que « Wagner c'est Berlioz moins la mélodie (*) », mais, de son admiration très grande, au servilisme esthétique qu'on lui a prêté, il y a un gouffre que sa nature indépendante n'aurait jamais pu franchir.
(*) Dans sa biographie d'Auber, publiée au Ménestrel dans le courant de l'année 1863, B. Jouvin avait attribué le mot à l'auteur du Domino noir ; celui-ci alla trouver son biographe, protesta de son innocence et, tout en le remerciant des éloges nombreux dont il l'avait comblé, le pria de glisser une petite rectification. La rectification parut au Ménestrel le dimanche suivant.
Voici, du reste, une lettre, écrite le 1er avril 1869, le lendemain de la répétition générale de Rienzi au Théâtre-Lyrique ; elle dira, mieux que nous ne saurions le faire, ce qu'il pensait du Maître allemand (*).
(*) Un élève de Bizet, M. Edmond Galabert, a publié en 1877, à la librairie Calmann-Lévy, sous le titre : Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance, une brochure de 26 pages, contenant des fragments de correspondance. Cette publication a été complétée en 1909 par un volume : Lettres à un ami (Calmann-Lévy édit.). C'est à M. Edmond Galabert que fut adressée la lettre que nous reproduisons ici.
« On a commencé à huit heures. — On a terminé à deux heures. — Quatre-vingts musiciens à l'orchestre, trente sur la scène. — Cent trente choristes, — cent cinquante figurants. — Pièce mal faite ; un seul rôle : celui de Rienzi remarquablement tenu par Monjauze. — Un tapage dont rien ne peut donner une idée. — Un mélange de motifs italiens ; bizarre et mauvais style ; musique de décadence plutôt que de l'avenir. — Des morceaux détestables ! Des morceaux admirables ! au total : une œuvre étonnante vivant prodigieusement ; une grandeur, un souffle Olympien ! — Sera-ce un succès ? Je l'ignore. — La salle était pleine — pas de claque ! — Des effets prodigieux ! des effets désastreux ! des cris d'enthousiasme ! puis, des silences mornes d'une demi-heure. — Les uns disent : C'est du mauvais Verdi ! les autres : C'est du bon Wagner ! C'est sublime ! — C'est affreux ! c'est médiocre ! — Ce n'est pas mal ! — Le public est dérouté, c'est très amusant. — Peu de gens ont le courage de persister dans leur haine contre Wagner. Le bourgeois, le gandin, sentent qu'ils ont affaire à un grand bougre, et ils pataugent. — Nous verrons mardi ; — le public d'hier composé d'invités était forcé d'être poli. »
A rapprocher de cette lettre curieuse, l'appréciation d'Auber sur le Tannhäuser et en général sur l'œuvre de Wagner : « Wagner est un musicien de talent et sa partition renferme de belles pages ; mais elle ressemble à un livre qui serait écrit sans point ni virgule de la préface à la conclusion ; on ne sait à quel endroit respirer : même lorsqu'il admire, l'auditeur étouffe. »
Voici maintenant, pour en finir, une anecdote qui tendrait à confondre Gounod, Bizet et Ernest Reyer dans un même fanatisme pour l'auteur de Niebelungen. Elle est contée par B. Jouvin dans le Figaro littéraire de 1863 dont il était alors rédacteur en chef (*). « L'an dernier je me trouvais à Bade, moi profane, au milieu d'un petit nombre de croyants intraitables sur l'article de la foi allemande, et, comme bien vous pensez, je marchais irrévérencieusement au rebours de l'allure dévotieuse de ces sectaires ardents et convaincus. Dans ce cénacle de demi-dieux, ou aspirant à le devenir, Hector Berlioz représentait le vénéré Nestor, Charles Gounod le prudent Ulysse, Ernest Reyer le bouillant Ajax et l'auteur des Pêcheurs de perles, le jeune et déjà fougueux Achille, — un Achille échappé de la veille de la cour de Lycomède et rejetant avec dédain le nom et le costume féminin de Pyrrha (c'est-à-dire l'enseignement classique du Conservatoire), pour se jeter dans la mêlée artistique. L'éclair du glaive avait révélé à Achille sa vocation de héros ; le choc des harmonies que l'auteur du Tannhäuser fait pénétrer comme la pointe d'un sabre dans les oreilles de ses auditeurs, avait opéré sur mon jeune ami Bizet un miracle analogue. Au reste, à l'exception de Berlioz — un protestant de l'autre côté du Rhin — tous chantaient les louanges de Wagner. Bien plus, persuadés que la foi qui n'agit pas n'est point une foi sincère, ils voulurent, entre la poire et le fromage, me confier une partie dans cet Hosannah, — probablement celle que le musicien de Béatrice et Bénédict ne consentait à aucun prix à exécuter. Georges Bizet, croyant me conquérir par un pieux mensonge qui devait brûler sa langue, alla jusqu'à me dire : « — Vous aimez la musique de Verdi, eh bien ! Wagner, c'est Verdi avec du style. » — J'entends encore cette parole captieuse, je vois encore d'ici la cabriole que cette comparaison sacrilège fit exécuter à Reyer indigné. Le diable se tiendrait plus commodément dans un bénitier empli jusqu'aux bords, que le nom de Verdi sur les lèvres intolérantes de l'auteur de la Statue. Reyer regarda Bizet de travers. Celui-ci, baissant les yeux, semblait dire pour s'excuser : « Il faut bien un peu mentir dans l'intérêt de la bonne cause. » Quant à moi, cet essai de conversion resté infructueux me fit sourire et me rappela une historiette de Plutarque, celle de ce musicien que les Lacédémoniens mirent à l'amende « parce qu'il avait touché les chordes de son cithre avecque les doigts ». Ce passage obscur devenait clair pour moi. Richard Wagner était justement ce musicien qui, appuyant sans ménagement les doigts sur les cordes, faisait rendre à son luth des sons par trop grinçants, et les Parisiens s'étaient montrés non pas Spartiates, vraiment, mais Athéniens, et des plus délicats, en mettant le compositeur à l'amende. »
(*) Figaro du 8 octobre 1863.
L'anecdote est charmante et contée avec infiniment d'esprit ; mais ce brave Jouvin a été, je le crains fort, victime de quelque aimable plaisanterie. Il a dû prendre pour argent comptant des théories excessives débitées, avec un parti pris évident de paradoxe, par nos trois musiciens français. Ce qui me confirme dans mon idée, c'est le silence de Berlioz. Certes, l'auteur de la Damnation de Faust eût protesté, s'il n'eût saisi cette pointe d'ironie paradoxale qui échappa à B. Jouvin. Il n'eût pas laissé échapper une aussi belle occasion de rompre une lance, en faveur du grand Art français dont il fut un des plus admirables représentants. « A l'exception de Berlioz, dit Jouvin, tous chantaient les louanges de Wagner. » J'avoue que j'ai peine à me figurer Gounod, ce doux Maître si personnel, ce poète si éloigné par tempérament et par goût de tout ce qui est excessif, chantant sur le mode majeur les louanges du Maître de Bayreuth. Quant à Bizet, à qui B. Jouvin fait prononcer la malencontreuse phrase : « Wagner, c'est Verdi avec du style », nous avons vu, par la lettre plus haut reproduite, lettre écrite au mois d'avril de l'année 1869, six ans à peine après l'aventure si spirituellement contée par B. Jouvin, ce qu'il pensait alors du style de Wagner ; nous le verrons bientôt, au contraire, s'éprendre de Verdi (*), admirer ses grandes qualités scéniques, son style dramatique si puissant, et entreprendre et mener à bonne fin la composition d'un grand opéra en cinq actes, où, s'inspirant de son illustre modèle, il avait cherché et réussi à s'assimiler la manière nerveuse et dramatique du Maître italien. Ce grand opéra, c'est Ivan le Terrible qui, reçu au Théâtre-Lyrique mais bientôt retiré par le jeune artiste, ne fut jamais représenté.
(*) S'il reconnaissait la grandeur de certaines conceptions Wagnériennes, il admirait sans réserve les œuvres si puissamment scéniques de Verdi et prenait plaisir à vanter les inspirations chaleureuses de ce « grand Maître de l'art italien. » Voilà ce que Marmontel, dans son ouvrage : Symphonistes et virtuoses, a écrit sur les prétendus enthousiasmes Wagnériens de Bizet et sur sa grande admiration pour Verdi.
LES PÊCHEURS DE PERLES.
Le poème des Pêcheurs de perles ne brille pas par excès d'originalité. Cependant, il transportait le jeune artiste au pays de toute féerie, dans cet Orient plein de lumière, et allait lui fournir les moyens de produire au grand jour son talent si avide de couleur et de nouveauté. De plus, quoique amenées par des moyens puérils, des situations dramatiques, des scènes d'un caractère bien tranché, pouvaient mettre en relief le talent nerveux et la puissante facture du musicien. Bizet n'avait pas hésité ; s'il eût pu choisir, il eût, sans doute, réclamé un poème plus sérieusement conduit, plus artistement développé ; mais, n'ayant pas le choix, il avait accepté le livret des Pêcheurs de perles avec enthousiasme.
C'est dans l'île de Ceylan, au milieu d'une nature poétique et sauvage, que les auteurs ont placé l'action.
Au lever du rideau, la scène représente une plage aride. Des pêcheurs indiens, hommes, femmes, enfants, couvrent le rivage. Les uns achèvent de construire les huttes du campement, tandis que d'autres boivent le vin de palmier et dansent au son des instruments. Çà et là quelques arbres ombragent de gigantesques cactus tordus par le vent ; au fond, sur un rocher qui domine la mer, une pagode délabrée. C'est sur cette plage sablonneuse que les pécheurs de l'île se réunissent chaque année, à la même époque, pour pêcher la perle. Après avoir élu un chef à qui ils jurent d'obéir, ils commencent leur pêche périlleuse, tandis que, debout sur le rocher qui domine la mer, mystérieusement voilée, une vierge inconnue, que les vieux de la tribu sont allés chercher sur un rivage lointain, chante pour apaiser les esprits de l'abîme et éloigner les tempêtes.
La vierge doit, sous peine de mort, dérober ses traits à tous les regards :
Seule au milieu de nous, vierge pure et sans tache,
Promets-tu de garder le voile qui te cache ?
De rester jusqu'au bout fidèle à ton serment ;
De prier jusqu'au jour au bord du gouffre sombre,
D'écarter par tes chants les noirs esprits de l'ombre,
De vivre sans ami, sans époux, sans amant ?
Et Leïla, la jeune fille inconnue que le vieux Nourabad et les anciens de la tribu sont allés chercher au loin, promet à Zurga, le chef que les pêcheurs indiens viennent de se donner, de rester pure et voilée à tous les yeux, tandis qu'elle apaisera par ses chants les esprits de l'abîme...
Parmi les pêcheurs, se trouve Nadir, l'ami d'enfance de Zurga, son compagnon dévoué. Il a vécu longtemps au milieu des forêts, faisant la guerre aux tigres et aux panthères, pour tâcher d'oublier une funeste passion. Un soir, à Candi, tandis que les brahmines appelaient la foule à la prière, les deux amis ont pénétré dans la mosquée. Ils ont aperçu une femme, voilée, à la démarche de déesse ; le voile s'est un instant entr'ouvert, alors leurs deux mains se sont désunies, l'un et l'autre a senti dans son âme germer une passion funeste ; ils ont fui, jurant d'oublier l'enchanteresse qui allait aussi désunir leurs cœurs. Et Nadir, pour se guérir, s'est réfugié au milieu des forêts où il a vécu depuis ce jour. Aujourd'hui il est guéri ! il le croit du moins...
Soudain, du haut du rocher, une voix s'élève invoquant Brahma le maître souverain du monde et la blanche Shiva. C'est Leïla qui commence ses chants, tandis que les fakirs, accroupis à ses pieds, allument un bûcher de branches et d'herbes sèches dont Nourabad attise la flamme. Nadir tressaille ; il a cru reconnaître la jeune inconnue, à son geste gracieux, à sa démarche ; maintenant il ne doute plus, c'est elle, c'est la jeune fille de Candi, et son amour vient de se réveiller plus violent au fond de son cœur...
A la nuit, pendant que tout repose dans le camp des pêcheurs, que seule dans la pagode en ruine, où le cactus et les palmiers s'élèvent à côté des colonnes brisées, où les lianes chargées de fleurs enguirlandent les voûtes, Leïla songe aux jours écoulés, à l'étranger qu'elle a reconnu et dont elle avait gardé un souvenir ineffaçable, sur la terrasse de la pagode, éclairée par les rayons de la lune, un homme paraît. C'est Nadir. Il a escaladé les rochers du côté de la mer pour parvenir jusqu'à celle qu'il aime...
Tandis que, doucement enlacés, les deux amants oublient le danger qui les menace, le ciel s'est soudain obscurci et l'orage a commencé à gronder. A ce signe manifeste de la colère des divinités de l'abîme et des airs, Nourabad qui veille s'est approché de la pagode et a tout vu ; il a donné l'éveil. Alors, au milieu des éclats de l'orage déchaîné, les pêcheurs furieux et les fakirs armés de torches envahissent la pagode ; ils demandent à grands cris la mort des coupables... Zurga, fidèle à l'amitié qui le lie à Nadir, va faire grâce, mais, à son tour, il reconnaît Leïla. Ivre de fureur et de jalousie, il condamne les malheureux...
C'est dans la forêt sacrée, au pied de la statue de Brahma, qu'est dressé le bûcher ; Nadir est enchaîné et attend l'heure du supplice ; le vin de palmier circule ; les pêcheurs, animés par l'ivresse, exécutent des danses furibondes. Aux sons d'une marche funèbre, Leïla est amenée à son tour.
Mais, pendant que se font les apprêts du supplice, une immense lueur éclaire tout à coup la forêt du côté du camp. Au milieu de leur ivresse, les Indiens s'arrêtent, croyant à l'apparition de l'astre du jour. Zurga paraît, une hache à la main.
Regardez, c'est le feu !
Le feu du ciel sur nous tombé des mains de Dieu !
. . . . .
La flamme envahit et dévore
Votre camp ! Courez tous ! Il en est temps encore,
Pour arracher vos enfants au trépas !
Et les Indiens se précipitent en désordre vers le camp. Zurga, d'un coup de hache, brise alors les chaînes qui retiennent Leïla et Nadir.
Ce que l'amitié n'a pu faire, la reconnaissance va l'accomplir. Jadis, poursuivi, traqué par une « horde sauvage » qui en voulait à sa vie, il a été sauvé par une enfant qui lui donna asile en sa chaumière, le cacha, et, au péril de ses jours, sauva les siens. Cette enfant, c'est Leïla ; il vient de voir, autour de son cou, le collier qu'il lui donna en signe de reconnaissance. Aussi, pour arracher les deux amants à un supplice qu'il serait impuissant à empêcher désormais, il a mis le feu aux tentes du campement, et, pendant que les Indiens affolés se précipitent pour sauver leurs enfants, il délivre les condamnés et leur indique le rivage où sa barque amarrée les attend...
Je me suis attaché à mettre en relief les grandes scènes de la pièce, les scènes vraiment musicales, négligeant à dessein les petits moyens qui les amènent souvent. Le drame lyrique, celui de tous les genres qui doit le moins à la convention, étant le produit du drame et de la Comédie musicale, vit de grandes scènes, de situations tendres, dramatiques ou joyeuses, amenées par des moyens simples et naturels, sans complications et sans ficelles, marchant au dénouement sans inutilement s'attarder. Les procédés du vieux mélodrame ne sont pas de mise, et les lettres, les colliers, qui servent à reconnaître l'héroïne au cinquième acte, au moment opportun, n'ont que faire ici. Voilà pourquoi je trouve ridicule la bizarre imagination des auteurs d'avoir cru qu'il était nécessaire, pour intéresser, que la jeune fille chargée d'apaiser par ses chants les vents et les tempêtes, eût sauvé, jadis, étant enfant, la vie de Zurga, et de l'avoir affublé d'un collier chargé de la faire reconnaître. N'eût-il pas été plus simple et plus grand de pardonner à l'ami infidèle ? Zurga généreux, sacrifiant son amour à l'amitié, eût pris un relief étonnant ; l'acte de pardon qu'il accomplit et pour lequel il n'a pas reculé devant un crime, le plus grand de tous, celui de livrer aux flammes le camp de ceux qui lui confièrent leurs biens et leur vie et l'élurent chef pour les protéger, eût donné à cette scène finale un pathétique grandiose qui lui fait défaut, rapetissée qu'elle est par cette mesquine histoire. Zurga, reconnaissant et sauvant parce qu'il a été autrefois sauvé, n'est plus qu'un scélérat qui fait acquitter par les siens ses petites dettes personnelles. La scène finale est décapitée...
La critique fut juste pour le poème et releva, unanimement, les nombreuses banalités qui l'émaillent. Elle remarqua, non sans raison, sa ressemblance fâcheuse avec la Vestale de de Jouy, ressemblance portant, non seulement sur les principales situations du drame, mais aussi sur les personnages. Nadir et Leïla n'ont-ils pas un grand air de famille avec Licinius et la vestale Julia ? Quant à Nourabad, il n'est qu'une réduction, presque grotesque, du superbe personnage du grand pontife...
La première représentation eut lieu le 29 septembre 1863. Primitivement fixée au 14, elle avait été retardée par l'indisposition de Mlle Léontine de Maësen, chargée du rôle de Leïla. Enfin le 29, quoique imparfaitement établie, la jeune cantatrice put créer son rôle, et la représentation eut lieu sans encombre.
La presse et les nombreux amis de Bizet avaient, dès longtemps, annoncé le succès probable, et, les indiscrétions aidant, le bien que l'on disait de l'artiste et de son œuvre avait allumé la curiosité ; aussi était-ce avec une véritable impatience que l'on avait attendu la première représentation de l'ouvrage. Le public, cependant, écouta avec plus de surprise que de véritable plaisir : cette musique, à laquelle il n'était pas habitué, cette recherche constante de l'originalité et de la couleur, ces néologismes fréquents, l'étonnaient plus qu'ils ne l'enthousiasmaient. Certaines pages, toutefois, furent chaleureusement admirées, et le succès général assez grand pour permettre aux nombreux amis de l'artiste, disséminés dans la salle, de lui faire une chaude ovation et de l'appeler en scène après la chute du rideau, lorsque Ismaël, qui venait de jouer le rôle de Zurga, vint annoncer que « la pièce était, pour la musique, de M. Georges Bizet, prix de Rome de l'année 1857 ». Sans trop se faire prier, Bizet parut et fut couvert d'applaudissements. C'était la manifestation première de cette jeune École qui nous donne des Maîtres aujourd'hui, saluant dans ce jeune homme de vingt-cinq ans, un de ses chefs, le plus jeune et le plus audacieux.
Mais la presse fit payer cher à l'artiste cet instant de triomphe ; elle le lui reprocha aigrement et l'exhorta à plus de calme, à plus de tenue, à l'avenir, lui faisant observer que de pareils procédés étaient peut-être de mise en Italie, mais qu'il ne devait pas oublier qu'il était en France (*). Certain Aristarque broda même d'assez peu brillantes variations sur le thème du bon La Fontaine : « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ! » Tout cela est bien puéril, bien mesquin !...
(*) Il paraît, du reste, que ces procédés étaient aussi de mise en France, à cette époque du moins, si l'on en croit la spirituelle boutade de Gabriel Guillemot au Figaro littéraire et bi-hebdomadaire de 1863, au lendemain de la première des Pêcheurs de perles. Voici un fragment exquis et instructif : « Je ne sais si la France compte un compositeur de plus. Le fait n'est pas de ma compétence, mais le Club des entraînés compte de plus un sociétaire. Il faut vous expliquer, n'est-ce pas ? ce qu'on entend par : les Entraînés. Sous ce substantif générique on classe les heureux auteurs qui, à la chute du rideau, cédant aux clameurs d'imprudents amis, se font voir sur la scène en compagnie des exécutants ou des interprètes de leur œuvre. Comme leur modestie se débat toujours un peu... on les entraîne. Meyerbeer est le chef des Entraînés. — Il est leur chef, non parce qu'il est le plus illustre, mais parce qu'il n'est déjà plus nécessaire qu'on l'entraîne. — Sûr de son succès, il a, par avance, revêtu le costume de régisseur parlant au public, et, derrière un portant de coulisses, il attend le signal que l'enthousiasme ne peut manquer de donner. — Il est enfin donné ce signal !... Meyerbeer apparaît, seul, ému, heureux, et par trois fois, il s'incline en appuyant la main sur son cœur ! — Gounod est un entraîné... féroce ; mais un entraîné dans le sens exact. — Entre les mains des chanteurs qui le poussent, il s'agite, il se tord, il lutte, il se débat. — Les chanteurs sont toujours les plus forts. — Pas de succès pour Gounod sans l'entraînement final. — Gounod va jusqu'à Milan se faire entraîner. — Halévy faisait partie du club des entraînés. — A la première représentation de la Dame de pique, je me rappelle avoir vu Battaille le porter dans ses bras et l'offrir au public. — Félicien David, entrainé ! — Jules Cohen... eh ! eh ! Jules Cohen... il me semble... mais je ne suis pas assez sûr. — Si cela n'est pas, cela sera ; — tous les musiciens y passent... mode italienne ! — Etre entraîné ! le rêve de Berlioz ! Heureusement que les Troyens sont là !
Le succès, qui avait paru définitivement se fixer après cette première représentation, ne se maintint pas. Bizet était monté, du coup, très haut dans l'estime des artistes, mais le public payant resta froid et n'alla pas au Théâtre-Lyrique. Les Pêcheurs de perles se traînèrent pendant tout le mois d'octobre, alternant avec les Noces de Figaro, chantées par Lutz l'excellente basse qui devait, quelques années plus tard, se révéler grand comédien dans le Ralph de la Jolie fille de Perth, par Mme Ugalde et Mme Miolan-Carvalho, puis, le 3 novembre, la première représentation des Troyens de Berlioz ayant eu lieu, ils ne furent plus joués que rarement et de loin en loin, le 6, puis le 20, enfin le 23 pour la dix-huitième et dernière fois. Ils disparurent de l'affiche, faisant définitivement place aux Troyens qui alternèrent à leur tour avec le chef-d'œuvre de Mozart...
La Partition des Pêcheurs de perles s'ouvre par un court prélude. L'introduction chantée et dansée :
Sur la grève en feu
Où dort le flot bleu...
est pleine d'entrain. Dès le début, l'originalité s'accuse par des recherches harmoniques donnant à la phrase principale, chaque fois qu'elle reparaît, un relief, un charme nouveau et une saveur d'imprévu des plus attrayantes. Toute cette scène initiale, comprenant : le chœur dansé, l'élection de Zurga, puis l'arrivée de Nadir et la reprise du chœur, est pleine de mouvement et menée avec une grande entente des effets scéniques.
Le duo de Nadir et de Zurga :
Au fond du temple saint...
qui vient immédiatement après, est une page d'un style sobre et élevé, d'une grande simplicité, se développant avec beaucoup d'art. Le motif principal reparaîtra souvent, toutes les fois que le musicien aura à évoquer la chaste apparition de Candi (*).
(*) C'est ce beau duo, adapté par Guiraud aux paroles du Pie Jesu, qui fut exécuté le 5 juin 1875, par Duchesne et Bouhy, aux obsèques de Bizet et qui produisit une si grande impression sous les voûtes de la Trinité.
Le Chœur qui se chante à l'arrivée de Leïla :
Sois la bienvenue,
Amie inconnue...
manque un peu de relief ; par contre, celui qui le suit immédiatement après le récit de Zurga, avec lequel il s'enchaîne : « Brahma, divin Brahma, que ta main nous protège... » est d'une majesté et d'une pompe harmonique des plus remarquables. La romance de Nadir avec accompagnement obligé de violoncelle et de cor anglais :
Je crois revoir encore, etc...
est une bien douce chose, d'un charme pénétrant ; le ténor Morini (*) la chantait d'une façon délicieuse. Vient ensuite le Finale ; il débute par un joli chœur exécuté dans la coulisse :
Le ciel est bleu, la mer est immobile et claire...
puis, la scène sur la montagne. Les fakirs allument un bûcher de branches et de feuilles sèches dont Nourabad attise la flamme. Tout ce morceau, à trois temps, dans un mouvement vif, a beaucoup de caractère ; le solo de violon est d'un effet très original. Quant à l'air de Leïla :
O Dieu Brahma,
ô maître souverain du monde...
il subit la loi fatale de tous les airs à roulades. Berlioz ne l'aimait pas, pas plus que le chœur qui l'accompagne ; il en trouvait le rythme vulgaire, la mélodie terne et légèrement banale...
Le second acte débute par un chœur très pittoresque, chanté dans la coulisse, que suit l'air de Leïla avec solo de cor :
Comme autrefois dans la nuit sombre...
Cet air est sans contredit une des grandes pages de la partition. Sa mélodie en est ravissante, d'un tour d'une délicatesse extrême. L'art du musicien se manifeste ici, d'une façon des plus heureuses, par l'habileté avec laquelle il fait intervenir un groupe de trois instruments à vent et amène ainsi des effets d'une originalité charmante.
(*) Les Pêcheurs de perles étaient interprétés par Morini dans le rôle de Nadir ; Ismaël : Zurga ; Guyot : Nourabad et Mlle Léontine de Maësen : Leïla.
La chanson de Nadir est connue ; elle figure dans le recueil des Vingt mélodies du Maître ; il n'est pas de ténor qui ne l'ait murmurée. Quant au duo de Leïla et de Nadir, qui contient de très beaux mouvements, il ne manque ni de chaleur ni d'une certaine majesté. La phrase : « Ton cœur n'a pas compris le mien, etc... », est d'une exquise tendresse. Le grand Finale est mené avec une habileté et une entente parfaite de l'effet scénique et du mouvement, assez rare chez un aussi jeune musicien, un débutant au théâtre. Mais, en même temps que les grands Symphonistes, Bizet avait étudié les maîtres de la scène et il tenait d'eux l'art si difficile de faire mouvoir les personnages, de les faire palpiter et vivre.
Le troisième acte comporte deux tableaux : le premier, sous la tente de Zurga, c'est là qu'il reconnaît dans Leïla la jeune fille au collier qui sauva ses jours ; le second, dans la forêt sacrée. L'air de Zurga qui ouvre le premier tableau, ainsi que le récit qui le précède, est d'un très beau caractère ; j'en dirai autant du duo de Leïla et de Zurga. On a reproché à ce duo sa forme italienne. Le début, ou la phrase, exposée d'abord par Leïla : « Je frémis, je chancelle, etc... » est ensuite reprise par Zurga, soutenue par les premiers violons, sur un contrepoint qu'exécute le soprano, peut, j'en conviens, par sa forme mélodique et son mouvement, autoriser la critique, mais, si ce duo est italien, il l'est à la façon des bonnes choses des derniers opéras de Verdi. La phrase : « Tu demandais sa vie... » a une ampleur et une majesté farouche d'une bien grande puissance. Puissant, bien puissant aussi, le chœur, dansé dans la forêt sacrée, qui précède l'arrivée de Leïla. Ceci est une page de premier ordre, d'une vigueur et d'un accent de férocité incroyable. Les Indiens, ivres, dansent autour du bûcher où est attaché Nadir. En poussant des cris féroces, ils invoquent Brahma et attendent avec impatience le jour dont l'apparition va donner le signal de la vengeance. La musique prête à cette scène sauvage un relief véritablement surprenant. L'arrivée de Leïla a lieu sur une large phrase d'orchestre : c'est le motif principal de la Marche funèbre du troisième envoi de Rome de notre jeune artiste. Le duo avec ses accompagnements de harpe et le finale avec le grand récit de Zurga : « Non, ce n'est pas le jour ; regardez, c'est le feu... » terminent sur deux grandes pages cette œuvre puissante, étrangement colorée, l'œuvre d'un jeune homme qui sera un Maître...
Berlioz, seul parmi les grands pontifes de la Presse musicale, sut lire dans l'avenir et entrevoir le destin réservé à ce musicien dont les audaces si généreuses, unies à un métier impeccable et à une profonde science, devaient certes lui plaire. « La partition de cet opéra, dit-il dans son article des Débats, a obtenu un véritable succès ; elle contient un nombre considérable de beaux morceaux expressifs, pleins de feu et d'un riche coloris. » Et plus loin, à la fin de son article : « La partition des Pêcheurs de perles fait le plus grand honneur à M. Bizet qu'on sera forcé d'accepter comme compositeur, malgré son rare talent de pianiste-lecteur. »
Les confrères en critique de l'illustre Maître ne surent pas comprendre cette œuvre jeune, où, la part faite aux exagérations, il eût été juste de constater le très réel talent et le savoir du musicien, l'habileté et la richesse de coloris de son orchestration et surtout la vigueur et la netteté de sa pensée, se détachant, claire et lumineuse, sur le fond un peu brumeux, parfois. Ils se montrèrent sévères, injustes et puérils. On ne peut sans un sourire feuilleter les longs articles des grands organes de la presse quotidienne et des journaux spéciaux. Jamais, au grand jamais, la Critique ne se fourvoya aussi étrangement. Bizet, certes, n'eut pas, de son vivant, à se louer de la presse qui ne lui a pleinement rendu justice qu'après sa mort, mais jamais ses jugements n'ont revêtu un tel caractère de partialité, presque de mauvaise foi. Peut-être aussi, ces juges intègres se trompèrent-ils grossièrement.
« M. Bizet, déclare le très érudit critique de l'un de nos principaux organes politiques, M. Bizet pourra nous donner un jour quelque charmant opéra-comique, mais, pour cette fois, il s'est trompé en voulant écrire un grand opéra pathétique et emphatique. Par son genre de talent il est du nombre des musiciens qui se rapprochent de Grisar ; ce talent a son attrait, son mérite, etc., etc. » J'ai cité textuellement pour n'être pas taxé d'exagération.
Un second trouve l'orchestration trop chargée et reproche au jeune artiste, précisément ce qui constitue le principal attrait de sa musique : ses harmonies toujours si piquantes, souvent si imprévues, qu'il appelle « des bizarreries harmoniques dues à une recherche mal entendue de l'originalité ». Un troisième signale « dans l'œuvre de M. Bizet, des secousses et des effets violents dignes de la nouvelle École Italienne dont il a forcément entendu les cris durant son séjour à Rome » ; d'autres, et c'est le plus grand nombre, exhibent, pour la première fois, devant le musicien atterré, le spectre de Wagner, ce spectre qui le poursuivra jusqu'à la tombe. Tous enfin, ou presque tous, constatent « l'imitation de certains effets mélodiques ou rythmiques employés par Félicien David ». C'est là le seul reproche qui paraisse sérieusement fondé. Il me sera facile d'en justifier Bizet.
La similitude du poème des Pêcheurs de perles avec ceux qu'affectionnait David, devait forcément amener cette ressemblance plutôt apparente que réelle. Sa préoccupation constante de la vérité, son amour de la couleur exacte, devaient amener Bizet à employer des rythmes, des formes mélodiques, déjà employés par l'auteur du Désert, dont le seul titre véritablement sérieux à l'admiration de la postérité est, précisément, la vision artistique de cet Orient qu'il a chanté dans toutes ses œuvres, et sa traduction musicale très poétique.
Mais l'imitation, puisqu'on est forcé d'employer ce mot pour traduire une idée si éloignée de sa signification ordinaire, l'imitation, dis-je, ne va pas plus loin, et je ne pense pas que les critiques qui ont fait cette remarque aient jamais entendu, en dehors de cette similitude de rythmes, qui n'est pas trop fréquente du reste, établir le moindre point de contact entre l'œuvre première du jeune homme et n'importe quel ouvrage de David, tant au point de vue de la facture qu'au point de vue purement musical...
Depuis leur disparition de l'affiche du Théâtre-Lyrique, les Pêcheurs de perles n'avaient jamais été repris, en France (*) du moins, lorsque tout à coup, dans les premiers jours du mois d'août 1886, — trois mois à peine après la publication de cet ouvrage, — je reçus la nouvelle que le théâtre du Cercle d'Aix-les-Bains était en train de les monter. M. Albert Carré — qui préludait à sa brillante direction de l'Opéra-Comique, où il devait produire tant d'œuvres intéressantes et donner un essor considérable à notre Ecole Française que Carvalho vieilli laissait vraiment trop sommeiller — avait conçu cette idée très artistique de faire applaudir, par son élégant public de baigneurs, la première œuvre de Bizet. Et il avait la délicate attention de m'en aviser, lui-même, sachant que nul, plus que moi, ne s'intéresserait à sa tentative et n'en souhaiterait la réussite. Quelques jours après, des échos nous arrivaient du succès qu'il venait de remporter. Admirablement montés, interprétés par des artistes de talent : Engel, Morlet et Mlle Félicie Arnaud, les Pêcheurs furent accueillis avec la plus grande faveur par le public cosmopolite et se maintinrent toute la saison (**). Malheureusement les saisons des Villes d'Eaux sont éphémères !... Les Pêcheurs de perles ont été peu joués, en France, depuis cette époque ; à Paris nulle importante reprise n'a été tentée.
(*) Le Théâtre de la Scala de Milan a repris l'ouvrage pendant la saison de Carnaval de l'année 1886.
(**) Voici la distribution complète des Pêcheurs de perles représentés le 8 août 1886 au Théâtre du Cercle d'Aix-les-Bains : Nadir : Engel — Zurga : Morlet — Nourabad : Poitevin — Leïla : Mlle Félicie Arnaud — un pêcheur : Leroy — chef d'orchestre : M. Barwolf.
IVAN LE TERRIBLE. — PÉRIODE FIÉVREUSE. —
NOUVELLE
INCURSION AU PAYS DE L'OPÉRETTE.
Bizet fut un musicien d'avant-garde dont la devise : « Il faut monter, monter, monter toujours », indique bien l'effort constant, et, cependant, on ne peut nier qu'au début de sa carrière, il n'ait subi des influences. Les Grands Maîtres, eux-mêmes, ont traversé des crises analogues, et leurs œuvres de début ont souvent reflété les œuvres, longtemps admirées, des génies qui les avaient précédés. C'est le cas de Beethoven dont les premières compositions se rattachent à celles de Haydn et de Mozart.
Après les Pêcheurs de perles, Bizet s'était vivement épris du style dramatique de Verdi, de ses grandes qualités scéniques, et, par une aberration bien explicable chez une nature capable d'enthousiasmes sincères, il en vint bientôt à ne plus voir au théâtre, à ne plus admirer, que le Maître Italien. Toute sa vie du reste il a professé une grande admiration pour Verdi, mais cette admiration raisonnée n'eut rien de commun avec la crise étrange d'engouement qu'il traversa à cette époque. Il travaillait, en ce moment, à un grand opéra en cinq actes d'Arthur Leroy et Trianon (*) : Ivan le Terrible ; rien d'étonnant à ce que son œuvre reflétât les préoccupations de son esprit ; Ivan fut donc écrit dans le style dramatique de Verdi. Inconsciemment ? — Je ne le crois pas. Bizet était un artiste trop intelligent, pour subir ainsi une influence aussi caractérisée ; je crois plutôt que, à ce moment de sa vie, presque au début de sa carrière, cherchant sa voie, il crut la trouver dans l'accouplement du style du Maître Italien et de l'art musical Français dont il était un des virtuoses les plus habiles. Car, il ne faut pas l'oublier, pour avoir subi à certaines époques des influences esthétiques, il n'en est pas moins resté, même dans cette étrange aventure d'Ivan le Terrible, un musicien original ; l'influence des idées, il l'a subie, parfois ; l'influence de la forme et du procédé, jamais.
(*) J'avais, par erreur, attribué le poème d'Ivan le Terrible à Édouard Blau et Louis Gallet. Or, quelque temps après la publication de cet ouvrage, je reçus la visite d'un aimable petit vieillard ; c'était M. Trianon, bibliothécaire à Sainte-Geneviève. Il me dit que son livret se trouvait entre les mains d'un jeune musicien qui s'était alarmé de cette fausse attribution lui faisant craindre un livret rival sur le même sujet. Et à ce propos, il me raconta que le livret d'Ivan, avant d'aller à Bizet, avait été offert à Gounod ; que Gounod, enthousiasmé, en avait commencé la composition ; puis, qu'il hésita ; et finalement le rendit. (Voilà un livret qui n'eut pas de chance !) Et, chose curieuse, l'un des airs écrits pour Ivan et que chantait un bouvier dans les Karpathes, est devenu une des pages les plus charmantes de Mireille ; c'est l'air que chante le berger dans la Crau : Le jour se lève et fait pâtir la sombre nuit.
La partition d'Ivan fut terminée, orchestrée, présentée et reçue au Théâtre-Lyrique. Mais Bizet reconnut bien vite son erreur ; il revint à une appréciation plus saine de ses propres qualités scéniques ; il comprit que le musicien qu'il était ne pouvait mettre son art au service d'idées qui procédaient, même indirectement, d'autrui ; qu'il ne suffisait pas d'être musicien original, qu'il fallait encore, pour être grand, être un artiste primesautier. Il retira donc sa partition qu'il brûla quelques années après. Ceci se passait en 1865.
En 1866 il entreprit la composition de la Symphonie qui devait être exécutée aux Concerts Pasdeloup, pendant l'hiver de 1869, sous le titre : Souvenirs de Rome ; mais, Carvalho lui ayant, vers cette même époque, confié le livret d'un opéra en quatre actes de de Saint-Georges et Adenis : la Jolie fille de Perth, il dut abandonner momentanément sa Symphonie à laquelle pourtant il tenait beaucoup. L'influence de Verdi était morte, il ne songeait plus qu'à être complètement original. Nous verrons, toutefois, en analysant la Jolie fille de Perth, que de vieux levains d'idolâtrie fermentaient encore dans son cœur.
Cependant, il fallait vivre en attendant le succès ; Bizet dut interrompre, à diverses reprises, la composition de son opéra et s'occuper de travaux lucratifs. Il orchestra de la musique de danse, et, sous le nom de Feuilles d'Album, composa six mélodies pour l'éditeur Heugel. Nous trouvons, dans une de ses lettres (*), de bien curieux détails sur ces travaux qui le détournaient de son occupation favorite, mais dont la nécessité s'imposait.
(*) Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
Il reprenait du reste la composition de la Jolie fille entre deux morceaux de danses orchestrés : « Croyez bien, écrivait-il, que c'est enrageant d'interrompre pendant deux jours mon travail chéri pour écrire des solos de piston. Il faut vivre !... Je me suis vengé. J'ai fait cet orchestre plus canaille que nature. Le piston y pousse des hurlements de bastringue borgne, l'ophicléide et la grosse caisse marquent agréablement le premier temps avec le trombone basse et les violoncelles et contrebasses, tandis que les deuxième et troisième temps sont assommés par les cors, les altos, les deuxièmes violons, les deux premiers trombones et le tambour ! Oui, le tambour !... Si vous voyiez la partie d'alto ! Il y a des malheureux qui passent leur existence à exécuter ces machines-là !... Horrible !... Ils peuvent penser à autre chose, si toutefois ils peuvent encore penser !... Je travaille énormément ; je viens de faire au galop six mélodies pour Heugel. Je crois que vous n'en serez pas mécontent. J'ai bien choisi mes paroles : les Adieux à Suzon, d'Alfred de Musset, A une fleur, du même, le Grillon de Lamartine, un adorable sonnet de Ronsard, une petite mièvrerie gracieuse de Millevoye et une folle Guitare de Hugo. Je n'ai pas supprimé une strophe, j'ai tout mis. Ce n'est pas aux musiciens à mutiler les poètes. Mon opéra, ma symphonie, tout est en train. Quand finirai-je ? Dieu ! que c'est long, mais comme c'est amusant ! Je me mets à adorer le travail ! Je ne vais plus qu'une fois par semaine à Paris (*). J'y fais mes affaires strictement, et je reviens au galop. Je suis si bien chez moi, à l'abri des raseurs, des flâneurs, des diseurs de rien, du monde enfin, hélas ! »
(*) Il habitait alors Le Vésinet.
Il ne pouvait cependant pas mener longtemps de front tous ces travaux ; d'autant plus que, pour rester dans les « termes rigoureux de son traité », il devait livrer sa partition de la Jolie fille à la fin de cette même année 1866. Il abandonna donc momentanément sa Symphonie. « Je suis harassé de fatigue, j'avance, mais il est temps, je n'en puis plus. J'ai été obligé de renoncer à l'orchestre de ma Symphonie. (*) » Et plus loin, dans la même lettre : « Je vais me coucher, mon cher ami, je n'ai pas dormi depuis trois nuits et je tourne trop au noir ! J'ai de la musique gaie à faire demain !... » C'est avec fièvre qu'il travaillait, et cela sans pouvoir interrompre, même un instant, les leçons, les travaux d'éditeur, les réductions, les transcriptions pour piano qui assuraient son existence. Le temps pressait cependant, le terme imposé par le traité approchait, il dut se surmener : « Si vous saviez mon existence depuis un mois! écrivait-il à son élève qu'il avait pris pour confident de ses peines et de ses joies ; je travaille quinze et seize heures par jour, plus quelquefois ; car j'ai des leçons, des épreuves à corriger ; il faut vivre. Maintenant, je suis tranquille ; j'ai quatre ou cinq nuits à passer, mais j'aurai fini. Je suis très content de moi. C'est bon, j'en suis sûr, car c'est en avant. (**) » Le 29 décembre 1866, la Partition fut remise à Carvalho ; elle avait été composée en six mois. Une nature moins vivace, moins solidement trempée, n'eût pu résister à cet excès de travail...
(*) Novembre 1866. Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
(**) Décembre 1866. Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
Il semblait qu'il n'y eût plus, dès lors, qu'à entrer en répétitions ; hélas ! les amertumes et les ennuis allaient commencer pour notre pauvre artiste. Il s'était hâté, pour rester dans les termes de son traité, plein de confiance dans l'amitié de son directeur et dans ce même traité ; cependant la première représentation n'eut lieu qu'un an plus tard.
Il fut d'abord convenu que l'on répéterait en mars, jusqu'à la fin mai ; Nilsson, chargée du rôle de Catherine Glover, devait à cette époque aller deux mois à Londres et rentrer le 15 août au Théâtre-Lyrique dans la Jolie fille de Perth. D'après cette combinaison la Jolie fille était donnée en pleine canicule, mais l'admirable interprète, chargée du rôle de Catherine, compensait largement le désavantage de la saison. Bientôt, cependant, les plans se modifient : « Je vais entrer en répétition, écrit Bizet (*) ... Ce qu'il m'a fallu dépenser d'intelligence et de volonté pour arriver à ce résultat, vous ne pouvez vous l'imaginer... Je passerai sans doute en avril. » C'était une illusion ! Il n'était pas au bout de ses ennuis. En mars, on commençait à peine à copier les rôles, et il partait pour Bordeaux pour entendre le ténor Massy. « Ma première marchera fin mai ; mettons le 15 juin et n'en parlons plus (**) », écrivait-il avant son départ. Hélas ! pas plus en mai qu'en juin, qu'en juillet, qu'en août !...
(*) Février 1867. Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
(**) Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
Cependant ses idées s'étaient modifiées. Les difficultés sans nombre qui surgissaient, alors même que tout paraissait aplani, lui suggérèrent la pensée de retarder sa première au lieu de la presser et d'éviter la canicule, malgré l'Exposition et l'affluence d'étrangers qu'elle allait attirer à Paris : « Je vais changer mes plans ; au lieu de presser, je vais différer le plus possible. Je vais essayer de ne répéter qu'en juin, et ferai tout mon possible pour n'arriver qu'en octobre, novembre, ou, s'il est possible, en décembre ! Ceci entre nous. Je veux arriver à l'hiver... Rien de décidé donc aujourd'hui, si ce n'est qu'à tout prix je veux éviter la canicule. » Un instant il crut ne pouvoir y réussir.
Tandis que, pressé de voir son œuvre à la scène, il hâtait, par tous les moyens en son pouvoir, cette première si désirée, les obstacles surgissaient de tous côtés et semblaient se jouer de ses efforts ; aujourd'hui, qu'il avait à cœur de retarder, pour attendre l'hiver, tout s'aplanissait ; Roméo et Juliette allait passer en avril, et la Jolie fille de Perth devait marcher immédiatement après, c'est-à-dire en plein juillet.
Bientôt, cependant, de nouvelles difficultés surgirent qui faillirent tout compromettre, tout remettre en question ; Nilsson venait d'être engagée à l'Opéra pour créer Ophélie de l'Hamlet d'Ambroise Thomas ; elle quittait le Théâtre-Lyrique, abandonnant brusquement le rôle d'Estella des Bleuets de Jules Cohen, dont le succès se trouva interrompu, faute de virtuose capable de chanter le rôle, spécialement écrit pour la fugitive ; Catherine Glover se trouva dès lors sans interprète.
Bizet crut tout perdu, il se désespéra : « Je viens de passer quinze jours atroces, écrivait-il après la tourmente ; enfin, tout est arrangé de ce matin. » Le rôle de Catherine fut confié à Mlle Jane Devriès et les répétitions commencèrent...
La répétition générale eut lieu en octobre, dans d'excellentes conditions, et la pièce, suivant le désir du jeune artiste, fut remise au milieu de décembre. Bizet était complètement heureux ; tout faisait présager un succès. Voici une lettre qui montre bien son état d'esprit et ses espérances (*). « Le monde sera revenu fin novembre ; l'ouverture des Chambres, la rentrée, tout me servira alors. Bref, cher ami, je suis complètement content ! Jamais opéra ne s'est mieux annoncé ! la répétition générale a produit un grand effet ! la pièce est vraiment très intéressante ; l'interprétation est excellentissime ! les costumes sont riches ! les décors sont neufs ! le directeur est enchanté ! l'orchestre, les artistes pleins d'ardeur ! et ce qui vaut mieux que tout cela, cher ami, la partition de la Jolie fille est une bonne chose ! Je vous le dis parce que vous me connaissez ! l'orchestre donne à tout cela une couleur, un relief que je n'osais espérer, je l'avoue ! je tiens ma voie ; maintenant en marche ! il faut monter, monter, monter toujours ! » Hélas !... Le succès devait se montrer rebelle encore. La Presse fut excellente, le public de la première presque enthousiaste, mais le vrai public resta froid comme il était resté froid pour les Pêcheurs de perles. La Jolie fille de Perth n'eut que vingt et une représentations.
(*) Octobre 1867. Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance.
Elle a été depuis très peu reprise. A l'étranger, je signalerai le grand succès qu'elle obtint à Bruxelles en avril 1868. Elle a également figuré, avec honneur, aux programmes des théâtres royaux de Gand et d'Anvers, ainsi qu'à celui du théâtre de Francfort pour la saison de 1884-1885...
Pendant qu'il luttait au Théâtre-Lyrique, avec des alternatives d'espérances sitôt déçues et de mornes découragement, Bizet faisait une nouvelle incursion dans le domaine de l'Opérette. Laissons le Ménestrel (*) nous raconter l'aventure, en style élégiaque ! L'Athénée apostasiait ; Bizet se faisait son complice ! « L'Athénée de la rue Scribe vient de passer aux faux dieux. En rouvrant les portes de cette charmante salle fondée par M. Bischoffsheim en l'honneur de la grande musique et d'une belle œuvre de bienfaisance, le nouveau directeur, M. Busnach, s'est dit, non sans à-propos, qu'il fallait être de son siècle, et il a introduit l'Opérette où régnait l'Oratorio. Adieu, ô saintes ombres de Haydn, Mozart, Beethoven, Weber et Mendelssohn ! Foin de l'orgue admirable de Cavaillé-Coll et des fugues de Bach impitoyablement chassées du temple ; loin de nous les chœurs d'Athalie, ceux du Désert, et la belle messe de Mme de Grandval ! Allons, Monsieur Pasdeloup, cédez le pupitre de chef d'orchestre à M. Bernardin et faites place aux réjouissantes cascades de Léonce, aux chansons réalistes de Suzanne Lagier. La transition est raide, mais c'est la bonne, s'est dit M. Busnach, et le public, resté indifférent à la voix des chefs-d'œuvre des grands Maîtres, est bien capable de lui donner raison. D'ailleurs, en se conformant résolument à son nouveau programme, la nouvelle administration a bien fait les choses ; sa pièce d'ouverture, Marlbrough s'en va-t'en guerre, opérette-bouffe en quatre actes, a été confiée à quatre musiciens dont le talent ne peut être mis en question. Je nommerai, malgré l'incognito rigoureusement gardé par le premier de ces jeunes maîtres, MM. Georges Bizet, Émile Jonas, Léo Delibes et Legouix. C'est M. Léo Delibes qui a pris soin, en bon camarade, de l'acte esquissé seulement par G. Bizet, tout entier à sa Jolie fille de Perth. A tout prendre, nos jeunes compositeurs sont encore heureux de trouver une scène où produire quelques actes, et il ne faut pas oublier que Ad. Adam, Grisar, de Flotow, et bien d'autres, n'ont pas dédaigné les Bouffes-Parisiens. Il ne s'agit que de diriger le genre de l'opérette vers un style avouable, afin de faire pardonner à l'Athénée sa brusque apostasie. »
(*) Le Ménestrel, 15 décembre 1867.
Marlbrough obtint un grand succès, mais Bizet jugea l'expérience suffisante ; il s'en tint là et ne recommença plus (*) ; quant à Léo Delibes, il devait donner encore quelques-unes de ces charmantes fantaisies musicales (**), fines, spirituelles, qui avaient commencé à le faire connaître ; Coppélia (***), cette œuvre exquise et charmante, représentée en 1870 à l'Opéra, le Roi l'a dit, donné à l'Opéra-Comique en mai 1873, devaient enfin l'arracher à un genre indigne de son talent, mais où il avait montré de si réelles qualités.
(*) Pourquoi ne pas tout dire ? Quand il s'agit d'un artiste comme Bizet, tout n'est-il pas intéressant ?... Bizet avait, dans le courant de l'année 1868 ou 69, écrit la musique d'une opérette-vaudeville de W. Busnach : Sol-si-ré-pif-pan, représentée aux Menus-Plaisirs. Cette fois-là il n'avait pas signé sa partition. A une vente de matériel, faite à ce théâtre, en 1884 ou 85, Busnach s'étant porté acquéreur des parties — la partition ayant été détruite ou égarée — pria M. Paul Puget de reconstituer cette partition absente. Mais les parties de chant ne purent être retrouvées et la reconstitution désirée devint impossible.
(**) L'Ecossais de Chatou, 1 acte (Bouffes Parisiens, 16 janvier 1867) ; la Cour du Roi Pétaud, 3 actes (Variétés, 24 avril 1869), etc.
(***) Avant cette époque il avait déjà donné à l'Opéra la Source, ballet en 3 actes et 4 tableaux. La partition avait été composée en société avec un musicien russe, M. Minkus ; Delibes avait écrit pour sa part les deuxième et troisième tableaux.
LA JOLIE FILLE DE PERTH.
« Enfin, » écrivait E. Lemoine, le 28 décembre 1867, dans sa chronique au jour le jour du Temps, « enfin, la Jolie fille de Perth, qu'on a trouvée trop belle pour être donnée pendant l'Exposition Universelle, a été représentée au Théâtre-Lyrique. Cette fois-ci, cependant, il y a toute apparence que M. Carvalho tient un succès vrai et durable, etc. » L'apparence fut trompeuse, cette fois encore. J'ai déjà dit le grand succès de la première représentation et l'unanimité de la presse ainsi que l'indifférence du public.
Les diplomates de la presse musicale, nous dit le Ménestrel, avaient prétendu, pour expliquer tous les retards successifs dont nous avons parlé, qu'il s'agissait de reprendre le rôle principal, celui de Catherine Glover, qu'avait dû créer Nilsson, à Mlle Jane Devriès, à qui il avait été confié après le départ de la diva, pour le faire accepter à Mme Carvalho. Il n'en était rien, malheureusement ; le rôle de Catherine ne fut pas offert à Mme Carvalho qui devait, quelques jours après la première de la Jolie fille, mettre le concours de son art merveilleux au service de la reprise de la Fanchonnette de Clapisson. Ce fut Mlle Devriès qui le créa.
La raison vraie de tous ces atermoiements, je ne la vois guère que dans l'état chancelant du Théâtre-Lyrique, dans l'indécision de la direction, dans les tiraillements dont les extraits de lettres cités plus haut trahissent l'existence. Dans son numéro du dimanche 3 décembre, le Ménestrel manifestait déjà les craintes que lui inspirait la situation, de plus en plus précaire, de la direction Carvalho : « Grande émotion cette semaine au Théâtre-Lyrique, disait-il. L'existence de ce théâtre a été sérieusement menacée. On ne peut se dissimuler que la retraite de M. Carvalho serait un coup fatal porté à notre troisième scène lyrique qui s'était élevée si haut en ces dernières années. Espérons que tout s'arrangera et que notamment la Ville de Paris comprendra l'intérêt général qu'inspire, à tant de titres, le Théâtre-Lyrique. » C'était un appel indirect à une subvention municipale ; le Conseil fit la sourde oreille. « Demain, lundi, première représentation du Cardillac de M. Dautresme, ajoute le Ménestrel, et peu après la Jolie fille de Perth, de M. Bizet. » Et dans son numéro du dimanche 15 décembre : « A bientôt la Jolie fille de Perth, puis, dans le courant de l'hiver, le Timbre d'argent de M. Saint-Saëns, dont les rôles sont déjà distribués, et plus tard, le Lohengrin de Wagner. » Hélas ! le Timbre d'argent ne devait pas de sitôt faire son apparition. La chute de la direction Carvalho, survenue dans le courant de l'année suivante, puis la courte et non moins malheureuse direction Pasdeloup et la fermeture du théâtre, l'ajournèrent à une époque lointaine. En 1877, seulement (*), au nouveau Théâtre-Lyrique éphémère de la Gaîté, sous la direction Vizentini, il fut enfin représenté.
(*) Le Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, opéra fantastique en 4 actes, fut représenté pour la première fois le 23 février 1877 au Théâtre-Lyrique de la Gaîté. Dans un intéressant article de l'Écho de Paris (19 février 1911), Saint-Saëns a raconté les longues tribulations de cette œuvre, commandée par Carvalho, qui passe du Lyrique à l'Opéra, puis émigre à l'Opéra-Comique, pour venir enfin échouer au Théâtre-Lyrique de la Gaîté où Vizentini l'exécute, c'est le cas de le dire ! Et quelles mutilations, quelles transformations n'avait-elle pas subies !
La Jolie fille de Perth fut la dernière pièce nouvelle que monta Carvalho, et avec grand soin, je vous assure (*). Rien ne faisait présager la chute prochaine ; tout était irréprochable : les décors pittoresques, les costumes exacts, la mise en scène réglée avec art, enfin l'interprétation était excellente. Les promesses de la répétition générale s'étaient réalisées et la première représentation fut extrêmement brillante. Massy, le jeune ténor que Bizet avait ramené de Bordeaux, créa avec intelligence le rôle de Henri Smith l'armurier. Doué d'une voix jeune et fraîche d'une grande force et d'une grande étendue, il sut donner au personnage sa physionomie, bien qu'il fût un peu novice comme comédien. A Mlle Jane Devriès était confié le rôle de Catherine Glover qui avait été écrit pour Nilsson. Mlle Devriès s'en tira à son honneur. Elle avait débuté l'été précédent dans la Somnambule ; elle était trop maniérée ; son organe manquait un peu de force et d'éclat ; du reste, le soir de la première représentation, paralysée par l'émotion, elle ne parvint guère à donner la mesure exacte de ses moyens que vers le milieu du troisième acte, sous l'influence de la sympathie marquée que lui témoignait le public et du succès qui se dessinait. Elle réussit cependant, avec beaucoup de bonheur, les scènes de sensibilité vraie qui étaient les plus difficiles à exprimer. Barré, sous les traits du duc de Rothsay, Wartel, dans le rôle du gantier Simon Glover le père de Catherine et Mlle Ducasse-Mab, la Bohémienne, complétaient un excellent ensemble. Quant à Lutz, qui donna au rôle secondaire de Ralph une physionomie si originale, il obtint un très gros succès dans la scène admirable de l'ivresse, au second acte, et s'y révéla excellent chanteur et grand comédien...
(*) Voici la liste des pièces nouvelles données au Théâtre-Lyrique pendant l'année 1867, la dernière de la direction Carvalho.
1° Déborah (3 actes), de Plouvier et Adolphe Fabre, musique de Devin-Duvivier (14 janvier).
2° Sardanapale (3 actes), de H. Becque, musique de V. Joncières (8 février).
3° Roméo et Juliette (5 actes), de Jules Barbier et Michel Carré, musique de Ch. Gounod (27 avril).
4° les Bleuets (4 actes), de Cormon et Trianon, musique de Jules Cohen (23 octobre).
5° Cardillac (3 actes), de Nuitter et Beaumont. musique de Dautresme (11 décembre).
6° la Jolie fille de Perth (4 actes), de de Saint-Georges et Adenis, musique de Georges Bizet (26 décembre).
Le poème de la Jolie fille de Perth est tiré du célèbre roman de Walter Scott. Très scénique, très mouvementé, bien coupé, fournissant au musicien de nombreuses situations très musicales, il plut beaucoup et ne récolta que des éloges. Cependant, qu'il me soit permis de regretter la rude et sauvage poésie dont le grand romancier a imprégné son œuvre. Les Écossais de de Saint-Georges et Adenis sont trop proches parents des aimables et généreux Écossais de la Dame Blanche.
Que sont devenues ces scènes si pittoresques, si grandes dans leur noble simplicité, où le romancier nous dépeint, avec cet art que l'on connaît, les mœurs pleines de rudesse et d'âpreté de ces montagnards à demi sauvages ? Envolés ces tableaux si vibrants de poésie mâle et guerrière : la lutte des clans rivaux de Chattan et de Quhele, où le vieux Torquil et ses huit fils se font tuer jusqu'au dernier pour défendre leur jeune chef Eachim ; et le combat des deux joueurs de cornemuse, ce combat digne des héros du divin Homère. Pendant toute la lutte, ils ont fait leurs efforts pour ranimer le courage des combattants ; les sons sauvages de leurs pibrochs ont soufflé le carnage. Voyant la querelle presque terminée, faute de bras pour la soutenir, ils jettent loin d'eux leurs instruments inutiles désormais et se précipitent l'un contre l'autre le poignard à la main : « Chacun songeait à donner la mort à son adversaire plutôt qu'à se défendre. Le musicien du clan de Quhele fut tué presque sur-le-champ, et celui du clan de Chattan tomba au même instant mortellement blessé. Il ramassa pourtant son instrument, et les sons expirants de son pibroch continuèrent à animer les combattants jusqu'au moment où la vie abandonna celui qui les faisait entendre. » Envolée aussi la scène des funérailles de Gilchrist Mac-Jan ! Envolée l'investiture d'Eachim le jeune chef du clan de Quhele ! Envolés tous ces beaux paysages de l'Écosse ; envolé tout ce qui fait le charme et la poésie. Il ne reste plus de ces tableaux si vivants et si colorés qu'une scène, la scène du Jugement de Dieu, où Ralph, l'apprenti de Simon Glover, provoque Henri Smith en combat singulier pour prouver l'innocence de Catherine. Smith, le gow-Chrom au poignet de fer, battant en se jouant l'enclume, avec Samson, le lourd marteau, « cette masse de fer qu'un cheval aurait peine à porter », Henri du Wynd, le redoutable champion de Perth, n'est plus qu'Henri Smith l'armurier, et Ralph, le Conachar, l'Eachim Mac-Jan de Walter-Scott, l'apprenti de Simon Glover... La pièce, très habilement faite, je l'ai dit, se trouve formée par l'intrigue bourgeoise qui fournit l'ossature du roman. C'est l'histoire de la belle Catherine Glover, la fille de Simon le gantier, la fiancée d'Henri Smith, sottement compromise par le duc de Rothsay le gouverneur de la ville ; du désespoir d'Henri qui croit sa fiancée coupable et la maudit ; de la folie de Catherine ; enfin des événements qui prouvent son innocence, la rendent à la raison et à l'amour d'Henri Smith désabusé...
La belle partition de Bizet débute par un Prélude, finement instrumenté où l'habileté de main du jeune maître se révèle dès les premières mesures. Au lever du rideau nous sommes dans l'atelier d'Henri Smith, l'atelier de l'armurier ; çà et là des armures, des cottes de mailles, des épées, des haches appendues aux murs ; les ouvriers forgerons frappent l'enclume à coups redoublés, les étincelles jaillissent. Le chœur des ouvriers forgerons, rythmé avec accompagnement de coups de marteau battant l'enclume, est d'un joli effet et d'une couleur charmante. Survient Smith, le maître :
Ce soir, amis, c'est grande fête !
Le joyeux carnaval s'apprête ;
Chacun de vous peut y courir ;
Allez, allez, votre besogne est faite.
Après le travail, le plaisir.
Il congédie ses ouvriers... Resté seul, il laisse le champ libre à ses rêves, et, dans un court tableau musical, très heureusement conçu, exprime ses craintes et ses espérances. Il aime Catherine, la fille de Simon Glover le gantier, et il attend avec impatience le jour de la Saint-Valentin, où il pourra la choisir pour Valentine et lui donner sa foi. Simon consent à l'union projetée, mais la coquette Catherine, sans se refuser à l'amour d'Henri, n'a pas encore dit le mot qui le rendrait heureux.
Une rumeur soudaine vient interrompre le cours de ses rêveries. Que se passe-t-il ?... C'est une femme qu'on insulte. Henri saisit une hache et va ouvrir la porte de la rue ; la femme entre vivement... C'est Mab la Bohémienne ! Poursuivie par de jeunes seigneurs de la cour qui voulaient lui prendre la taille et l'embrasser, elle a résisté et a pris la fuite ; la voilà en sûreté maintenant. Alors, reconnaissante du service que lui a rendu Smith, à la façon des filles de Bohême, elle veut le remercier ; elle s'empare de sa main pour lire sa destinée. Les couplets de Mab sont charmants, pleins de mutinerie et de malice... A ce moment, on frappe au dehors ; Simon Glover et sa fille Catherine, suivis de Ralph l'apprenti gantier, viennent, chez leur voisin et ami, fêter dignement le joyeux carnaval, et, pour éviter des ennuis au brave garçon, Simon apporte les vivres : un quartier de venaison, un pâté, du vieux whisky d'Écosse, un succulent pudding. Henri ne veut pas rendre Catherine jalouse ; la présence de Mab est suspecte ; il fait entrer la jeune Bohémienne dans la pièce à côté. Toute cette scène est excellemment présentée ; les récits, d'une bonhomie, d'une vérité d'accent surprenante ; le morceau d'ensemble, admirablement écrit pour les voix, est d'un effet des plus heureux. Mais, tandis que Simon ne songe qu'à fêter le carnaval, à sa manière, au coin du feu, avec son ami Smith et Ralph son apprenti, car, comme il le dit joyeusement :
... Chacun fête à sa guise
Le carnaval... et par ce temps de bise
On doit surtout bien boire et bien manger...
sa fille, la coquette Catherine, songerait à le fêter autrement. Elle entrevoit le brillant cortège de la Folie et les joyeux éclats de rire, plaisirs qui conviendraient mieux à son âge et à sa beauté. L'Air qu'elle chante, « Vive l'hiver et son cortège », est un de ces malheureux airs à roulades dont n'ont pas su se garder nos meilleurs musiciens eux-mêmes. Il semble que, par la nature de son talent, par son horreur du faux, par sa répulsion pour tout ce qui n'est pas sincère et vrai, Bizet eût dû être affranchi du funeste tribut. Hélas ! à cet âge de sa vie, où, avec l'estime des artistes, il devait désirer un succès de public qui lui permît de vivre pour son art, de travailler à ses heures, et d'abandonner les obscurs travaux d'éditeurs indignes de son talent, il crut, sans doute, arriver à son but par ces concessions faites au mauvais goût et à la mode. Le rôle de Catherine avait été, on le sait, écrit pour Nilsson ; rien d'étonnant à ce que Bizet, en vue de sa merveilleuse interprète, qui devait forcément attirer le public, surtout si son rôle cadrait bien avec la nature de sa voix et donnait à la virtuosité prodigieuse l'occasion de se produire à l'aise, rien d'étonnant, dis-je, à ce qu'il ait succombé à la tentation d'écrire de la musique à roulades et à vocalises. Le sacrifice était dur, sans doute, mais il lui parut nécessaire.
Nous retrouverons, au cours de la partition, plusieurs passages écrits dans ce même style. Bizet, on le verra plus loin, accusa loyalement sa faute, mais il ne voulut pas s'en excuser et faire valoir les bonnes raisons qui lui coûtaient sans doute à avouer. Depuis, plus jamais il n'est tombé dans l'erreur... Avec le duo qui suit : « Deux mots encor, ma belle Catherine, etc. », nous retrouvons Bizet, le Bizet plein de finesses, de délicatesses harmoniques... Simon et Ralph sont allés présider aux apprêts du souper, ce dernier bien à contre-cœur car il aime Catherine, lui aussi, et il ne voudrait, à aucun prix, la laisser seule avec son rival. Catherine et Henri sont donc en présence ; Henri de plus en plus amoureux, Catherine toujours coquette ; elle vient cependant d'ouvrir son cœur et d'accepter, d'avance, en gage de sa foi, le présent de la Saint-Valentin, une fleur en or émaillé. Tout à coup un homme enveloppé d'un manteau entre par la porte du fond, sans frapper. Interrompu au milieu de son dialogue amoureux, Smith se retourne avec humeur. L'étranger, que ni Catherine ni Henri ne connaissent, est le duc de Rothsay, le gouverneur de la ville ; il a suivi Catherine et l'a vue entrer chez Smith ; alors, pour arriver jusqu'à elle et lui parler, il imagine d'entrer à son tour chez l'armurier et de lui donner à réparer sa dague dont la lame s'est faussée, dit-il, dans le « bras stupide d'un manant ». Smith hésite un instant, puis se met à sa forge en maugréant. Le duc s'approche alors de Catherine, et lui débite un compliment, auquel la coquette fille répond en souriant. Bientôt Smith, qui un instant a interrompu son travail, s'aperçoit de ce qui se passe ; il redouble alors ses coups de marteau pour interrompre les galanteries de l'étranger. Comme on le voit, la situation est originale ; le trio qu'a écrit Bizet ne l'est pas moins ; l'effet des coups de marteau sur l'enclume, scandant la phrase musicale, a par malheur déjà été entendu au commencement de l'acte, ce qui lui enlève un peu du cachet d'imprévu pittoresque, qu'il aurait eu, certainement, si Bizet n'avait cru devoir en escompter l'effet. Smith frappe de plus en plus fort ; le duc, railleur, se retourne, et, sur un ton qui ne souffre pas de réplique :
Eh ! mais, là-bas...
Votre musique est enragée.
. . . . .
Frappez un peu moins fort, car on ne s'entend pas !
Smith s'arrête un instant... Cependant, voyant le duc plus galant, plus empressé, il recommence de plus belle. Bientôt il n'y peut tenir ; le duc vient de prendre la main de Catherine ; il lui parle avec amour. Smith s'avance alors, à pas de loup, pour surprendre la conversation qu'il ne peut entendre. Au moment où il est derrière Rothsay, celui-ci porte la main de Catherine à ses lèvres. Ivre de fureur, Henri lève son marteau et va frapper. Soudain un cri retentit ; Mab qui de sa cachette a suivi toute la scène, s'élance pour sauver le duc. Henri abaisse son marteau ; Catherine et Rothsay, qui ne soupçonnent même pas le drame, qui allait avoir lieu sans l'intervention de Mab, regardent la jeune Bohémienne avec surprise.
Que vois-je une femme en ces lieux !...
Le quatuor qui se déroule alors est une page charmante ; Bizet s'y montre maître en l'art difficile de marier les voix, de les agencer, de les grouper. avec une aisance et une étonnante habileté. Le finale est plein de mouvement ; Catherine, excitée par le duc, qui joue là un assez vilain rôle, croit à la trahison d'Henri.
Cette femme est votre maîtresse,
dit-elle ; en vain Henri proteste de son innocence ; en vain il supplie ; la belle capricieuse ne veut rien entendre. Elle jette la fleur émaillée que lui avait donnée Smith et veut, à l'instant même, quitter sa maison. Ceci ne fait pas l'affaire du brave Simon qui vient de préparer le souper. Il apparaît, un flacon à chaque main, en chantant un refrain bachique, suivi de Ralph, qui, aidé d'un valet, porte une table servie. Sans s'occuper de rien, il prend ses dispositions pour le souper. Tout à coup il lève les yeux et aperçoit Mab :
Eh ! mais, voici nouvelle compagnie ;
puis le duc de Rothsay :
Quoi ! vous ici, vous, Monseigneur !...
C'est le duc de Rothsay, c'est notre gouverneur !
Le gouverneur !... Surprise générale !... Simon en profite pour demander une audience, que le duc s'empresse de lui accorder, pour le lendemain. Ce finale est musicalement très scénique ; tout y est à sa place et y tient bien sa place. A citer la jolie Chanson à boire de Simon :
Il était jadis un bon roi
Qui de Bacchus suivait la loi, etc.
pleine de rondeur et de bonhomie ; enfin l'ensemble final, bien sonore, bien écrit pour les voix, et dont la phrase, un peu courte, peut-être, et que l'on aimerait un peu plus développée : « il est infidèle et parjure », mais d'une belle venue mélodique et d'une heureuse inspiration, se déroule, chantée par Catherine et par Henri, sur le motif de la Chanson à boire, dit par Simon et Ralph soutenus par les violoncelles et les bassons...
Le second acte débute d'une façon spirituellement charmante. Le théâtre représente une place publique, la place principale de la ville de Perth ; il fait nuit ; une patrouille bourgeoise, munie de lanternes, parcourt les rues ; elle est commandée par Simon Glover.
Bons citoyens, dormez !
chantent les braves citadins chargés de veiller à la tranquillité de la ville.
Bons citoyens, dormez !
Tout est calme et tranquille ;
Vos voisins sont armés,
Ils veillent sur la ville.
Bons citoyens, dormez !
On entend tout à coup les cris et les clameurs des masques dans les rues voisines ; la patrouille s'arrête indécise, inquiète ; elle se consulte de l'œil; alors Simon Glover, le chef :
Rentrons chez nous pour ne pas nous commettre
Avec des malfaiteurs ; ce serait compromettre
Notre valeur et notre dignité.
Et la patrouille s'éloigne dans la direction opposée à celle où le tumulte s'est produit... Clameurs nouvelles, cris nouveaux... la patrouille fuit en désordre, tandis que Glover, qui est en tête, ne s'apercevant pas de la défection de ses hommes, continue en tremblant de tous ses membres :
Vos voisins sont armés, etc.
Soudain il se retourne et se voit seul... il prend ses jambes à son cou et fuit à son tour. L'orchestre achève en sourdine la Ronde nocturne.
Bizet a inauguré ici une forme musicale qui lui a été familière depuis et de laquelle il a tiré de bien grands effets. Elle consiste en ceci : prendre une idée, et, sans la développer, en tirer tout le parti possible, la présentant sous ses différents aspects, variant les harmonies, les formes de ses basses et des parties intermédiaires, lui faisant parcourir la gamme des couleurs éclatantes et sombres, tristes et joyeuses. La première partie du prélude de l'Arlésienne est restée un admirable chef-d'œuvre en ce genre. Ici, dans cette introduction d'acte, le Maître, conservant à sa phrase ses harmonies naturelles, celles qui ressortent de sa contexture mélodique, s'est borné à varier ses dessins d'orchestre et ses procédés ; il leur a fait suivre une gradation ascendante qui amène un crescendo d'effet très heureux. Le motif est d'abord exposé par les basses, sous des tenues de cor ; les bois le reprennent, pianissimo, sur un contrepoint continu des violoncelles et des altos ; puis, avec un léger crescendo, les basses reprennent le motif qu'elles ont initialement exposé. Cette fois l'effet change encore ; la flûte soupire, à son tour, un doux contrepoint, tandis que les violons répliquent à chacun des temps forts par un dessin persistant de trois notes qui accentue le rythme et prépare l'explosion qui se produit à la reprise du motif, attaqué, cette fois, par tout l'orchestre et accompagné par le trait en contrepoint des altos et des violoncelles, que l'on a déjà entendu, doublé ici par toutes les basses, les contrebasses, les bassons et les trombones. J'ai donné une description aussi complète que possible de ce petit tableau musical, car c'est la première fois, je le répète, que nous trouvons chez Bizet la trace d'une préoccupation de ce genre. Dans ses œuvres suivantes, il est revenu quelquefois à cette forme qui l'a toujours beaucoup séduit, car il pouvait à l'aise y déployer toute sa dextérité, sa virtuosité de Maître musicien incomparable, et son originalité toujours si piquante. Il a, par la suite, varié ses effets, varié ses procédés harmoniques, ses dessins d'orchestre, donné à son tableau des tons plus chatoyants, des contours plus imprévus, il a souvent ménagé à ses auditeurs des surprises harmoniques incroyables d'audace, mais la forme, c'est-à-dire le procédé qui a présidé au plan général de l'œuvre, est restée la même ou à peu près.
La Ronde de nuit, qui s'enchaîne directement avec ce petit prélude instrumental, ou plutôt qui fait corps avec lui, — car la première phrase que chante le chœur des bourgeois-veilleurs de nuit n'est, pour ainsi dire, que le développement du motif du prélude, — est d'une allure héroïco-bouffonne des mieux réussies. L'accent est juste, vrai ; en entendant chanter ces paisibles citadins transformés en guerriers, on pressent le drame burlesque de la débandade qui va se produire. Toute cette scène est d'une bonhomie, d'une simplicité, d'un naturel charmant...
Voici maintenant la grande scène du Carnaval. A peine la patrouille bourgeoise s'est-elle enfuie que les masques envahissent la place ; à la lueur des torches, ils forment un cortège burlesque au duc de Rothsay, richement travesti, juché sur un char enrubanné. Au premier aspect cette scène de folie joyeuse paraît un peu terne, un peu mélancolique ; ce n'est pas la franche gaieté, la gaieté exubérante, débordante, qui conviendrait, semble-t-il. Un instant de réflexion et nous jugerons plus sainement. Où sommes-nous ?... à Rome ? à Naples ?... Non, à Perth ; dans le pays du spleen et de la noire mélancolie ; sous le ciel brumeux de l'Écosse ; dans une ville maussade, aux rues étroites et sombres, bordées de maisons à l'aspect triste et sévère malgré leur accent pittoresque ; au milieu d'un peuple qui boit du gin et s'enivre lourdement. On pourrait juger le tempérament d'un peuple rien qu'à sa manière de boire et de s'enivrer. Ici, rien de l'ivresse gaie et joyeuse, loquace et souvent spirituellement gouailleuse des peuples enfants du Soleil ; aussi, pas de gaieté, ou plutôt une gaieté morne, toujours légèrement mélancolique. A Rome, à Naples, à Florence, le Carnaval délirant, hurle joyeusement, frénétiquement, dans les rues, sans frein, sans retenue ; la joie débordante s'épand sous les caresses du soleil ; ici, la gaieté, elle-même, a le spleen.
Bizet a été exact et sincère. Tout autre, peut-être, eût succombé à la séduisante tentation de traduire musicalement un joyeux carnaval Italien, joyeux sans mesure et sans retenue. Bizet les connaissait bien ces gaies Saturnales pour s'y être mêlé, pendant son séjour à Rome, comme s'y mêlent toujours nos jeunes artistes de l'Académie (*). Entraîné par sa nature expansive, éprise de lumière et de mouvement, et par l'incontestable originalité du spectacle, nouveau pour lui, il avait dû, au seuil de ses vingt ans, jouer sa partie dans la Bacchanale universelle. Il sut résister à la tentation de traduire ses propres sensations ; l'amour de la vérité l'emporta. Voilà pourquoi, ayant non des Romains, mais des Ecossais en délire carnavalesque, il a su donner à ce délire un vague parfum spleenétique qui en atténue les exubérances et en calme les ardeurs. Le tableau perd un peu de son côté brillant, pour gagner en pittoresque et en vérité.
(*) Il écrivait de Rome, à sa mère, le 26 février 1858 : « Tu ne t'es pas trompée, je me suis beaucoup amusé au Carnaval. J'ai été en voiture avec quelques camarades, et là nous avons jeté des bouquets et des confetti à pleines mains. Rien n'est plus charmant que le Carnaval de Rome. » Lettres de Georges Bizet (Calmann-Lévy, éditeurs).
Le Chœur : « Carnaval ! Carnaval ! » ouvre la scène ; d'une allure franche et résolue, il sert de frontispice à ce large tableau musical... Le duc de Rothsay prend la parole. Peut-être trouverez-vous que ce noble duc joue un rôle bien singulier, d'autant plus qu'il s'appelle, lui-même, et sans façon : « grand duc des sauteurs, roi de la cabriole ». Mais, voilà ; il fallait, à la faveur du cortège carnavalesque, faire rencontrer Mab la bohémienne et le duc de Rothsay, afin de préparer et d'expliquer le quiproquo qui se produit au troisième acte, de nouer l'action ; les librettistes n'ont pas hésité. Ils ont encanaillé leur duc, au risque de lui enlever le peu de sympathie dont il peut encore jouir. N'eût-il pas mieux valu faire de la scène du Carnaval un hors-d'œuvre sans attaches directes avec l'action, tout en lui conservant son importance, et du duc de Rothsay, un comparse, dissimulé dans la foule des masques, inconnu de tous, venant, a la faveur de son déguisement, trouver la jeune Bohémienne, lui confier ses projets et la prier d'en aider la réalisation ?...
Les Couplets bachiques : « Tout boit, amis, dans ce monde », que chante le duc, pendant que les masques se passent de l'un a l'autre une coupe colossale et essayent à tour de rôle de la vider, car le vainqueur de ce tournoi d'un nouveau genre doit être sur-le-champ proclamé « chevalier du plaisir et de la folie », les Couplets bachiques, dis-je, ne manquent ni de rondeur ni de brio, de même que la courte scène qui les suit : l'arrivée des Bohémiens et de Mab, « la piquante reine aux regards vainqueurs ». Mais voici le chef-d'œuvre : la Danse Bohémienne. Le soir de la première, l'effet fut irrésistible ; la salle entière se leva et, d'une acclamation unanime, redemanda le morceau. On a comparé cette merveille au célèbre chœur des Derviches tourneurs, des Ruines d'Athènes de Beethoven ; même allure progressive, même fièvre désordonnée ; mais, l'avouerai-je, je trouve la Danse Bohémienne de notre jeune Maître Français plus saisissante, plus troublante ! Cela tient-il à la nature même de la mélodie et à son cachet oriental, si gracieusement lascif, ou au tourbillonnement du rythme, obtenu, non seulement par une accélération de mouvement, mais encore, — et c'est ce qui lui donne cette allure fiévreuse qui saisit, — par la déformation rythmique du motif, qui, exposé d'abord à quatre-temps, dans un mouvement lent, s'accentue peu à peu, passe de la tonalité de si mineur, dans laquelle il a été d'abord exposé, en si majeur, tandis que le mouvement s'accélère sans cesse, puis reparaît, transformé à neuf huit, d'abord, à six huit ensuite, pour arriver, par une incessante progression de lumière et de mouvement, à la vertigineuse explosion de la fin où la folie du rythme devient du délire ?
Pendant que les danses se déroulent, lascives et troublantes, les chants ont cessé ; cependant, quand le rythme enfiévré a emporté le mouvement, les Bohémiennes, grisées, enivrées par le tourbillon, finissent par mêler leur voix à la voix délirante des instruments ; sur une même note, les chœurs poussent des exclamations étranges, pleines de langueur, dont la sonorité, douce et vague, toujours uniforme, venant se mêler à l'orgie instrumentale, produit un effet d'une saveur exquise, et donne à ce tableau de grand Maître un haut relief, une chaleur de coloris, et une puissance d'effet vraiment incroyable...
C'est ce moment, où les masques sont à la joie et regardent de tous leurs yeux les danses échevelées des filles de Bohême, que choisit le duc pour entretenir Mab des projets qu'il médite et pour lui demander son concours : Il donne, dans la nuit, une fête en son palais ; il voulait y attirer Catherine, mais Catherine a refusé de s'y rendre ; il s'agit donc, maintenant, d'obtenir par la force ce que la persuasion n'a pu faire et d'enlever la jolie fille. « Eh bien donc », ajoute Rothsay,
Eh bien ! donc, tâche que ce soir
Catherine, en domino noir,
Un masque sur les traits, vienne sur cette place.
En secret, à minuit, ma litière y sera...
Et jusqu'à mon palais bientôt la conduira...
Et Mab, qui naguère encore était courtisée par le duc, dépitée de se voir préférer une rivale, honteuse de l'étrange commission dont on la charge, consent à ce qu'on lui demande, tout en se promettant bien de se venger.
Les couplets qu'elle chante : « Les seigneurs de la Cour, etc. », sont charmants ; le trait des violons qui les encadre est plein de caresses. La scène se termine par la reprise du chœur initial. « Carnaval ! Carnaval ! » ; le duc remonte sur son char, auquel les masques s'attellent, et la bruyante et joyeuse cohorte disparaît, allant porter ailleurs sa folle gaieté...
Pendant les ébats du cortège carnavalesque, l'heure a marché ; minuit va sonner à l'horloge ; Smith, malheureux, désespéré, rôde depuis quelques instants sur la place. Dès qu'il a vu les derniers masques s'éloigner, il s'approche de la maison de Catherine. Il est triste ; la joie et la gaieté des autres le font souffrir encore davantage. Depuis l'instant fatal où Catherine l'a accusé de trahison, il n'a pu trouver un instant de repos. Il vient, comme à l'ordinaire, sous la fenêtre de la jeune fille ; mais daignera-t-elle entendre et répondre à sa voix. La Sérénade :
A la voix
D'un amant fidèle,
Ah ! réponds, ma belle,
Ainsi qu'autrefois !
est d'une poésie et d'une suavité de sentiment exquise. La fenêtre de Catherine s'éclaire soudain ; Henri croit à son pardon... la fenêtre va s'ouvrir !... Hélas ! l'ombre de Catherine passe et repasse derrière les rideaux croisés... et la fenêtre ne s'ouvre pas. Alors Smith, désespéré, confie aux échos de la nuit l'ardeur de son amour et les souffrances de son cœur. Les librettistes avaient écrit un second couplet à la Sérénade, sur ces paroles :
Je t'attends
Et vers toi d'avance
Mon cœur qui s'élance,
Compte les instants ! etc.
Ce second couplet devait, dans leur pensée, être la reproduction musicale du premier. Bizet avait un sentiment trop vif des choses du théâtre pour tomber dans une aussi grossière erreur. Il a pensé que l'amant, que l'injuste rigueur de son amante désespère, ne devait pas s'exprimer comme l'amant qui espère trouver l'oubli et le pardon d'un crime imaginaire. Au début, Smith chante l'air qu'il a coutume de dire sous la fenêtre de sa bien-aimée, mais, quand il a vu que la fenêtre restait close, quand il a aperçu l'ombre de la jolie fille passer et repasser froide et insensible derrière ses rideaux, quand il a désespéré de son pardon, la phrase musicale a changé de rythme et s'est élargie, a pris un cachet personnel, douloureux : ce n'est plus l'amant qui chante, c'est l'amant qui pleure et qui gémit...
Minuit vient de sonner à l'horloge. Smith jette un dernier regard désolé sur la fenêtre de Catherine, mais, voyant que rien ne bouge, que la lumière s'est éteinte :
Allons! de mon logis reprenons le chemin,
Je serai plus heureux demain !
Et il s'éloigne... Il fait quelques pas dans l'obscurité ; se trouve en présence d'un homme qu'il n'a pas vu :
Qui va là ?... C'est vous, maître...
C'est un ouvrier qui va fêter le carnaval au cabaret. S'apercevant de la douleur de Smith, douleur dont il devine aisément la cause, le forgeron veut le distraire et l'emmène avec lui : « Entrons gaiement à la taverne », lui dit-il ; Henri résiste : « Moi ?... non ! » Allons, répond le brave ouvrier en montrant la maison de Glover, allons, venez, « vous serez là près d'elle ». Et il l'entraîne. Ici commence la grande scène d'ivresse, une des pages les plus douloureusement dramatiques que nous connaissions. On ne peut nier, cependant, qu'elle ne doive son sentiment si profond à une inspiration étrangère, malgré la nouveauté de la forme et l'originalité de la pensée. Je l'ai dit, l'influence de Verdi n'était pas complètement morte ; de vieux levains d'idolâtrie fermentaient encore au fond du cœur de notre jeune artiste. C'est sous l'influence évidente du style dramatique du Maître italien que cette page admirable a été écrite ; mais qu'importe ? En attendant cette sombre mélodie si douloureuse, ces sanglots déchirants, qui de vous n'a été ému, de cette émotion profonde qui vous prend aux entrailles et vous secoue ? avez-vous, alors, songé à l'influence plus ou moins caractérisée qui a guidé l'inspiration du musicien ? Pour moi, sur ce point, je pense comme Reyer, « Il y a, dit-on, dans Rigoletto une situation identique ; je n'y ai pas songé en écoutant la belle et bonne musique de M Bizet qui m'a paru, au contraire, présentée sous une forme toute nouvelle... »
Ralph est ivre, il a noyé ses chagrins. Le malheureux aime Catherine, lui aussi, mais la jolie fille ne daigne pas s'apercevoir de son amour ; alors, morne, triste, désespéré, il boit. Lutz, l'excellente basse du Théâtre-Lyrique, se révéla artiste de premier ordre, dans cette scène ; il la chanta en grand chanteur, mais la joua, surtout, d'une si poignante façon, que son succès tint du délire et qu'il fut sacré par cette unique création. Mais aussi, sans chercher à atténuer le mérite de l'interprète, quelle puissance porte en elle cette musique admirable ! quel tableau saisissant !
La mélodie s'étale lentement, morne, fatale d'abord; le malheureux a conscience de son état... Soudain les sanglots éclatent, la mélodie prend un accent déchirant ; bientôt les éclats de rire sinistres, les tra la la qui s'efforcent d'être joyeux, de bannir la tristesse qui envahit la raison à demi noyée de l'ivrogne, résonnent lugubrement. Alors, désespéré, il s'avance vers la porte de la taverne et, dans un cri déchirant semblable à un sanglot : « Eh ! l'hôtesse, l'hôtesse... Mon flacon ! Que j'y laisse ma raison ! » Accablé, il se laisse tomber sur le banc de bois qui est sous la fenêtre de la taverne.
En ce moment, le majordome du duc de Rothsay apparaît sur la place, précédant une litière portée par deux valets et escortée de deux autres valets armés de torches ; il s'approche de l'ivrogne endormi et lui frappant amicalement sur l'épaule :
Hé ! camarade !... à pareille heure
Au lieu de dormir en plein air,
Indiquez-nous donc la demeure
De miss Catherine Glover.
Ralph se soulève et écoute sans comprendre. Une femme masquée traverse la place ; le majordome va vers elle : « Miss Catherine Glover ? ... Ah, venez, je vous cherchais... », et il ouvre la porte de la litière. La femme entre rapidement, la portière se referme, et la litière et son cortège s'éloignent dans la direction du palais.
Ralph, immobile de surprise, a suivi cette scène rapide ; il se lève en chancelant :
Je rêve... ou n'ai plus ma raison...
Catherine quittant en secret sa maison...
Et, subitement dégrisé, il appelle, il crie : « Simon... Smith... Smith... à moi !... »
Henri sort de la taverne, étonné : « Ah, viens vite », et en quelques mots rapides l'ivrogne lui raconte ce qu'il a vu. « Vois-tu là-bas cette lumière ?... » Henri, fou de douleur, se précipite, sans attendre Ralph, qui, secouant les fumées de l'ivresse, essaye de retrouver son équilibre et se dispose à le suivre.
Mais tout à coup la voix de Catherine se fait entendre :
A la voix
D'un amant fidèle,
Ah ! réponds, ma belle,
Ainsi qu'autrefois !
Ralph s'arrête stupéfait ; il regarde du côté de la maison de Simon Glover ; la fenêtre de Catherine vient de s'ouvrir et la jolie fille, à sa fenêtre, fredonne le refrain de la Sérénade que chantait naguère Smith désespéré...
Chez le duc de Rothsay la fête est dans son plein ; le souper vient de finir, les invités se livrent aux plaisirs du jeu. Tout ce début d'acte est plein de gaîté brillante et sonore. Les danses commencent ; un orchestre invisible accompagne les danseurs, dans les salons voisins. Bizet a trouvé de fort jolis accouplements de timbres pour ce minuscule orchestre de danse ; ici, ce sont la flûte et des violons, soutenus par des accords de harpe, d'un effet délicieux ; plus loin, nous trouverons d'autres accouplements aussi ingénieux et aussi suaves. En scène, les joueurs devisent gaiement. La cavatine : « Elle sortait de sa demeure... » dans laquelle le duc raconte à ses amis sa nouvelle conquête, est d'une fatuité charmante, avec sa ligne aux ondulations caressantes et ses points d'orgue précieux... En ce moment une femme masquée paraît ; elle est accompagnée de deux valets porteurs de torches, qui la conduisent respectueusement jusqu'à l'entrée du salon. A sa vue, le duc s'empresse vers elle :
Soyez, ici, comme une reine
Au milieu de tous vos sujets ;
Mais pourquoi nous voiler les traits
De votre beauté souveraine ?
— Pour vous seul, Monseigneur, je me démasquerai.
Alors le duc, se tournant vers ses invités : « Vous l'entendez, Messieurs... »
Et les seigneurs se retirent dans les salons voisins, tandis que les valets, sur un signe du maître, emportent toutes les lumières. Une seule bougie éclaire le boudoir.
Mab, on l'a deviné, a pris la place de Catherine, pour se venger du duc volage qui l'a délaissée. Celui-ci, croyant réellement avoir devant lui la fille de Simon, se montre tendre, galant, empressé ; il la rassure et essaye de lui faire croire à son amour ; mais la rusée Bohémienne sait à quoi s'en tenir... Devenant de plus en plus pressant, il veut lui faire ôter son masque :
Catherine, accorde à ma flamme
De contempler tes yeux, ton visage enchanteur.
Tu me l'as dit : Pour vous seul Monseigneur
Je me démasquerai...
Mab, alors, s'échappe des bras du duc, court à la bougie qu'elle souffle, et, ôtant son masque :
Et je tiens ma parole... En découvrant mes traits.
Ce duo très scénique, très mouvementé, est une vraie perle. Il se déroule et évolue, tantôt tendre, caressant, tantôt vif, pressant, animé, sur les sons lointains de l'orchestre invisible qui guide les ébats des danseurs. C'est d'abord une phrase d'une préciosité exquise, dite à l'unisson par la flûte, la clarinette et le hautbois, et enveloppée de doux arpèges de harpe. C'est tendre, presque langoureux, avec des inflexions caressantes et surannées de pastiche rococo. Au milieu, le motif prend l'allure solennelle d'un menuet ; mais il se fond, bientôt, et revient à la phrase tendrement vieillotte du début. Et pendant ce temps le duc toujours amoureux, Mab toujours coquette, échangent leurs propos galants...
Cependant, craignant d'être surprise par le jour, qui commence à poindre, et reconnue, la Bohémienne vient de s'esquiver par une porte latérale ; le duc, malgré l'obscurité, s'est aperçu de sa fuite ; il court après elle. En ce moment, paraît Smith qui a suivi la litière et qui, enfin, a pu pénétrer jusque chez le duc ; il est pâle, défait, ses vêtements sont en désordre. Or, admirez ici l'ingéniosité des librettistes. Voilà un homme fou de douleur, un amant éperdu, désespéré, qui, après avoir suivi dans l'ombre, sans avoir pu l'atteindre, la litière emportant sa fiancée, après avoir franchi, au prix de mille peines, les obstacles qui s'opposaient à son entrée, est parvenu, frémissant d'indignation, dans le boudoir du duc où il a cru trouver l'infidèle. Que pensez-vous que fait cet homme ?... Vous pensez que, trouvant le boudoir vide, il va se précipiter dans les salons voisins, criant, appelant la traîtresse, voulant la convaincre de son infamie, lui jeter à la face son mépris ? Eh bien, non ! Le malheureux qui vient d'entrer refoule subitement sa douleur et chante un air. Il pose d'abord son récitatif :
C'est donc ici, sans honte et sans pudeur,
Que l'infidèle vient chercher le déshonneur.
Et après une ritournelle habilement ménagée, il commence :
O cruelle !...
Infidèle...
Quoi ! ton cœur
Sans honneur
S'abandonne...
et cela continue ainsi longtemps, longtemps ! Il ne manque, vraiment, au brave armurier si platoniquement désespéré, qu'une guitare, un sombrero et un manteau couleur de muraille pour donner l'impression ridicule d'un hidalgo mélancolique pleurant sous le balcon de son infidèle.
C'est cette convention absurde, — qui avait fini par faire de l'opéra, de l'opéra-comique, voire même du drame lyrique, un véritable canevas scénique où la vérité recevait de continuels crocs-en-jambe, sous l'unique prétexte de fournir matière à de nombreuses cavatines, à d'interminables airs à roulades, — que nous avons flétrie du nom de « vieux jeu ». Nous pensons, aujourd'hui, qu'il est ridicule de greffer ainsi cette convention inutile, absurde, sur cette autre convention nécessaire sur laquelle reposent le drame et la comédie musicale. Qu'il soit chanté ou non, le drame doit marcher au dénouement par des moyens naturels et vrais, et s'abstenir de ces arrêts incessants qui entravent l'action et lui enlèvent toute vraisemblance...
Le dénouement de ce troisième acte, qui est en quelque sorte le nœud de l'action, est beaucoup plus heureux scéniquement ; musicalement, il est d'une puissance et d'une vigueur peu communes. Simon Glover est venu au palais, dès l'aube, à l'audience que lui a accordée le duc. Il a amené sa fille Catherine qui, ne se doutant de rien, naturellement, a repris sa gaieté charmante de la veille, a pardonné à Henri et a reconnu ses torts. Tous deux viennent inviter Rothsay au mariage qui se prépare : Monseigneur, dit Glover,
...Pardonnez, de votre Seigneurie
Et de tous ses aïeux, j'ai fourni la maison.
Je viens donc près de vous, et comme à mon patron,
Vous annoncer que ma fille chérie
Pour son Valentin a choisi
Henri Smith, l'armurier, qu'elle prend pour mari.
Le duc est confondu de tant d'audace. Smith, confus, désespéré, se précipite du coin obscur où il se tenait caché depuis quelques instants, et jette, à la face de Simon et de sa fille stupéfaits, la douloureuse expression de ses reproches. Catherine proteste énergiquement de son innocence... Henri vaincu va pardonner, mais il vient d'apercevoir, dans les mains du duc, la fleur en or émaillé avait, la veille, donnée à sa fiancée comme cadeau de la Saint-Valentin, fleur que, dans son dépit contre Smith, la jolie fille a jetée, que Mab a ramassée et que le duc vient de lui ravir. Alors, sa douleur ne connaît plus de bornes, il repousse l'infidèle et l'accable de son mépris.
Dans ce finale se trouve un ensemble, le premier à l'arrivée de Simon et de Catherine : « Ce beau coureur d'aventure, etc... » où Bizet a encore subi la contagion de la roucoulade et du trait vocal dont rien ne justifie la présence ; c'est la seule tache de ce large tableau si vigoureusement touché, dont l'ensemble final a une ampleur, un souffle des plus puissants...
Nous voici au milieu d'un site sauvage. Après le coup terrible qui l'a frappé, Smith a quitté la ville et s'est refugié dans la montagne. Ses amis viennent à lui, pour le calmer, l'apaiser et proclamer hautement l'innocence de la fille de Simon Glover, de l'honneur de laquelle ils se portent garants ; mais Smith les repousse et ne veut rien entendre. En vain ils insistent et jurent sur leur honneur que Catherine a passé la nuit dans sa maison,
Lorsque dans ma douleur, je n'ai pu me venger,
C'est vous qui venez m'outrager,
Vous qui venez pour femme offrir à ma tendresse...
Du duc de Rothsay la maîtresse !
s'écrie Smith indigné.
Alors Ralph avec énergie : « Henri Smith, vous mentez ! » Smith furieux va s'élancer sur son ancien camarade, mais tous les artisans, étendant la main, répètent, comme lui « Henri Smith, vous mentez ! »
Je mens !... par Saint Dunstan!... Ah ! je mens... écoutez !
Vous dites qu'elle est pure ! et moi je la proclame
Coupable, indigne, infâme !
Eh bien... au jugement de Dieu je fais appel.
Et Ralph s'avance alors et accepte de défi ; il prouvera l'innocence de la fille de Simon Glover ; le combat aura lieu, dans quelque instant, sur les bords de la Tweed. Cette scène, connue sous le nom de Scène du jugement de Dieu, est une des plus belles de la partition ; vivante, mouvementée, admirablement écrite pour les voix, elle contient des passages d'une vérité puissante et saisissante : le chœur du début :
Smith, tu nous connais tous, artisans comme toi...
la belle réplique de Ralph : « Henri Smith, vous mentez ! » reprise par le chœur, enfin le finale sonore et pathétique :
Moi Ralph, simple artisan,
Seul, sans autre assistance
Que mon bon droit et que Saint Jean,
Du jugement de Dieu j'accepte la sentence...
Le beau duo qui suit cette scène magistrale est aussi une page maîtresse. Catherine est venue auprès de celui qu'elle aime et qu'elle a voulu voir, une dernière fois, avant de mourir. Quels accents poignants ne trouve-t-elle pas pour toucher ce cœur qui ne battait que pour elle et qui vient de se fermer, croyant à son infamie !
La phrase en mi bémol mineur : « A peine au printemps de la vie », dite par Catherine, d'abord, puis par Henri, est une merveille d'inspiration douloureuse et résignée ; c'est d'une émotion sincère et profondément sentie, de même que le bel ensemble : « Beaux rêves d'or », qui s'enchaîne directement avec elle et forme la conclusion de cette page émouvante. Henri ne croit plus à la vertu de Catherine, mais il l'aime encore et a juré de mourir, pour que les décrets du Jugement de Dieu la proclament innocente. Le clairon vient de résonner, annonçant le combat ; il s'arrache des bras de l'infortunée et va à la mort...
La grande place de Perth est en fête ; le soleil vient de se lever. C'est le matin de la Saint-Valentin ; des groupes joyeux parcourent les rues. Les jeunes garçons en costume de dimanche, des flots de rubans à la boutonnière, des bouquets à la main, viennent se placer devant les fenêtres de celles qu'ils ont choisies pour Valentines :
Aux premiers rayons du matin
Paraissez, belle Valentine,
C'est à vous que mon cœur destine
Le baiser de Saint Valentin.
Et les fenêtres de se garnir de têtes rieuses qui envoient aux jeunes garçons leurs plus doux sourires :
Aux premiers rayons du matin
Je vais être la Valentine
De l'amant auquel je destine
Le baiser de Saint Valentin.
Toute cette scène est d'une fraîcheur, d'une jeunesse rayonnante, d'une poésie suave, dont il est facile de rendre compte, même à la lecture de la partition, car tout le charme réside ici dans les caresses juvéniles de la phrase mélodique qui jaillit, d'un seul trait, coquette, pimpante, avec ses inflexions charmeresses. Ce chœur de la Saint-Valentin a toujours obtenu un très grand succès ; longtemps il a été chanté dans les concerts, dans les salons ; il est resté l'une des pages les plus colorées, — la plus alerte, la plus spirituellement charmante de cette belle partition, — et l'une des plus fraîches inspirations du Maître.
Catherine est devenue folle. Cette circonstance imprévue nous amène une scène de folie, naturellement. Messieurs les librettistes se seraient bien gardés, en gens avisés qu'ils étaient, de laisser échapper une aussi belle occasion d'exhiber une fois encore les vieux poncifs usés ; et cette scène de folie amène, à son tour, non moins naturellement, un air à roulades : « Écho, viens dans l'air embaumé... etc. », que nous n'aimons pas plus que les précédents, bien qu'il ait au moins l'avantage d'être en situation... Mais Mab la Bohémienne, qui a perdu Catherine, s'est juré de réparer le mal qu'elle a fait, inconsciemment ; elle a tout dit au duc qui s'est hâté d'aller arrêter le combat mortel que les deux adversaires se livraient sur les bords de la Tweed, d'arracher Smith à la mort et de lui apprendre la vérité. C'est à l'aide d'un substitution ingénieuse que la pauvre fille va recouvrer la raison un instant égarée : « Pour la perdre j'ai pris sa place, a dit Mab, je la prendrai pour la sauver. » Et en effet, tandis que Catherine, à travers sa folie, ne voit qu'une chose, son amour brisé, et que, douloureusement, elle murmure :
Le jour de la Saint-Valentin
Henri Smith est mort !... Catherine
Ne sera jamais Valentine !
une voix s'élève tout à coup derrière elle, soupirant la délicieuse Sérénade qu'Henri avait l'habitude de chanter sous ses fenêtres :
A la voix
D'un amant fidèle,
Ah ! réponds, ma belle,
Ainsi qu'autrefois.
Catherine tressaille ; elle a reconnu la voix... c'est la voix d'Henri ; elle se retourne et elle aperçoit, en effet, Smith, qui, vêtu de ses beaux habits du dimanche, un flot de rubans à la boutonnière, un gros bouquet à la main, s'avance vers sa maison, les yeux fixés sur la fenêtre de sa chambre, en chantant la sérénade qu'elle aimait. Elle le regarde et cependant ne peut en croire ses yeux :
Mais qui donc avait dit qu'Henri Smith était mort ?
C'est lui que je vois sur la place,
Catherine l'attend... tous deux ils sont d'accord.
Devant sa fenêtre il se place.
Et en effet, Henri, arrivé devant la demeure de Simon Glover, s'est arrêté, et, tandis que la fenêtre s'ouvre, il chante le joli motif de Saint-Valentin :
Aux premiers rayons du matin
Paraissez ! chère Catherine,
C'est à vous que mon cœur destine
Le baiser de Saint Valentin.
Mab, vêtue d'une belle robe appartenant à Catherine, est apparue, souriante, à la fenêtre ; Catherine, en proie à une violente émotion, suit avec anxiété la scène qui se passe sous ses yeux ; Henri, continuant, et s'adressant à la fausse Catherine :
Voulez-vous accepter ces fleurs
Et m'en donner la douce récompense ?
Un baiser ?... un baiser, il m'est promis d'avance
Et pour la vie il doit réunir nos deux cœurs.
Alors, la pauvre fille, au comble de l'émotion, se précipite vers Smith, en criant :
Ne crois pas cette femme... elle surprend ta foi.
Ta Catherine, Henri... c'est moi !
et elle tombe, délirante, dans ses bras. Et, tandis que Simon et ses amis qui, de loin, suivaient la scène, se précipitent vers elle, des rues voisines débouchent des couples joyeux redisant aux échos la joli chœur de la Saint-Valentin :
Bonjour, ma belle Valentine.
— Bonjour, fidèle Valentin.
C'est sur ce tableau, où tout est admirablement mis en valeur, avec une grande habileté, avec un art et une prescience des effets scéniques des plus rares, que finit la Jolie fille de Perth.
La partition, je me suis efforcé de le démontrer au courant de l'étude un peu rapide que je viens d'en faire, renferme des pages de premier ordre, parmi lesquelles il faut citer, en première ligne, le second acte, qui est une véritable merveille de vie, d'expression scénique, de couleur et de mouvement ; elle est, de plus, admirablement pondérée, bien équilibrée et d'une belle venue mélodique. C'est une œuvre très remarquable, pas encore un chef-d'œuvre. Le jeune musicien, si sûr de son art, si complètement maître de son instrument, auquel il sait faire rendre, en virtuose incomparable, les sons les plus délicatement subtils, n'a pas encore atteint sa pleine maturité artistique ; il n'est pas encore arrivé à l'épanouissement complet de sa nature originale, primesautière, qui marquera d'une touche si personnelle chacune de ses productions postérieures. S'il n'a plus les exagérations voulues, les généreuses exubérances des Pêcheurs de perles, cette première œuvre si discutée, il n'a pas encore cette sûreté de goût, cette profonde originalité de pensée et de forme qui font de Djamileh, de l'Arlésienne et de Carmen des chefs-d'œuvre d'une saveur artistique si intense. Ici, des influences esthétiques étrangères se font sentir, par instant, légèrement la plupart du temps, mais assez, cependant, pour enlever à certaines pages le charme si réel que dégage tout ce qui ne procède que du Maître lui-même.
Bizet, qui, ainsi qu'on l'a vu, s'était plusieurs fois déclaré fort satisfait de son œuvre, se montra très touché du grand succès qu'elle obtint, d'abord.
« Je n'espérais pas un accueil aussi enthousiaste et à la fois aussi sévère, écrivait-il quelques jours après la première représentation (*). On m'a tenu la dragée haute, on m'a pris au sérieux et j'ai eu la vive joie d'émouvoir et d'empoigner une salle qui n'était pas positivement bienveillante. J'avais fait un coup d'État ; j'avais défendu au chef de claque d'applaudir. Je sais donc à quoi m'en tenir. La presse est excellente !... »
(*) Lettre du 1er janvier 1868 à M. Edmond Galabert.
Excellente, en effet !
Si j'ai conservé aux jugements portés sur la première œuvre de Bizet un caractère anonyme, si, tout en citant les principaux d'entre eux, j'ai évité de désigner les Aristarques qui les ont rendus, c'est que ces jugements sont si faux, si injustes, parfois même ont une telle apparence de malveillance et de mauvaise foi, qu'il me répugnait de signaler les coupables : « Peut-être, après tout, me suis-je dit, peut-être se sont-ils réellement trompés ! »
Pour la Jolie fille de Perth il en est bien autrement ; c'est avec joie que je constate l'unanimité de l'éloge. La Jolie fille de Perth, dit le Ménestrel, est le vrai type du drame lyrique qui procède à la fois de l'opéra-comique et de l'Opéra ; la partition est bien coupée, bien chantante, bien nette et sans confusion... « Le second acte est un chef-d'œuvre d'un bout à l'autre, et il ne sera pas de musicien qui ne fasse le pèlerinage de la place du Châtelet rien que pour l'entendre. (*) » Et plus loin, après avoir détaillé la partition, il conclut : « Tel est cet opéra remarquable qui est le précurseur de partitions plus complètes encore, aujourd'hui que M. Bizet est en pleine possession de son talent et peut marcher, d'un pas plus ferme, sur cette scène déjà deux fois affrontée. Le deuxième acte, à lui seul, constitue une œuvre ; il affirme une individualité qui n'a aucun besoin de se rattacher à celle d'autrui. »
(*) Le Ménestrel, 29 décembre 1867.
Le Figaro (*), par la plume d'Edmond Tarbé, déclare l'œuvre nouvelle « d'une facture des plus savantes » ; il constate « une entente réelle de l'optique du théâtre et une grande habileté »; mais l'œuvre, dit-il, « manque d'originalité dans la pensée ». Il est vrai que, pour atténuer ce que son jugement peut avoir d'excessif, même à ses propres yeux, il s'empresse d'ajouter : « M. Bizet est un musicien habile, on fonde sur lui de sérieuses espérances, et c'est un de ces hommes qui ont droit à une critique sévère ; les ménagements que l'on conserve avec les musiciens médiocres ne sont pas de mise avec lui. Bien que son bagage dramatique ne renferme, outre la Jolie fille, que les Pêcheurs de perles, la réputation de M. Bizet est assise ; la critique doit compter avec ses ouvrages, c'est‑à-dire lui prouver son estime par son exigence. » Plus loin, ayant à parler de l'orchestration de la Jolie fille, le critique du Figaro ajoute : « L'orchestration est d'une finesse et d'un détail qui témoignent un soin de chaque mesure. » Il serait trop long de poursuivre les citations ; je ne puis cependant négliger les importants articles d'Ernest Reyer aux Débats et de Johannès Weber au Temps. Ils se rattachent à un ordre d'idées trop intéressant pour que nous les passions sous silence.
(*) Le Figaro, 28 décembre 1867.
Il s'agit des concessions, faites à la mode et au goût du public, que nous avons signalées au cours de l'étude de la partition. Reyer, qui connaissait et aimait son jeune confrère, qui estimait profondément l'artiste et admirait le musicien, se montra plein d'une douce indulgence : « Quand la science musicale, dit-il, n'a plus eu de secrets pour lui, il a demandé à l'étude des grands Maîtres cette nourriture forte et vivifiante sans laquelle les intelligences, même les plus supérieures, finissent par s'étioler et s'éteindre. Et comme M. Bizet a su comprendre qu'il existe aujourd'hui des Maîtres qui, malgré les violentes critiques dont ils sont l'objet, ne font que continuer l'œuvre de ceux qui les ont précédés, il n'a pas assigné une date rétrospective au but de ses études et de ses admirations. Aussi suis-je bien éloigné de faire à l'auteur de la Jolie fille de Perth un reproche de son éclectisme ; il est à un âge où les hésitations sont permises, et si sa position ne l'autorise pas encore à être extrêmement sobre de toutes concessions faites au goût du public et à la virtuosité de certains artistes, ce ne sont là, à mes yeux, que des défauts de jeunesse dont le temps le corrigera et dont lui-même, si on lui demandait sa profession de foi sur l'art musical, serait le premier à s'accuser. » Comme on le voit, le critique des Débats n'attacha pas à ces légères hésitations, à ces diverses influences, dont on sent l'artiste préoccupé, parfois malgré lui, une importance excessive. Il n'en fut pas de même de J. Weber. Le critique du Temps, dans son très intéressant article, que je citerai, dans ses parties essentielles, car il en vaut réellement la peine, prend la chose au sérieux ; il y fait le procès à toute notre jeune Ecole musicale qu'il accuse de sacrifier à Baal. Baal est pour Weber tantôt Wagner, tantôt Auber, ou plutôt le style à flonflons des mauvaises partitions d'Auber ; tout ce qui s'écarte du juste milieu, soit à droite, soit à gauche ; tout ce qui sort des sentiers battus et tend à s'élever, et tout ce qui verse dans l'ornière de la « roucoulade et du mensonge ». Gounod, lui-même, en l'an de grâce 1867, après Faust et Roméo, n'est pas exempt du reproche adressé à toute notre École musicale, et la chose est d'autant plus curieuse qu'elle émane, non d'un ignorant et d'un sot, mais d'un esprit cultivé, d'un écrivain érudit, d'un critique de bon sens et de bonne foi. « Lors de l'apparition des Pêcheurs de perles, écrit Weber, je ne fus pas peu surpris d'entendre décrier M. Bizet comme Wagnérien. Ce n'est pas sa partition qui m'eût jamais semblé justifier ce reproche. Wagner, c'est Croquemitaine avec qui l'on fait peur aux grands enfants quand ils ne sont pas sages, c'est-à-dire quand ils ne veulent pas croire ce qu'on veut leur faire croire, quand ils ne veulent pas adorer ce qu'on veut leur faire idolâtrer, quand ils ne veulent pas goûter aux drogues qu'on veut leur faire avaler. S'ils avaient tant soit peu de jugement et qu'on ne leur eût pas fait peur d'avance, ils verraient aussitôt que Croquemitaine est un homme comme un autre, faisant parfois la grosse voix, mais aussi peu semblable que vous et moi à l'Ogre qui a mangé les frères du petit Poucet, ou à la fausse grand'mère qui a dévoré le Petit Chaperon rouge. Et puis, quelles bonnes gens que les prétendus Wagnériens français ! Ils aiment de tout leur cœur, croyez-le bien, le vrai Dieu, celui de Gluck, mais ils ne dédaignent pas de sacrifier à Baal, parce qu'il est bon d'avoir des amis partout. Ce ne sera pas une petite affaire pour M. Gounod de se purifier de tout levain d'idolâtrie avant d'entrer en Paradis. Quant à M. Bizet, je ne dois pas trop lui faire son procès puisqu'il faut regarder les Pêcheurs de Perles comme une première épreuve qui ne porte pas à conséquence. » Puis, entrant dans l'analyse détaillée de la Jolie fille, Weber arrive à la scène du troisième acte, où l'arrivée de Glover et de Catherine au palais du duc, après le bal, provoque l'explosion de Smith, victime, comme le duc, de la supercherie de Mab : « L'arrivée du bonhomme Glover et de sa fille, écrit-il, provoque un morceau d'ensemble style Auber et accompagné de copieuses roucoulades de Catherine. Il y aurait là de quoi faire fuir M. Richard Wagner jusqu'au fond de la Cochinchine : « O Baal ! puissant Baal ! » comme chantent les prêtres dans Elie de Mendelssohn ! »
Aujourd'hui, l'optique s'est modifiée ; ce qui pouvait paraître excessif en 1867 est accepté, admiré ; quant à Gounod, s'il a été entaché d'idolâtrie, comme l'affirme Weber, il n'y paraît plus.
Il ne reste, de toutes ces critiques, que la dernière, la plus juste : le reproche des concessions faites au goût du public. Bizet y fut très sensible et s'empressa d'écrire au critique du Temps, non pour excuser sa faiblesse, mais pour l'accuser et affirmer sa foi.
Voici sa lettre que J. Weber a reproduite dans l'article très ému qu'il publia le 15 juin 1875, quelques jours après la mort de Bizet.
« Il m'est impossible, Monsieur, de résister au désir de vous dire tout le bien que je pense de l'excellent article que vous avez bien voulu consacrer à mon nouvel opéra la Jolie fille de Perth. Non, Monsieur, pas plus que vous je ne crois aux faux dieux, et je vous le prouverai. J'ai fait, cette fois encore, des concessions que je regrette, je l'avoue. J'aurais bien des choses à dire pour ma défense,... devinez-les ! L'École des flonflons, des roulades, du mensonge, est morte, bien morte ! Enterrons-la, sans larmes, sans regret, sans émotion et... en avant ! Il est bien entendu, Monsieur, que cette lettre n'est pas de ma part une avance qui serait indigne de mon caractère comme du vôtre, j'en suis convaincu, mais votre critique m'a plu, je vous le répète, et j'ai éprouvé le besoin de vous le dire sincèrement. »
Qu'ajouter à cet aveu si loyal, si spontané ? Bizet tint parole et ne sacrifia plus « aux faux dieux ». A partir de ce moment, nous allons le voir « monter, monter toujours » et nous donner successivement trois chefs-d'œuvre : Djamileh, l'Arlésienne, Carmen.
BIZET CRITIQUE. — NOÉ. — MUSIQUE DE PIANO. — CONCOURS DE LA COUPE DU ROI DE THULÉ.
Pendant qu'il subissait les ennuis de l'attente prolongée, après les atermoiements successifs qui avaient mis un instant en péril sa partition de la Jolie fille de Perth, au mois d'août de l'année 1867, Bizet s'essaya dans la critique musicale. Il prit vaillamment la plume pour faire bonne justice des erreurs et des préjugés ; malheureusement, — car les débuts du jeune artiste promettaient un maître polémiste, — malheureusement, dis-je, la plume lui échappa des doigts après son premier article.
C'est à la Revue Nationale et Étrangère que parut cet intéressant article. La Revue Nationale venait de subir une transformation complète ; de mensuelle, qu'elle avait été jusqu'alors, elle devenait hebdomadaire et donnait une large part à la polémique et à l'actualité. Laboulaye, qui allait y publier son Prince Caniche, préludait par des articles de philosophie politique ; Baudelaire donnait de spirituelles fantaisies ; enfin Jules Ferry et Henri Brisson traitaient les questions économiques et politiques. A Bizet fut offerte la plume du critique musical que nul n'eût tenue avec une plus parfaite compétence. Sous le pseudonyme transparent de Gaston de Betzi, parut le premier article de notre jeune maître, le 3 août 1867, dans la première livraison de la Revue Nationale transformée.
Cet article est d'un très grand intérêt, en dehors de ses qualités de style, de brio, d'entrain, car il contient une double profession de foi : profession de foi critique, profession de foi esthétique. Ce que Bizet aimait en art, il nous le dit avec sa franchise habituelle ; il s'y montre ennemi déclaré de l'esprit de système, éclectique aux idées larges, sans préjugé, sans parti pris, le contraire, en un mot, de ce que ses détracteurs ont voulu nous faire croire qu'il était, sectaire intransigeant, « farouche Wagnérien »
Et d'abord, en débutant, il semble éprouver le besoin d'expliquer sa conduite, de répondre d'avance aux objections qui lui seront faites au sujet de la détermination qu'il vient de prendre. Il a accepté la rédaction de la partie musicale de la Revue Nationale, quoique compositeur, dit-il, parce qu'il pense que l'on doit réagir vivement contre le préjugé d'après lequel, « pour juger sainement une œuvre d'art, il est absolument nécessaire de n'être pas artiste soi-même ».
A l'exemple de Berlioz, à qui sa rude franchise créa de si cruelles inimitiés, de Reyer, qui venait de succéder à Berlioz dans la rédaction du feuilleton musical des Débats, il a voulu prouver, à son tour, que l'artiste sincère peut être juste pour tous. Certes, on ne peut nier, ajoute-t-il, « que tout homme instruit, éclairé, doué de sensibilité, ait la faculté, et par conséquent le droit, de louer ou de blâmer une production artistique quelconque, j'en demeure d'accord ; mais que l'ouvrier de la pensée, continuellement préoccupé, tout à la fois, des questions les plus élevées et les plus spéciales de son art, ne puisse être admis à juger les œuvres de ses pairs, sous je ne sais quel prétexte de bienséance et de bonne confraternité, cela me paraît, je l'avoue, absolument illogique et souverainement injuste ».
Ensuite, il s'excuse sur ses facultés littéraires, qu'il ignore, mais qu'il ne nous est pas permis de méconnaître, après cet article d'une forme si nette, si serrée, qui annonçait un maître. « Vous ne trouverez ici, dit-il, ni les puissantes images de Paul de Saint-Victor, ni l'esprit étincelant de Nestor Roqueplan, ni le style enchanteur de Théophile Gautier, ni la forme élégante et serrée de B. Jouvin, ni la fougue sympathique de Gasperini, ni l'impressionnable nervosité de Xavier Aubryet, ni la verve railleuse d'Ernest Reyer » ; mais, du moins, « vous trouverez, à défaut du talent des maîtres que je viens de citer, deux de leurs qualités les plus essentielles, à savoir : 1° une étude approfondie de l'art musical et de toutes les questions qui s'y rattachent ; 2° une bonne foi que ne sauraient altérer mes amitiés ni mes inimitiés. Je dirai la vérité, rien que la vérité, et, autant que possible, toute la vérité. Je ne fais partie d'aucune coterie, je n'ai pas de camarades ; je n'ai que des amis, qui cesseraient d'être mes amis, le jour où ils ne sauraient plus respecter mon libre arbitre, ma complète indépendance. Me renfermant dans l'examen des choses purement artistiques, j'étudierai les œuvres sans m'occuper de l'étiquette qui les accompagne. Respect à tous, telle est ma devise ! Ni encenseur, ni insulteur : telle est ma ligne de conduite ».
Après cet exposé sommaire des droits et des devoirs de l'artiste critique d'art, Bizet entre au cœur de son sujet : « Depuis quelques années, dit-il, l'esprit de système a fait, en art et en critique d'art, des progrès inquiétants ; de là cette polémique stérile, ces discussions arides qui égarent, qui dévorent, qui énervent les organisations les plus courageuses, les plus robustes, les plus fécondes, de là, aussi, ces divisions, ces subdivisions, ces classifications, ces définitions quelquefois obscures, souvent erronées, toujours inutiles ou dangereuses. On chicane au lieu d'avancer, on ergote au lieu de produire. Les compositeurs se font rares, mais, en revanche, les partis, les sectes, se multiplient à l'infini ; l'Art s'appauvrit jusqu'à la misère, mais la technologie s'enrichit jusqu'à la diffusion. Jugez-en vous-même. Nous avons la musique Française, la musique Allemande, la musique Italienne, et, accessoirement, la musique Russe, la musique Hongroise, la musique Polonaise, etc., etc. ; sans compter la musique Arabe, la musique Japonaise et la musique Tunisienne, très en faveur, toutes les trois, depuis l'ouverture de l'Exposition Universelle. » Puis, poussant à la charge la fièvre de classification qui nous domine, il fait une énumération grotesque des diverses familles : « Nous avons, aussi, la musique de l'Avenir, la musique du présent et la musique du passé ; puis, la musique philosophique et politique récemment découverte... »
« Nous avons encore la musique mélodique, la musique harmonique, la musique savante (la plus dangereuse de toutes), et, enfin, la musique-canon breveté (s. g. d. g.) (*). — J'en oublie ! Nous aurons demain la musique à aiguille, à hélice, à pompe foulante et refoulante... refoulante surtout ! Quel galimatias ! Pour moi, il n'existe que deux musiques : la bonne et la mauvaise. Béranger a défini l'Art ainsi : L'Art, c'est l'Art, et voilà tout. »
(*) Allusion au Chant des Titans, cantate de Rossini, pour quatre voix de basse et orchestre, exécutée à l'Exposition Universelle de 1867.
Eh bien ! qu'en pensez-vous? Le voilà ce révolutionnaire qu'on a accusé d'avoir voulu tout renverser ; le voilà ce « farouche Wagnérien ! »... Vous êtes surpris de le trouver si raisonnable ; bah ! ceci n'est rien ; écoutez encore et vous serez complètement édifiés... « Est-ce qu'il est nécessaire de décrier Molière pour aimer Shakespeare ? Est-ce que le génie n'est pas de tous les pays, de tous les temps ? »... « Non, le Beau ne vieillit pas ! le Vrai ne meurt pas !... Comment ! un poète, un peintre, un musicien, consacre le plus pur de son intelligence et de son âme à concevoir et à exécuter son œuvre ; il croit, doute, s'enthousiasme, se désespère, jouit, souffre, tour à tour ; et, lorsque, plus anxieux, plus tremblant qu'un criminel, il vient nous dire : « Voyez et jugez ! » au lieu de nous laisser émouvoir, nous lui demandons son passeport ! nous nous enquérons de ses opinions, de ses relations, de ses antécédents artistiques ?... Mais ce n'est plus de la critique, cela ; c'est de la police !... L'artiste n'a pas de nom, pas de nationalité ; il est inspiré ou il ne l'est pas ; il a du génie, du talent, ou il n'en a pas; s'il en a, il faut l'adopter, l'aimer, l'acclamer ; s'il n'en a pas, il faut le respecter, le plaindre.., et l'oublier !... Nommez-vous Rossini, Auber, Gounod, Wagner, Berlioz, Félicien David ou Pitanchu, que m'importe ?... Faites-moi rire ou pleurer ; peignez-moi l'amour, la haine, le fanatisme, le crime ; charmez-moi, éblouissez-moi, transportez-moi, et je ne vous ferai certes pas la sotte injure de vous classer, de vous étiqueter comme des coléoptères !... »
Et ce n'est pas tout ; voici un passage autrement significatif et qui va corroborer l'opinion, que j'ai émise plus haut, au sujet de la fameuse phrase que B. Jouvin attribue à notre jeune artiste : « Wagner c'est Verdi avec du style », et nous montrer, une fois de plus, sa profonde admiration pour le grand Maître Italien. « Soyons donc naïfs, vrais ; ne demandons pas à un grand artiste les qualités qui lui manquent, et sachons profiter de celles qu'il possède. Quand un tempérament passionné, violent, brutal même ; quand un Verdi, dote l'art d'une œuvre vivante et forte, pétrie d'or, de boue, de fiel et de sang, n'allons pas lui dire froidement : « Mais, cher Monsieur, cela manque de goût, cela n'est pas distingué. » Distingué !... Est-ce que Michel-Ange, Homère, Dante, Shakespeare, Beethoven, Cervantès et Rabelais sont distingués ? »...
Ces fragments n'en disent-ils pas suffisamment sur les tendances esthétiques de Bizet ? Tout commentaire ne pourrait que les affaiblir ; ils sont assez clairs, assez saisissants par eux-mêmes ; mais est-il permis de penser que ceux pour qui l'œuvre de notre artiste regretté est restée lettre morte, puisque, malgré tout, ils n'ont pu porter un jugement sain ; que ceux qui ont des oreilles et n'ont pas voulu entendre, n'ont pas su, peut-être, — ce dont il faudrait les plaindre, non les accuser, — auront des yeux pour lire, cette fois ? L'esprit de système est une chose bien terrible en matière de critique ; il aveugle, il rend injuste et partial. Or, la partialité est l'arme à deux tranchants, l'arme meurtrière, qui blesse l'artiste et trappe l'homme au cœur. Ecoutez notre jeune critique : « Ah croyez-moi, la critique partiale est une arme cruelle, terrible, mortelle !... j'ai été l'élève, l'ami d'Halévy ; plus d'une fois j'ai reçu ses confidences à ce sujet. Eh bien, ni sa haute position, ni sa gloire indiscutable, ne pouvaient le consoler des attaques injustes, odieuses, dont il était l'objet. » Et lui, n'a-t-il pas souffert de cette ridicule accusation de Wagnérisme qui lui fut si particulièrement sensible ? Plus il s'efforçait de réagir contre des tendances qui étaient loin d'être les siennes, plus l'accusation devenait intense. Car c'était une accusation, un blâme, que formulaient les critiques, retranchés derrière leurs préjugés et leur étroit esprit de système. Or, il n'est pas possible d'accuser Bizet de Wagnérisme, si l'on n'est guidé par la partialité la plus condamnable, ou égaré par la plus complète ignorance !...
Après le critique partial, vient le tour du critique pédant, du critique savant qui fait étalage de son pédantisme. Bizet le flagelle de la belle façon : « J'ai horreur du pédantisme et de la fausse érudition. Certains critiques de troisième ou de quatrième ordre usent et abusent d'un jargon, soi-disant technique, aussi inintelligible pour eux que pour le public. Je me garderai soigneusement de ce travers ridicule. Vous ne trouverez donc ici aucun renseignement sur les octaves, quintes, tritons, fausses quintes, dissonances, consonances, préparations, résolutions, suspensions, renversements, cadences rompues, interrompues ou évitées, canons à l'écrevisse et autres gentillesses ; je renverrai les amateurs de cet aimable tangage aux savants articles de M. de L..., ils y apprendront, entre autres choses du plus palpitant intérêt, que Niccolo a écrit les Rendez-vous bourgeois en contrepoint non renversable ; qu'il est nécessaire d'écouter l'instrumentation de Mendelssohn avec le soin le plus scrupuleux, l'auteur du Songe d'une nuit d'été traitant la partie du deuxième basson aussi mélodiquement que la partie de 1er violon ». etc...
Et la conclusion ! Conclusion d'un artiste qui a connu les difficultés de la route, qui s'est épuisé en luttes vaines, mais qui aime son art plus que tout et qui a trouvé, dans cet amour profond, le courage nécessaire pour l'attente longue et énervante, la force et l'âpreté pour la lutte : « En vérité, je vous le dis, les compositeurs sont les parias, les martyrs de la société moderne. Comme les gladiateurs antiques, ils tombent en s'écriant : Salve popule, morituri te salutant ! Oh ! la musique ! quel art splendide ! mais quel triste métier ! enfin... attendons !... attendons !... et surtout, espérons ! »
Ce brillant article, si intéressant, si sagement pensé, écrit avec une plume élégante et tacite, n'eut pas de lendemain ; après quelques mois d'interrègne, M. Jules Ruelle succéda au Maître dans la rédaction musicale de la Revue Nationale, et cela sans secousse, sans explication ni de Bizet ni de la direction (*).
(*) Dans une lettre à M. Edmond Galabert, publiée dans Lettres à un Ami, Bizet donne les raisons de sa brusque retraite : Crepet, le Directeur de la Revue, s'en allait, et la nouvelle direction voulait restreindre les droits du Critique ; elle voulait l'empêcher « d'éreinter Azevedo » et supprimer quelques « lignes d'un article qu'il avait préparé sur Saint-Saëns. » Bizet n'entendit pas de cette oreille et démissionna.
Depuis lors, Bizet n'a plus renouvelé son intéressante tentative ; il fut critique une fois dans sa vie, et c'est assez pour nous faire regretter qu'il n'ait pas continué à dire son mot sur les hommes et sur les choses de l'Art musical, avec cette sincérité, cette franchise et cette entière bonne foi...
Après la Jolie fille de Perth, on proposa à Bizet de terminer la dernière partition d'Halévy, Noé, opéra biblique, en trois actes et quatre tableaux, de de Saint-Georges. L'amitié profonde que lui avait toujours témoignée l'auteur de la Juive, l'affectueuse familiarité qui n'avait cessé de régner entre le maître et son élève, devenu un maître à son tour, avaient naturellement désigné le jeune artiste au choix de la famille et des amis d'Halévy. C'était une besogne ingrate, mais Bizet n'hésita pas ; il vit dans ce travail, dont il ne devait retirer que bien peu de gloire, et peu de profit, aussi, sans doute, un dernier tribut d'affectueuse reconnaissance à la mémoire de son maître, en même temps qu'un témoignage de sympathie pour la famille de l'illustre mort. Vers le milieu de l'année 1868, Bizet commença ce pénible travail, qui consiste à pénétrer l'idée d'autrui, à s'inspirer de sa manière, enfin, à abdiquer sa personnalité et à mettre son talent au service d'une inspiration étrangère. Pour une imagination ardente, pour une nature primesautière, ce travail, appliqué à une œuvre de grande envergure, à un grand opéra, devait rapidement engendrer la lassitude ; aussi, malgré l'ardeur qu'il avait d'abord manifestée, l'abandonna-t-il bientôt. Il devait cependant le reprendre l'année suivante, et le mener à bonne fin cette fois.
Il s'occupait aussi beaucoup, à cette époque, de musique instrumentale, non plus, comme aux heures difficiles de ses débuts, en transcripteur, consciencieux certes et habile, mais qui recherche surtout, dans ses travaux, une rémunération nécessaire aux besoins journaliers de l'existence. Entre temps, il réduisait bien, pour l'éditeur du Ménestrel, les partitions de Mignon et d'Hamlet, pour piano-solo ; mais la plupart de ses compositions instrumentales de cette époque ont une portée artistique beaucoup plus haute.
C'est en entendant son ami l'éminent pianiste Henri Delaborde sur le piano à pédalier de la maison Érard, qu'il conçut le projet de composer de la musique de piano originale, sans abandonner, toutefois, sa Symphonie, à laquelle il n'avait jamais cessé de songer et de travailler, même pendant la période fiévreuse de la Jolie fille de Perth.
Les Grandes Variations Chromatiques, morceau dont il s'avouait « tout à fait content », le déclarant « traité très audacieusement », et le Nocturne pour piano furent écrits à cette époque...
Bizet ne s'est jamais produit en public comme virtuose ; il cachait à la foule, avec un soin jaloux, son merveilleux talent de pianiste, son incomparable, sa vertigineuse habileté de lecteur. Au Théâtre-Lyrique, sous la direction Carvalho, c'était à lui qu'incombait la lourde tache de lire, au directeur et à ses collaborateurs, les partitions des œuvres nouvelles que l'on montait, des chefs-d'œuvre que l'on reprenait. Ce ne fut jamais, il convient de le dire, une fonction rémunérée qu'il occupa officiellement ; les nombreux services qu'il rendait, il les rendait à titre purement gracieux ; en ami reconnaissant du directeur qui avait facilité ses débuts, et à qui il devait de n'avoir pas connu les amertumes et les déboires de ses camarades les pensionnaires de l'Institut. Ceux qui ont eu la rare fortune de l'entendre, disent avec quelle fougue, avec quel brio, mais aussi avec quelle sûreté, avec quel art parfait, il traduisait, ainsi, à première lecture, les partitions d'orchestre les plus enchevêtrées (*).
(*) « Les grandes partitions d'opéra n'effrayaient pas le pianiste : son œil parcourait les amas de portées de l'orchestration et, couramment, il résumait sur le clavier ces combinaisons de timbres plus ou moins compliquées, avec une sûreté de coup d'œil et un fini d'exécution tout à fait extraordinaires. Nous en fûmes témoin, un jour, chez Offenbach, qui venait de recevoir de Londres la partition écrite par Gounod pour la Jeanne d'Arc de Jules Barbier. Bizet se mit au piano et y posa la partition d'orchestre encore vierge. Il ne prit pas même le temps de la parcourir pour s'habituer le regard à la fine écriture du Maître, pour examiner, en éclaireur, les casse-cou qui pouvaient s'y trouver et prendre une connaissance rapide de l'œuvre et de ses surprises. Non, il attaqua l'accord de l'introduction ; puis, quand ce furent les chœurs, sa voix se joignit aux nôtres, qui déchiffraient le manuscrit, en même temps qu'il rendait au piano — autant que le rebelle instrument le permet — tous les effets de l'orchestre : ici une tenue de cor qu'il se gardait de négliger ; là un dessin de violon ou de flûte ; plus loin un tutti où les notes basses du piano ronflaient sous ses doigts comme des timbales ou vibraient comme des triangles. » Armand Gouzien (l'Evénement du 6 juin 1875).
Quant à son talent de virtuose, il était vraiment prodigieux...
Un soir de l'année 1861, Halévy réunissait chez lui, en un dîner d'amis, quelques-uns de ses intimes ; parmi eux, Liszt, et le jeune Georges Bizet fraîchement débarqué à Paris, après ses trois années d'exil de la Villa Médicis. Le dîner fini, on passe dans le cabinet de travail du Maître, et, après la vague causerie à bâtons rompus, au coin du feu, dans la fumée bleue des fins havanes, après le moka lentement savouré, Liszt se met au piano. Il exécute une de ses récentes compositions encore inconnue des convives, hérissée de difficultés, de traits d'une hardiesse vertigineuse, et avec quelle verve, avec quelle audacieuse virtuosité ! Les applaudissements éclatent, Liszt vient de terminer sur un dernier trait, le plus hardi, le plus follement vertigineux ; tous s'empressent autour du grand pianiste et lui serrent affectueusement la main, le félicitant, ne tarissant pas d'éloges sur son merveilleux talent, louant sans réserve l'œuvre qu'il vient d'exécuter, admirant la virtuosité prodigieuse qui permettait à l'étonnant artiste de vaincre, en se jouant et sans le moindre effort apparent, les plus insurmontables difficultés.
— « Oui, répond Liszt, ce morceau est difficile, horriblement difficile, et je ne connais guère que deux pianistes capables de l'exécuter tel qu'il est écrit et dans le mouvement que j'ai voulu : Hans de Bulow et moi. » Halévy s'était approché du piano et complimentait, à son tour, le grand pianiste.
Soudain, se tournant vers le jeune Bizet, dont il connaissait l'heureuse mémoire et la prodigieuse faculté d'assimilation : « As-tu remarqué ce passage ? » lui dit-il ; et, frappant quelques accords sur le clavier, il esquissait, vaguement, le passage qui avait éveillé sa curiosité. Bizet, à cette invite, s'était assis au piano, et reproduisait, sans la moindre défaillance de mémoire, le fragment qui avait attiré l'attention de son maître. Liszt, étonné, le regardait, tandis qu'Halévy, souriant avec malice, jouissait de sa surprise. « Attendez, jeune homme, attendez, s'écria Liszt vivement intéressé, j'ai précisément le manuscrit, il va aider votre mémoire. » Le manuscrit fut déroulé sur le pupitre. Alors, à la stupéfaction générale, Bizet attaqua les premières notes du redoutable morceau et, avec une verve, un brio, une audace inouïe, le lut jusqu'au dernier accord, sans une faiblesse, sans une hésitation. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, plus chauds, plus enthousiastes ; Halévy souriait toujours, savourant à longs traits le triomphe de son élève bien-aimé. Mais Liszt, l'émotion générale calmée, s'était approché du jeune homme et, saisissant sa main qu'il serra avec effusion : « Mon jeune ami, lui dit-il, j'avais cru qu'il n'y avait que deux hommes capables de lutter victorieusement contre les difficultés dont j'ai pris plaisir à hérisser ce morceau ; je m'étais trompé ; nous sommes trois, et je dois ajouter, pour être juste, que le plus jeune des trois est peut-être le plus audacieux et le plus brillant »...
Un ridicule préjugé, malheureusement bien enraciné chez nous, qui consiste à confiner les pianistes dans leur spécialité, empêcha seul, je crois, Bizet de produire en public son talent de virtuose. Contre ce préjugé, bon nombre de grands artistes eurent à lutter, longtemps et péniblement, avant d'arriver à s'imposer comme ils étaient dignes de le faire ; je citerai, à titre d'exemple : Saint-Saëns, d'abord, qui n'a pas encore complètement vaincu, puisque bon nombre d'excellents esprits, lui accordant sans conteste le don symphonique, lui refusent la fibre dramatique qu'il possède pourtant ; ensuite, Liszt et Rubinstein, qui ont eu tant de difficulté, en raison de leur grande renommée de virtuoses, à se faire prendre au sérieux comme symphonistes et comme compositeurs dramatiques.
Malgré son peu de goût pour les exhibitions publiques, aux heures difficiles de ses débuts, Bizet eût sans doute consenti à se produire dans les grands concerts, s'il n'eût craint de compliquer les difficultés premières de sa carrière de Compositeur et de paralyser sa marche par l'entrave ridicule de ce préjugé (*). A maintes reprises des offres brillantes lui furent faites ; toujours il les repoussa. Après la Jolie fille de Perth, sans se départir de son excessive réserve, il ne pouvait cependant se soustraire, complètement, aux exigences de la situation que venaient de lui créer le succès de sa nouvelle partition et sa notoriété artistique incontestée. Les salons parisiens le recherchaient et, souvent, il ne pouvait décliner les avances qui lui étaient faites. Vers la fin de janvier 1868, il allait à Beauvais, en compagnie de Mme Carvalho et d'Hermann-Léon, « défrayer le royal programme (**) d'un raout de Recette générale ». A Paris, il affectionnait particulièrement le salon du docteur Trélat. C'était, à cette époque, un des salons artistes par excellence ; les premiers virtuoses s'y faisaient applaudir ; à Mme Massart, Massart, Jacquart, Demunck, Taudou, était confiée, d'ordinaire, la partie instrumentale ; Mlle Jane Devriès, la créatrice du rôle de Catherine Glover, soupirait « avec une véritable émotion la Jeune Religieuse de Schubert (***) » ; la Maîtresse de la maison chantait, en « grande artiste (****) », les stances admirables de Sapho ; Bizet dirigeait le chœur de la Saint-Valentin et Léo Delibes, son chœur des Nymphes des bois. Les deux chœurs, d'ordinaire, « étaient bissés d'enthousiasme, et c'était justice, pour les auteurs et pour les exécutants, tous hommes, femmes, amateurs distingués (***) ». Parfois, Bizet prenait une part active au concert. Ainsi le 16 mars, où, après le Benedictus de la Messe de Mme de Grandval, chanté par l'auteur, Mme Trélat et le ténor Pagans, après les deux chœurs de la Saint-Valentin et des Nymphes des bois, bissés suivant la coutume, après un quatuor de Beethoven par Mme Massart, Massart, Demunck et Taudou, il exécuta avec Mme Massart, à l'admiration générale, le scherzo, à quatre mains, du Songe d'une nuit d'Été de Mendelssohn « avec autant de style que de perfection... (****) ». C'est à cette époque, où il commençait à voir le sort lui sourire et où sa situation s'améliorait sensiblement, qu'il entreprit la composition de la Coupe du Roi de Thulé.
(*) « Oui, je pouvais faire autre chose que du théâtre, et c'est justement ce qui m'en fermait l'accès. Symphoniste, organiste, pianiste, comment aurai-je été capable d'écrire un opéra ? La qualité de pianiste était surtout mal vue dans le monde des coulisses ; Bizet, qui jouait admirablement du piano, n'osa jamais en jouer en public dans la crainte d'aggraver sa situation. » Camille Saint-Saëns, Echo de Paris du 19 février 1911.
(**) Le Ménestrel, 2 février 1868.
(***) Gazette des Etrangers, 13 février 1868.
(****) Le Ménestrel, 22 mars 1868.
Dans les derniers mois de l'année 1867, trois concours avaient été, simultanément, ouverts dans chacun des Théâtres Lyriques subventionnés par l'État, et des mesures avaient été prises, les règlements de chacun d'eux avaient été élaborés, de telle sorte qu'ils pussent avoir lieu dans les conditions les plus libérales, les plus larges, « en entrant, autant que possible, dans les goûts et les idées des jeunes musiciens ».
« Pendant le cours de l'année 1867, dit le Ménestrel (*), et particulièrement depuis l'ouverture de l'Exposition Universelle, les théâtres de Paris ont joui d'une prospérité matérielle sans exemple jusqu'à ce jour. Tous sont demeurés ouverts, sans interruption, même ceux qui, chaque année, ont l'habitude de suspendre momentanément leurs représentations durant la saison d'été, et les visiteurs étrangers ont répondu à l'appel, avec un empressement qu'il est permis de considérer comme un hommage rendu à l'attrait et à la supériorité de l'art dramatique français. Quelques œuvres nouvelles ont été représentées avec un succès éclatant, mais, en général, c'est par la reprise des pièces anciennes, éprouvées, que les directeurs, maîtres de leurs choix, ont cru devoir tenter la curiosité publique, et le résultat a paru leur donner raison.
Au moment où les diverses productions de l'Art étaient, comme celles de l'Industrie, offertes à tous les regards dans une exposition commune, l'attention du gouvernement s'est reportée, avec intérêt, sur une branche moins favorisée que les autres, à qui ce genre de publicité n'est pas applicable, et des études ont été faites pour chercher le moyen de seconder dans leur essor les jeunes compositeurs de musique.
Déjà des dispositions utiles avaient été prises en faveur des lauréats de Rome ; presque tous avaient pu aborder la scène et des facilités plus grandes leur étaient assurées pour l'avenir. Mais, quand partout en France le sentiment musical fait chaque jour de nouveaux progrès, ce n'est pas à quelques élus seulement, c'est à tous les compositeurs français qu'il était juste de venir en aide. »
(*) Le Ménestrel, 1er décembre 1867.
On le voit, le triple concours, organisé par le gouvernement Impérial, était basé sur une idée généreuse, une idée de protection, pour un art si peu encouragé, si peu favorisé ; son but était noble et élevé : permettre à trois jeunes artistes français, prix de Rome ou non, d'arriver à la scène, de se produire, sans les déboires et les ennuis de toute sorte des premiers débuts (*).
Malheureusement le résultat ne répondit pas à l'attente générale. On connaît les avortements que produisit ce triple concours. Et il en sera toujours ainsi, tant que les concours ne seront pas envisagés sous un aspect plus sérieux, et que, malgré l'anonymat exigé pour les œuvres soumises à leurs décisions, Messieurs les membres du jury ne sauront pas se soustraire aux influences étrangères, échapper aux sollicitations ; qu'ils ne seront pas, en un mot, des juges sérieux, intègres et impartiaux. Jusqu'à ce moment-là, — qui n'arrivera jamais, — les artistes de talent refuseront toujours de prendre part aux concours, qui resteront, sauf quelques rares exceptions, l'apanage exclusif des médiocres ou des gens très protégés (**).
(*) Les trois concours n'étaient pas régis par les mêmes règlements. Pour l'Opéra, le sujet du poème devait être mis au concours, et c'est sur le poème couronné que les compositeurs concurrents devaient écrire leur partition ; pour l'Opéra-Comique, le Florentin, poème de de Saint-Georges, avait été imposé ; enfin, pour le Théâtre-Lyrique, les concurrents pouvaient envoyer des ouvrages composés sur des livrets à leur choix. Les trois partitions couronnées furent : la Coupe du roi de Thulé de Diaz, qui fut représentée le 10 janvier 1873 à l'Opéra et n'obtint qu'un fort médiocre succès, — en tout douze représentations, — malgré les splendeurs de la mise en scène et le grand talent de Faure ; le Florentin, de Lenepveu, représenté le 16 février 1874 à l'Opéra-Comique, ne fut pas plus heureux ; quant au Magnifique, opéra-comique en un acte de M. Philipot, qui avait remporté la palme du concours du Théâtre-Lyrique, il vit le jour le 24 mai 1876. L'accueil du public et de la presse fut tel, qu'il ne put être joué que quatre fois.
(**) A propos du Concours d'opéra-comique, le Figaro du 6 novembre 1868 publia la lettre suivante que lui avait adressée l'un des concurrents : « Monsieur le Rédacteur : — Il n'est pas possible que sur 63 partitions envoyées (il ne s'agit, bien entendu, que du concours d'opéra-comique pour lequel avait été imposé le poème de de Saint-Georges, le Florentin), il ne s'en trouve pas, à la lecture, au moins dix ou douze dignes de fixer l'attention du jury. Ne pourrait-on obtenir de ce jury que les dix compositeurs choisis fussent nommés et qu'ils pussent assister à l'exécution au piano de leurs œuvres ? Certes, on est loin de contester le mérite et l'intelligence des hommes qui composent le jury ; mais dans une œuvre de cette nature, il y a une question de mouvement, de couleur, et d'intentions qui ne peut être résolue que par la présence de l'auteur. Et puis, ne serait-ce pas une véritable compensation, pour celui qui a consacré tout son temps à cette œuvre, que de se trouver nommé parmi les dix premiers ! Ce résultat honorable pourrait faire entrevoir pour l'artiste, dans l'avenir, un plus facile accès près de l'un des directeurs des théâtres lyriques. Agréez etc., etc. Un amateur Compositeur de musique. » Le concours musical de la Ville de Paris a réalisé, de nos jours, ce que demandait le correspondant du Figaro, en 1868 ; l'anonymat est supprimé et chaque concurrent fait, lui-même, entendre sa partition au Jury. Cela vaut-il mieux ? Hélas ! les derniers concours, en écartant des œuvres de valeur pour donner le prix à des médiocres, ont prouvé que rien n'était changé !
Selon les règles ordinaires, il fut décidé que les concurrents pour le poème du concours d'opéra devraient déposer leurs manuscrits, portant, sur le premier feuillet, une épigraphe, reproduite sur un pli cacheté contenant le nom de l'auteur, et destinée à faire connaître le vainqueur, une fois la décision du jury prononcée.
Le 15 mars (*) fut fixé, comme dernier délai, aux concurrents pour le poème d'opéra ; deux jours après, ils se réunissaient, ainsi qu'ils y avaient été invités, au Ministère des Beaux-Arts, dans le cabinet du directeur des théâtres, et élisaient, au scrutin secret, les membres du jury (**) chargés de juger les poèmes envoyés au Concours.
(*) MINISTERE DE LA MAISON DE L'EMPEREUR ET DES BEAUX-ARTS. — Direction Générale des Théâtres. Le concours institué au Théâtre Impérial de l'Opéra pour la composition d'un poème destiné à être mis en musique, sera clos définitivement le 15 mars, présent mois. Les auteurs qui y auront pris part, sont invités à se réunir le mardi 17 courant à 1 heure, au ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, dans le cabinet du directeur général des théâtre, pour élire eux-mêmes le jury chargé de juger ces poèmes envoyés au concours. Ils seront admis sur la présentation du titre de leur ouvrage et de l'épigraphe annexée à leur manuscrit. Paris, 8 mars 1868.
(**) Voici la composition du jury nommé par les concurrents pour le concours du poème d'opéra. — Jurés : MM. Perrin, directeur de l'Opéra, Gounod, Félicien David, Ambroise Thomas, Emile Augier, Théophile Gautier, Paul de Saint-Victor, Francisque Sarcey, Victor Massé. — Jurés supplémentaires : MM. Jules Janin, Auber, de Gasperini, Hector Berlioz, E. Arago, Reyer, B. Jouvin, Roqueplan, de Saint-Georges. — Les concurrents nommèrent ensuite une commission de cinq membres chargés de les représenter dans les démarches à faire, pour solliciter l'adhésion des notabilités choisies, pour la composition du jury. Avant de se séparer, les concurrents émirent le vœu que des mentions honorables fussent accordées aux cinq ou six poèmes les plus méritants, après celui qui serait choisi pour être mis en musique et exécuté à l'Opéra. Ce vœu fut favorablement accueilli par Camille Doucet, directeur général de l'administration des théâtres.
Un mois après, conformément aux conclusions du rapport, déposé par Francisque Sarcey, le prix était décerné au poème « ayant pour titre la Coupe du Roi de Thulé (*) ». Les auteurs étaient Louis Gallet et Édouard Blau, deux jeunes écrivains à peu près inconnus, alors (**). Le libretto couronné fut immédiatement livré à l'impression, afin de pouvoir être remis le plus tôt possible, aux musiciens concurrents. Cent soixante-huit poèmes avaient été envoyés.
(*) Extrait du rapport de Francisque Sarcey relatif au poème : Catherine II, dont on a tant parlé : « Le n° 164 est, au jugement de la commission, une œuvre remarquable. La grandeur du sujet qui est tiré de l'histoire de Russie, la simplicité et la rapidité avec laquelle l'action est conduite, la vérité des coups de théâtre, l'habileté singulière de l'auteur à préparer au musicien et des caractères bien dessinés et des situations où s'opposent les passions les plus violentes, tout, dans ce livret, a frappé le jury qui n'a fait que de rares objections..... Peut-être eût-il remporté le prix proposé par Votre Excellence, si nous n'avions rencontré un poème qui, du premier coup, a réuni tous les suffrages et nous a paru hors ligne... Le mérite de ce poème que nous proposons à Votre Excellence de couronner est tout à fait supérieur. » Les mauvaises langues affirment que Catherine II eût été couronnée sans l'intervention du directeur de l'Opéra, membre du jury, qui, effrayé des dépenses que nécessiterait cet important ouvrage en cinq actes, fit pencher le choix de ses collègues sur la Coupe du Roi de Thulé, de moindres proportions et de mise en scène plus restreinte.
(**) Louis Gallet n'était guère connu à cette époque que par de jolies poésies, publiées dans l'Artiste ; Edouard Blau était déjà connu au théâtre, par l'opérette le Chanteur florentin, en collaboration avec Alfred Blau, mise en musique par J. Duprato et représentée, le 20 novembre 1866, non sans succès, sur le théâtre des Fantaisies-Parisiennes.
Bizet hésita longtemps avant de prendre part au concours ; il savait les conditions dans lesquelles ils s'effectuent, la plupart du temps, et le peu de garantie de sincérité artistique qu'ils offrent ; et puis, d'ailleurs, il était question, en ce moment, de lui confier un poème pour l'Opéra.
Le projet n'eut malheureusement pas de suite ; alors, sa Symphonie, à laquelle il n'avait jamais cessé de penser, n'absorbant qu'une fort brève partie de ses journées, libre de son temps, malgré les excellentes raisons qui l'avaient d'abord fait hésiter, malgré la certitude, presque complète, de l'inutilité de ses efforts, il se mit à composer la musique de la Coupe du Roi de Thulé.
Il avait engagé son ami, M. Edmond Galabert, autrefois son élève, à travailler pour ce concours, et celui-ci avait entrepris, de son côté, la composition de la Coupe, « à titre d'exercice », nous dit-il modestement. Dès lors s'établit entre le maître et l'élève, qui habitait le Midi, une intéressante correspondance. Bizet donnait au jeune amateur de précieux conseils ; il étudiait avec lui les personnages, fouillait leurs caractères, mettait en relief les côtés saillants de leur nature, les multiples facettes de leur changeante physionomie ; en même temps, il indiquait les moyens à employer pour traduire musicalement les sentiments divers qui les agitent, pour faire saillir les traits qui les différencient et établir, nettement, leur entité musicale.
Il lui donne d'abord des conseils d'ensemble, portant sur l'œuvre entière, ou plutôt, sur toute œuvre musicale scénique : « En général, lorsque vous avez un texte important, faites en sorte d'avoir à l'accompagnement des accords détachés et des traits dans les blancs du chant. » Ailleurs, réagissant contre cette tendance qui pousse certains artistes à exprimer les vagues sentiments de l'âme par une musique qu'ils croient la traduction saisissante du sentiment à exprimer, et qui n'est, souvent, qu'un galimatias sans forme, le produit d'une habileté de main plus ou moins grande : « sans forme, écrit-il, pas de style, et sans style, pas d'art... La rêverie, le vague, le spleen, le découragement, le dégoût, doivent être exprimés, comme les autres sentiments, par des moyens solides. Il faut toujours que ce soit fait ».
Puis, vient l'étude du poème ; scène par scène et pour ainsi dire pas à pas, Bizet étudie, commente, développe, avec une clarté et une pénétration bien grandes ; il met en lumières les traits saillants qui devront guider le musicien dans la peinture de ses personnages, traits bien faiblement indiqués, parfois, par les librettistes, « mais, dit-il, c'est au musicien à réparer cette faute »...
Il composa, de son côté, la musique du premier acte de la Coupe : « J'ai terminé le premier acte de la Coupe du Roi de Thulé, écrivait-il alors à Guiraud, et j'en étais ravi ; mais... j'ai changé d'avis et je n'irai pas plus loin. » Il travaillait pourtant au second, dont il avait déjà écrit plusieurs fragments, lorsqu'on lui demanda un ouvrage pour l'Opéra-Comique : « Je suis charmé de lâcher le concours, et d'essayer de changer le genre de l'Opéra-Comique. » Et, de fait, il abandonna la composition de la Coupe du Roi de Thulé. Plus tard, comme on le pressait de reprendre ce travail : « J'ai revu mon premier acte de la Coupe, à deux reprises différentes : la première fois, j'ai trouvé cela tout bonnement admirable ; la seconde fois, cela m'a paru infect (*). » Et le concours fut abandonné définitivement...
(*) Lettre à Ernest Guiraud.
Le Théâtre-Lyrique était passé, depuis le mois de septembre de l'année 1868, des mains de Carvalho à celles de Pasdeloup, sans trouver une meilleure fortune ; le répertoire du malheureux théâtre allait s'appauvrissant des chefs-d'œuvre qu'il avait produits, qui avaient fait sa gloire et avaient, un instant, ralenti sa chute ; Faust étincelait à cette heure sur la scène de l'Opéra ; Roméo, Mireille, les Dragons de Villars, allaient émigrer à l'Opéra-Comique ; la catastrophe finale était imminente (*). On conçoit, dès lors, que Bizet qui, sept ans auparavant, avait refusé d'aborder la scène de l'Opéra-Comique avec une œuvre conçue selon le rite esthétique des jours passés, tandis qu'il croyait à l'avenir glorieux de la scène jeune, vivante, que dirigeait alors Carvalho, ait consenti, à ce moment, à déserter ce théâtre de ses premières luttes et de ses espérances. Mais, s'il revenait vers la scène de la rue Favart, d'où il s'était volontairement banni, c'était avec l'inébranlable résolution de rester fidèle à ses principes et de ne pas mentir, d'être et de rester lui, et, fût-ce même avec un ouvrage en un acte, « d'essayer de changer le genre de l'Opéra-Comique » où la convention prend une importance vraiment trop grande, trop incompatible avec le sentiment élevé de l'Art.
(*) « M. Gounod, qui a délaissé, cet hiver, le Théâtre-Lyrique, ainsi qu'on a pu voir, a transféré, par traité, tout son répertoire (Faust excepté) à M. de Leuven : le Médecin malgré lui, Philémon et Baucis, Mireille, et même Roméo et Juliette (qui semblait plutôt convenir au Grand-Opéra). — C'est dit-on, le premier apport et cadeau d'avènement de M. Du Locle, qui va, comme on sait, succéder à M. Ritt auprès de M. de Leuven. » (le Ménestrel, 30 mai 1869.)
SYMPHONIE SOUVENIRS DE ROME — IL REPREND ET TERMINE NOÉ. — CALENDAL. — GRISELIDIS. — CLARISSE HARLOWE.
Deux ans, il travailla à sa Symphonie ; non pas d'un travail de tous les instants, qui poursuit un but immédiat et s'obstine après l'idée fugitive, mais intermittent, souvent interrompu, toujours repris dans les moments de calme et de tranquillité. C'est vers le milieu de l'année 1866 qu'il conçut l'idée première de cette Symphonie. Il se mettait aussitôt au travail, jetait les premières assises. traçait le plan général, qu'il devait modifier plus d'une fois, esquissait les premiers contours. Quelque temps, on l'a vu, il essaya de faire marcher de front la composition de cette œuvre, pour laquelle, il le dit lui-même, il avait « un faible marqué », et celle de la Jolie fille de Perth, qu'on venait de lui commander ; mais il avait trop présumé de ses forces ; les leçons, les travaux d'éditeurs, absorbaient la meilleure partie de son temps ; il dut réserver le reste à son opéra et abandonner, momentanément, la Symphonie. Il la reprit après la Jolie fille, sans s'y adonner exclusivement, car nous l'avons vu, à la même époque, travailler d'abord à Noé, écrire ensuite de la musique instrumentale, commencer enfin la composition de la Coupe du Roi de Thulé.
Pendant ces deux longues années de travail et de chercheuse rêverie, — car, même aux jours les plus difficiles de cette période agitée de sa vie, où, débordé de besogne, il reprenait sur son sommeil les heures que, pour assurer ses besoins quotidiens, il avait dû soustraire à la composition de sa Jolie fille de Perth ; aux jours, plus pénibles encore, où, agitée par des sentiments divers qui la faisaient brusquement passer par des émotions si opposées, son âme commençait à désespérer, il n'avait jamais cessé de penser à son œuvre préférée, — pendant ces deux longues années, dis-je, le plan général de la Symphonie avait été complètement modifié.
Il avait, d'abord, eu l'intention d'écrire une Symphonie dans la forme de celles de Mendelssohn, dans laquelle il eût intercalé le Scherzo de son troisième Envoi de Rome, ce Scherzo déjà entendu aux Concerts populaires et aux Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts, dans le courant de l'année 1863. Mais, bientôt, certaines modifications lui parurent nécessaires. Il pensait, non sans raison, qu'il ne devait pas s'en tenir aux formes qu'avaient immortalisées les Maîtres, qu'il devait chercher à innover, ne fût-ce qu'en partie, et donner ainsi à son œuvre un accent original bien personnel, et, sans changer encore le plan général de sa Symphonie, sans en modifier essentiellement la forme, il entrevit, pour le premier morceau, un thème avec variations. Après quelques mois de méditations et de recherches, les variations furent abandonnées à leur tour et le thème fut seul conservé ; encore perdit-il de son importance et fut-il relégué au second plan...
De nouveaux changements survinrent encore ; le Scherzo fut supprimé ; l'Andante fut largement développé, au moyen de la seconde phrase du finale s'arrangeant admirablement dans ce mouvement lent ; enfin de modifications à changements, Bizet en vint, peu à peu, insensiblement, à transformer complètement son œuvre et à lui donner la forme et les proportions d'une grande Fantaisie descriptive.
Alors, seulement, il fut satisfait (*) : « J'ai terminé la Symphonie, écrivait-il (**), j'ai renoncé aux variations. Je crois que le premier morceau sera bon. C'est l'ancien thème précédé d'une importante introduction calme, qui revient au milieu, dans l'agitation, et termine le morceau dans une tranquillité complète... C'est nouveau et je compte sur un bon effet... Le milieu de l'andante est le deuxième motif du finale qui s'arrange à merveille dans ce mouvement large : Curieux !... Satanée musique ! On n'y comprend rien ! »
(*) Si le Scherzo fut supprimé, il faut bien convenir que ce ne fut pas sans protestations de la part de Bizet ; mais Pasdeloup, se rappelant l'accueil que lui avait fait son public du Cirque le 11 janvier 1863, les lettres menaçantes qui en avaient été la conséquence, craignant une nouvelle manifestation hostile, conseilla au jeune artiste cette suppression provisoire : « Faisons entendre la Symphonie sans le Scherzo, lui dit-il, et une fois qu'elle aura obtenu le succès qu'elle mérite et qui ne saurait être douteux, à la troisième ou quatrième audition, nous glisserons le Scherzo qui passera comme une lettre à la poste. » Malheureusement, Souvenirs de Rome n'eut qu'une audition. Ce ne fut que le 31 octobre 1880, cinq ans après la mort de Bizet, lors de la 2e audition da la Symphonie sous le titre de Roma, que le Scherzo reprit sa place et obtint les honneurs du bis, aux mêmes Concerts populaires où il avait été d'abord conspué. — La symphonie Roma devait être gravée du vivant de Bizet ; l'éditeur Choudens s'était engagé, mais des retards survinrent et ce ne fut qu'après la mort du Maître, parmi ses œuvres posthumes, que la partition gravée put paraître. C'est ce qui a fait croire que Roma était une œuvre posthume.
(**) Lettre à M. Edmond Galabert, juin 1868.
La Symphonie, qui avait reçu le nom de Souvenirs de Rome, fantaisie symphonique, fut exécutée par l'orchestre Pasdeloup, au Cirque Napoléon, le dimanche 28 février 1869.
Voici le programme de ce concert du 28 février :
Jubel. Ouverture Weber.
Souvenirs de Rome (1re audition). Fantaisie symphonique G. Bizet.
1° Une chasse dans la forêt d'Ostie.
2° Une Procession.
3° Carnaval à Rome.
Allegro agitato Mendelssohn.
Mazurka (arrangée par Mme Viardot. Chantée par Mule Schrœder) Chopin.
Septuor Beethoven.
Comme on le voit, chacun des différents morceaux avait reçu une désignation spéciale. Est-ce à dire que Bizet avait eu en vue les différentes scènes qu'il paraît avoir voulu traduire musicalement ? Je ne le crois pas. Ce n'est qu'au cours des modifications successives qu'il avait fait subir à son œuvre, je l'ai déjà dit, que l'idée lui était venue de faire de la musique descriptive. Le titre Souvenirs de Rome a été choisi à la dernière heure, et les désignations des différents tableaux, certainement, une fois l'œuvre terminée, parce qu'ils s'adaptaient bien aux scènes musicales dont ils résumaient le mouvement et la couleur. J'excepte, toutefois, le Carnaval de Rome qui a été conçu et exécuté sur la donnée descriptive bien établie.
La Symphonie Souvenirs de Rome n'eut qu'une seule audition, le 28 février. Le dimanche 4 avril les Concerts populaires de Musique classique faisaient leur clôture annuelle et il ne fut plus question de l'œuvre préférée de Bizet. Et puis, d'ailleurs, en avait-il été bien sérieusement question un seul instant ? Hélas ! c'est bien triste à dire, mais Souvenirs de Rome était passé inaperçu. Oui, le silence, la pire de toutes les insultes, se fit autour de la belle Symphonie de Bizet. Je comprends à la rigueur, sans l'excuser, le mutisme des grands journaux politiques ; mais les journaux spéciaux, l'Art musical, le Ménestrel, etc.... Muets comme les autres !...
Le public du concert du 28 février n'avait pas imité la prudente réserve des journaux et revues ; il avait manifesté, bruyamment, et son verdict, malgré tout, parut satisfaire Bizet. Lisez la lettre curieuse qu'il écrivait, à ce sujet, dans les premiers jours de mars (*) : « Ma Symphonie a très bien marché. — Premier morceau : une salve d'applaudissements, quelques chut ! seconde salve, un sifflet, troisième salve. — Andante : une salve. — Finale : beaucoup d'effet, applaudissements à trois reprises, chut ! trois ou quatre coups de sifflet. En somme, succès. »
Qu'on ne s'étonne pas de ces protestations éparses au milieu des applaudissements et qu'on n'accuse pas, surtout, Bizet d'être peu exigeant, en se contentant d'un succès ainsi mitigé par des chut ! et des sifflets. C'était alors, on s'en souvient, la belle époque des protestations systématiques et ridicules aux concerts de musique classique du Cirque. Pasdeloup, après avoir acclimaté en France la musique instrumentale des grands Maîtres Allemands, après avoir forcé l'admiration rebelle, produisait, alors, les œuvres symphoniques de nos jeunes musiciens Français. Sans se laisser décourager par les hostilités qui avaient accueilli ses premières tentatives, il allait toujours de l'avant. Mais le clan des imbéciles ne désarmait pas ; à chaque œuvre nouvelle, nouvelles protestations ; quelques chut !, un sifflet, d'ordinaire, suffisaient ; c'était assez pour bien établir la protestation. Mais, quand l'œuvre en valait réellement la peine et était reconnue dangereuse, on lui faisait les honneurs d'une bordée. On le voit, la Symphonie de Bizet avait été bien traitée ; on lui avait accordé une protestation de première classe.
(*) Lettre à M. Edmond Galabert.
L'effervescence s'est calmée peu à peu ; en 1874, 1875, quelques rares sifflets se faisaient bien entendre, de-ci, de-là, mais l'opposition était domptée, le clan des imbéciles définitivement vaincu (*). Aujourd'hui on ne siffle plus que les œuvres qui le méritent ; encore se montre-t-on, a ce sujet, d'une indulgence quelquefois coupable, ce en quoi on a tort, vraiment.
(*) Ces quelques coups de sifflet isolés qui accueillirent la Symphonie de Bizet, ne sont certes rien comparés au tumulte épouvantable, aux injures et aux cris qui saluaient les plus belles pages de Wagner. Le 12 décembre 1869, Pasdeloup donnait une première audition de l'ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg. L'ouverture est sifflée à outrance. Pasdeloup prend la parole au milieu du tumulte : « Je comprends parfaitement, dit-il, qu'on ne saisisse pas, à une première audition, une œuvre de cette importance » ; et en même temps il annonce une seconde audition pour le dimanche suivant.
Le dimanche suivant, le tumulte redouble et prend des proportions inconnues jusqu'alors.
Huit jours après, nouveaux cris, nouveaux sifflets. Cette fois le bon Rameau est fortement éclaboussé. Une partie du public ayant voulu bisser un fragment du ballet de Dardanus, l'autre partie siffle et proteste. Quand vient le tour du prélude de Lohengrin, annoncé au programme, les ennemis de Dardanus acclament et bissent ; les partisans du vieux Rameau protestent et crient à leur tour ; sifflets, hurlements d'un côté, applaudissements frénétiques, cris d'enthousiasme de l'autre ; rien ne manque à la petite fête. — Et il en était ainsi, souvent, fort souvent, aux concerts populaires de musique classique du Cirque Napoléon.
La Symphonie Souvenirs de Rome ne fut plus exécutée du vivant de Bizet. Après sa mort, l'éditeur Choudens l'a publiée parmi les Œuvres Posthumes ou soi-disant Posthumes, car, dans le nombre, je retrouve de vieilles connaissances : la Symphonie, d'abord, qui a changé de titre et qui s'appelle Roma, puis quelques œuvres de première jeunesse, dont la plus importante, l'Ode Symphonique Vasco de Gama, exécutée pendant l'hiver de 1863, aux Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts, est le second envoi de Rome du Maître.
La Symphonie, ainsi rebaptisée, a aussi subi quelques modifications.
A l'exception du finale, toujours rubriqué : Carnaval, les deux autres parties ont perdu leurs désignations descriptives. Le titre Chasse dans la forêt d'Ostie a été remplacé par Introduction-Allegro, et Procession par Andante ; de plus, le Scherzo, suivant l'idée première de l'artiste, a repris sa place. La Symphonie Roma comprend donc aujourd'hui quatre numéros au lieu de trois : 1° Introduction-Allegro, 2° Andante, 3° Scherzo, 4° Carnaval.
C'est ainsi qu'elle fut exécutée aux Concerts Pasdeloup, le 31 octobre 1880, cinq ans après la mort de Bizet (*). Le Scherzo et le Carnaval furent surtout très applaudis. Elle a été donnée de nouveau, avec un très grand succès, aux Concerts de l'Association Artistique, au théâtre du Châtelet, le dimanche 18 janvier 1885 ; le Scherzo a été bissé à l'unanimité et la Symphonie, dans son ensemble, très applaudie. Devant cette faveur marquée de son public, Colonne s'empressa de donner, à son concert du dimanche suivant 25 janvier, une seconde audition de la belle symphonie de Bizet. Depuis lors, elle n'a cessé de figurer au répertoire des Concerts du Châtelet où elle a été exécutée, à plusieurs reprises, et toujours avec succès (**).
(*) Programme du Concert populaire de Musique classique du 31 octobre 1880 :
1° Ouverture de Léonore Beethoven.
2° Roma, symphonie posthume de Georges Bizet.
3° Berceuse pour instruments à cordes Reber.
4° Concerto de violon Antoine Rubinstein
(**) Notamment aux concerts du 21 novembre 1886 et du 29 décembre 1901 où l'accueil du public fut particulièrement chaleureux.
Bizet n'était pas un symphoniste, au sens moderne du mot ; la polyphonie instrumentale n'était pas son moyen d'expression. Il était essentiellement musicien dramatique et il s'en rendait parfaitement compte (*). La scène le sollicitait, l'attirait ; il avait le don de l'évocation musicale, qu'il ne faut pas confondre avec le goût du réalisme. Il savait faire vivre, d'une vie intense, dans les milieux les plus divers, toujours poétiquement exacts et colorés. Aussi la symphonie Souvenirs de Rome doit-elle être considérée comme un essai, une expérience qu'il n'aurait probablement pas renouvelée...
(*) Parlant dans son article de l'Écho de Paris du 19 février 1911 des amertumes de ses débuts et en général des difficultés qu'éprouvaient, à cette époque, pour aborder la scène, les jeunes musiciens, C. Saint-Saëns écrit, parlant de Bizet : « Tu es le moins malheureux, me disait-il, tu peux faire autre chose que du théâtre ; moi, je ne le puis pas. »
Après son mariage avec Mlle Geneviève Halévy (*), la fille de l'illustre auteur de la Juive, Bizet, pour complaire a sa nouvelle famille, et aussi pour remplir ce qu'il considérait comme un hommage pieux à la mémoire du Maître dont il avait toujours été l'élève préféré, revint à l'idée de terminer Noé. Il reprit donc la partition inachevée, pour la mener à bonne fin cette fois. Noé devait être représenté au Théâtre-Lyrique. A la fin de septembre 1869, Bizet avait déjà livré les deux premiers actes et s'était engagé, par traité, pour le restant de l'œuvre ; mais aussi, toujours par traité, il avait fait des réserves expresses au sujet de l'interprétation, les artistes composant la troupe du Théâtre-Lyrique ne lui paraissant pas suffisants.
(*) Le 3 juin 1369 Bizet épousait Mlle Geneviève Halévy.
Conformément aux engagements pris, le 1er tableau du troisième acte de Noé était livré le 25 octobre, et le second tableau le 15 novembre, trois semaines après, jour pour jour. Alors commencèrent les difficultés qu'il avait prévues ; la basse et la première chanteuse manquaient ; aucun des artistes du Lyrique n'était à la hauteur de ces principaux rôles de Noé ; on chercha ailleurs, mais vainement. « La Basse et la Première Chanteuse me manquent, écrivait-il. Je ne les vois nulle part, et si je ne les trouve pas, Noé attendra. » Noé attendit. Le Théâtre-Lyrique croula une seconde fois, la guerre survint, Noé ne fut pas représenté... (*)
Tout en mettant la dernière main à Noé, il ne perdait pas de vue l'ouvrage que lui avait commandé l'Opéra-Comique ; Noé terminé et livré, au milieu des soucis et des ennuis de toute sorte que lui causait la recherche des deux interprètes introuvables, il y consacra tout son temps.
(*) Noé a été représenté, avec un grand succès, le dimanche de Pâques, 6 avril 1885, sous la direction de Félix Mottl, sur la scène du théâtre Grand-Ducal de Carlsruhe. La partition piano et chant a été publiée par Choudens.
Il avait d'abord choisi un opéra-comique en trois actes de Paul Ferrier, Calendal, mais, quand il eut acquis la certitude que le sujet ne plaisait pas à Du Locle, directeur de l'Opéra-Comique, il s'empressa de renoncer à son idée et de rendre le poème (*).
(*) Bizet s'était d'abord pris d'un bel enthousiasme pour Calendal ; il avait recopié le manuscrit, employant des encres de différentes couleurs pour chacun des rôles de la pièce. C'est ce manuscrit qui fut rendu à M. Ferrier. A la mort de Bizet, M. Ferrier s'empressa de faire don à sa jeune veuve de ce précieux souvenir.
Il s'était alors adressé à Sardou, qui avait écrit pour lui un poème d'opéra-comique en trois actes : Griselidis, et comme, vers la même époque, Philippe Gille, de son côté, lui avait remis un livret également en trois actes, dont la Clarisse Harlowe de Richardson fournissait le thème, et qu'il en était très satisfait, il se mit à mener de front les deux ouvrages. Il en commença la composition vers le milieu du mois de mai de l'année 1870 ; mais il donna le pas à Griselidis, et, quoiqu'il songeât beaucoup à Clarisse, qu'il s'occupât d'elle au point d'en écrire d'importants fragments, qui ont été retrouvés et utilisés après sa mort, l'œuvre de Sardou prit la meilleure part dans ses préoccupations du moment. Dans une lettre écrite le 26 février 1871, Bizet déclarait la partition de Griselidis « très avancée » ; Clarisse était, au contraire, « à peine commencée » à cette époque. Ni l'un ni l'autre de ces deux importants ouvrages ne devait être achevé.
Bizet fut élu, en cette même année 1870, membre du jury chargé de juger le concours pour le grand prix de Rome (*).
(*) Voici la composition du jury : MM. Auber, Georges Bizet, Barbereau, Jules Cohen, Gevaert, Limnander, prince Poniatowski, Membrée et Vaucorbeil. — Bizet avait fait aussi partie du jury l'année précédente.
Depuis quelques années, déjà, le jugement du concours avait été enlevé à l'Institut pour être confié à un jury spécial. Bien qu'il réprouvât ce nouvel usage, pensant, avec raison, que l'on devait revenir, le plus tôt possible, à l'ancienne et excellente coutume de faire juger les élèves par l'Institut, dont l'autorité lui paraissait, seule, devoir être admise en pareille matière, il accepta de faire partie du jury.
Cette année les choses ne se passèrent pas sans encombre ; la décision des nouveaux juges fut aigrement et vivement discutée. Le prix avait été décerné à M. Henry Maréchal ; MM. Salvayre et Lefèvre, ce dernier à la limite d'âge, étaient restés sur le carreau.
La presse entière, le Figaro et le Gaulois en tête, prirent le parti des vaincus. « Cette année encore, disait de son côté le Ménestrel, le nouveau jury n'a pas répondu à l'attente générale ! » et l'on demandait à cor et à cri le retour à l'ancien état de choses, quitte à se plaindre, encore, après. L'émotion fut passagère et se calma bientôt cependant ; du reste, M. Taudou, le prix de Rome de l'année précédente, ayant renoncé, après quelques mois de séjour à Rome, aux bénéfices de sa pension, le Ministre des Sciences, Lettres et Arts avait décidé que les fonds, sans emploi par suite de sa renonciation, devaient être appliqués à un nouveau pensionnaire choisi parmi les concurrents de cette année 1870. Il fallut donc désigner un deuxième premier grand prix ; ce fut M. Lefèvre qui fut choisi, à la majorité de cinq voix sur neuf votants ; M. Salvayre devait attendre deux ans encore...
Nous étions à la veille de la guerre ; les événements que je viens de rapporter se passaient, en effet, dans la première quinzaine de juillet. Tandis que Paris, dans la joie, escomptait bruyamment nos victoires futures, — espoir chimérique que devait faire évanouir le premier coup de canon, mais qui, pour l'immense majorité de la nation, avait, à ce moment, la quasi-certitude d'une réalité qui va s'accomplir, — tandis que le Rhin Allemand et la Marseillaise faisaient florès et couraient les rues, Bizet voyait d'un œil attristé tout ce qui se passait autour de lui. Il était du petit nombre de ceux qui prévoyaient la catastrophe, et, ne pouvant rien faire pour l'empêcher, il déplorait amèrement l'aveuglement fatal qui nous entraînait, inconscients, à notre perte.
« Et notre pauvre philosophie, écrivait-il dans les premiers jours d'août (*), avant les premiers désastres, et nos rêves de paix universelle, de fraternité cosmopolite, d'association humaine !... Au lieu de tout cela, des larmes, du sang, des monceaux de chair, des crimes sans nombre, sans fin ! Je ne puis vous dire, mon cher ami, dans quelle tristesse me plongent toutes ces horreurs. Je suis Français, je m'en souviens, mais je ne puis tout à fait oublier que je suis un homme. Cette guerre coûtera à l'humanité cinq cent mille existences. Quant à la France, elle y laissera tout !... » Hélas !...
(*) Lettre à M. Edmond Galabert.
DJAMILEH
Esthétiquement, Djamileh est une œuvre de premier ordre ; musicalement, un petit chef-d'œuvre ; scéniquement, je ne crains pas de le dire, Djamileh est une erreur.
A qui la faute ? au librettiste ?... au musicien ?... A tous les deux sans doute, mais, encore et surtout, au directeur de l'Opéra-Comique.
Camille Du Locle était devenu, vers le milieu de l'année 1869, associé de de Leuven, directeur de ce théâtre. Il rêvait de rajeunir le répertoire de la vieille maison. Une ère nouvelle venait de s'ouvrir ; Auber étant mort, et avec lui le vieil opéra-comique jadis tant aimé du public, Du Locle pensait, avec raison, que la parole devait être aux jeunes, aux nouveaux venus dans l'Art, non pour s'évertuer à vagir sur les anciens rythmes, mais pour parler la nouvelle langue, cette langue si souple, si riche et si colorée qui était la leur.
Déjà, il avait pu enrichir le répertoire de son théâtre de la plupart des chefs-d'œuvre de Gounod ; maintenant, il appelait à lui les jeunes artistes que le Théâtre-Lyrique avait fait connaître et mis en lumière. A Bizet il confia le poème de Djamileh.
Peu porté par éducation et par goût vers les livrets d'opéra-comique dans le genre de Scribe, comédies à intrigues bourgeoises, Camille Du Locle voulait essayer une note nouvelle ; faire dévier le genre vers un idéal où la rêverie, la poésie extatique, l'élément symphonique pur, tiendraient une large place. Que de fois ne l'a-t-on pas accusé, même, de choisir, de préférence, des pièces où la pièce n'existait pas ! Il y avait là, évidemment, beaucoup d'exagération. Toujours est-il que c'est pour répondre à cette tendance, qui avait hâte de se manifester, que Louis Gallet, exagérant encore les idées du nouveau directeur de l'Opéra-Comique, avait écrit le poème de Djamileh.
Quoique l'ouvrage n'eût qu'un acte, Bizet avait accepté d'en composer la partition.
Depuis longtemps, déjà, il désirait écrire un opéra sur la Namouna de Musset (*) ; et puis, les idées de Du Locle, si heureusement mises en œuvre par le librettiste, répondaient trop bien à ses secrètes aspirations ; il voulait « essayer de changer le genre de l'opéra-comique », l'occasion se présentait et les circonstances les plus favorables semblaient conspirer en sa faveur. Connaissant ses sentiments, de tout temps hautement manifestés, sur ce genre vieilli, qu'il croyait incompatible avec les tendances élevées de l'Art contemporain, ses aspirations vers un idéal, un peu vague, peut-être, mais à coup sûr très noble et très élevé, on ne sera pas étonné qu'il ait perdu toute mesure, et que, ayant accepté d'écrire la partition de cette pièce si peu mouvementée, si peu faite pour le théâtre, il ait cru voir, non seulement dans la déviation du genre vers un but essentiellement poétique, mais aussi, peut-être, dans ces tendances antiscéniques, si ingénument manifestées dans le livret de Djamileh, la rénovation qu'il rêvait. Si bien que l'on se demande, en lisant cette partition, où les coups de pouce du grand Maître apparaissent fréquents, où la netteté et le charme profond de l'idée mélodique enveloppée de poésie, de couleur vibrante, jettent l'âme dans une suave rêverie, comment un artiste si merveilleusement doué, un musicien si sûr de son art, un poète si profondément original, a pu partager une aberration aussi étrange, et, de gaieté de cœur, laisser sacrifier l'intérêt scénique de son œuvre, au point d'en compromettre le succès certain, sans essayer de réagir contre des idées aussi fausses, si rigoureusement mises en pratique.
(*) Le poème de Louis Gallet s'était d'abord appelé Namouna.
Louis Gallet, j'en suis certain, n'a pas, en écrivant Djamileh, obéi à un esprit de système. Cet aimable écrivain, homme de talent, poète ne manquant ni de charme ni de couleur, nous a, depuis, surabondamment prouvé qu'il avait sur le théâtre les idées banales de presque tous ses confrères. Il croyait, comme tout le monde, que le mouvement, la vie, la structure générale de l'action scénique, doivent préoccuper, avant tout, l'auteur qui travaille pour la scène, et que, quand on écrit pour le théâtre, il faut avant tout faire du théâtre. De nombreux livrets, très mouvementés, bien coupés, abondants en situations, ont, en effet, depuis cette époque, fait à Louis Gallet une réputation de spécialiste de talent. De plus, je ne sache pas que le librettiste de Djamileh ait jamais passé pour un novateur audacieux, pour un artiste convaincu tâchant de faire triompher des idées bien personnelles. Je crois au contraire qu'il excella, surtout, à mettre en œuvre les idées d'autrui, à présenter et à encadrer, à l'aide d'une grande expérience lentement acquise, ce que de moins expérimentés ne savaient présenter tout seuls, en un mot, qu'il fut un adaptateur habile. D'où je conclus que Louis Gallet a bien pu n'être, en cette circonstance, comme en bien d'autres, comme en presque toutes les autres, que le traducteur des idées d'autrui, et qu'il a simplement mis en œuvre, en les exagérant, les théories sur lesquelles Camille Du Locle paraissait vouloir baser la régénération projetée.
J'ajoute que le sujet de Djamileh était merveilleusement choisi pour une tentative de ce genre.
Tout ne peut être traduit scéniquement ; il est des sujets qui, par leur nature même, échappent à l'action du théâtre ; Namouna est de ce nombre. L'analyse du sentiment qui s'empare d'Haroun et le transforme, qui d'un libertin sans vergogne fait un amant passionné, est d'une psychologie trop subtile pour servir de base à une action scénique ; elle est du domaine du livre, du poème, du roman, mais non du théâtre, qui vit de données moins vagues, et où les idées et les sentiments doivent découler des faits, ou, du moins, être les générateurs de faits qui intéressent et forment l'action, mais d'où l'analyse passionnelle pure doit être sévèrement proscrite.
Quant à Bizet, on connaît trop sa nature sincère, ennemie de toute contrainte, pour supposer qu'il ait subi, sans les partager, des idées si contraires aux principes ayant servi de bases à ses œuvres précédentes. On s'est étonné qu'un artiste de sa valeur, qui avait toujours manifesté un amour absolu pour la vérité scénique ; qui pensait que le premier souci du musicien doit être de s'attacher à approprier sa musique aux situations qu'il a à rendre, aux sentiments qu'il a à exprimer ; que la musique doit commenter, développer, expliquer l'action, la compléter au besoin, — et cela fut cause qu'on le traita de Wagnérien, comme la plupart des jeunes compositeurs de la Nouvelle École, à cette époque, — ait consenti à prêter l'appui de son talent à cette transformation de la Comédie musicale. Mais il est bon de remarquer que la peinture des caractères, la traduction des sentiments, qui forment ce que l'on pourrait appeler la partie psychologique de l'action, sont complètement indépendants du mouvement, de l'agencement scénique, de la structure de la pièce, c'est-à-dire de la partie matérielle et sensible ; que Bizet, dans Djamileh, comme dans ses autres œuvres, s'est toujours vivement préoccupé de l'effet scéniquement expressif de sa musique, qu'il s'est, comme toujours, attaché à la traduction exacte des sentiments, à la vérité des caractères; on ne peut donc que lui reprocher d'avoir accepté cet étrange et séduisant poème, et de l'avoir trop fidèlement exprimé. Il faut croire, pour expliquer cette passagère erreur, qu'il vit, dans cette exagération dont il se rendait parfaitement compte, un utile moyen de réaction contre un genre qu'il abhorrait. Il s'est trompé, il l'a reconnu, puisqu'il a abandonné la voie dangereuse dans laquelle il s'était engagé, pour écrire Carmen, un chef-d'œuvre de vie, de couleur pittoresque, de passion et de mouvement...
Dès le début de Djamileh, nous voilà en pleine poésie, en plein rêve. Nous sommes au grand Kaire, dans une salle du palais d'Haroun. Le soleil est à son déclin. Au fond, derrière une fontaine jaillissante, entre des colonnes de marbre rose, d'élégants mucharabis laissent apercevoir le ciel bleu. Haroun, étendu sur des coussins, fume nonchalamment son chibouck, en écoutant les chansons des bateliers du Nil, tandis que, près de lui, Splendiano, son intendant, accroupi devant une table basse, écrit des comptes.
Le chœur des bateliers du Nil est une chose vraiment merveilleuse. Les chants, d'abord lointains et à peine entendus, se détachent plaintifs et doux, dits par les soprani, sur des accords d'une harmonie vague et mystérieuse, murmurés, à bouche fermée, par les ténors et les basses ; le tambourin rythme gaiement la mesure, tandis que la mélodie, à la tonalité indécise, aux contours charmeurs, se rapproche, prenant, par intervalles, des inflexions d'une troublante langueur... Haroun, plongé dans la blonde fumée qui s'élève autour de lui en spirales odorantes, se laisse peu à peu aller à une douce rêverie. Le Cantabile qu'il chante est d'une poésie langoureuse et suave; l'orchestre, en sourdine sur un dessin continu de deux notes, fa et sol, répétée obstinément en triolets, le souligne et l'enveloppe de plus fines harmonies, des plus capricieuses arabesques au tissu léger, des plus ingénieuses combinai sons, toujours claires, simples et naturelles... Splendiano s'est assoupi ; Haroun, insensible à ce qui se passe autour de lui, se plonge dans son rêve.
Sur une large phrase, tendre et passionnée, exécutée dans le grave par les instruments à cordes, Djamileh, l'esclave amoureuse, apparaît. Elle entre par une porte latérale, s'arrête un instant devant Haroun qui ne la voit pas, puis, après avoir contemplé le maître qu'elle aime, elle s'éloigne discrètement en lui jetant un dernier regard chargé d'amour et de tendresse... Le chant des bateliers se fait entendre de nouveau, plus rapproché ; les barques défilent maintenant sous les murs du palais ; la mélodie, d'abord vague et lointaine, prend des contours plus nets, sans rien perdre de sa grâce troublante et de sa langueur.
Dans cette scène, ainsi que du reste dans toute la partition de Djamileh, excepté peut-être dans le pas de l'Almée où il a voulu serrer la vérité d'un peu plus près, Bizet a fait de la vraie musique orientale ; vraie, non par l'imitation servile des procédés naïfs, des instruments plus ou moins primitifs, des habitudes musicales — qui souvent affecteraient désagréablement nos oreilles — des peuples au milieu desquels se déroule l'action, mais par la couleur vibrante de ses harmonies, par l'accentuation pittoresque de sa mélodie, par ces mille riens combinés qui font que l'audition d'une belle page de musique, même purement instrumentale, éveille en nous les sentiments que le Maître a voulu y faire naître, et que, les yeux mi-clos, nous voyons, dans un rêve, flotter les douces images qu'il s'est plu à évoquer. N'est-ce pas là le vrai réalisme ? le vrai réalisme musical ? le seul que notre éducation et nos goûts puissent permettre ? C'est une vérité relative, une vérité poétique, qui interprète et qui traduit...
Les chants des bateliers ont cessé ; Haroun est sorti de sa rêverie ; il se lève et secoue Splendiano toujours endormi : « Hé ! Splendiano ! raconte-moi ton rêve, je te prie... » Haroun est un débauché qui se ruine sans compter ; il aime les vins choisis, « les beaux chevaux, le jeu, tous les plaisirs ruineux ». Tous les mois il lui faut une esclave nouvelle. Splendiano, après avoir été le précepteur de l'enfant terrible, est devenu l'intendant du garnement ; il essaye de ralentir la chute et met un peu d'ordre à ses affaires ; il tient ses comptes. « Eh ! lui dit Haroun, ne pouvons-nous pas nous ruiner sans compter ?... » Djamileh — on l'a deviné dès son apparition et sa pantomime expressive de la première scène — aime passionnément Haroun son maître ; mais celui-ci, qui n'a jamais connu l'amour, veut, malgré un sentiment qu'il se garde bien de laisser deviner à son confident, rester fidèle à ses habitudes ; tous les mois une esclave nouvelle doit remplacer celle qui l'a précédée dans les bonnes grâces d'Haroun.
Pour la première fois, le débauché laisserait passer le terme fixé sans s'en apercevoir, si Splendiano, qui en bon intendant veille aux plaisirs du Maitre, comme il gère ses affaires, ne prenait le soin de le lui rappeler, avec d'autant plus d'empressement qu'il est lui-même amoureux de Djamileh, et qu'il espère pouvoir se faire aimer d'elle, une fois qu'Haroun l'aura abandonnée... Le mois est passé bien vite ! Bah ! Haroun restera fidèle à son principe de ne pas aimer. Ce qu'il aime, ce n'est pas une femme, ce n'est pas Djamileh, c'est la femme. Le duo d'Haroun et de Splendiano est charmant : beaux vers, musique exquise.
Les couplets d'Haroun, encadrés dans le duo :
Tu veux savoir si je préfère
La Mauresque aux yeux languissants...
sont d'une forme très originale ; le refrain en sol bémol : « Que l'esclave soit brune ou blonde », profession de foi de l'épicurien, est d'une saveur et d'une pénétration bien grande ; il règne, dans toute cette scène, un souffle de sensualisme voluptueux qui enivre (*).
(*) Ces couplets ont été reproduits dans le Recueil de vingt Mélodies de Georges Bizet sous le titre : J'aime l'amour ; ils occupent le n° 6 du Recueil.
Sur la belle phrase qui a annoncé sa venue, à la première scène, Djamileh paraît ; elle baise la main qu'Haroun lui a tendue :
Quelle pâleur est sur ta joue ?
Quelle ombre furtive a glissé
Sur ton front si pur...?
lui demande le débauché. — J'ai fait un rêve ! — Enfant ! répond Haroun en la baisant au front.
On sent l'amour au fond de ce cœur endurci ; mais l'orgueil, les vices, sont encore les plus forts et étouffent, ou du moins refoulent, la douce vision du bonheur, la radieuse image de Djamileh. Le trio est d'une exquise poésie. Tandis qu'Haroun cherche à ramener la confiance dans le cœur de Djamileh, et que, craintive, la charmante enfant raconte le rêve qui l'a effrayée, Splendiano, dirigeant les esclaves chargés de mets, préside aux apprêts du souper — le dernier repas que Djamileh doit prendre dans la maison du Maître. Splendiano doit, après le départ d'Haroun, lui remettre quelques cadeau une bourse de sequins, puis lui donner « la volée », aller chercher une autre esclave. Arakel, le marchand, est prévenu et va venir avec son gracieux bataillon ; pour le choix, comme toujours, Haroun s'en rapporte au goût de son fidèle Splendiano. La pauvre Djamileh ignore ce qui va se passer, mais son cœur est agité de bien tristes pressentiments. Splendiano, lui, est heureux, ravi ; il voit, avec délices, venir l'instant où la jeune fille, libre enfin, pourra accueillir ses vœux, et il ne doute pas de son bonheur. En attendant, il remplit les coupes et le souper commence. Haroun et Splendiano boivent, mais Djamileh repousse la coupe que lui tend Haroun.
Eh bien, si ta lèvre repousse
Cette blonde liqueur,
Dis-moi quelque chanson...
Splendiano prend un luth sur un meuble et le présente à Djamileh, qui chante alors :
Nour-Eddin, roi de Lahore,
Est fier comme un dieu,
Il est beau comme l'aurore ;
Ses yeux sont de feu ! etc...
Bizet a donné à ce morceau le nom de Ghazel (*), ce qui st l'appellation d'une forme poétique orientale ayant de grandes analogies avec notre Ballade ; c'est assez dire qu'il a eu l'intention d'écrire un morceau caractéristique ; et de fait, cette page est une des plus finement colorées, des plus suavement poétiques, de cette partition à mille facettes chatoyantes ; c'est une perle fine, des plus précieuses, enchâssée dans ce bijou qu'est la partition de Djamileh...
(*) Le Gazel ou Gazal, et non Ghazel, comme l'orthographie Bizet, est un genre de poésie appartenant aux littératures Arabe, Persane, Turque et Hindoustanie. C'est une ode, d'une douzaine de vers au plus, lesquels, comme dans le Cacida, sont sur une même rime, à l'exception du premier vers dont les deux hémistiches doivent rimer ensemble. Les règles sont très généralement suivies de tout point. Le dernier vers du Gazel contient, le plus souvent, le nom du poète ou le pseudonyme qu'il s'est choisi.
Mais les amis de Haroun viennent d'arriver ; ils viennent le chercher pour jouer jusqu'à l'aurore. C'est le moment où Djamileh, confiante, rassérénée, heureuse, va apprendre son sort ; « c'est la fin de la comédie », dit Haroun. Comme il se calomnie ce malheureux, ce débauché endurci dans ses vices ; il aime Djamileh, mais l'orgueil est le plus fort ; il ne peut avouer qu'il aime, qu'il est vaincu, lui, le sceptique, le blasé, et il quitte la douce enfant, sans faiblesse apparente, mais avec un regret au fond du cœur, un regret qu'il n'a jamais éprouvé pour les autres. Il lui passe au cou un beau collier de perles, et, saisissant sa main, qu'il serre dans les siennes : « Enfant ! tu entres dans la vie ; tu es bonne, aimante ; le bonheur t'est promis, sans doute ; souviens-toi de moi. » Djamileh le regarde, tout interdite ; elle ne comprend pas ; voici Splendiano qui va lui apprendre la vérité.
Le chœur des amis d'Haroun et l'ensemble qui suit, sont d'une couleur charmante et d'un heureux mouvement ; il en est de même de la chanson chantée en chœur quelques scènes plus loin : « La fortune est femme... » Je me garde bien d'analyser toutes ces choses exquises, de porter une main téméraire sur ces curieuses, sur ces ingénieuses inventions d'un artiste délicat, d'un esprit chercheur, toujours en quête d'imprévu, de nouveau — pourvu que l'imprévu, le nouveau, aient une saveur originale, un parfum poétique, un accent personnel — et qui ne craint jamais de s'égarer, même en allant parfois un peu loin, parce qu'il est sûr de lui-même et qu'il est maître de sa plume, qu'il guide toujours et ne laisse jamais courir au hasard...
Djamileh vient d'apprendre son sort ; elle est libre !... Splendiano s'est déclaré et a offert son amour à la pauvre abandonnée. « Il ose parler d'amour ! » s'écrie-t-elle. Hélas ! elle a tout perdu en perdant l'amour d'Haroun ; la liberté n'a pas de prix pour elle ; elle n'avait qu'un espoir, qu'un désir : rester toujours son esclave... une idée soudaine vient de jaillir de son cœur, une espérance : « Tu prétends m'aimer, Splendiano ?... Promets-tu de m'obéir ? »... Djamileh obtient alors d'être de nouveau présentée au maître : « Une autre esclave va venir ce soir ; eh bien ! présente-moi à sa place. En me reconnaissant, Haroun comprendra, peut-être, qu'il y a au monde un bien plus précieux pour moi que cette liberté... Si tu consens et... qu'il me repousse, eh bien, j'aurai perdu à la fois ma liberté et mon amour. Je serai ton esclave. » Splendiano, ravi et ne doutant pas un seul instant du dénouement, accepte avec empressement.
Ici se place un lamento d'une adorable poésie douloureuse et résignée ; malheureusement Mme Prelly. chargée du rôle de Djamileh, ne parvint jamais à rendre cette belle page avec tout l'accent de douce tristesse qu'elle comporte, de sorte qu'elle ne produisit pas l'effet que Bizet était en droit d'attendre. Ce fut, du reste, une bien grande faiblesse, de la part de Bizet, de s'être laissé imposer cette brune Djamileh, n'ayant aucune des qualités vocales et dramatiques qu'exige l'interprétation de cette chaude musique si poétique et si passionnée. Mme Prelly était une charmante femme du monde, d'une radieuse beauté, qui avait eu le caprice de fouler les planches de l'Opéra-Comique et qui avait débuté, quelque temps auparavant, dans la Zerline de Fra Diavolo ; elle aurait dû s'en tenir là et ne pas priver les auteurs de Djamileh de l'artiste de talent capable de comprendre, de sentir et de rendre l'admirable musique du jeune Maître. Il n'en fut malheureusement rien, et je crois, pour ma part, que l'interprétation très insuffisante de ce beau rôle de Djamileh ne fut pas sans exercer une grande influence sur le sort de la pièce...
Les esclaves arrivent, guidés par leur maître Arakel, le marchand. La petite Marche en ut mineur que Bizet a intitulée Mélodrame, déjà entendue dans l'ouverture dont elle forme le premier morceau, est d'une saveur étrange, avec ses heurts de notes d'un effet si piquant et si original.
Vient ensuite la danse de l'Almée.
Sur un signe du marchand, l'Almée, accroupie au milieu des autres esclaves, se lève et vient se placer sur le tapis que des serviteurs ont disposé au milieu de la scène ; les amis d'Haroun l'entourent et suivent, d'un œil ravi, tous ses mouvements. La Danse de l'Almée est accompagnée du chœur des amis d'Haroun ; c'est bien accompagnée qu'il faut dire, car tout l'intérêt, tout le charme capiteux, troublant, réside dans la symphonie instrumentale qui guide et souligne la danse voluptueuse de l'Almée. Bizet a voulu faire ici un pastiche de musique arabe, donner plus qu'une impression du tableau oriental, reconstituer le tableau lui-même, avec les déhanchements lascifs de la danseuse et l'accent pittoresque de la musique autochtone. Il a produit un morceau curieux, un spécimen très coloré de musique bizarre, et c'est tout ; de pastiche, point ; il est resté original malgré lui.
C'est dans l'emploi persistant de la note à côté qu'il a cru obtenir l'effet cherché. Sur une pédale continue, dans la tonalité de la mineur, la mélodie, folle et capricieuse, cabriole sans jamais se fixer, biaisant sans cesse, sans jamais se poser sur une tonalité franche ; il en résulte une grande fatigue, qui dégénérerait bientôt en énervement, si le musicien n'avait su borner sa course fantaisiste et donner, vers le milieu du morceau, plus assis et plus franchement tonal, sans excès cependant, quelques points de repère qui délassent. Je le répète, c'est une page intéressante, très mouvementée, très pittoresque, mais n'ayant rien à démêler avec la musique des indigènes des bords du Nil. Elle encadre merveilleusement la danse de l'Almée et donne, à toute la scène, un subtil parfum de poésie, d'un charme très réel et très profond.
Dans un tout autre caractère sont écrits les charmants couplets de Splendiano : « Il faut pour éteindre ma fièvre », que Potel chantait à ravir ; la mélodie est franche de rythme, d'une coupe très heureuse, d'un accent d'une justesse et d'une vérité charmantes. Splendiano se croit sûr de son bonheur et déjà il l'escompte en rêve ; il se voit, déjà, côte à côte avec la brune Djamileh, promenant sa rêverie amoureuse « sous les ombrages parfumés » ; il prend dans ses mains la petite main de la charmante enfant qui tressaille, ferme les yeux, et appuie languissamment sa jolie tête sur ses épaules ; alors... alors...
O rêve d'amour, ô délire !....
Je ne sais plus ce que je vois !...
Potel prêtait à Splendiano une physionomie qui s'efforçait d'égayer un peu la pièce, vainement le plus souvent, car le rôle de l'intendant qui aurait pu, sinon être bouffe, ce qui eût été contraire au caractère général de l'œuvre, mais du moins gai et plaisant, ne sait pas être franchement comique ou complètement ennuyeux.
Ce bon Splendiano a rêvé. Dans son délire amoureux, il n'ose dire le dénouement qu'il entrevoit. Hélas ! du rêve à la réalité la distance est encore plus grande que de la coupe à la lèvre... Conformément au pacte conclu, Djamileh prend la place de l'Almée ; elle attend, voilée, dans l'ombre ; Splendiano, qui ne doute pas du dénouement, se frotte les mains et rit à part lui, en songeant à la tête que va faire Haroun. Celui-ci vient d'entrer ; il a perdu et vient chercher de l'or. Tandis qu'il puise à même au coffret qu'a ouvert Splendiano et qu'il remplit sa bourse, il aperçoit, immobile, dans l'ombre, la blanche silhouette de Djamileh : « Tiens ! c'est la danseuse ! » Il s'approche d'elle et la regarde : « Tout à l'heure si provocante et maintenant tremblante et inquiète ! C'est singulier. Hé ! mignonne, t'aurait-on dit du mal de moi ?... » Il veut la prendre dans ses bras, Djamileh se dérobe et fuit. Cette résistance, à laquelle il n'est pas habitué, émoustille le libertin ; il ne songe plus au jeu, à ses amis qui l'attendent : « Ah ! mais, c'est délicieux, cette révolte reste ! » Puis, se tournant vers Splendiano ahuri et lui jetant sa bourse : « Prends cet or ; va jouer à ma place, va ! »... Alors il s'approche de Djamileh, qu'il continue à prendre pour l'Almée, et cherche à calmer ses frayeurs, à vaincre ses résistances. Djamileh fuit toujours. Alors, Haroun :
L'esclave dont tu prends ici la place
Avait moins de rigueur
Et je l'aimais...
— « Si vous l'aimiez pourquoi l'avoir bannie ? » répond douloureusement Djamileh. — « Si j'ai dit que j'aimais, ma chère, entendons-nous... » Et le libertin, honteux de l'aveu spontané qui a jailli de son cœur, cherche à se rattraper et à reconquérir sa propre estime... Djamileh essuie furtivement une larme. — « Pourquoi pleurer ? T'ai-je offensée ? » s'écrie Haroun, et, de nouveau, il s'élance vers elle ; mais elle s'éloigne de nouveau. Il va pour la suivre, elle court au fond de l'appartement et se trouve, tout à coup, éclairée par les rayons de la lune, pénétrant à travers les mucharabis ; alors, lentement, elle laisse tomber son voile. « Ah ;... s'écrie Haroun. Oui ! c'est elle !... Insensée. Elle m'aimait ! » Et il reste là, rêveur, accablé, insensible en apparence, tandis que Djamileh, anxieuse, désespérant de faire parler ce cœur mort, le contemple avec angoisse. Et cependant il l'aime !
Si l'amour était un mensonge,
Me sentirais-je ainsi troublé ?
mais il lutte contre son amour, contre lui-même, car toutes les forces de son être le poussent vers Djamileh. Il essaye de résister à l'émotion qui le gagne ; l'amour est le plus fort, et, au moment où la pauvre enfant, après une dernière prière, une dernière supplication, s'éloigne en gémissant, pour aller à la mort, loin du maître qu'elle aime et qui l'a repoussée, Haroun se précipite vers elle et la reçoit défaillante dans ses bras.
Chère enfant, c'était une épreuve,
O Djamileh ! mon âme, mon seul bien !...
Splendiano et les amis d'Haroun paraissent à ce moment ; inquiets de son absence prolongée, ils viennent voir ce qui se passe. A la vue de ses amis, Haroun ramène jalousement, sur les traits de Djamileh, le voile qu'elle avait laissé tomber sur ses épaules. Puis, lentement, il passe devant eux, la tenant enlacée. Arrivé sur le seuil de son appartement, il y fait entrer la jeune fille, et, se retournant vers ses amis stupéfaits, d'un geste il les congédie.
Ce duo final est un vrai chef-d'œuvre. Il est écrit dans un style élevé, avec une chaleur, une sincérité d'accent, une passion profonde. Le motif de la première scène, qui a souligné l'entrée de Djamileh, reparaît ici et amène une phrase passionnée du ténor : « Ah, chère enfant, c'était une épreuve ! » La phrase qui suit : « Ta lèvre parfumée peut cesser de mentir », est d'une tendresse passionnée, d'une poésie suave. Enfin la péroraison : « Viens, pour toi je veux vivre... » pleine de feu et de chaleur, termine, sur un accent d'une puissance bien grande, ce beau duo et cette œuvre remarquable, à laquelle il a manqué si peu de chose pour être un merveilleux chef-d'œuvre...
J'ai déjà parlé de Mme Prelly, pour constater l'influence néfaste que son concours dut exercer sur le sort de Djamileh, et pour blâmer Bizet de sa faiblesse ; le rôle d'Haroun, confié au ténor Duchesne, n'était guère mieux tenu. Cet artiste, alors au début d'une carrière qui devait avoir quelque éclat, possédait une fort jolie voix dont il usait en prodigue, mais avec beaucoup trop d'inexpérience. Il promettait beaucoup à cette époque, mais, pour interpréter comme il convient la musique nerveuse et colorée de Djamileh, il ne suffit pas de promettre. Traduttore, traditore ; le proverbe Italien eut bien raison cette fois ; Bizet fut trahi par ses interprètes, qui restèrent bien au-dessous de l'œuvre qu'ils interprétaient. Malgré tout, il ne leur en garda pas trop rigueur : « Djamileh n'est pas un succès », écrivait-il le 17 juin, c'est-à-dire trois semaines, environ, après la première représentation (*) ; « pourtant, je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus. La presse a été très intéressante, car jamais opéra- comique en un acte n'a été plus sérieusement et, je puis le dire, plus passionnément discuté. La rengaine Wagner continue. Reyer (les Débats), Weber (le Temps), Guillemot (le Journal de Paris), Joncières (la Liberté), c'est-à-dire plus de la moitié du tirage de la presse quotidienne, ont été très chauds. — De Saint-Victor, Jouvin, etc., ont été bons, en ce sens qu'ils constatent inspiration et talent, le tout gâté par l'influence de Wagner... Ce qui me satisfait, plus que l'opinion de tous ces messieurs, c'est la certitude absolue d'avoir trouvé ma voie. Je sais ce que je fais... (**) »
(*) La première représentation de Djamileh eut lieu le 22 mai 1872.
(**) Lettre à M. Edmond Galabert.
Jamais, en effet, Bizet n'avait été aussi bien traité par la presse. Sauf les discordances que le maître a lui-même signalées, sauf, encore, des restrictions sur les qualités scéniques, absentes cette fois, — restrictions portant, du reste, en grande partie, sur la valeur même du poème et sur son appropriation à la scène, — unanimement elle avait proclamé l'auteur de Djamileh l'un des musiciens les plus remarquables de notre temps. Et le soir de la première représentation, le public, lui-même, qui devait se montrer réfractaire quelques jours après, fit chorus avec la presse et les invités habituels des soirs de première, à tel point que l'on dut, un instant, croire à un très grand succès. « Aux applaudissements des amateurs sérieux, écrivait quelques jours après le feuilletoniste de la Liberté (*), sont venus se joindre les bravos de la foule ignorante qui, d'abord dépaysée dans ce nouveau milieu, où la transportait l'imagination poétique du musicien, a subi bientôt, sans s'en douter, l'influence irrésistible du parfum oriental qu'exhale la partition de M. Bizet. »
(*) La Liberté du 27 mai1872 (Victorien Joncières).
Hélas ! la nouvelle œuvre de Bizet eut le sort de ses devancières ; acclamée le soir de la première représentation, comme avaient été acclamés les Pêcheurs de perles et la Jolie fille de Perth, elle ne devait pas fournir une bien longue carrière. Elle se traîna péniblement jusqu'à la dixième représentation — encore les trois dernières, espacées par de longs intervalles, ne furent-elles données que comme complément d'un spectacle un peu court, qu'elles étaient destinées à compléter. Enfin , le 29 juillet, apparut pour la dernière fois Djamileh ; depuis lors, plus jamais il n'en fut question,... si ce n'est entre délicats, pour qui cette œuvre exquise n'est pas morte.
L'ARLÉSIENNE.
Quel magicien prestigieux que Bizet ! Plus que tout autre, il possédait le don des évocations ; mais ses évocations étaient tout intuitives. Il chantait d'instinct, avec une justesse d'accent, avec une vérité de couleur qui surprenait les coloristes les plus exacts, ceux qui avaient préludé à leurs œuvres artistiques par de longs voyages, étudiant les mœurs, les usages, les arts des peuples qu'ils voulaient chanter. Dans les Pêcheurs de perles, dans Djamileh, il avait évoqué l'Orient qu'il ne connaissait pas, et l'évocation avait été si rayonnante, si lumineuse, et en même temps si exacte, si vraie, que Félicien David et Reyer avaient applaudi. « Voilà bien la vraie musique Orientale, écrivait Reyer, telle que l'ont comprise, du moins, ceux qui, étant allés dans le pays même, en ont rapporté des souvenirs. (*) » Voici maintenant la Provence, qu'il avait à peine entrevue, quatorze ans auparavant, en se rendant à la Villa Médicis, la Provence poétique, cette gueuse parfumée, qu'il a traduite avec une grâce, une fraîcheur d'inspiration, une couleur, un accent, un style véritablement merveilleux.
(*) Les Débats, 31 mai 1872.
Demain ce sera l'Espagne pittoresque, avec ses cigarières à l'œil noir, ses bohémiennes, ses toreros et ses bandits ; et la note sera toujours aussi exacte, aussi poétique, aussi vraie...
En ce temps-là, Carvalho était devenu directeur du Vaudeville. Malgré tous ses efforts, il n'avait pu dépouiller le vieil homme ; les souvenirs d'antan, de sa glorieuse, mais, hélas ! malheureuse direction du Théâtre-Lyrique, le harcelaient sans cesse. Il rêvait de faire une petite place, sur cette scène, jusqu'alors exclusivement littéraire, au dieu qu'il avait toujours adoré malgré ses injustes rigueurs ; en un mot, ne pouvant transporter l'opéra au Vaudeville, de faire de la musique le complément du drame et de ressusciter, d'une façon absolument artistique, le Mélodrame, tombé dès longtemps en désuétude.
II voulut confier cette tâche délicate à un écrivain de grand talent, — et il choisit Alphonse Daudet qui avait, précisément, une pièce provençale en préparation au Vaudeville, — et à un jeune musicien ardent, sincère et convaincu, — et, naturellement, il jeta les yeux sur Bizet.
C'est donc à Carvalho, à son initiative courageuse et si profondément artistique, que nous devons ce chef-d'œuvre complet, admirable, qui a nom l'Arlésienne, cette merveille de grâce, de fraîcheur et d'inspiration.
« On a jadis approuvé le Vaudeville, disait le Ménestrel (*), quand il supprima les couplets de la comédie afin de l'ennoblir ; faut-il l'approuver aujourd'hui, quand il introduit la musique dans le drame afin de l'enrichir ?... Posons mieux la question : ce qui ennoblissait la comédie, c'était d'en retirer les flonflons puérils, la musiquette ; ce qui enrichit le drame de l'Arlésienne c'est que les morceaux de symphonie et les Chœurs ne sont pas ici des trémolos ou des rondes vulgaires, comme à l'autre bout des boulevards, mais qu'ils sont l'œuvre d'un vrai musicien, vraiment inspiré cette fois. On le voit, tout se réduit à une question de tendance vers l'Art digne de ce nom. »
(*) Le Ménestrel, 6 octobre 1872.
Le cas de l'Arlésienne n'était d'ailleurs pas sans précédents. En Allemagne, où ce genre de production musicale a toujours été en grand honneur, les maîtres s'y sont exercés avec succès ; quelques-uns d'entre eux ont même laissé de grands chefs-d'œuvre en ce genre, parmi lesquels nous pourrions citer : le Roi Thamos dont Mozart écrivit la musique, le Comte Egmont de Beethoven, la Jeunesse de Henri IV, Turandot et Preciosa de Weber, la Harpe enchantée et Rosemonde de Schubert, le Songe d'une Nuit d'été, le chef-d'œuvre de Mendelssohn, Struensée de Meyerbeer, enfin Manfred de Robert Schumann.
En France, le Mélodrame est toujours resté l'apanage des médiocres ; je ne vois guère que deux grands artistes qui se soient exercés, comme Bizet, dans ce genre si peu en faveur chez nous : Gounod, qui avait écrit, quelques années avant l'Arlésienne, le prélude et les mélodrames des Deux Reines, de Legouvé (*), et Massenet, qui composa, quelque temps après, la musique de la belle pièce antique de Leconte de l'Isle : les Érinnyes.
(*) Les Mélodrames des Deux Reines furent exécutés ce même hiver, au Théâtre Italien, Salle Ventadour. Ils avaient été écrits six ans auparavant.
La tentative avait donc tout l'attrait de la nouveauté et devait vivement solliciter l'attention du Monde artiste. On connaissait trop Bizet, ses tendances élevées et son art impeccable, pour se méprendre, un instant, sur la portée de l'entreprise. On prêtait même à Carvalho l'intention de composer, le soir de la première représentation, une salle toute littéraire et artistique (*). Il n'en fut rien, malheureusement.
(*) Le Ménestrel, 29 septembre 1872.
La première représentation de l'Arlésienne eut lieu le 1er octobre 1872, quatre mois après Djamileh. Bizet avait rapidement, on le voit, composé sa nouvelle partition, qui ne comporte pas moins de vingt-quatre morceaux. Tous, il est vrai, n'ont pas la même importance ; mais tous sont traités avec un soin extrême ; les moindres mélodrames ont leur accent, leur style, leur couleur toujours vraie et sincère, et soulignent élégamment, naïvement, douloureusement, la pensée du poète, sans jamais l'écraser. Quel régal pour le musicien, pour l'artiste, d'entendre ces phrases exquises, au contour pur et élégant, ces fines harmonies, ces délicieux détails d'orchestre !
L'orchestre ! parlons de l'orchestre !... Le Vaudeville ne pouvait mettre à la disposition de Bizet de bien grandes ressources orchestrales : vingt-six musiciens, en tout ! Voici comment le Maître distribua ces rares combattants.
Il composa son orchestre de deux flûtes, un hautbois prenant le cor anglais, une clarinette, deux bassons, un saxophone, deux cors, un timbalier, sept violons, un seul alto, cinq violoncelles, deux contrebasses, et, comme cela ne faisait que vingt-cinq exécutants et qu'il pouvait user d'un vingt-sixième, à son choix, il eut l'excellente idée de faire soutenir son minuscule orchestre par un piano. Bien entendu, il n'employa jamais le piano à découvert, ou comme instrument concertant, si ce n'est pour faire des arpèges et suppléer la harpe absente, mais seulement dans les forte, pour augmenter la sonorité, remplacer, autant que faire se peut, les instruments en cuivre, et donner plus de consistance aux bois, un peu maigres.
Dans les coulisses, on avait installé un harmonium, pour soutenir les chœurs qui sont tous (*) chantés à la cantonade ; il était tenu, tantôt par Guiraud, tantôt par Bizet lui-même (**). L'effet fut excellent.
(*) Le chœur : Le flûtet se marie au pan pan pan du tambourin, le seul qui dût être chanté en scène, fut supprimé, on le verra plus loin.
(**) Parfois le jeune Antony Choudens, fils de l'éditeur des œuvres du Maître, les remplaçait.
Bizet, avec une habileté et une ingéniosité des plus rares, avait tiré un parti extraordinaire des faibles ressources dont il disposait ; il est vrai, aussi, qu'il n'eut qu'à se louer de sa mince phalange symphonique, et que les vingt-six virtuoses, tous de vrais artistes, conduits par le vaillant archet de leur chef d'orchestre, Constantin, pénétrés du chef-d'œuvre qu'ils interprétaient, exécutèrent « avec une perfection rare, un ensemble irréprochable, avec les nuances les plus délicates et un sentiment exquis, cette jolie partition de l'Arlésienne (*) ».
(*) Ernest Reyer (les Débats du 10 octobre 1872).
La musique de Bizet réunit, cette fois, tous les suffrages, ce dont Djamileh, l'œuvre du Maître la plus favorablement accueillie, n'avait pu encore se flatter. On fut d'accord pour louer sans réserves la fraîcheur de l'inspiration, le charme poétique, le coloris charmant épandu sur l'œuvre entière, la vérité pittoresque du paysage musical. « C'est de la musique dite savante, écrivait le feuilletoniste du Temps (*), mais où le travail se cache sous l'aisance avec laquelle il a été accompli, sans nuire à l'inspiration. »
(*) Johannès Weber (le Temps du 8 octobre 1872).
Quant à la pièce, — et je dis pièce, car c'est ainsi que l'Arlésienne fut désignée sur l'affiche, ainsi qu'elle est nommée dans le volume (*) qui réunit les œuvres dramatiques de Daudet, — on la discuta vivement. Cela devait être, étant donné les tendances, non pas antiscéniques, car lorsque la situation se présente Daudet sait la traiter avec force et vérité, mais descriptives et essentiellement poétiques de l'œuvre, et aussi son manque de vigueur et de mouvement.
(*) Alphonse Daudet : Théâtre (Paris, G. Charpentier, 1880).
Ce n'est ni une comédie ni un drame ; l'action est simple, presque banale, et serait sans intérêt, si l'auteur, — et c'est ici que le poète se révèle, avec tout son charme subtil, avec toute sa magie, — ne l'avait ornée de détails charmants, d'épisodes poétiques, d'une saveur exquise. C'est l'histoire d'un jeune fermier de la Camargue, Frédéri, le fils de Rose Mamaï la fermière de Castelet, follement épris d'une fille d'Arles. Il est sur le point de l'épouser, et déjà l'on célèbre à Castelet les fiançailles prochaines, lorsque l'on apprend, à n'en pouvoir douter, l'infamie de la jolie fille. Depuis deux ans, elle est la maîtresse d'un gardien de chevaux des marais de Pharaman. Désespéré, croyant que le mépris va tuer l'amour, le malheureux promet d'oublier ; il essaye... vainement ! Le souvenir de l'infâme créature est toujours vivant au fond de son cœur. Il veut aimer Vivette, une charmante jeune fille qui a grandi auprès de lui et qui l'aime, mais le souvenir de l'Arlésienne maudite est toujours là, qui se place entre ses lèvres et les lèvres de la chaste enfant, qui vient paralyser toutes ses effusions, glacer son cœur, raviver sa douleur inconsolée. Enfin, à bout de forces et de souffrance, une nuit, tandis que les paysans célèbrent la fête de la Saint-Eloi et dansent la farandole aux sons du flûtet et du tambourin, il se précipite de la fenêtre du grenier de la ferme et vient se briser le crâne sur le pavé de la cour.
Voilà le drame, dans sa brutalité presque banale : L'enfant qui aime et, dans son innocence passionnée, n'a pas compté avec les tristes réalités de l'existence, et qui meurt d'amour, malgré l'indignité de celle qu'il avait choisie.
Cette lutte d'un enfant de vingt ans contre un penchant irrésistible, qui le pousse à la mort, sous les yeux des siens impuissants, de sa mère qui l'adore, de son vieux grand-père accablé de douleur, voilà l'action, bien ténue et purement psychologique. Daudet est un descriptif ; il aime à analyser, à raconter et à dépeindre ; au théâtre, le public préfère voir, quel que soit le charme du conteur, l'esprit délié et subtil de l'analyste. Mais que de détails charmants, qui sont d'un poète exquis ; que d'épisodes touchants ou simplement gracieux, qui viennent ranimer, un peu, la marche languissante de l'action ! Et les personnages épisodiques ; quel charme profond ne dégagent-ils pas sur l'œuvre entière !
D'abord le patron de la Belle-Arsène, frère de Rose Mamaï, chargé par les habitants de Castelet de prendre des renseignements sur l'Arlésienne et sur sa famille. « C'est égal, va ! c'est un habile homme, et qui n'est pas embarrassé de sa langue pour parler avec les bourgeois... Voilà trente ans qu'il est dans la marine d'Arles ; il connaît tout le monde de la ville, et selon ce qu'il va nous dire... » Séduit sans doute par « le ratafia de la demoiselle — c'est la mère qui le fait, une recette de famille », — Marc donne les meilleurs renseignements, et l'on fête, le verre en main, les fiançailles prochaines, quand Mitifio, le gardien des marais de Pharaman, vient révéler l'infamie de la fiancée. « Est-ce que je pouvais aller voir sous les sabots de cette margoton, pour savoir si elle avait perdu un fer ou deux en route ? » s'écrie philosophiquement le patron Marc, et, indifférent à la douleur des autres, il va chasser au marais, suivi de l'Équipage : un vieux matelot qui porte la carnassière, toujours vide, avant comme après.
y a au premier tableau du second acte, sur les bords de l'étang de Vaccarès, une bien jolie scène de chasse au marais, qui encadre pittoresquement le tableau. Marc et l'équipage sont à la poursuite « d'un flamant rose... une bête magnifique qui nous fait courir depuis ce matin autour du Vaccarès » ; et, tandis que sur le bord de l'étang, auprès de la bergerie, se passent des scènes de douleur poignante, que Vivette, sur les conseils de Rose, essaye de distraire la douleur de Frédéri, de se faire aimer, qu'elle sourit, qu'elle pleure, les cris lointains des chasseurs se font entendre, se répondant à travers les roseaux : « Ohé!... — Ohé !... — manqué ! » et se mêlent aux appels du soir des bergers réunissant leurs troupeaux, et aux chants joyeux des filles et des garçons, que l'on entend là-bas dans la plaine.
Combien je préfère, cependant, à cette joyeuse figure, les touchantes et bien personnelles inventions de Balthazar, de la mère Renaud et de l'Innocent. Ce sont les trois physionomies vraiment poétiques, musicales par conséquent ; elles ont inspiré à Bizet ses plus beaux, ses plus ravissants mélodrames.
Balthazar, c'est le vieux berger de Castelet, un patriarche moitié philosophe moitié sorcier. Depuis cinquante ans il garde les troupeaux de la ferme ; il a acquis, peu à peu, sa place au foyer, comme un membre de la famille ; on l'aime, on le respecte, on prend ses conseils. L'été, il mène les troupeaux dans la montagne, et, la nuit, au milieu du calme grandiose de la nature, sous l'œil des étoiles, il rêve... : « Tiens... dans quelques jours je vais partir pour la montagne, viens avec moi... tu verras comme on est bien là-haut. C'est plein de sources qui chantent, et puis des fleurs grandes comme des arbres, et des planètes, des planètes !... » Aussi le patron Marc l'a-t-il surnommé le père Planète.
Balthazar est la droiture même, l'honneur, le devoir ; il est, comme le dit Francet Mamaï, « d'un temps plus dur que le nôtre, où l'on mettait l'honneur par-dessus tout ».
Après le coup imprévu qui vient de frapper la famille joyeuse, le vieux berger, qui a pris part à la douleur commune, essaye, lui aussi, de verser un baume bienfaisant sur la blessure faite au cœur de l'enfant ; il lui parle au nom du devoir, il le supplie d'oublier et de vivre, non pour lui, mais pour sa pauvre mère, pour le vieux que sa mort tuera. « Pardi !... ça serait bien facile si l'on n'avait à songer qu'à soi : on aurait vite fait de mettre son fardeau bas ; mais il y a les autres. — Je souffre tant, si tu savais, lui répond Frédéri. — Je sais ce que c'est, va ! Je connais ton mal, je l'ai eu. — Toi ? — Oui, moi... J'ai connu cet affreux tourment de dire : Ce que j'aime, le devoir me défend de l'aimer. J'avais vingt ans alors. Dans la maison où je servais, c'était tout près d'ici, de l'autre main du Rhône. La femme du maître était belle, et je fus pris de passion pour elle... Jamais nous ne parlions d'amour ensemble. Seulement, quand j'étais seul dans le pâturage, elle venait s'asseoir et rire contre moi. Un jour, cette femme me dit : « Berger, va‑t'en !... maintenant je suis sûre que je t'aime... » Alors, je m'en suis allé, et je suis venu me louer chez ton grand-père. — Et vous ne vous êtes plus revus ? — Jamais. Et pourtant nous n'étions pas loin l'un de l'autre, et je l'aimais tellement, qu'après des années et des années tombées sur cet amour, regarde ! j'ai des larmes qui me viennent encore en en parlant... C'est égal ! je suis content. J'ai fait mon devoir. Tâche de faire le tien. »
La fermière qu'a aimée Balthazar, a vieilli comme lui, aujourd'hui on l'appelle la mère Renaud ; c'est la grand'mère de Vivette. Elle habite à Saint-Louis, « de « l'autre main du Rhône », et, depuis le jour où le berger, fuyant de chez elle, est venu se louer à Castelet, elle a évité la ferme de Francet : « Le plus souvent, je l'emmène, dit Vivette. Ainsi, le mois dernier, quand je suis allée faire les olives à Montauban, elle est venue avec moi... mais à Castelet, jamais elle n'a voulu. Pourtant, tout le monde d'ici nous aime bien. » Mais lorsque Frédéri, se croyant guéri de sa funeste passion, va épouser Vivette, la vieille grand'mère doit se rendre, elle aussi, à Castelet.
Les gens de Castelet reviennent de la messe ; en rentrant, ils ont fait le tour par Saint-Louis, et ils ramènent la mère Renaud ; ils vont célébrer le repas des fiançailles. C'est aussi, ce jour-là, la fête de saint Éloi patron du labourage, et les confrères du saint, qui vont de ferme en ferme, dansant la farandole, aux sons du flûtet et du tambourin, vont venir à Castelet ; aussi la cour de la ferme est-elle ornée d'arbres de mai tout enguirlandés de fleurs. Nos gens ont revêtu, de leur côté, leurs plus beaux atours, coiffes de dentelles, jaquettes à fleurs ; en tête, marche la mère Renaud, appuyée sur Vivette et sur Frédéri. En se revoyant, après cinquante ans, dans la cour de Castelet, la bonne vieille se laisse aller à ses souvenirs ; elle reconnaît les êtres, la magnanerie, les hangars, le puits ; « cela me fait plaisir de revoir toutes ces choses. Il y a si longtemps... Depuis ton mariage, Francet... » ; enfin, dans un coin, elle aperçoit le vieux berger : « Bonté divine ! mais c'est... c'est Balthazar ! »
Alors se produit cette scène émouvante des deux vieillards, des deux vieux amoureux qui se sont fui pour rester fidèles au devoir, et qui se retrouvent, après cinquante ans, se reconnaissent et se jettent dans les bras l'un de l'autre !
A côté de Balthazar, Daudet a placé l'Innocent ; à côté de la mère Renaud, Vivette Renaud, sa petite-fille.
L'Innocent est le frère de Frédéri ; c'est un chétif enfant de quatorze ans, dont l'intelligence ne s'est point développée. Il aime le vieux Balthazar qui lui raconte de belles histoires, l'histoire de la chèvre de M. Séguin, qui est allée dans la montagne et qui a été surprise par le loup : « mais ça ne l'empêcha pas de se défendre comme une brave chèvre de M. Séguin qu'elle était... Elle se battit toute la nuit, mon enfant, toute la nuit... Puis le petit jour blanc arriva. Un coq chanta en bas, dans la plaine. « Enfin ! » dit la petite chèvre qui n'attendait que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle pelure blanche tachée de sang. Alors le loup se jeta sur elle et il la mangea. » Et l'Innocent de répliquer : « Elle aurait aussi bien fait de se laisser manger tout de suite, n'est-ce pas ? »
Depuis quelque temps la petite cervelle de l'Innocent travaille, « il y a quelque chose qui remue, dit Balthazar, comme dans le cocon du ver à soie quand le papillon veut sortir. » Il semble s'éveiller, il commence à saisir, à comprendre ce qui se passe autour de lui ; il s'éveille. Et en effet l'Innocent revient à la raison, et, au moment même où, complètement éveillé, il se jette dans les bras de sa mère, en lui disant : « Mon nom est Janet, ma mère. Appelez-moi Janet. Il n'y a plus d'innocent à la maison, » Frédéri, repris par sa terrible passion, ayant repoussé Vivette et ne pouvant plus vivre sans celle qu'il ne peut avoir, se précipite du haut de la fenêtre du grenier et se brise le crâne sur le pavé de la cour...
Et Vivette ; quelle charmante créature, modeste, douce, résignée : « Té ! Vivette... D'où sors-tu donc, petite, que te voilà chargée comme une abeille ? », s'écrie Balthazar dès qu'elle apparaît pour la première fois.
Elle vient à Castelet, chez Rose Mamaï sa marraine, « pour les vers à soie, comme tous les ans ». Mais c'est surtout pour voir Fréderi qu'elle aime et dont elle n'est pas aimée.
Quand la catastrophe soudaine est venue frapper la famille, elle se dévoue pour sauver Frédéri : « Le mal qu'une femme a fait, une femme peut le guérir ! » Et elle essaye de se faire aimer, sachant bien que c'est inutile ; elle est repoussée durement.
Enfin, touché des pleurs, de la désolation des siens, l'enfant consent à oublier, à épouser Vivette. La douce créature se dévoue encore, ne croyant guère à ce revirement subit. Hélas ! elle est repoussée de nouveau, abandonnée. Et le vieux Balthazar de s'écrier en la contemplant douloureusement : « Pauvre petite Vivette !... La voilà en deuil pour toute sa vie... Aimer sans rien dire et souffrir !... Ce sera sa planète à elle comme à sa grand'mère... »
Je me suis, peut-être un peu longuement, étendu sur les personnages, non pas secondaires, mais à côté de l'action principale, qui, étant les plus vivants et les plus saisissants, jettent sur l'Arlésienne un parfum de poésie bien personnelle à Daudet, et lui donnent un accent pittoresque, qui font de cette œuvre étrange une œuvre à part, bien originale et bien sincère. Ils ont inspiré à Bizet ses plus beaux mélodrames, ses pages les plus intenses, les plus chaudes, les plus poétiques, et j'ai dû mettre en relief leurs physionomies, pour donner le plus d'intérêt possible à l'analyse du chef-d'œuvre musical et expliquer certains mélodrames qui, sans cela, auraient paru inexplicables.
La partition de Bizet s'ouvre par une Ouverture-Prélude. La première partie est formée par le motif d'un vieux Noël provençal, connu sous le nom de Marcho dei Rei, attribué au Roi René, et très populaire dans la Provence et dans le Comtat. Il est bon de remarquer, toutefois, que la poésie seule de ce Noël est attribuée au Roi René ; quant à l'air qui y a été adapté, et qui lui est postérieur de deux siècles, environ, son vrai nom est : Marche de Turenne. Ici, dans le prélude, il n'est donc question que de la Marche de Turenne ; quant au Noël, nous le retrouverons dans la scène finale, chanté en chœur avec un arrangement en canon d'un effet des plus heureux, puis venant s'enchevêtrer aux sons joyeux du galoubet et du tambourin jouant gaiement la farandole.
Le motif, d'une belle allure, de beaucoup de caractère, apparaît tout d'abord dans sa nudité. C'est un large unisson de tous les instruments à cordes, posant simplement le sujet, sans aucune trame harmonique ; puis les variations apparaissent, variations symphoniques, bien entendu, très serrées de forme et d'harmonies ; le motif s'étale et reparaît sans cesse, avec de nouvelles parures claires et sonores, de nouveaux tons de plus en plus vibrants. C'est un de ces tableaux musicaux qu'affectionnait Bizet et qu'il a disséminés dans son œuvre ; mais jamais, il convient de le dire, les couleurs n'avaient été si intenses et si variées.
La seconde partie se compose de deux idées musicales bien distinctes qui vont prendre, comme la Marcho dei Rei, une grande place dans le drame. Mais, tandis que le Noël provençal souligne le côté pittoresque de l'action, ces deux phrases, l'une triste et douloureuse, avec ces sanglots persistants des violons, l'autre passionnée, sombre et farouche, vont exprimer les côtés intimes et subjectifs du drame. La première traduira musicalement la douce figure de l'Innocent, sa grâce maladive, sa pauvre intelligence qui sommeille, s'éveillant peu à peu à la lumière ; la seconde, l'amour fatal de Fréderi, sa passion que rien ne peut distraire et qui le pousse à la mort. Largement traitées, avec un soin profond du détail, un souci constant de l'inentendu et du pittoresque, soit dans l'enchaînement des harmonies, soit dans l'accouplement des timbres, ces deux idées mères, unies par une transition très habilement ménagée et faisant, pour ainsi dire, corps avec les deux pensées musicales qu'elle rapproche, forment une magistrale péroraison à ce splendide prélude.
Le rideau se lève ; la scène représente la cour de la ferme de Castelet ; le berger Balthazar est assis, son brûle-gueule aux dents, sur la margelle du puits ; l'Innocent, assis par terre, la tête appuyée sur les genoux du berger, écoute la belle histoire de la chèvre de M. Séguin : « Dis, berger, interroge-t-il de sa voix dolente, qu'est-ce qu'il lui a fait le loup à la chèvre de M. Séguin ? » et l'orchestre murmure une bribe vague de la phrase douloureuse qui exprime les balbutiements de l'intelligence paresseuse de l'enfant. Bientôt la phrase se précise et prend un peu plus de consistance, sur ces mots de Balthazar : « Pauvre Innocent ! je voudrais bien savoir qui s'en occupe quand je ne suis pas là. » Le vieux berger reprend le fil, un instant interrompu, de l'histoire de la petite chèvre blanche, l'enfant écoute attentivement, et l'orchestre, dans les deux mélodrames qu'il vient de faire entendre, a exprimé l'effort douloureux de sa pauvre cervelle et le travail intérieur qui s'opère et d'où jaillira la raison. Dans la scène III, quand Balthazar, répondant à Vivette qui, caressant l'Innocent, vient de dire : « Quel dommage... est-ce qu'il ne guérira jamais ?... » — « Ils disent tous que non, mais ce n'est pas mon idée... Il s'éveille, cet enfant ! je suis sûr qu'il s'éveille !... » la phrase reparaît, précise et complète cette fois, avec les harmonies déjà entendues dans le prélude, et les mêmes sanglots persistants qui toutes les deux mesures viennent la scander douloureusement ; elle n'a pas encore l'éclat et l'ampleur de développement qu'elle avait dans le prélude et qu'elle retrouvera dans la scène finale, mais sa ligne précise, sa forme et son intégrité mélodique, indiquent et soulignent l'espérance qui vient de naître au cœur du vieux Balthazar. Ces trois mélodrames où la pensée musicale, d'abord indécise et comme voilée, se précise peu à peu pour arriver à se fixer d'une façon à peu près complète, sont traités, comme tous les autres, du reste, avec une habileté de main, une préoccupation constante du détail, un soin scrupuleux des moindres choses. Chaque fois, l'idée revêt une forme nouvelle, l'arrangement harmonique varie, suivant l'état plus ou moins précis de la pensée. Ce sont ces courts lambeaux, ces bribes musicales de quelques mesures fugitives, qui faisaient dire à Reyer, quand, après avoir loué comme elles le méritent les grandes pages de l'œuvre : le Prélude, les divers entr'actes, l'Intermezzo, l'Entrée de la Mère Renaud, l'Adagietto, l'Appel des bergers, la Farandole, il résumait : « Ce sont autant de pages qu'un maître signerait. Et quel que fût ce maître-là, ajoutait-il, je crois bien qu'il signerait tout aussi volontiers le reste... »
Tandis que les gens de Castelet, enchantés des bonnes nouvelles que vient d'apporter le patron Marc, sont allés fêter, le verre en main, les fiançailles qui auront bientôt lieu, Balthazar, qu'un pressentiment n'a cessé d'assiéger, depuis qu'il a appris le mariage que l'on projette, et qui a vainement essayé de faire passer ses doutes dans l'âme du vieux Francet, Balthazar reste seul dans la cour, toujours assis sur la margelle du puits ; il allume sa pipe et réfléchit... Soudain un chœur joyeux de paysans se fait entendre au loin :
Grand soleil de la Provence,
Gai compère du mistral,
Toi qui siffles la Durance
Comme un coup de vin de Crau,
O grand Soleil !
Allume ton flambeau vermeil !
Les basses marquent fortement le rythme à six-huit, tandis que la mélodie, sonore, s'élance, charmante et folle, pleine de vie et de soleil. C'est d'un effet poétique très saisissant.
Balthazar, qui a écouté, la tête inclinée sur la poitrine, le chœur lointain qui vient de s'éteindre, relève son front pensif ; il aperçoit Mitifio, le gardien de chevaux des marais de Pharaman, debout dans l'encadrement de la porte d'entrée, derrière laquelle, au loin, on aperçoit le Rhône : « C'est bien Castelet ici, berger ? » et les violoncelles pleurent une large mélopée, tandis que les pizzicati des contrebasses scandent tristement la mesure ; le tableau musical vient de changer subitement ; tout à l'heure gai, riant, plein de soleil, il s'est soudain assombri ; il s'est, dès l'apparition de Mitifio, imprégné d'une tristesse profonde qui fait pressentir le malheur, l'infamie de l'Arlésienne, que vient révéler le gardien...
Après que Mitifio a tout dit à Francet Mamaï consterné, qu'il a fourni les preuves, — deux lettres qu'il a pu conserver, non par esprit de vengeance, mais par amour, — qu'il a laissé les deux vieillards face à face, abîmés de douleur, des frissons lointains de gaîté, le souvenir du chœur joyeux qui vient de passer, courent dans l'orchestre... « Allons, grand-père, s'écrie Frédéri, en s'avançant vers la porte, le verre haut... A l'Arlésienne ! — Non... non... mon enfant... Jette ton verre, parce que ce vin t'empoisonnerait. — Qu'est-ce que vous dites ? — Je dis que cette femme est la dernière de toutes, et que, par respect pour ta mère, son nom ne doit plus être prononcé ici... Tiens ! lis... » Et le vieillard tend à l'enfant les lettres de Mitifio.
Frédéri lit, pousse un cri déchirant, fait un pas vers son grand-père et vient tomber sur le rebord du puits. Et, tandis que la famille consternée se précipite autour de lui, le chœur joyeux se fait entendre de nouveau, là-bas, lançant gaiement vers le ciel ses notes claires et sonores. Ce tableau est un tableau de grand Maître !...
Voici maintenant les bords de l'étang de Vaccarès, en Camargue ; à droite un fourré de roseaux, à gauche une bergerie ; immense horizon désert. Le décor musical ne le cède en rien au paysage. C'est, d'abord, une Pastorale aux accents plaintifs et doux. La phrase, dite largement par les violons, a des inflexions pleines de grâce ; bientôt le hautbois et la clarinette dialoguent en canon, amenant dans le paysage un accent de gaieté champêtre d'une poésie profonde. Cependant, la large phrase du début reparaît, de nouveau, et s'étale, mais pour se perdre, s'effacer peu à peu, et disparaître enfin dans un pianissimo d'une ténuité extrême.
Un chœur de paysans et de paysannes passe au loin. Comme un murmure, vague d'abord, un peu plus accentué ensuite, les voix d'hommes, posant d'abord les assises chorales, rythment la mesure à trois temps ; les femmes font bientôt jaillir la mélodie. Librement, franchement, elle se détache sur le murmure harmonieux qui l'accompagne ; le flûtet fait la ritournelle, tandis que les voix d'hommes et les seconds dessus des voix de femmes continuent à rythmer la mesure sur les trois notes de l'accord. L'effet est absolument merveilleux. Il est obtenu bien simplement : par la disposition des parties vocales, et par la façon dont elles sont exécutées. Le chœur, en fa dièse mineur, est vocalisé en entier, et de plus, il est chanté, du moins dans ses parties d'accompagnement, presque à bouche fermée et sans détacher les notes qui, cependant, rythment la mesure. Les ténors attaquent les premiers, très piano, sur la deuxième note de l'accord, le la, produisant un murmure confus ; à la troisième mesure, le murmure se précise un peu, les basses viennent de faire leur entrée sur la tonique ; enfin, à la cinquième mesure, le chant jaillit, très soutenu et lié malgré son apparence folâtre, chanté par les premiers dessus, tandis que les seconds dessus complètent l'accord. L'effet d'éloignement est ainsi obtenu ; c'est la gaieté champêtre qui passe au loin, dans la plaine, les filles et les garçons qui vont aux champs, en chantant en chœur, comme cela a lieu encore dans notre Midi, les douces et poétiques chansons du pays. Cette page ravissante a été utilisée par Bizet ; il l'a transcrite pour une voix seule ; elle figure dans son recueil de Mélodies, sous le nom de Pastorale, c'est le n° 9 du Recueil.
Viennent ensuite deux mélodrames ayant une affinité directe avec les trois premiers. Après la scène où Rose, qui s'est aperçue de l'amour de Vivette pour son fils, essaie de stimuler la coquetterie de la pauvre enfant pour attirer sur elle les regards du jeune homme et calmer, par ce dérivatif charmant, sa douleur inconsolée, Balthazar et l'Innocent paraissent, et l'orchestre de murmurer la phrase plaintive et douloureuse, qui se montre, cette fois, avec un arrangement nouveau, un enchevêtrement de parties d'un effet délicieux. Dans la même scène, quand Rose, s'adressant au berger, lui dit : « Il t'aime plus que nous cet enfant. — A qui la faute, maîtresse ? Pour innocent qu'il est, il comprend bien que vous l'avez tous un peu abandonné... », la phrase revient, encore, sous une autre forme, à six-huit, moins triste, moins douloureuse, un peu vague, un peu déformée, mais toujours reconnaissable, néanmoins, sous la trame harmonique dont elle est enveloppée.
A la fin de la scène, Frédéri apparait sur la porte de la bergerie, pâle, les vêtements en désordre, de la paille dans les cheveux ; l'orchestre fait alors entendre, en sourdine, la phrase désespérée, farouche et passionnée qui a formé la foudroyante conclusion du prélude.
Ici se place l'Appel des bergers, page de grand art, malgré son extrême simplicité. Le morceau compte en tout dix mesures, mais jamais impression de plein air, de poésie rustique, ne fut traduite musicalement avec une sincérité plus grande, une vérité plus profonde et plus saisissante. Les violons, en sourdine, frémissent en un trémolo confus, imitant, avec bonheur, les vagues rumeurs lointaines de la campagne, le soir ; les tenues, à bouche fermée, des premiers et des seconds dessus viennent accentuer et fondre le murmure, tandis que les voix des bergers, ténors et basses, s'appellent sur une mélopée plaintive formée de trois notes et se répondent, au loin, comme un écho ; le tout noyé dans un lointain vaporeux, d'un charme très profond et très poétique.
Un petit bijou, aussi, le joli mélodrame qui berce le sommeil de l'Innocent. Le pauvre petit a voulu raconter une histoire à son grand frère Frédéri : « Il y avait une fois... Il y avait une fois... C'est drôle, le commencement des histoires, je ne me le rappelle jamais. » Et il prend dans ses mains sa pauvre petite tête... Bientôt, vaincu par l'effort douloureux qu'il vient de faire, il se couche sur les roseaux et il s'endort, en murmurant : « et puis au matin... au matin... le loup l'a mangée ! » Et l'orchestre berce, doucement, avec des délicatesses infinies, le sommeil du pauvre enfant. C'est un air provençal, connu sous le nom de Er d'ou Guet, qui a servi à Bizet pour écrire cette délicieuse berceuse ; mais, avec quel amour, avec quel art, n'a-t-il pas orné cette charmante inspiration ! que de caresses n'a-t-il pas semées dans ces doux murmures de l'orchestre...
Le tableau du Vaccarès finit comme il a commencé. Le soir est tout à fait tombé, la nuit vient, les bergers sont rentrés. Tandis que Vivette fait part à Rose, accablée de tristes pressentiments, de l'accueil brutal qu'elle vient de trouver auprès de Frédéri, que, du milieu des roseaux, s'élèvent, au loin, les cris d'appel de Marc et de l'équipage, toujours à la poursuite du flamant, le chœur des paysans, revenant des champs, se fait de nouveau entendre dans la plaine, mais plus doux, plus calme, presque recueilli dans le silence attiédi du soir. Il diminue peu à peu et finit par se perdre dans le lointain...
Ce second acte comporte un second tableau : La Cuisine de Castelet.
C'est une vieille et grande cuisine provençale, avec sa haute cheminée à manteau, ses bahuts de chêne et sa table entourée de bancs et d'escabeaux. Le petit jour commence à poindre. C'est là que va se tenir le conseil de famille ; c'est là aussi que Frédéri, vaincu par l'amour de sa mère, de son vieux grand-père, qui pour lui conserver la vie viennent de consentir au déshonneur du nom respectable qu'ils portent et de lui accorder l'Arlésienne infâme, se jette dans les bras de Rose en s'écriant : « La femme à qui je donnerai votre nom en sera digne, je vous jure... » et apercevant Vivette qui vient de rentrer : « Qu'en dites-vous, grand-père ? Je crois que celle-là, vous n'aurez pas de honte à l'appeler votre fille... »
Ce tableau ne contient que deux morceaux, le prélude et le morceau final.
Un sentiment nouveau vient de surgir dans le drame : l'amour de Frédéri pour Vivette ; une idée nouvelle qui servira à exprimer cette tendresse, douce et chaste, de l'époux pour l'épouse, par opposition à l'amour violent, farouche, aveugle, qu'avait inspiré la coquine, est apparue dès le prologue instrumental du tableau ; elle revient au final sous une forme nouvelle, et de nouveau, toutes les fois que le naïf et tendre amour des deux enfants traversera l'action, elle renaîtra toujours plus séduisante et plus parée.
Dans le prélude, page d'une couleur austère, la phrase, aux inflexions chastes et tendrement passionnées, revêt une teinte de mélancolie grave, presque de tristesse. Cet effet, très original, est obtenu, d'abord par la tonalité de mi bémol qui pose la phrase dans le grave, ensuite, et surtout, par l'accouplement de timbres des deux instruments mélancoliques qui la chantent à l'octave, le saxophone et le cor. Mais au finale du tableau, quand l'idée musicale reparaît, murmurée en sourdine par les violons, la mélancolie s'est envolée pour faire place à la tendresse et à l'amour. C'est en comparant ces deux pages écrites sur la même idée mélodique, qui plus est, dans la même tonalité, et dégageant des impressions si différentes, que l'on peut se rendre compte du sentiment profond qui était au cœur du grand artiste et de l'art surprenant avec lequel il savait, avec des moyens d'une simplicité extrême, faire exprimer à ses idées musicales les nuances infinies de la gamme des sentiments.
Que dire de l'Intermezzo, cette page si fine et si délicate ? L'Intermezzo, de même que le Carillon qui vient immédiatement après, de même que l'Entrée de la mère Renaud et l'Adagietto qui suivent le Carillon, fait partie de la suite d'orchestre que le Maître composa avec les principaux fragments de sa belle partition. Ainsi que l'indique son nom, c'est un véritable Entr'acte, indépendant du prélude instrumental du quatrième tableau, et destiné à être exécuté entre les deux parties du drame : l'exposition, un peu longue, qui a comporté trois tableaux, et le dénouement plus prompt, plus rapide, plus saisissant, qui va se dérouler. On l'a désigné sous le nom de Menuet des Vieillards et encore de Menuet-Valse. Et en effet, la première partie, qui revient à la fin et forme la conclusion de cette page si piquante, si originale, a bien l'allure un peu maniérée, un peu rétrospective, qui convient au Menuet. Donner par des moyens originaux, bien personnels, d'une nouveauté pleine d'audaces, une impression de sénilité charmante, tel a été le but du Maître, et il l'a atteint avec un rare bonheur. Quant à la phrase en la bémol, qui forme le milieu, elle exprime bien la tendresse douce et résignée des deux vieillards, les souvenirs émus, pleins de charme. Elle s'étale, largement soupirée par les violoncelles, tandis que les violons, exécutant un trait d'une grâce et d'une flexibilité extrême, l'enveloppent de capricieuses arabesques.
Le Carillon forme le prélude instrumental de ce quatrième tableau : La Cour de Castelet.
Elle a revêtu sa parure de fête, la cour de la vieille ferme ; deux fêtes à la fois : les fiançailles de Frédéri et de Vivette, la fête de saint Éloi patron du labourage. Aussi, on a planté les beaux arbres de mai tout enguirlandés de feuillage, et au-dessus de la porte d'entrée, un gigantesque bouquet, de blés verts, de bluets et de coquelicots, s'épanouit. Et les cloches sonnent gaiement, avec une allégresse joyeuse. Sur un trait persistant, exposé d'abord par les seconds violons et les altos, et formé uniquement des trois notes des cloches sol dièse, mi, fa dièse, qui scandent chacune des cinquante-deux mesures, à trois temps, dont se compose ce Carillon, les dessins les plus capricieux, les arabesques les plus pittoresques, viennent s'enchevêtrer, amenant des chocs de notes de l'effet le plus piquant, les harmonies les plus savoureuses, tantôt calmes et apaisées, tantôt jetant à toute volée leurs notes claires et sonores vers le ciel.
La scène des deux vieillards est d'une grande émotion ; elle tire une partie de son charme, de sa franchise d'impression et de sa simplicité, de sa sincérité d'accents. C'est, d'abord, l'Entrée de la mère Renaud, un duettino exquis des deux flûtes. Ici, comme dans la première partie de l'Intermezzo, Bizet, en dépit de ses hardiesses, de ses audacieux chocs de notes, a su donner à son mélodrame l'allure charmante, doucement vieillotte, que la situation exigeait ; la bonne mère Renaud s'avance, appuyée sur Vivette et sur Frédéri, et la mélodie, chevrotante et cassée, prend des allures de bonne petite vieille qui sautille, courbée sur son bâton.
Puis vient l'Adagietto, ou plutôt l'Adagio, car c'est le mouvement primitivement indiqué pour les représentations du Vaudeville, et c'est bien celui qu'il convient de prendre pour accompagner le dialogue ; mais on a l'habitude d'appeler ce chef-d'œuvre Adagietto, parce qu'il est ainsi désigné dans la Suite d'Orchestre où il a été intercalé.
« Dieu vous garde, Renaude... — Oh !... ô mon pauvre Balthazar » et la phrase se développe, lentement, avec une douceur résignée, une émotion sincère et contenue. Je ne connais rien de plus émouvant sous une apparence de simplicité plus grande. C'est le summum de l'art, de dissimuler la science, l'incroyable habileté de main, sous le charme, sous l'abondance de l'idée mélodique, qui semble couler de source, naturellement ; de donner une impression de simplicité extrême avec des moyens si raffinés, un art si souple, fait de nuances exquises, de délicatesses subtiles et charmantes. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un Maître plus familiarisé que Bizet avec tous les artifices de la fugue et du contrepoint, un musicien plus complet dans le sens technique du mot ; et ce musicien était doublé d'un poète délicat, d'un artiste sincère, sentant juste, voyant les choses d'une façon bien originale, bien personnelle, d'un coloriste épris de vie et de lumière et sachant toujours, avec un art au-dessus de tout art, mettre des ombres puissantes et vigoureuses à ses tableaux les plus sonores, à ses symphonies les plus rayonnantes.
Cette scène, si belle et si touchante, se termine par la reprise de l'Intermezzo. Renaude et Balthazar, suivis des gens de Castelet, rentrent dans la cuisine pour prendre le repas du soir ; la scène reste vide quelques instants ; la nuit vient...
Bientôt Frédéri et Vivette sortent tous deux de la maison, ils s'approchent du puits, s'asseyent côte à côte. Alors, à la lueur des étoiles, commence une scène d'amour, naïve et charmante, et la douce phrase qui exprime les tendres sentiments des deux enfants, apparaît, calme et sereine, enveloppée d'arpèges de harpes ; elle prend ici une expression radieuse, d'un effet suave... Etroitement enlacés, les deux amoureux s'éloignent ; ils marchent à petits pas et disparaissent derrière les bâtiments de la ferme. A ce moment, Mitifio paraît ; apercevant Balthazar, sur le seuil de la maison, il va droit à lui : « Mes lettres ?... — Comment ! tes lettres ?... mais je les ai portées à ton père ce matin ; tu ne viens donc pas de chez vous ?... — Voilà deux nuits que je couche à Arles. — Ça dure donc toujours ?... — Toujours... » et alors il raconte au vieillard qu'il a reconquis son amoureuse : « Quand c'est pour elles qu'on est lâche, les femmes vous pardonnent toutes les lâchetés... » Ils s'aiment plus que jamais. Mais Frédéri a entendu prononcer le nom de l'Arlésienne ; à ce nom maudit, sa funeste passion s'est réveillée ; il a repoussé Vivette éperdue ; bondissant, il s'est précipité sur le gardien, et, saisissant un des gros marteaux avec lesquels on a planté les mais : « Allons, défends-toi, que je te tue, je ne veux pas mourir seul. » Le gardien recule ; Frédéri va frapper malgré Balthazar, mais Rose, qui a tout vu, qui a tout compris, s'élance au-devant de son fils. Alors l'enfant chancelle et laisse échapper le marteau... Et la joyeuse farandole, qui depuis un instant tourbillonnait au loin, s'est rapprochée : elle est maintenant devant Castelet. Les farandoleurs envahissent la cour, secouant leurs torches et criant à pleins poumons : « Saint Eloi ! Saint Eloi! A la farandole ! » tandis que le galoubet et le tambourin résonnent allègrement.
Bizet, sur le motif de la farandole, d'abord lointaine, puis se rapprochant peu à peu, en un crescendo continu, — motif qui n'est autre qu'un vieil air provençal, connu sous le nom de Danso dei Chivau Frus, — a écrit un chœur dont voici les paroles :
Le flûtet se marie
Au pan pan pan du tambourin
Et sa voix si jolie
Met tout entrain par son refrain.
Ce chœur doit commencer quand le crescendo de l'orchestre a atteint le fortissimo, c'est-à-dire quand les joyeux confrères de saint Eloi sont arrivés dans la cour de la ferme. Mais, pour éviter aux masses chorales cette exécution en scène, le rideau tombait au moment précis où le chœur eût dû commencer, et l'orchestre exécutait seul la fin du morceau, la toile baissée. Faute d'artiste capable de jouer du galoubet, cet instrument, essentiel à la couleur exacte de la scène, était remplacé par la petite flûte, tandis que le tambour ordinaire tenait la place du tambourin. La petite flûte n'a pas les sons du galoubet, pas plus que le tambour ceux du tambourin. La résonance particulière et très caractéristique de ce dernier instrument, est due à sa forme cylindrique très allongée, et surtout aux vibrations des cordes tendues sur la peau à son extrémité inférieure. En Provence, le galoubet, percé de trois trous seulement, ne nécessitant l'emploi que d'une main, c'est, ordinairement, le même virtuose qui joue à la fois des deux instruments ; on le nomme tambourinaïre. Précédant les farandoleurs qui le suivent à la file indienne, le tambourinaïre tient son galoubet de la main gauche et joue la farandole, tandis que, de la main droite, il marque le rythme, au moyen d'une baguette, sur le tambourin suspendu à sa ceinture...
Le prélude instrumental du second tableau du troisième acte : La Magnanerie, est formé des deux idées musicales qui ont fourni la deuxième partie de l'Ouverture-Prélude : la phrase passionnée qui a exprimé, pendant l'action, le mortel amour de Frédéri pour l'Arlésienne, et la phrase douloureuse et plaintive qui a traduit le balbutiement de la pauvre intelligence de l'Innocent. C'est la phrase passionnée qui apparaît la première ; mais, ici, elle a perdu son expression ardente et farouche ; elle se déroule, lentement, doucement, calme et résignée ; la mort va mettre terme aux souffrances du pauvre enfant dont l'Arlésienne maudite a brisé le cœur...
Vient ensuite, s'enchaînant directement, dans la même tonalité, la phrase plaintive de l'Innocent. Elle a recouvré toute son ampleur primitive ; elle est là, telle qu'elle va bientôt apparaître, au moment où le pauvre petit recouvrera la raison...
Voici de nouveau la farandole qui tourbillonne ; les fenêtres ouvertes laissent monter les sons des instruments, les rires bruyants et joyeux. L'orchestre se tait, c'est le tour des chanteurs. Ils chantent le Noël provençal du roi René, la Marcho dei Rei :
De bon matin
J'ai rencontré le train
De trois grands rois qui allaient en voyage
De bon matin
J'ai rencontré le train
De trois grands rois dessus le grand chemin.
Venaient d'abord
Des gardes du corps,
Des gens armés avec trente petits pages,
Venaient d'abord
Des gardes du corps,
Des gens armés dessus leur justaucorps,
Le Noël est d'abord exposé, à l'unisson, par les ténors et les basses ; puis les premiers et les seconds dessus entrent à leur tour, et le reprennent, en canon ; enfin, le motif reparaît, une troisième fois, en majeur, dit à l'unisson par les voix, tandis que l'orchestre reprend à toute volée la joyeuse farandole. Il résulte bien, de l'accouplement imprévu de ces deux motifs, quelques licences harmoniques, quelques chocs de notes un peu durs, mais cela passe, à la faveur de la différence des timbres ; l'oreille n'est pas choquée, et l'effet obtenu est très pittoresque et très original.
Sur un char
Doré de toutes parts,
On voit trois rois graves comme des anges ;
Sur un char
Doré de toutes parts,
On voit trois rois parmi les étendards.
Le Noël, cette fois, a pris l'allure grave et recueillie d'un Choral ; les harmonies, pleines et sonores, suivent chaque note et serrent de près la mélodie qui apparaît, sous un aspect nouveau, puissante et large.
Maintenant, le dénouement rapide : Rose surveille Frédéri ; depuis la scène qui vient de se passer, ses angoisses maternelles ont reparu plus vives ; elle craint un malheur ; elle veille. Soudain, une porte s'ouvre, l'Innocent à demi vêtu, ses cheveux blonds ébouriffés, s'avance vers elle et lui dit tout bas : « Couchez-vous, et dormez tranquille... Il n'y aura rien encore cette nuit... — Comment ! rien... tu sais donc ?... » L'Innocent sait tout ; lui aussi, il surveille son frère ; cette nuit il l'a entendu pleurer, se lamenter, parler tout seul ; mais, enfin, il s'est couché, maintenant il dort. Et comme sa mère le regarde avec étonnement : « Ça vous étonne que j'y voie si fin et que j'aie tant de raisonnement... Mais vous savez bien ce que Balthazar disait : Il s'éveille, cet enfant, il s'éveille ! — Est-ce possible ?... Oh !... ô mon Innocent ! — Mon nom est Janet, ma mère. Appelez-moi Janet. Il n'y a plus d'innocent à la maison. » Et la phrase du prélude s'épanouit, pour la dernière fois, claire et limpide, avec ses ornements et ses harmonies premières, ses sanglots qui pleurent, non sur l'enfant retrouvé, mais sur l'enfant qui va mourir.
Tandis que tout sommeille dans la ferme, Frédéri se lève ; il est trois heures, le jour commence à poindre. Au bruit qu'il vient de faire, Rose s'est éveillée. Elle aperçoit Frédéri et devine ; elle court à lui et veut le retenir, mais l'enfant vient de monter précipitamment l'escalier qui conduit au grenier et il a fermé la porte derrière lui. Elle frappe, elle secoue inutilement la porte ; ses pleurs, ses sanglots, ses appels désespérés, sont vains. Alors, folle de douleur, elle redescend l'escalier et va droit à la fenêtre ; elle pousse un cri déchirant... son enfant est là, râlant, la tête fracassée sur le pavé de la cour. Et, comme un dernier écho douloureux, comme un dernier élan d'amour farouche, indomptable, l'orchestre fait entendre, dans un fortissimo délirant, un fragment de la phrase, vibrante et passionnée, qui a caractérisé dans le drame la fatale passion du pauvre enfant...
Ainsi finit l'Arlésienne, — œuvre de poète exquis, œuvre de grand musicien, — qui, malgré tout le charme profond qui est en elle, malgré le doux et pénétrant parfum de poésie champêtre qu'elle dégage, malgré les merveilleuses pages musicales qui l'encadrent et la soutiennent, n'eut pas le moindre succès. Soit que cette forme, nouvelle pour nous, de l'union du drame avec la musique, ait dérouté l'esprit profondément routinier du public, soit que la poésie, la grâce, le style de Daudet, n'aient pu suffisamment racheter le défaut de mouvement, d'intérêt scénique de l'action, l'Arlésienne se traîna péniblement sur l'affiche du Vaudeville et ne put aller au delà de la quinzième représentation.
Elle avait été montée avec le plus grand soin ; elle inaugurait une nouvelle direction (*), et, en dehors de la sympathie qu'il éprouvait pour l'œuvre et pour le musicien, le nouveau directeur tenait à faire bien augurer de l'avenir par cette entrée en matière. La troupe chargée de l'interprétation était excellente (**) ; les chœurs, très suffisants ; l'orchestre, réduit comme nombre, mais vaillant, habile et bien discipliné ; enfin, les décors, très exacts et très pittoresques. Le décor de l'étang de Vaccarès, avec ses roseaux touffus et sa vaste plaine marécageuse, était surtout d'un effet superbe et faisait illusion ; la toile de fond donnait l'impression d'un lointain très habilement ménagé. Quant à la Magnanerie, elle était d'un très grand caractère, avec son vieil escalier et ses fenêtres semi-gothiques...
(*) La direction Carvalho devait être inaugurée, au Vaudeville, par une pièce de M. Robert Halt : Madame Frainex, qui fut au dernier moment arrêtée par la Censure. L'interdiction n'ayant pu être levée, M. Robert Halt dut s'incliner et céder la place à la pièce d'Alphonse Daudet.
(**) Voici quelle était la distribution du Vaudeville.
Balthazar MM. Parade.
Frédéri Abel.
Le Patron Marc Colson.
Francet Mamaï Cornaglia.
Mitifio Régnier.
L'Equipage Lacroix.
Rose Mamaï Mmes Fargueil.
Renaude Alexis.
L'Innocent Morand.
Vivette J. Bartet.
Bizet ne se tint pas pour battu ; il protesta contre le verdict sévère du public qui, en frappant, presque sans l'avoir entendue, la pièce de Daudet, atteignait son œuvre et condamnait au silence ses fraîches et poétiques inspirations.
Le dimanche 10 novembre, moins d'un mois après la disparition de la pièce de l'affiche du théâtre du Vaudeville, les Concerts populaires du Cirque d'hiver annonçaient la première audition de l'Arlésienne, « drame d'Alphonse Daudet, musique de Georges Bizet » (*). C'était une sélection importante de la partition du Maître, qui comprenait : l'Ouverture-Prélude, l'Intermezzo, désigné sous le nom de Menuet l'Adagietto, enfin, le Carillon, encadrant le duettino des flûtes : l'Entrée de la mère Renaud. L'accueil fut enthousiaste ; le Menuet fut bissé et la suite d'orchestre de l'Arlésienne tint, dès ce jour, une des places d'honneur aux programmes des Concerts populaires du Cirque. Un an après, le 9 novembre 1873, l'Arlésienne obtenait, pour la première fois, droit de cité aux Concerts Colonne du théâtre du Châtelet, de par les applaudissements chaleureux d'un public aussi enthousiaste que celui du Cirque ; enfin, le 21 février 1875, un mois avant la première représentation de Carmen, quatre mois avant la mort du Maître, ce chef-d'œuvre recevait, aux Concerts du Conservatoire, l'éclatante consécration qui lui était due. Depuis, tous les orchestres Symphoniques de France et de l'étranger l'ont exécuté.
(*) Voici le programme du Concert Pasdeloup du 10 novembre 1872 où fut exécutée, pour la première fois, l'admirable Suite d'Orchestre de l'Arlésienne :
1° Symphonie en mi bémol (op. 97) Robert Schumann.
2. Andante Haydn.
3° L'Arlésienne, drame d'Alphonse Daudet, musique de Georges Bizet.
N° 1 Prélude.
N° 2 Menuet.
N° 3 Adagietto.
N° 4 Carillon.
4° Ouverture de la Belle Mélusine Mendelssohn.
5° Fragments du Septuor Beethoven.
Cette Suite d'Orchestre (1) restera l'un des plus purs chefs-d'œuvre musicaux ; elle attestera aux siècles à venir ce que fut ce jeune artiste de trente-six ans si prématurément enlevé à l'admiration de tous : un artiste délicat, ému, sincère, épris de couleur, de lumière, de soleil ; le musicien le mieux doué, et, certainement, le plus en pleine possession de son art, le plus habile, le plus complet de sa génération...
(*) Une seconde Suite d'Orchestre sur l'Arlésienne a été composée par Ernest Guiraud.
L'Arlésienne sommeillait depuis cette époque, d'un sommeil qu'on eût pu croire éternel, si l'éclatante reprise de Carmen, à l'Opéra-Comique, le 24 avril 1883, n'était venue la rappeler au souvenir du directeur de l'un de nos théâtres subventionnés. La pièce de Daudet, à vrai dire, ne lui inspirait pas grande confiance, mais la belle, l'admirable partition de Bizet ?... Il n'était plus possible de douter de son action sur le public. L'Odéon hésita, cependant, deux ans encore. Enfin, la reprise, depuis longtemps annoncée, eut lieu dans les premiers jours du mois de mai 1885.
Comme nous l'avions prévu, la musique de Bizet alla aux nues... et la pièce de Daudet l'y suivit. Elle était, d'ailleurs, montée avec beaucoup de soin ; l'interprétation, où figuraient : Paul Mounet — Balthazar, Albert Lambert — Frédéri, Mme Tessandier — Rose Mamaï, était excellente, et l'orchestre Colonne, qui prêtait son concours, exécuta la partition avec un art et une délicatesse remarquables. Le succès fut tel qu'il fallut retarder, de quinze jours, la clôture annuelle du théâtre. A la réouverture, le 1er septembre, Mlle Rousseil, spécialement engagée pour jouer le rôle de Rose Mamaï, s'y montra tout à fait originale...
Depuis ce jour, l'Arlésienne n'a, pour ainsi dire, jamais quitté l'affiche de l'Odéon, où elle va, prochainement, atteindre sa cinq centième représentation. Qu'une pièce nouvelle tombe, que le théâtre soit en détresse, et l'on voit la phalange symphonique des Concerts Colonne, aujourd'hui guidée par son nouveau chef, Gabriel Pierné, se hâter vers le Luxembourg, et, aussitôt, l'heureux Odéon connaît la joie des salles combles et des recettes fructueuses. Et il en sera longtemps ainsi... longtemps ! Car les chefs-d'œuvre sont immortels, et, comme Carmen, l'Arlésienne est un chef-d'œuvre.
DE 1873 A 1875. — PATRIE, OUVERTURE.
« On vient de me commander trois actes, à l'Opéra-Comique. Meilhac et Halévy font ma pièce... Ce sera gai, mais d'une gaieté qui permet le style. » Ainsi s'exprimait Bizet, dans une lettre à un ami (*), quelques jours après la première de Djamileh, et ces deux lignes, insignifiantes en apparence, contiennent l'aveu de la révolution esthétique qui venait de s'opérer en lui.
(*) Georges Bizet, Souvenirs et correspondance.
N'ayant pu « changer » la forme de l'opéra-comique, en la faisant dévier vers l'idéal poétique qu'il rêvait, mais qui avait le tort grave de supprimer la vie, d'attenter, en un mot, aux conditions essentielles du théâtre ; ne pouvant rompre, complètement, cette forme mauvaise, surannée, usée, mais dont l'origine nationale, enracinée par plus d'un siècle (*) de succès, était encore consacrée par les chefs-d'œuvre des vieux Maîtres Français, où une pointe de sentiment, une vraie larme, perce, parfois, au milieu des éclats de rire, de la verve franche et de bon aloi qu'aimaient nos pères ; il s'était proposé de l'élargir ; de lui donner plus de vérité, en faisant à la convention le moins de concessions possibles ; plus de nouveauté, plus d'originalité, en y introduisant l'élément pittoresque, le décor musical, le paysage, qui lui avaient, la plupart du temps, fait défaut ; plus de vie et plus d'art, en la pliant aux exigences scéniques et musicales modernes : l'élément comique n'y tiendrait plus qu'un emploi secondaire, laissant au drame réel de la vie la meilleure place ; enfin, la musique, qui avait, jusqu'à ce moment, joué dans l'opéra-comique un rôle parfois si restreint, cesserait d'être uniquement le moyen pour devenir aussi le but.
(*) C'est en 1753, l'année même de l'expulsion des bouffons italiens de l'Opéra, que fut représentée sur le théâtre de la Foire Saint-Laurent, ce berceau de notre opéra-comique français, la première Comédie à Ariettes, les Troqueurs, paroles de Vadé, musique de Dauvergne. Les Aveux indiscrets de Monsigny, que nous pouvons à bon droit regarder comme le créateur de notre opéra-comique, car il fut le premier maître véritablement créateur qui illustra le genre, ne furent représentés que six ans plus tard, en 1759, toujours au théâtre de la Foire Saint-Laurent.
Et qu'on n'objecte pas que Faust, Roméo et Mignon avaient, longtemps avant Carmen, été conçus dans une esthétique analogue. Sans vouloir amoindrir la gloire de Gounod, je ferai simplement remarquer que Faust, — quoique écrit, à l'origine, dans la forme de l'opéra-comique, c'est-à-dire avec l'alternance des scènes chantées et parlées, — ne fut jamais un opéra-comique. Gounod subit l'erreur de ses librettistes, qui avaient plié le beau drame de Goethe à cette forme conventionnelle si peu faite pour lui, mais il n'en fut certes pas victime. La musique qu'il composa sur ce livret d'opéra-comique est de la musique d'opéra et il lui a suffi, en 1867, d'écrire les récitatifs sans changer une note à la partition, pour que ce chef-d'œuvre trouvât, sur notre première scène, l'éclatante consécration qui lui était due. Roméo a été conçu, d'origine, dans la forme de l'opéra de demi-caractère, et après une carrière brillante à l'Opéra-Comique, où il avait d'abord émigré, il a enfin trouvé sa vraie place à l'Opéra, où il tient dignement son rang à côté de son aîné. Quant à Mignon, ce n'est ni un opéra-comique ni un opéra, c'est une œuvre hybride, estimable, certes, mais visiblement inspirée des chefs-d'œuvre de Gounod.
C'est donc à Bizet, seul, que nous devons la révolution esthétique qui s'est faite à l'Opéra-Comique, en ces dernières années, révolution pacifique, opérée sans fracas, mais réelle et véritablement régénératrice. Dans Carmen, Bizet a donné la formule de l'opéra-comique nouveau, élargi et vivifié, formule acceptée par tous nos musiciens, et qui restera, jusqu'à l'époque lointaine où un artiste de génie donnera à ce genre une appropriation nouvelle, en rapport avec les goûts et les tendances de son époque.
« Ta place est à l'Opéra, disait souvent Bizet à Guiraud, au cours de leurs causeries familières ; pour moi, je crains d'y manquer d'ampleur ; c'est à l'Opéra‑Comique que je brillerai ; j'élargirai, je transformerai le genre. »
Aussi, après Carmen, travaillait-il, ou du moins songeait-il, à Clarisse Harlowe et à Griselidis, et la direction de l'Opéra-Comique, malgré l'échec relatif qu'il venait de subir, comprenant bien que là, — c'est-à-dire en ce jeune grand artiste de trente-six ans, à peine, — était l'avenir, venait, nous affirme le Figaro (*), de lui demander un nouvel ouvrage en trois actes, dont Henry Meilhac et Ludovic Halévy, les deux habiles librettistes de Carmen, devaient de nouveau écrire le livret.
(*) Le Figaro, 10 mars 1875.
L'avenir, qui serait aujourd'hui le passé, ne nous a pas permis de juger si le Maître, lorsqu'il répétait : « Je crains de manquer d'ampleur à l'Opéra », se faisait une idée bien exacte et bien nette de la mesure de ses moyens, ou si, par une modestie excessive, mais sincère, il en était arrivé à se faire illusion sur ses propres forces. C'est cette dernière supposition qui me paraît la plus vraisemblable. Le maître, au moment où la mort le surprit, travaillait à une œuvre importante, le Cid, qui était destinée à l'Opéra ; la partition, malheureusement perdue pour ses admirateurs, était très avancée ; quelques intimes ont eu la rare bonne fortune d'en pouvoir apprécier d'importants fragments, et Guiraud, dont on ne récusera certes pas la compétence, nous a maintes fois affirmé qu'ils étaient d'une grande beauté et d'une réelle puissance...
« J'ai aussi des projets Symphoniques », disait Bizet, dans la lettre du 17 juin 1872, dont j'ai cité déjà plusieurs fragments. Ces « projets » reçurent une éclatante réalisation, au Concert populaire du Cirque d'hiver, le dimanche 15 février 1874.
C'est en effet ce jour-là que fut exécutée, pour la première fois, la belle ouverture : Patrie.
L'année précédente, Bizet avait donné une Petite Suite d'Orchestre, dans des circonstances qu'il importe de ne pas passer sous silence. Edouard Colonne venait de fonder, sur la rive gauche, au théâtre de l'Odéon, des Concerts dominicaux, calqués sur le patron de ceux que dirigeait, au Cirque, depuis douze ans, l'infatigable et vaillant Pasdeloup. Colonne, voulant mettre son entreprise sous le patronage artistique de nos jeunes musiciens, s'était, d'abord, adressé à Bizet, et lui avait demandé une œuvre inédite. Le Maître s'exécuta rapidement. Il venait de publier, chez les éditeurs Durand-Schœnewerck et Cie, douze pièces pour piano, sous le titre de Jeux d'enfants ; ne voulant pas excéder les moyens restreints dont disposait la nouvelle entreprise, à laquelle étaient réservées de si brillantes destinées, il eut l'idée de composer une Petite Suite d'Orchestre, en instrumentant quelques-uns des douze morceaux de ces Scènes enfantines.
Son choix se porta sur les pièces Nos 2, 3, 6, 11 et 12 : la Toupie, impromptu ; la Poupée, berceuse ; Trompette et tambour, marche ; Petit mari, petite femme, duo ; le Bal, galop. C'est le dimanche 2 mars 1873 que fut donné le premier concert de l'Odéon, date importante dans l'histoire de l'art, car ces concerts devaient se développer rapidement et se transformer bientôt en ces brillants concerts de l'Association Artistique qui rendent de si éminents services à nos musiciens (*).
(*) Ce n'est certes pas une mince gloire, d'avoir réhabilité Berlioz dans l'admiration du public français si longtemps rebelle.
Voici le programme de ce 1er Concert.
1° Symphonie Italienne Mendelssohn.
2° Rêverie Schumann.
3° Jeux d'Enfants, petite Suite d'Orchestre Georges Bizet.
4° Le Roi des Aulnes, chanté par Mme Viardot Schubert.
5° Carnaval (n° 4 de la Suite d'Orchestre) Ernest Guiraud.
La Petite Suite d'Orchestre fut accueillie avec la faveur qu'elle méritait. Depuis, elle a été exécutée à maintes reprises, ainsi que la Danse bohémienne de la Jolie fille de Perth, aux concerts Danbé, au Grand Hôtel d'abord, à la salle Herz ensuite. Elle fut aussi exécutée une seconde fois aux concerts Colonne, devenus concerts de l'Association Artistique, au théâtre du Châtelet, le 8 janvier 1882.
Le 9 novembre de cette même année 1873, les concerts Colonne étaient transférés au Châtelet, sous le nom de Concerts Nationaux, d'abord ; ce n'est que l'année suivante qu'ils devaient prendre le nom de Concerts de l'Association Artistique, qu'ils ont gardé depuis. Bizet fut encore de la fête cette fois ; le programme d'inauguration contenait la Suite d'Orchestre de l'Arlésienne (*). Ce chef-d'œuvre a, depuis ce jour, fait partie du répertoire des concerts du Châtelet, de même qu'il faisait partie de celui des Concerts populaires du cirque, depuis le 10 novembre 1872, où, pour la première fois, il avait été acclamé... (**)
(*) Voici ce programme dans son ensemble :
1° Symphonie en la Beethoven.
2° L'Arlésienne G. Bizet.
3° Concerto en sol, exécuté par Sarasate Max Bruch.
4° Valse des Sylphes de la Damnation de Faust Berlioz.
5° Ouverture d'Athalie Mendelssohn.
Ce premier concert fut donné au bénéfice des employés du théâtre de l'Opéra.
(**) Le dimanche 18 janvier 1874, l'Arlésienne était, par une coïncidence fortuite, qui prouve bien la grande vogue de ce chef-d'œuvre, exécutée, simultanément, aux Concerts populaires du Cirque et aux concerts de l'Association artistique du Châtelet.
Au début de cette même saison de l'année 1873-74, Pasdeloup avait eu l'excellente idée de demander, à trois de nos jeunes Maîtres Français les plus en renom, une Ouverture Symphonique ; les trois œuvres devaient être données successivement, à huit jours d'intervalle. Ces trois musiciens étaient : Georges Bizet, Ernest Guiraud et Massenet.
Le dimanche 15 février 1874, fut exécutée pour la première fois l'ouverture de Bizet (*). Cette première exécution est ainsi annoncée sur le programme : « Première audition d'une ouverture dramatique intitulée : Patrie ». Le dimanche suivant, Massenet donnait, à son tour, l'ouverture de Phèdre ; enfin, le troisième dimanche figurait au programme « l'Ouverture de Concert » d'Ernest Guiraud (**).
(*) Programme du Concert populaire du 15 février 1874 :
1° Symphonie en sol (n° 31) Haydn.
2° Andante de la symphonie Romantique V. Joncières.
3° Trio en ut mineur (MM. Jaëll, Sivori, Franchomme) Mendelssohn.
4° Première audition d'une ouverture dramatique intitulée : Patrie G. Bizet.
5° Romance et Tarentelle pour violon Sivori.
6° Ouverture de Sémiramis Rossini.
(**) Cette ouverture, qui n'obtint pas, lors de son apparition, le succès qu'elle méritait, peut-être à cause de l'insuffisance de l'exécution, a reparu, depuis lors, et a été, à maintes reprises, acclamée sous le nom d'ouverture d'Artewelde.
Huit jours après, Patrie reparaissait sur l'affiche du Cirque et prenait triomphalement possession définitive du répertoire des Concerts populaires de musique classique. Dès lors, il ne s'est pas passé de saison sans que Pasdeloup n'ait fait entendre, deux ou trois fois, cette page nerveuse et colorée. A son tour, Colonne l'a donnée à son public du Châtelet, le dimanche 20 décembre de la même année, et le succès a été si grand, que Patrie a été classée, de suite, au répertoire des concerts de l'Association Artistique, comme l'avait été l'Arlésienne dès le jour de leur inauguration.
On a dit, bien à tort, que le titre de l'ouverture de Bizet était dû à Pasdeloup (*), qui, au dernier moment, voulant désigner plus clairement que par cette appellation vague : « Ouverture dramatique », l'œuvre nouvelle, trouvant que ce nom sacré : Patrie, exprimait à merveille les sentiments expressifs de cette page puissante, pleine de vigueur et d'éclat, l'avait ainsi nommée, avec le consentement de l'auteur, sur le programme de son concert du 15 février, et que le titre, si heureusement trouvé, était resté, depuis.
(*) Voir à ce sujet le Temps du 15 juin 1875.
Ceci est inexact et mérite d'être rectifié, d'autant plus que cette version accréditée tendrait à établir que Bizet avait composé son œuvre au hasard, sans se rendre bien compte des sentiments qu'il exprimait, sans se préoccuper de rien, en musicien seulement, non en artiste qui, ayant une idée grandiose à traduire, la traduit avec toute la fougue et tout l'entraînement de sa nature, servi par les ressources infinies de l'art merveilleux qui est son instrument.
Bizet avait eu d'abord en vue, en écrivant son« Ouverture dramatique », les malheurs de la Patrie vaincue et livrée, les angoisses de l'année terrible. Toutes ces souffrances, tous ces deuils, qui avaient douloureusement ému l'âme du patriote, avaient vivement sollicité son imagination de poète. Il voulait chanter la Patrie en deuil, toujours vivante et chère au cœur de ses enfants, la Patrie mutilée et saignant encore, le relèvement futur ; mais il comprit bientôt que les chants de douleur, que l'évocation des jours d'angoisses et de larmes, ne convenaient pas à notre époque d'apaisement et de paix ; alors, par une fiction de poète, par une substitution heureuse, d'une allégorie touchante, pleine d'enseignements, il évoqua la grande ombre de la Pologne agonisante, toujours vaincue, toujours debout, et dont le souvenir ineffaçable, dont le nom sacré vit toujours au cœur de ses enfants dispersés.
C'est ce sentiment profond, ce désespoir sombre et douloureux du vaincu, cet amour indélébile de l'enfant pour la mère meurtrie et violée, que le maître a traduits avec une nervosité farouche, une vigueur et un éclat incomparables.
Après cela, Pasdeloup peut bien avoir trouvé le titre : Patrie, le mot qui résume et qui synthétise l'idée qu'a voulu exprimer l'artiste ; je n'y vois pas d'inconvénient.
Mais le nom a fait tort à la chose ; aujourd'hui que l'œuvre est classée et admirée, comme elle le mérite, on oublie, trop souvent, en l'écoutant, le sentiment profond qui a guidé la main de l'artiste ; on oublie l'idée pour ne guère voir que la forme, belle sans doute, mais qui doit, comme dans toute œuvre d'art, disparaître devant la pensée vigoureuse et profondément expressive qu'elle dégage.
CARMEN.
Le 3 mars 1875, eut lieu la première représentation de Carmen.
« Après tant d'essais divers, après de si nombreuses tentatives dans des genres différents, tous ceux qui avaient souci de l'École Française et qui pensaient que, malgré ses erreurs passées, malgré ses dédains calculés ou exagérés pour certaines formes musicales, malgré des partis pris évidents et fâcheux, Bizet était l'un des soutiens les plus fermes, les mieux doués et les plus intelligents de cette école, attendaient avec intérêt ce jeune Maître à sa première œuvre dramatique importante. (*) » C'est M. Arthur Pougin qui parle. Il est vrai qu'il se hâte d'ajouter : « Il s'agissait pour eux de savoir si Bizet, s'adressant de nouveau au théâtre, voudrait se décider à faire de la musique théâtrale, ou bien si, s'obstinant dans les théories antidramatiques de Richard Wagner et de ses imitateurs, il voudrait continuer à transporter à la scène ce qui lui est absolument hostile, c'est-à-dire la rêverie, la poésie extatique et l'élément symphonique pur... »
(*) Arthur Pougin : Supplément à la Biographie générale de Fétis.
Telle était l'opinion de ceux qui voudraient nous voir revenir aux beaux jours de Monsigny et de Niccolo, que toute tentative audacieuse déconcerte et qui, ne pouvant nier les grandes qualités du musicien, son incontestable puissance, son originalité indiscutable, feignaient de voir dans un essai malheureux, où des tendances antiscéniques, heureusement passagères, s'étaient un peu trop librement manifestées, la caractéristique essentielle de son talent.
« Le musicien qui trébuche en faisant un pas en avant, disait Ernest Reyer à propos de Djamileh, est plus digne d'intérêt que celui qui nous montre avec quelle aisance il sait faire un pas en arrière. (*) » Or, nous l'avons vu, Bizet n'avait trébuché qu'à demi... Quant à ceux qui pensent que les Arts ne doivent pas rester stationnaires ; que la Musique, le plus jeune de tous, doit, sans cesse, aller de l'avant, à la conquête d'un idéal sublime que les siècles futurs laisseront peut-être entrevoir, ceux-là, dis-je, attendaient avec confiance. Ils aimaient Bizet, ils l'avaient suivi, pas à pas, depuis l'heure de ses débuts, dans cette marche progressive où chaque étape était marquée par une œuvre toujours plus parfaite et plus en avant. Après l'Arlésienne, ils sentaient que le Maître, en pleine possession de lui-même, allait donner un chef-d'œuvre.
(*) Ernest Reyer (les Débats, 31 mai 1872).
Carmen était donc attendue avec impatience par tous. Les uns comptaient voir triompher, enfin, avec l'œuvre du Maître, les idées esthétiques, les théories musicales de notre jeune École française qui luttait si vaillamment, depuis longtemps, sans avoir pu encore parvenir à s'imposer, de notre jeune École, qu'on accusait de vouloir « nous pousser au germanisme », parce qu'elle pensait, contrairement à ce qui avait été admis jusqu'à cette époque, par tous nos compositeurs, surtout en matière d'opéra-comique, — que la musique de théâtre ne doit pas seulement être jugée et appréciée au point de vue de sa traduction plus ou moins vraie, plus ou moins exacte, de la scène qu'elle est appelée à vivifier par son mouvement, mais aussi sur sa valeur intrinsèque, et que le compositeur dramatique, tout et subordonnant, avec plus de vérité encore, sa musique aux exigences de l'action, en s'efforçant d'atténuer, d'amoindrir la convention, ne doit jamais oublier qu'il est musicien, et que la musique n'est pas seulement le moyen, mais aussi le but.
Les autres, les retardataires, espéraient au fond de leur cœur, sans s'en rendre bien compte, peut-être, une éclatante revanche du vieil opéra-comique français.
Cette première de Carmen était donc un véritable événement d'une très réelle importance. Aussi, le mercredi 3 mars, la salle de l'Opéra-Comique était-elle comble. Tout ce que Paris compte d'illustrations de toutes sortes : le Paris de la littérature et des arts et le Paris mondain, s'y étaient donné rendez-vous.
On a peine à comprendre, aujourd'hui, l'accueil glacial qui fut fait, ce soir-là, à ce chef-d'œuvre.
Le rideau se leva, la pièce se joua devant un public certainement très sympathique et bien disposé, et que rien, cependant, ne put parvenir à dérider. Carmen vivait, palpitait ; l'œuvre puissante, tour à tour pittoresque, et chaude, et passionnée, se déroulait, et, cependant, l'on restait froid. A peine quelques applaudissements : le prélude du second acte bissé, l'air du toréador, le Quintette, remarqués et applaudis, et ce fut tout. Et le rideau se baissa sur une indifférence, sympathique sans doute, mais qui ne parvint que péniblement à s'échauffer un peu quand on vint proclamer le nom des auteurs.
Pendant ce temps, Bizet, navré au plus profond de son âme, s'était réfugié dans le cabinet de Du Locle ; là, quelques-uns de ses amis essayaient de le réconforter, de lui donner en son œuvre une confiance qu'il n'avait plus, déjà.
La représentation venait de finir ; calme en apparence, mais refoulant au fond de son cœur la douleur profonde qui le poignait, Bizet sortit l'un des derniers.
Toujours maître de lui, serrant les mains qui se tendaient, nombreuses et sympathiques, il prit le bras de Guiraud, l'ami cher entre tous. Alors, donnant libre cours à sa douleur si longtemps refoulée, marchant au hasard, errant jusqu'à l'aube, à travers ce Paris qui venait de méconnaître son œuvre, cette œuvre où il avait mis le meilleur de lui-même, il déversa dans le sein de son ami toutes les amertumes de son cœur... (*)
(*) M. Edmond Galabert, dans la préface de Lettres à un ami (Calmann-Lévy édit.), a écrit : « Il est possible qu'en sortant de la première de Carmen, il ait subi une dépression morale passagère, mais Guiraud ne me l'a pourtant pas signalée, n'y attachant pas, probablement, plus d'importance qu'il ne convenait, et il ne m'a pas parlé de cette marche dans Paris qui aurait duré toute la nuit et pendant laquelle Bizet, seul avec lui, aurait exhalé sa douleur. » Eh bien, ce qu'il n'a pas dit à M. Galabert, Guiraud, qui fut mon guide, lorsque j'écrivis cet ouvrage, et documenta, avec un soin jaloux, ma jeune et fervente inexpérience, me l'a souvent répété. Mais, il y a quelques années, fait remarquer M. Galabert, une phrase de Ludovic Halévy, dans un article du Théâtre, sur la Millième représentation de Carmen, est venue contredire le récit de Guiraud : « Nous habitions, Bizet et moi, écrit Ludovic Halévy, la même maison... nous rentrâmes à pied, silencieux. Meilhac nous accompagnait. » Il y a là, évidemment, deux affirmations contraires ; laquelle croire ?... celle de Guiraud, sans hésiter. Halévy, fatigué, vieilli, écrivant le 1er janvier 1905, c'est-à-dire trente ans après la première de Carmen, un article de journal où il faisait appel à des souvenirs imprécis, a dû commettre une inexactitude. Certainement il habitait la même maison ; certainement il est rentré en silence avec Bizet et Meilhac; mais est-ce bien le soir de la première ? N'est-ce pas la veille ou le lendemain ?... Quant à Guiraud, en 1884 ou 85, en pleine vigueur, en pleine maturité, il ne s'est certainement pas trompé. La précision des détails qu'il me donna et que je retrouve, encore aujourd'hui, dans mes notes, est telle qu'il ne m'est pas permis de douter, un instant, de la netteté de ses souvenirs.
Je n'essayerai pas d'expliquer l'incompréhensible accueil du public parisien, du grand public des premières, le Paris artiste qui dirige l'opinion et fait les succès ; il est vraiment inexplicable. L'œuvre se releva bien, vers la cinquième représentation ; mais le verdict injuste porté le premier soir, confirmé par la presse, ne fut jamais complètement rapporté ; les recettes s'élevèrent, mais le public allait à l'Opéra-Comique pour voir cette pièce immorale dont on parlait tant, qu'on avait si vivement discutée, et ne songeait guère à admirer, et Carmen arriva péniblement à 37 représentations.
Pour comprendre une pareille attitude, si visiblement injuste, il faut croire à une éclipse momentanée du goût, phénomène étrange, incompréhensible, mais réel. L'histoire musicale nous offre plusieurs exemples de cette aberration passagère, de cette défaillance cérébrale de tout un peuple. Se souvient-on de l'accueil qui fut fait à Vienne, en 1788, à l'un des plus grands chefs-d'œuvre du génie humain, à l'immortel Don Juan ? Comment l'expliquer, sinon par le phénomène que je signale ? Mozart, triste, découragé, disait avec mélancolie : « J'ai écrit Don Juan pour moi et pour deux de mes amis !... (*) »
(*) Don Juan fut représenté pour la première fois à Prague, pour l'arrivée en cette ville de la grande-duchesse de Toscane, le 4 novembre 1787. Bientôt après, il fut mis en scène à Vienne, mais il obtint un sort tout différent. Mal monté, mal répété, mal joué, mal chanté et plus mal compris, dit Oulibicheff, il y fut complètement éclipsé par l'Axur de Salieri. Don Juan ne fit aucun plaisir. Tout le monde, Mozart excepté, s'imagina que l'ouvrage avait besoin d'être retouché.
En Italie, au pays des enthousiasmes faciles, deux des œuvres les plus justement célèbres de Verdi, le maître cher entre tous aux Italiens : Rigoletto et la Traviata, reçurent un accueil aussi étrange. Rigoletto se releva rapidement ; quant à la Traviata, outrageusement sifflée à Venise, à la Fenice, elle ne dut son salut qu'à l'initiative d'un directeur artiste qui eut le courage de la reprendre trois ans après, au théâtre San Benedetto, où elle obtint, cette fois, un succès triomphal. Mais c'est en France que nous paraissons avoir le triste privilège de ces passagères erreurs. Nous sommes réfractaires à l'admiration sincère et spontanée. Il semble que la méconnaissance des génies nouveaux, de ceux-là qui, ne procédant que d'eux-mêmes, puisent en eux seuls les traits qui les caractérisent et revêtent leur pensée d'une forme bien personnelle, soit une des faiblesses et des infirmités de notre race. Que de tristes souvenirs il me serait facile de rappeler ; je me contenterai d'évoquer la grande ombre de Berlioz.
Pour Berlioz, comme pour Bizet, l'heure de la justice a été tardive ! Ni l'un ni l'autre n'a pu assister au triomphe définitif ! Bizet est mort, emportant dans la tombe les cruelles incertitudes du doute. Il n'a pas même eu, comme son illustre devancier, la consolation bienfaisante des acclamations venues d'au delà les frontières ; il est mort, avant que sa Carmen ait commencé, à travers l'Europe, ce voyage triomphal qui devait enfin nous faire ouvrir les yeux.
D'ordinaire, quand une pièce de théâtre ne réussit pas, une fois l'oraison funèbre prononcée, il n'en est guère plus question ; elle se traîne péniblement, tâchant d'atteindre le plus grand nombre de représentations possible, puis disparaît à jamais, laissant après elle un vague souvenir que personne ne songe à évoquer. Il en fut différemment pour Carmen. Contrairement aux autres œuvres de Bizet, qui, toutes sans exception, avaient eu un assez gros succès à la première représentation, et même — si j'en excepte les Pêcheurs de perles — en général assez bien traitées par la presse, n'avaient pu, malgré tout, arriver à un succès de public, Carmen, accueillie avec une excessive réserve par le public de la première, vivement discutée, bafouée, calomniée par la presse entière, s'était peu à peu sensiblement relevée et obtenait un nombre de représentations bien supérieur à celui des œuvres précédentes, en même temps qu'elle préoccupait vivement l'opinion, surtout dans le monde spécial des dilettantes et des artistes. Carmen froidement accueillie prit, dans les préoccupations artistiques du moment, une place beaucoup plus grande que n'eût, sans aucun doute, occupée Carmen triomphatrice. Il fallait justifier l'attitude, plus que réservée, des premiers jours, expliquer cette froideur que rien dans l'œuvre nouvelle ne semblait justifier ; alors, chacun de recueillir ses souvenirs, d'analyser ses impressions, de les traduire...
Que de grosses accusations ne formula-t-on pas ! La plus ridicule, la plus insensée, est bien certainement celle d'immoralité. On accusa Carmen d'être une œuvre immorale ! Et que l'on ne croie pas que cette absurdité ait été l'émanation unique de l'impression produite par la pièce nouvelle sur le public habituel de la Salle Favart, public un peu bourgeois habitué aux douces émotions du vieil opéra-comique français ; le Tout-Paris artiste et mondain la formula, très nettement. Et l'on vit même en cette affaire, étrange spectacle, Du Locle, le directeur de l'Opéra-Comique, l'homme qui, après Bizet, paraissait devoir être le plus intéressé au succès de Carmen, dénigrer l'œuvre et être le premier à crier à l'inconvenance et à l'immoralité. Je n'exagère rien ! Un ministre lui ayant personnellement écrit pour lui demander une loge à la première représentation, il lui répondit par une invitation à la répétition générale, car, disait-il, la pièce était tellement inconvenante que, avant de lui envoyer une loge pour sa famille, il désirait qu'il vînt juger, par lui-même, s'il pouvait y amener ses enfants. C'est, du reste, avec de pareils procédés, que l'aimable directeur mena son théâtre à la débâcle qui devait mettre fin à son règne, et amener à la salle Favart, avec la direction Carvalho, une ère nouvelle de prospérité.
On comprend sans peine l'influence qu'un directeur si bien prévenu en faveur de l'œuvre qu'il monte, qui a de pareils partis pris et ne se gêne nullement pour les laisser transparaître, faisant en son for intérieur — malgré son amitié pour l'auteur — tous les vœux du monde pour la chute de cette Carmen qu'il n'aimait pas, dut fatalement exercer sur tout son personnel ; les ennuis, les difficultés de toutes sortes, qui durent en résulter pour Bizet ; tandis que des articles de journaux, habilement et perfidement, préparant la chute, annonçant et escomptant le revers, des indiscrétions répandues dans le public par les artistes et les employés du théâtre, propos de coulisse répétés, mots échappés au directeur, grossis et commentés, durent créer des préventions et établir, longtemps même avant la première représentation, un courant défavorable. Mais, ce qui paraît incompréhensible, c'est ce reproche d'immoralité fait à cette œuvre si originale. Quand une œuvre, ne s'attachant pas, de parti pris, à des descriptions lubriques et malsaines, traduit, en des tableaux vrais et palpitants de vie, avec une intensité si douloureuse, les faiblesses de notre chair, le Maître qui l'a conçue n'a pas fait œuvre immorale ; il a fait œuvre d'artiste, de grand artiste ; et l'œuvre d'art n'est jamais malsaine, parce qu'elle s'adresse au cœur, non aux sens, parce qu'elle parle à ce qu'il y a de grand, de noble, d'élevé, au fond de notre faible nature humaine, malgré sa pauvre infirmité. En art, ce qui est immoral, c'est l'avorté, le laid, le médiocre... (*)
(*) Nous en avons vu bien d'autres, depuis lors ! et à l'Opéra-Comique, ex-théâtre des familles ! L'aimable et érudit bibliothécaire de l'Opéra, M. Malherbe, m'a raconté qu'occupant une place dans une loge vide, à la seconde représentation de Carmen, il avait vu, au moment du lever du rideau, la porte s'ouvrir et un gentleman cossu prendre place auprès de lui. Attentif, le nouveau venu contemplait le spectacle avec des yeux stupéfaits ; il s'agitait sur son siège, manifestait, par des gestes, sa mauvaise humeur et son impatience ; enfin, au second acte — au moment où Galli-Marié, avec un geste crâne, cassait une assiette pour s'en faire des castagnettes — n'y tenant plus, il se leva et sortit en faisant claquer la porte. Evidemment entraîné aux douces joies de l'Opéra-Comique, il trouvait celles-ci un peu trop vives. Eh bien, que ce gentleman timoré aille donc voir, à ce même Opéra-Comique ex-théâtre des familles, le second acte de la Jota... si on la joue encore !...
A côté de la grosse accusation, les petits reproches. Ceux-ci ne pouvaient guère porter que sur des parties de l'œuvre, non sur son ensemble ; c'est dans le peuple des jeunes artistes, qui, admirant le grand talent de Bizet, épluchaient la partition, qu'ils se produisirent en grande partie. Les uns, les timides, reprochaient au Maître toutes ses audaces, ses trouvailles harmoniques toujours si piquantes, qu'ils jugeaient risquées, ses tours mélodiques si vivants, si neufs ; la fameuse cadence du grand duo de Carmen et de don José, au second acte, sur ces mots : « Carmen, je t'aime », qui avait surpris tout le monde par son originalité, avait, surtout, le don de les faire bondir. D'autres, les farouches, ceux qui jettent leur gourme, reprochaient au Maître ce qu'ils appelaient ses défaillances, ses concessions au goût bourgeois : pour plaire, Bizet avait encanaillé sa pensée ; et ils se voilaient la face à l'air du Toréador et aux chaudes et généreuses mélodies dont fourmille la partition. Enfin, dérision suprême, certains, non des moindres, renouvelèrent publiquement la fameuse et idiote théorie du « civet sans lièvre », et cela, sans que personne protestât, sans que personne défendît cette lumineuse partition où tout chante, où tout vit, palpite, rit, pleure, gémit de désespoir et d'amour, depuis la première note du prélude jusqu'à l'admirable duo final : « Et moi, Carmen, moi je t'adore », où le malheureux José trouve de si déchirants accents dans sa dernière supplication.
Tous ces reproches, si contradictoires et si vains, je les aurais certainement négligés, s'ils ne trahissaient pas l'état des esprits, le désarroi profond dans lequel l'œuvre du Maître les avait jetés, et, surtout, s'ils n'étaient émanés d'intelligences sérieusement et sincèrement tournées vers l'art.
Voyons maintenant ce qu'était cette œuvre immorale que l'on méconnaissait ainsi.
Le livret de Carmen est tiré, on le sait, de l'une des plus vivantes nouvelles de Prosper Mérimée, dans laquelle il a dépeint, avec une vérité saisissante et cruelle, en des tableaux vifs, j'en conviens, mais d'une netteté et d'une vigueur magistrales, les mœurs bizarres des gitanas et des bohémiens. Certes, on ne peut nier que la peinture ne soit d'une exactitude qui déconcerte souvent par son étrangeté, et que Mérimée ne nous ait mis en contact avec la plus belle collection de misérables et de bandits, et cependant, qui de nous, franchement, oserait taxer d'immoralité l'œuvre du charmant conteur ? C'est que l'écrivain ne s'est pas, lui aussi, complu en des descriptions de parti pris, qu'il s'est contenté d'être vrai, saisissant, de traduire, avec une liberté d'allures et une vigueur des plus grandes, les mœurs des fils d'Égypte, dans leur nudité hideuse et saisissante, mais exacte.
Carmen est l'histoire de ce bandit. Don José Navarro, entrevu par le conteur, une première fois dans la Sierra, une seconde fois dans le repaire de la Carmencita, où l'aventureux touriste archéologue, attiré par l'appât d'une bonne fortune et les yeux noirs de la bohémienne, s'est laissé entraîner, retrouvé, enfin, en chapelle, attendant l'heure de l'expiation. Touché de la sympathie que lui témoigne cet étranger qui lui a sauvé la vie lors de leur première rencontre, José lui ouvre son cœur, lui montre les ravages qu'ont faits dans son âme, qui fût jadis l'âme d'un honnête homme, les yeux noirs de la Bohémienne maudite, l'amour frénétique qui s'est emparé de lui à la vue de cette fille sans cœur...
A la suite d'une dispute, suivie d'une rixe où il avait eu l'avantage et avait tué son adversaire, il dut quitter son pays, la Navarre. Il s'était alors engagé dans un régiment de dragons, en garnison à Séville. Rapidement, il avait gagné les galons de brigadier, et il entrevoyait déjà un nouvel avancement prochain, lorsqu''un jour, qu'il était de garde devant la Manufacture de tabac, il fut chargé, par le chef de poste, de conduire à la prison une bohémienne qui, dans une scène violente avec une de ses camarades, l'avait blessée de son couteau. Cette bohémienne, c'était la Carmencita. En route, la prisonnière essaye le pouvoir de ses charmes sur le malheureux José qui sent déjà son cœur pris ; elle lui parle de son pays, se fait passer pour Navarraise, et, bien que l'infortuné brigadier se rende parfaitement compte qu'elle ment, il consent à tout et laisse échapper la prisonnière. J'aime mieux la façon dont les auteurs du livret ont présenté cette scène. Dans la nouvelle, on a peine à comprendre cet ensorcellement subit, résultat immédiat de quelques phrases rapides échangées en présence des deux soldats de l'escorte. Au théâtre, la scène a lieu devant le corps de garde, pendant que l'officier rédige l'ordre qui doit amener la bohémienne à la prison. Carmen a le temps d'essayer ses charmes sur le faible cœur du Navarrais, de prier, de mentir, de se promettre, de faire entrevoir au malheureux José, véritablement affolé, les enivrements que lui réserve son amour...
José a été dégradé et mis en prison. Dès qu'il est libre, il revoit Carmen, qui, généreusement, acquitte sa dette de reconnaissance. C'est dans une rue tortueuse, la rue du Candilejo, dans le bouge de la vieille Dorothée, une mégère complaisante et « qu'on apprivoise facilement avec quelques verres d'anisette », que les deux amants se retrouvent. Mais l'inconstante Carmen ne peut se fixer sur un unique amour. Tour à tour pris et repris par la bohémienne qui le repousse sans cesse après l'avoir aimé, le malheureux José commence à connaître les tortures de la jalousie. Un soir qu'il causait avec Dorothée, dans le bouge de la rue du Candilejo, tâchant d'obtenir de la vieille des nouvelles de Carmen qui a disparu depuis quelques jours, celle-ci apparaît avec un officier de dragons. José se dresse, blême de fureur ; l'officier veut le forcer à partir et le frappe au front avec son sabre ; José à son tour dégaine et tue son adversaire.
Il faut fuir, fuir dans la montagne, mener la libre vie du contrebandier. Cela sourit assez à l'amoureux qui pourra aimer sans contrainte et emporter sa Carmen, en croupe, à travers la sierra : « Si je te tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je serai sûr de toi ! Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. — Ah ! tu es jaloux, répondait-elle. Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela ! Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ? — Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. »
On l'admet dans la bande de Dancaïre, à laquelle Carmen était dès longtemps affiliée.
Alors commença la vie cruelle, la vie terrible du bandit, sans cesse en éveil, sans cesse poursuivi et traqué ; tour à tour contrebandier, tour à tour détrousseur et assassin, attendant, embusqué le long des routes, le gibier que Carmen rabattait. Mais le fatal amour était toujours là, vivant, au fond du cœur, et la jalousie féroce le tenait toujours en éveil.
Peu à peu ses compagnons se dispersent, les uns sont morts sous les balles des soldats, les autres ont fui ; José reste seul avec Carmen. Alors, las de cette vie d'aventures et de crimes, de ces alertes continuelles, de cette jalousie atroce qui le torture, de ces éternelles tromperies, il veut s'expatrier, redevenir honnête homme, emporter sa Carmen au fond de l'Amérique et vivre tranquillement, enfin. Mais la bohémienne refuse ; elle n'aime plus José. Vainement l'infortuné supplie, se jette à ses genoux ; Carmen ne l'aime plus et veut le quitter. José ne peut plus vivre sans cet amour qui est sa vie ; il mourra, mais Carmen mourra aussi, avant lui ; il ne la laissera pas, vivante, servir de proie à un nouvel amant : « Tu aimes donc Lucas ? lui demandais-je. — Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. A présent, je n'aime plus rien et je me hais pour t'avoir aimé... » Et le malheureux supplie encore, mais Carmen reste inflexible ; elle ôte de son doigt l'anneau que José lui avait donné, jadis, et le jette dans les broussailles. Ivre de fureur, José se précipite sur la malheureuse. « Je la frappai deux fois... Elle tomba au second coup, sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement ; puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague, et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle, avec une petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue et au premier corps de garde je me fis connaître. »
Telle est la nouvelle, cruelle, pleine d'amour et de coups de couteau, de sombre passion et d'éclats de rire.
Meilhac et Halévy en ont tiré un livret coloré, mouvementé, d'une originalité incontestable.
Ils ont compris que ce qui est dramatique dans le livre ne l'est pas toujours au théâtre ; que des scènes, grouillantes de vie, deviennent odieuses, parfois, à la scène ; aussi, sans diminuer en rien le caractère indomptable, capricieux et pervers de leur héroïne, sans atténuer l'amour délirant qui s'est emparé de l'infortuné José, la faiblesse de sa nature flottante et indécise, sa lâcheté criminelle, ils ont adouci les tons vigoureux du milieu dans lequel toutes ces passions s'agitent. Ils ont pensé, avec raison, que le réalisme théâtral n'était et ne pouvait être qu'un réalisme tempéré, que la vérité scénique ne serait jamais qu'une vérité relative, qui souligne et qui interprète, qui donne des impressions directes des objets, sans toujours présenter ces objets eux-mêmes. De là les nombreux changements qu'ils ont introduits dans leur livret. D'abord, Garcia le borgne, le rom (*) de Carmen, que la bohémienne vient de faire échapper du présidio de Tarifa, en séduisant, selon ses procédés habituels, les gardiens qui veillaient sur lui, a disparu. Il eût été trop vif de présenter, au théâtre, ce gredin dont Mérimée a mis, en deux mots, le saisissant portrait dans la bouche de son héros : « C'était bien le plus vilain monstre que la Bohème ait nourri ; noir de peau, noir d'âme. C'était le plus franc scélérat que j'aie rencontré dans ma vie » ; d'étaler l'horrible promiscuité qui règne dans la nouvelle, les continuelles scènes de jalousie entre José et Carmen, scènes dont le mari est la cause, le mari, se souciant de sa femme comme d'une guigne, et la faisant servir d'amorce au gibier qu'il abat ; enfin, le terrible duel au couteau où, toujours poussé par la jalousie, José égorge son adversaire. Ils ont substitué au mari l'amant, l'amant nouveau, plein de séductions et d'appas, le torero Escamillo, le bellâtre, qui n'est que le grossissement du torero Lucas, à peine entrevu dans le roman, où il reste tout le temps à la cantonade. De même, a disparu le bouge de la rue du Candilejo ; la vieille Dorothée a fait place au « marchand de friture » Lillas Pastia, qui, lui-même, est monté en grade et est devenu un aimable cabaretier, dont l'établissement, situé près des portes de la ville, sert de rendez-vous à la bande de Dancaïre, à laquelle est affiliée Carmen. Plus d'assassinat d'officier ; des coups suffisent ; plus de meurtres, plus d'égorgements. Le duel est sans issue ; partie remise ; à plus tard. Enfin, et ceci est la plus heureuse trouvaille des librettistes, ils ont créé la douce et charmante Micaëla. Cette chaste figure, qui ne fait qu'apparaître, rayonne sur l'œuvre entière ; sans elle, la nouvelle de Mérimée eût été intraduisible à la scène ; elle eût manqué d'intérêt. Et c'est là une des différences essentielles du livre et du théâtre. Au théâtre, il faut à tout prix que le spectateur s'intéresse à quelqu'un ou à quelque chose. A qui aurait-il donc pu s'intéresser dans l'abominable séquelle des scélérats de Mérimée ? Alors, cette phrase, dite par José Navarro au début de son histoire : « J'étais jeune alors, je pensais au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupes bleues et sans nattes tombant sur les épaules », a inspiré aux librettistes la douce Micaëla, et ils ont réalisé cette radieuse figure faite de poésie et de charme, ils ont projeté, sur leur sombre tableau, ce clair rayon de soleil qui en fait encore mieux saillir l'âpreté sauvage.
(*) Rom signifie mari dans la langue des libres fils de Bohême.
CARMEN (suite).
Carmen s'ouvre par un court et brillant prélude. Il semble que Bizet, au début de cette œuvre, sur laquelle il fondait de si légitimes espérances, ait voulu rassurer le public que son admirable talent de symphoniste pouvait égarer. Hélas ! les préjugés sont vivaces. Tous les trésors de mélodie, de couleur, de mouvement scénique, si prodigieusement répandus dans ce chef-d'œuvre, le furent en pure perte, tout d'abord.
Le motif principal de la Marche du quatrième acte, la Marche de la Quadrilla, lancé à toute volée dans l'éclatante tonalité de la majeur, encadrant le refrain de l'air du Toréador, forme la première partie de ce Prélude. La seconde partie, Andante moderato, est formée par une large phrase, dite par les altos et les violoncelles, accompagnée de tremolos des violons et de pizzicati intermittents des contrebasses. Cette phrase mélodique est le résultat de la reproduction, à divers intervalles, d'un groupe de cinq notes, groupe terrible, qui pèse sur l'œuvre entière comme le doigt implacable du Destin, qui s'attache à Carmen, paraît, pour la première fois, dans le drame musical, au moment de son entrée en scène, et l'accompagne pendant toute la durée de l'action, reparaissant sous différentes formes, toujours obsédante, murmurée par l'orchestre, au milieu des scènes tristes ou joyeuses, comme une sombre menace de mort ; menace que Carmen lira, dans les cartes, plus tard, au troisième acte, et contre laquelle son aveugle fatalisme l'empêchera de réagir.
Tout l'effet pittoresque de ce groupe de cinq notes, qui exprime, d'une si troublante façon, l'idée de mort qui domine le drame musical et amènera le dénouement, est obtenu par l'intervalle de seconde augmentée qui sépare la troisième note du groupe de la seconde et de la quatrième. Ici, au seuil du drame, la menace de mort prend une expression déchirante ; attaquée tutta forza, la phrase mélodique s'étend lentement, coupée, à intervalles réguliers, par les sanglots des contrebasses. Bientôt, cependant, le calme semble renaître, la plainte semble s'apaiser, mais pour reprendre plus douloureuse ; le tremolo des violons s'accentue et monte en crescendo, les sanglots des contrebasses deviennent plus pressés, la phrase mélodique plus déchirante, enfin, dans un beau déchaînement harmonique, un terrible accord de septième diminuée vient trancher la trame symphonique et conclure brusquement...
... Le rideau se lève. Nous sommes en Espagne, à Séville, vers 1820. Une place : à droite, la manufacture de tabac ; à gauche, un corps de garde ; au fond, un pont traversant la scène dans toute son étendue. Des passants, gens affairés, pressant le pas, flâneurs aux allures moins rapides, vont et viennent, tandis que les dragons du poste, les uns assis, les autres accoudés sur la balustrade de la petite galerie du corps de garde, fumant et causant, regardent passer les gens. L'exposition musicale est des plus simples ; d'abord le chœur des dragons, d'une allure si originale, puis l'entrée de Micaëla, la blonde Navarraise, et son dialogue avec le brigadier Moralès, d'une vérité d'accent et d'une justesse d'expression si remarquables. L'art, ici, comme partout, dans cette œuvre admirable, se dissimule et disparaît sous l'abondance de l'idée ; il souligne, sans trahir sa présence, la pensée mélodique, et donne à la phrase, claire, simple, ce relief étonnant qui surprend et qui charme, dès les premières mesures.
Après le dialogue de Micaëla et de Moralès et la courte reprise du chœur, les auteurs du livret ont placé une scène étrange, dont rien ne justifie la présence ; c'est la fameuse Pantomime qui se déroulait, — soutenue par la belle musique descriptive de Bizet et le plaisant monologue du brigadier Moralès, — lors des premières représentations de Carmen, à l'Opéra-Comique, en mars 1875. Bizet, malgré son sens profond des choses du théâtre, n'eut sans doute pas la force de faire disparaître cette scène inutile, de couper dans le vif. Il vit là un prétexte à tableau musical chatoyant, il conserva donc cette scène, essaya de l'animer, de la rendre intéressante, scéniquement, et il y réussit, car ce petit tableau musical est plein de charme et de mouvement, grâce au spirituel monologue de Moralès, qui l'accompagne et le souligne ; mais, malgré tout, il reste en dehors de l'action et ne constitue qu'un brillant hors-d'œuvre. Son tort le plus grave est de dérouter le spectateur, de le mettre sur une fausse voie, en attirant son attention sur des personnages épisodiques, dont la plupart ne reparaîtront pas dans l'action, tandis que les personnages principaux, les acteurs du drame, sont encore complètement inconnus. De plus, il n'apporte rien de nouveau au drame, auquel il reste complètement étranger, avec lequel il n'a même pas le moindre point de contact et qu'il ralentit, ou plutôt qu'il retarde, car il n'a pas encore commencé. Carvalho, en impitoyable metteur en scène, a supprimé la Pantomime, lors de la reprise de Carmen, le 24 avril 1883. La musique savoureuse de Bizet n'a pas trouvé grâce devant lui.
Aujourd'hui le n° 3 de la Partition s'enchaîne directement avec le n° 1. A peine les dernières notes du chœur des dragons ont-elles expiré, qu'un appel lointain de clairon retentit. Le clairon du poste répond. Alors, tandis que les dragons vont prendre leur lance et se rangent devant le corps de garde, on entend, au loin, une marche militaire, jouée par deux fifres, auxquels viennent se joindre des sonneries intermittentes de clairon. C'est la garde montante qui arrive.
Elle apparaît à la tête du pont. Derrière les fifres et les clairons, une bande de gamins, bras dessus bras dessous, faisant de grandes enjambées pour marcher au pas des dragons, chante à tue-tête. Ce Chœur des gamins est un chef-d'œuvre. C'est une de ces pages de facture où Bizet, n'ayant pas la préoccupation d'un sentiment tendre, pathétique ou pervers à exprimer, a cherché une idée musicale donnant l'impression exacte de la scène qu'il avait à rendre, l'a caressée, avec cet art suprême qui est le sien, la présentant sous ses différents aspects, trouvant sans cesse des combinaisons nouvelles et ingénieuses, des harmonies neuves et piquantes, véritable tableau de maître, aux tonalités exquises et harmonieuses. Ici, c'est le motif en ré mineur, esquissé dans le lointain, au début de la scène, par les deux fifres et le clairon, ensuite développé par l'orchestre, qui sert de thème. Il est repris par le chœur, d'abord dans sa tonalité première ; puis les modulations surgissent, les harmonies éclatantes et sonores ou caressantes et apaisées, suivant l'impression changeante de la scène, se succèdent, donnant une saveur nouvelle au motif déjà entendu.
Nous retrouverons, dans cette riche partition de Carmen, plusieurs de ces épisodes musicaux, si pleins d'art et de charme, que Bizet semble affectionner, qu'il a disséminés dans son œuvre, et dont le magnifique Prélude de l'Arlésienne est resté le type le plus célèbre.
Nous voici au point culminant du premier acte : l'entrée de Carmen. La cloche de la manufacture de tabac vient de sonner, appelant les ouvrières au travail. Des jeunes gens accourent, de tous côtés, pour voir défiler les cigarières. La scène débute par un petit chœur de ces jeunes amoureux transis, qui passe généralement inaperçu, malgré son incontestable originalité, absorbé qu'il est par le Chœur des cigarières, qui le suit, chœur suave, d'une poésie étrange, avec sa phrase coquette aux ondulations caressantes et ses jolies réponses des contralti, capiteux et troublant comme la blonde fumée que chantent ces filles d'Andalousie.
Mais voici Carmen. Attaqué par les violons, le groupe fatal, qui, lentement exposé et développé, a déjà gémi et pleuré dans la seconde partie du prélude, vient de s'élever du milieu de l'orchestre, serré, incisif, rapide. Cette plainte, tantôt lente et douloureuse, tantôt brève, toujours troublante, — réalisation symphonique de la figure de la bohémienne, de même que le refrain de l'air du second acte : Toréador, en garde, etc., est l'incarnation musicale du bravache Escamillo, dont il dessine la silhouette et met en relief la sotte vantardise, — exprime, avec une intensité parfois déchirante, le côté fatal qui domine le drame, qui mène les victimes à travers l'action et les livre, lui, pantelant, ivre de fureur et d'amour, elle, sombre et farouche, à l'implacable bras du Destin. Elle prend, ici, une allure de défi ; incisive et mordante, gardant toujours, cependant, ce sceau douloureux, si pittoresquement caractéristique, elle ressemble plutôt à une provocation qu'à une plainte. Carmen n'a pas encore vu José, elle l'ignore ; le fatal amour, caprice d'un jour chez la coquine, passion mortelle chez le faible Navarrais, n'est pas encore né dans leurs cœurs. Confiant et tranquille, José pense à la blonde Micaëla, dont son camarade Moralès lui a annoncé l'arrivée, à sa vieille mère, aux montagnes chéries de la Navarre ; assis dans un coin, indifférent à ce qui se passe autour de lui, il fabrique une chaîne en fil de laiton pour attacher son épinglette.
Escortée d'adorateurs empressés et obséquieux qui mendient un regard, un sourire, Carmen paraît, fière et coquette, telle que l'a décrite Mérimée : le poing sur la hanche, l'œil insolent, un bouquet de cassie à son corsage, une fleur de cassie au coin de la bouche. Musicalement, elle est posée dès sa première phrase.
« Quand je vous aimerai ? ma foi ! je ne sais pas... » C'est bien là le langage de la fille de Bohème, pleine d'insouciance, qui laisse aller son cœur au gré de sa fantaisie et de son caprice.
« Peut-être jamais, peut-être demain », et la phrase prend une inflexion caressante, quelque chose comme une promesse vague, l'apparence d'un désir qui permet d'espérer. C'est l'étrange fascination de la Sirène qui se manifeste, onduleuse, perverse.
Subitement la fille reparaît. « Mais pas aujourd'hui, c'est certain. » Avec cette mobilité d'impressions qui caractérise ses pareilles, elle passe d'un sentiment à un autre, brusquement, sans transition ; de l'amour troublant et lascif, à la haine aveugle, que rien ne motive et ne justifie.
Dès qu'elle lève les yeux sur José et lui adresse la parole, — semblant, de son regard magnétique, envelopper tout son être sous la chaude caresse d'un désir, — on a la subite intuition du drame, du furieux amour de José, de toutes ses lâchetés, de toutes ses trahisons, de tous ses crimes, et du coup de couteau final.
L'Habanera si populaire que dit Carmen, à son entrée en scène, fut écrite pendant les répétitions (*). Bizet avait d'abord composé une chanson, à six-huit, avec chœur. La chanson avait été apprise et répétée, mais Galli-Marié ne la trouvait pas à son goût. Elle voulait, dès son apparition, produire un grand effet, camper fièrement et définitivement le personnage de la bohémienne, et, pour cela, elle désirait un air caractéristique, quelque chose comme une chanson du cru, — chanson Espagnole, ou pastiche très coloré, légèrement troublant, — où elle pût à loisir déployer l'arsenal complet de ce que j'appellerai, volontiers, ses perversités artistiques : caresses de la voix et du sourire, inflexions voluptueuses, œillades assassines, gestes troublants.
(*) La Chanson d'entrée de Carmen fut refaite treize fois, m'a affirmé Guiraud : ce ne fut que la 13e version qui plut complètement à Galli-Marié et fut adoptée. Cette charmante Habanera a été inspirée par une chanson espagnole d'Yradier : le S'Areglito. La partition piano et chant de Carmen porte, au bas de la première page de l'Habanera, cette mention : « Imitée d'une chanson Espagnole propriété des éditeurs du Ménestrel ».
La chanson de Bizet ne répondait nullement au programme de son interprète. Celle-ci, après avoir hésité quelque temps, se décida, enfin, au moment des répétitions à la scène, à lui faire part de ses idées et de son vif désir, le priant de changer sa chanson, de « trouver autre chose ». Bizet n'osa refuser.
Exténué, énervé, brisé par de longues et fatigantes répétitions, il dut se remettre à la besogne et « trouver autre chose », pour complaire à son interprète. Enfin, pressé par les répétitions qui s'avançaient et par la première représentation imminente, il fixa son esprit sur le thème d'une chanson Espagnole qui avait attiré son attention, jadis, alors que, se préparant à écrire Carmen, il feuilletait des albums de chants caractéristiques de la Péninsule, pour bien se pénétrer de leur rythme et de leur couleur. Et c'est avec ce thème, peu intéressant par lui-même, mais élargi et vivifié par l'art, ce grand art de Bizet qui féconde tout ce qu'il touche, qu'il écrivit l'Habanera dont le succès fut colossal.
Avant de parler de la Séguidille, qui est une des pages les plus chaudes et les plus vibrantes de cette lumineuse partition, ainsi que la scène finale de ce premier acte, disons quelques mots du beau Duo de Micaëla et de don José.
Micaëla, la blonde Navarraise, est, dans ce sombre drame, la seule figure chaste et pure, servant de repoussoir lumineux à cette hideuse collection de filles et de bandits. Mérimée, dans sa nouvelle, a peint les mœurs des tribus errantes qui, sous le nom de Bohémiens ou d'Egyptiens, parcouraient et parcourent encore de nos jours l'Espagne, ainsi que certaines de nos provinces du Midi. Sa nouvelle, pour être intéressante, n'avait qu'à être vraie ; pour être émouvante, qu'à être sincère. Elle est un vrai chef-d'œuvre. Mais, sans crainte de me répéter, je le dis encore une fois, au théâtre les choses se passent différemment. Certes, je ne prétends pas que la traduction, vigoureuse et si magistralement burinée par le musicien, des scènes grouillantes de la libre vie, n'ait pas, par elle-même, un intérêt suffisant, mais, en dehors de l'intérêt de vérité et de rendu que dégage toute œuvre d'art, il en est un autre, que j'appellerais volontiers intérêt psychologique, qui est de l'essence même du théâtre ; c'est celui qui résulte de la réalisation, poétique ou simplement sympathique, d'une figure réunissant les vertus qui manquent aux autres. Dans un milieu bourgeois, où les vertus comme les vices affectent des allures tempérées, la figure sympathique se dissimule sous les habits de l'honnête homme que nous coudoyons, souvent sans le reconnaître ; ici, au milieu de cette collection de coquines et de bandits, au milieu de ce peuple de scélérats, dont les vices cachés des autres sont les vertus qu'ils étalent au grand jour, il fallait une figure chaste et radieuse. Les auteurs du livret l'ont compris, et ils ont introduit, dans l'action, cette douce Micaëla, qui l'éclaire d'un rayon de poésie. Et puis, sans Micaëla, José serait bien moins coupable ; ses lâchetés seraient moins odieuses, si sa blonde fiancée n'était venue, dès le début du drame, avant même que Carmen n'ait étreint de son ongle d'acier son pauvre cœur si faible, lui apporter, avec le baiser de sa vieille mère qui l'attend là-bas, au village, la promesse du bonheur tranquille, de l'amour pur.
Comme Bizet a bien réalisé musicalement cette figure de la Navarraise ! comme il en a bien saisi l'âme tendre et candide ! comme il l'a poétiquement traduite, Micaëla vient de là-bas, du pays ; c'est la mère de José qui l'envoie vers son fils ; alors José : « Parle-moi de ma mère ! » Et le Duo se déroule, d'une suavité d'accent, d'un charme, d'une douce et chaste poésie qui repose et qui épanouit l'âme. On a beaucoup critiqué, au début, la phrase en sol : « Ma mère, je la vois, » qui, d'abord dite par José, forme ensuite l'ensemble du Duo ; on la trouvait, ou, du moins, certains la trouvaient commune, banale. Je n'ai jamais compris, pour ma part, que l'on pût faire un pareil reproche à cette fraîche inspiration, faite de charme — le charme de la douce vision évoquée, du clocher lointain qui abrita l'enfance heureuse, des souvenirs d'autrefois... — les deux voix se marient, avec une suavité calme et tranquille, se complaisant dans l'évocation bienfaisante des jours passés. J'ai toujours trouvé, au contraire, cette partie du Duo absolument exquise ; aujourd'hui, tout le monde pense comme moi ; ce reproche de banalité s'est envolé, avec bien d'autres...
Un bruit strident, fait de clameurs, de hurlements, de cris de toute nature, vient d'éclater dans la manufacture de tabac qui fait face au poste ; tout le monde est en émoi ; les dragons sortent précipitamment pour connaître la cause du vacarme et le faire cesser ; ils s'avancent vers la manufacture... Soudain, les ouvrières font irruption sur la scène, criant, hurlant, gesticulant, encore rouges et chaudes de la lutte. Le chœur : « Au secours ! n'entendez-vous pas ? » est d'un mouvement, d'une allure, d'une vérité saisissante. Les femmes de la manufacture, divisées en deux camps ennemis, glapissant avec une volubilité rythmique extraordinaire, tout en s'injuriant encore, en se montrant le poing, racontent à l'officier du poste l'aventure qui vient de les diviser et d'occasionner le tumulte : chaque groupe parle à son tour, laissant à peine à l'autre le temps d'achever la phrase commencée, tirant l'officier de son côté pour essayer de le gagner à sa cause, le harcelant, l'assourdissant de ces jacasseries sans fin. On parvient à obtenir, enfin, un peu de silence ; les soldats ont repoussé et écarté les cigarières ; le lieutenant profite de cette accalmie pour donner ses ordres :
Prenez, José, deux hommes avec vous
Et voyez là-dedans qui cause ce tapage.
José, suivi de deux soldats, entre dans la manufacture. Pendant ce temps, les cigarières, qui n'ont pas cessé un instant de se disputer entre elles, glissent entre les mains des dragons qui cherchent à les écarter, et, se précipitant vers le lieutenant, reprennent le chœur avec une intensité nouvelle.
Enfin, après de nouveaux efforts, les dragons parviennent à les repousser et à les maintenir à distance, autour de la place.
En ce moment Carmen paraît sur la porte de la manufacture, amenée par don José, et suivie par les deux Dragons. « Voyons ! brigadier... Maintenant que nous avons un peu de silence, qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans ? »
Alors, commence l'interrogatoire de la coupable. A chacune des questions du lieutenant, Carmen, insolente, le poing sur la hanche, répond par des fredons.
« Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse. » Et la bohémienne, toujours gouailleuse, passe et repasse, en fredonnant, sous le nez du lieutenant stupéfait, rythmant, du balancement de ses hanches lascives, la chanson troublante qu'elle poursuit sans cesse, sans se préoccuper de ce qui se passe autour d'elle.
En ce moment, cinq ou six femmes réussissent à forcer la ligne des factionnaires et se précipitent sur la scène en criant : « Oui, oui, c'est elle !... » L'une d'elles se trouve à portée de Carmen ; elle lève la main et veut se jeter sur la malheureuse. Don José l'arrête, tandis que les dragons rétablissent l'ordre et repoussent définitivement les cigarières. « Eh ! eh ! vous avez la main leste décidément... trouvez-moi une corde. » Mais Carmen, redevenue indifférente, se remet à fredonner, de la façon la plus impertinente, en narguant le lieutenant.
Bizet a traduit, avec une bien grande vérité, cette scène étrange où le caractère indomptable de la bohémienne apparaît, pour la première fois, dans sa sauvage nudité ; il a posé, avec bonheur, ce type de fille inflexible que la crainte de la prison n'effarouche nullement, pas plus que la menace de mort et le couteau de José ne la feront trembler plus tard.
Voici l'étrange scène de séduction, de fascination.
Assise sur un escabeau, les mains liées derrière le dos, Carmen attend, avec une feinte résignation, l'ordre qui doit la conduire à la prison. Elle essaye, d'abord, par un mensonge, de surprendre la bonne foi de don José ; vainement ; le Navarrais est fidèle à sa consigne, il ne lui rendra pas la liberté, il la conduira à la prison.
« Au fait, s'écrie alors Carmen, je suis bien bonne de me donner la peine de mentir... Oui, je suis Bohémienne, mais tu n'en feras pas moins ce que je te demande... Tu le feras, parce que tu m'aimes...
JOSÉ
Moi !
CARMEN
Eh ! oui, tu m'aimes... ne me dis pas non, je m'y connais ! tes regards, la façon dont tu me parles. Et cette fleur que tu as gardée. Oh ! tu peux la jeter maintenant... cela n'y fera rien. Elle est restée assez de temps sur ton cœur ; le charme a opéré...
JOSÉ (avec colère)
Ne me parle plus, tu entends, je te défends de me parler. »
Carmen se met alors à fredonner cette Séguidille, à la phrase onduleuse et caressante, d'abord, se transformant, ensuite, en babil joyeusement cynique, où toutes les amours d'un jour, toutes les prostitutions sans nombre de la fille, défilent, dans un caquetage charmant, plein de caresses et de promesses enivrantes. Don José, haletant, éperdu, écoute avec angoisse. Enfin, n'y tenant plus, fiévreux, l'œil hagard, il se précipite vers la fille toujours impassible, et, dans un cri superbe, déchirant, où la passion mortelle qui vient de s'emparer de lui et de terrasser le devoir, l'honneur, l'amour chaste et pur de Micaëla, transparaît dans toute sa frénétique puissance :
Carmen, je suis comme un homme ivre,
Si je cède, si je me livre,
Ta promesse, tu la tiendras...
Si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimeras...
Et la bohémienne, sans répondre directement à cette explosion de passion délirante, sûre de son triomphe, reprend sa capiteuse chanson, toujours pleine de promesses, de danses folles et de baisers...
Le lieutenant vient de paraître sur le seuil du corps de garde, il apporte l'ordre signé ; Carmen, à qui José a délié les mains, reprend sa place sur son escabeau, les mains derrière le dos.
Le finale débute par une fugue des instruments cordes, en sourdine, dont le violoncelle expose gravement le sujet fourni par le motif du chœur de la dispute des cigarières.
Le cortège s'est formé ; Carmen, suivie de deux dragons, ayant à sa droite José, s'avance, toujours provocante, au milieu de l'affluence des ouvrières et des bourgeois ; arrivée au milieu du pont, selon l'accord intervenu entre les deux complices, Carmen pousse José qui se laisse renverser. Alors, au milieu d'un désordre inexprimable, fait de cris, de clameurs, d'éclats de rire, la bohémienne s'enfuit après avoir jeté sa corde à la volée, tandis qu'une partie des cigarières, qui tout à l'heure la défendaient avec tant d'acharnement, empêche les soldats de la poursuivre, et que les autres, entourant le lieutenant, au milieu des huées à l'adresse des dragons, lui chantent ironiquement le refrain de l'Habanera :
L'Amour est enfant de Bohême ;
Il n'a jamais, jamais connu de lois.
Si l'on voulait analyser toutes les beautés de ce chef-d'œuvre, un volume ne suffirait pas ; aussi dois-je me borner, indiquer, en passant, des merveilles d'inspiration et d'art, en les saluant, à peine, au passage. De ce nombre est le petit prélude instrumental qui précède le second acte. Il est de la famille des bijoux finement ciselés, dont j'ai parlé ; peut-être le plus fin et le plus délicat de tous, avec sa jolie phrase si caractéristique, en sol mineur, — qui est la phrase de la chanson des Dragons d'Alcala, que l'on va bientôt entendre, — que dialoguent si spirituellement la clarinette et le basson.
Vient ensuite la Chanson Bohême. Nous sommes dans la taverne de Lillas Pastia ; c'est le soir ; des bohémiennes et des soldats fument des cigarettes en buvant du manzanilla ; dans un coin, deux bohémiens raclent de la guitare, tandis que quelques gitanas, l'œil enfiévré, castagnettes au poing, le rire aux lèvres, se démènent et se contorsionnent, au milieu de la fumée et des gais propos. Et la mélopée des instruments, d'abord lente et indécise, se précise, prend du contour, du mouvement, de la couleur, et éclate dans un tourbillon lumineux où la folie du rythme enfiévré touche au délire. Quelle page maîtresse !... On a reproché à Bizet d'avoir, dans cette scène merveilleuse, abusé du chromatique, des chocs de notes dont les oreilles timorées se scandalisèrent, d'avoir, en un mot, poussé l'audace un peu loin. Mais c'est de ces chocs audacieux que jaillit l'étincelle lumineuse qui donne à cette page étrange sa saveur, sa troublante originalité ! Bizet était l'artiste de toutes les audaces ; dans son horreur du poncif, il allait un peu loin quelquefois, jamais trop loin, parce que son goût sûr, affiné par l'étude approfondie de son art, mûri et guidé par sa science profonde, ne lui permettait jamais de s'égarer. « Nous tous, jeunes compositeurs, écrivait Victorin Joncières au lendemain de la mort du Maître, nous tous, nous n'aurions peut-être pas abandonné les chemins monotones tant de fois parcourus par nos devanciers, si Bizet ne nous avait précédés dans le domaine inexploré de l'art nouveau. (*) »
(*) La Liberté du 7 juin 1875 : « C'est Bizet qui le premier eut le courage d'embrasser les doctrines nouvelles, et cela à une époque où, bien plus qu'aujourd'hui, il risquait de demeurer seul et incompris. Son audace fraya la route aux musiciens de sa génération qui, excités par son exemple, le suivirent dans la voie où il s'était avancé si résolument. Nous tous, jeunes compositeurs, nous n'aurions peut-être pas abandonné les chemins monotones tant de fois parcourus par nos devanciers, si Bizet ne nous avait précédés dans les domaines inexplorés de l'art nouveau. » (Victorin Joncières.)
Donc, laissons dire les détracteurs, et souvenons-nous de l'énorme poussée en avant que cet art nouveau , sans cesse en quête de l'imprévu, de l'inentendu, a déterminé dans notre Ecole contemporaine.
Voici maintenant l'Air du Toréador, ou, plutôt, les Couplets du Toréador, car ce sont de véritables couplets. Eh oui, Bizet, l'ennemi de toutes les vieilles formules surannées, n'a pas craint cette forme usée. Le tout est de rajeunir et de faire revivre ; aussi, quelle exubérance de mouvement, quelle richesse de coloris, quelle ampleur magistrale Et ce refrain, qualifié banal par les intransigeants, quelle allure n'a-t-il pas ! Il faut que l'esprit de système, que le préjugé les ait rendus bien aveugles, ces outranciers, pour qu'ils n'aient pas compris tout ce qu'il y a de morgue, de sotte vantardise, dans cette incarnation symphonique du bellâtre Escamillo, du toréador vaniteux et bête, faisant sottement la roue devant les bohémiennes fascinées. Escamillo vit par cette phrase unique qui l'exprime à ravir. Que l'orchestre la murmure, et la silhouette du matador apparaît, nette et précise, avec ses gestes vainqueurs et ses œillades enamourées. En vérité, je vous le dis, c'est le grand Art, celui qui fixe en quelques mesures une figure inoubliable, qui traduit le tempérament, les mœurs, le caractère d'un personnage de façon si saisissante, qui fait vivre, enfin.
Suit le Quintette. Les officiers et les paysans ont déguerpi faisant escorte à Escamillo ; les bohémiennes, sur un signe de Lillas Pastia, ont refusé de se joindre à eux. A peine le cortège a-t-il disparu, que Pastia ferme les portes et met les volets, et, quand les chants se sont éteints dans l'éloignement, le Dancaïre et le Remendado, le chef de la bande bohémienne et son lieutenant, qui se tenaient cachés, apparaissent. Il s'agit de faire passer en contrebande la cargaison entière d'un navire ; pour cela, le concours des trois bohémiennes est indispensable.
Que dire de cet admirable Quintette ?... Assurément que c'est une des pages les plus étonnantes au point de vue du métier, des plus savamment équilibrées, des plus magistralement développées ; mais aussi quel, charme ! quelle séduction ! comme toute l'habileté technique, la science et l'art, disparaissent sous l'abondance de l'idée, sous la vérité expressive et coquettement, malicieusement babillarde, de la phrase mélodique ! C'est du grand Art, dans ce qu'il a de plus élevé, malgré la situation, presque comique, que traduit et souligne cette page savoureuse.
La chanson des dragons d'Alcala se fait entendre, au loin d'abord, puis se rapproche peu à peu. C'est José qui vient au rendez-vous que lui a assigné Carmen.. Le motif est d'une allure crâne, qui n'exclut certes pas l'originalité ; c'est, en effet, un des motifs les plus caractéristiques de la partition. Il a déjà fourni le thème du prélude qui ouvre ce second acte ; ici, il apparaît sans le moindre accompagnement. La voix se rapproche, au fur et à mesure que les couplets se déroulent. Sur les derniers mots, José entre en scène.
Il est sorti, le matin même, de la prison où il est resté un long mois, après avoir été dégradé. On n'a pas voulu admettre que deux mignonnes mains de femme aient pu renverser un brigadier du régiment d'Alcala ; il a donc été puni, comme complice de la bohémienne. Carmen, qui tient sa promesse, en véritable fille de Bohême, lui a envoyé, dans sa prison, une lime et une pièce d'or... « Avec la lime, il fallait, lui dit-elle, scier le plus gros barreau de ta prison... avec la pièce d'or, il fallait, chez le premier fripier venu, changer ton uniforme pour un habit bourgeois. » Tout cela était possible, mais José a son honneur de soldat, intact encore, et, malgré son amour violent, il n'a pas voulu déserter ; il a gardé la lime, en souvenir de la bohémienne, pour affiler sa lance ; quant à la pièce d'or, il l'a gardée aussi et il la rend. Le Duo de Carmen et de don José est la grande page dramatique de ce second acte.
Carmen, s'accompagnant de ses castagnettes, danse la romalis, pour José, pour lui seul, et José, ravi, fou d'amour, la contemple avec extase, la dévore des yeux.
Soudain, au loin, bien au loin, des clairons se font entendre, ils sonnent la retraite ; José se dresse, prête l'oreille ; il arrête Carmen dont les castagnettes l'empêchent d'entendre et de distinguer. Bientôt il n'en peut plus douter, la retraite passe sous les fenêtres, ce sont les clairons du régiment. Alors, précipitamment, il remet sa giberne, rattache le ceinturon de son sabre, tandis que Carmen, qui comprend enfin, furieuse de sa peine perdue, de ses agaceries impuissantes à le retenir, lui lance son shako à la volée et le congédie brutalement.
Mais non, il ne partira sans lui avoir dit, encore une fois, l'amour délirant qui s'est emparé de son âme ; et voici cette phrase admirable : « La fleur que tu m'avais jetée », qui est une merveille de sentiment ému et profond. José évoque le souvenir du passé, de la première rencontre, de la fleur de cassie qu'il a conservée sur son cœur, et sa voix amoureuse se fait caressante, suppliante, tour à tour, et la phrase s'étale, d'un jet large et puissant, avec ses modulations d'une grâce infinie, qui lui prêtent une saveur d'intimité d'un charme si profond. C'est à la fin de cette belle supplication amoureuse que se trouve la trop fameuse cadence qui fit bondir les timides et surprit même les audacieux, fantaisie d'artiste, d'une originalité troublante, qu'il faut prendre telle quelle, en subir l'étrangeté, sans l'analyser, sans l'expliquer.
La péroraison de ce beau duo est d'un mouvement et d'une allure superbe : Carmen veut bien pardonner, elle veut bien croire à l'amour délirant du pauvre soldat, mais il faut que celui-ci le lui prouve, et, pour cela, il la suivra dans la montagne, il quittera le régiment, il désertera.
Non, tu ne m'aimes pas, non, car si tu m'aimais,
Là-bas, là-bas, tu me suivrais...
. . . . .
Là-bas, là-bas, dans la montagne,
Sur ton cheval tu me prendrais,
Et, comme un brave, à travers la campagne,
En croupe, tu m'emporterais.
José écoute le démon tentateur, qui le fascine, qui l'étreint ; il ne résiste plus ; il va céder... Mais non, l'honneur est le plus fort ; par un effort violent, il s'arrache à l'obsession :
Non, je ne veux plus t'écouter...
Quitter mon drapeau... déserter...
C'est la honte, c'est l'infamie,
Je n'en veux pas !
— Eh bien, pars !...
Et il va partir..... Il va, en courant, jusqu'à la porte, mais il s'arrête à moitié chemin ; on frappe avec violence au dehors. Bientôt la porte vole en éclats et le lieutenant, — un des gais lieutenants de tout à l'heure, qui vient retrouver Carmen, — entre par la brèche, l'insulte méprisante aux lèvres dès qu'il aperçoit le pauvre soldat en compagnie de la bohémienne. Les deux hommes se mesurent un instant de l'œil. L'officier vient de frapper José, et José a sauté sur son sabre et a dégainé ; il va tuer son officier, mais les bohémiens, accourus aux cris de Carmen, se jettent sur les deux hommes, les désarment, et entraînent le lieutenant en lieu sûr. Et Carmen, s'adressant alors à José :
Es-tu des nôtres maintenant ?
— Il le faut bien.
— Le mot n'est pas galant ;
Mais qu'importe, tu t'y feras,
Quand tu verras
Comme c'est beau la vie errante
Pour pays l'univers, pour loi ta volonté,
Et surtout la chose enivrante,
La liberté ! la liberté !
C'est la péroraison du duo qui fournit la conclusion du finale et qui termine l'acte, sur une page d'une puissance et d'un mouvement des plus heureux et des plus saisissants.
Le prélude, en Mi bémol, qui sert de frontispice au troisième acte, fut composé pour l'Arlésienne ; c'est assez dire, puisqu'il a trouvé place ici, qu'il n'a pas grande prétention au coloris spécial. C'est une page d'un sentiment apaisé, où la mélodie, caressante, flotte, enveloppée, au milieu de douces harmonies et de contrepoints qui viennent se mêler et s'enchevêtrer dans une confusion pittoresque, plongeant l'esprit du rêveur dans une suave extase.
La bande de Dancaïre est maintenant dans les montagnes. Au milieu des rochers, formant un petit campement naturel dans ce site sauvage, quelques bohémiens, enveloppés de leurs manteaux, sont couchés çà et là auprès des marchandises. Bientôt la bande entière apparaît, escortant, fusil à l'épaule, des contrebandiers portant des ballots. Dancaïre, Remendado, José, Carmen, Mercédès, Frasquita, sont là. Quelle entrée pittoresque, aux sons de cette marche à l'allure si mystérieuse ! Comme toute cette introduction est bien en scène, vivant, non de la vie factice et conventionnelle des contrebandiers de notre vieil opéra-comique, mais d'une saisissante réalité ! Et le chœur : « Ecoute, « compagnon, écoute... » avec son accompagnement continu, si sombre, si mystérieux. A la fin de ce chœur, Bizet a placé, sur ces mots : « Prends garde de faire un faux pas... », une succession d'accords de septième sensible, avec suppression de la tierce, évitant leur résolution naturelle pour se résoudre sur des accords de quinte augmentée. Les deux parties des ténors produisent ainsi une série de tierces majeures, descendant chromatiquement, dont l'effet est des plus original et des plus nouveau. De même, dans le pittoresque motif de la Marche, qui reparaît sous un contrepoint des chœurs, la marche ascendante, en tierce, des basses, — que les chœurs feront entendre à leur tour dans un instant, — est d'une nouveauté charmante, et donne une impression de sombre mystère, qui ajoute à l'accent du paysage musical.
Le trio des tireuses de cartes est un des morceaux les plus justement célèbres. Pendant que Dancaïre et Remendado sont allés reconnaître la brèche par où ils doivent faire entrer les marchandises dans la ville, les bohémiens se sont roulés dans leurs manteaux et étendus sur les rochers pour goûter un peu de repos ; quelques-uns allument un feu, auprès duquel Mercédès et Frasquita viennent s'asseoir. Les deux bohémiennes sortent de leurs poches des cartes et les étalent. Carmen les regarde faire et lit avec elles dans l'avenir. Mais, excitée par les promesses de fortune et de bonheur que le sort fait à ses deux camarades, elle veut, à son tour, essayer et lire sa destinée.
Aussitôt, triste et désolée, la menace de mort gémit à l'orchestre : « Carreau, pique ! » et toujours le groupe fatal reparaît, obstiné : « La mort !... j'ai bien lu... moi d'abord... ensuite lui... pour tous les deux la mort. » Alors, s'étale cette phrase, sombre et farouche, mais résignée, d'une expression si profonde et si poignante, où la malheureuse, qui vient de voir sa condamnation écrite dans les cartes et qui a essayé de corriger le destin, se confirme l'arrêt à elle-même : « La mort... toujours la mort ! » Et les rieuses Mercédès et Frasquita, à qui les cartes sourient, — promettant, à l'une, un jeune amoureux, beau, vaillant, l'emportant, à travers la montagne, en croupe sur son cheval, à l'autre, un vieil époux millionnaire, qui la couvre de pierreries, de diamants, qui meurt enfin et dont elle hérite, — viennent mêler leurs éclats joyeux aux plaintes désolées et farouches de l'infortunée.
Le Dancaïre et le Remendado sont de retour ; ils ont reconnu la brèche, mais... mais elle est gardée, et bien gardée, par trois douaniers. La douane, cela regarde ces dames ; les douaniers seront heureux et la contrebande passera. « En route alors. » Le Morceau d'ensemble : « Quant au douanier, c'est notre affaire » est brillant, d'une allure des plus crânes et des plus décidées ; il sonne d'une façon étonnante et aucun des détails, si fouillés, si ciselés, n'est perdu pour l'oreille de l'auditeur ; c'est un véritable enchantement...
Les bohémiens sont partis escortant la contrebande ; Carmen, Mercédès, Frasquita, en tête, précédant la troupe, sont chargées d'offrir le gâteau au cerbère à trois têtes et de l'apprivoiser. José, seul, est resté pour surveiller les marchandises que l'on n'a pas pu emporter ; du haut d'un rocher, en observation, la carabine au poing, il veille. Ici se place une des plus suaves inspirations du Maître : l'Air de Micaëla.
La jeune Navarraise est venue dans la montagne, à la recherche de don José. La vieille mère va mourir, là-bas, et elle ne voudrait pas mourir sans avoir revu son fils, sans lui avoir pardonné. Elle n'a pas eu peur, la brave enfant ; guidée par un paysan, elle est parvenue jusqu'au repaire des bandits ; mais à la vue du campement des bohémiens, à la pensée qu'elle va revoir la femme, mille fois maudite, qui lui a pris l'amour de son fiancé, son cœur bat, sa tête se trouble, et elle exhale cette plainte.
Bizet avait composé cet Air pour la Griselidis de Sardou. Comme cet opéra, auquel il avait tout d'abord travaillé avec assez de suite, était loin d'être terminé, il jugea à propos de reprendre son bien et de l'utiliser.
Un coup de feu vient de retentir, Micaëla fuit et se cache ; un homme dégringole rapidement les rochers ; il n'a pas été touché, mais peu s'en est fallu. José le suit, la carabine fumant encore dans la main. Cet homme, c'est Escamillo, le toréro ; il passait dans le voisinage, conduisant à Séville, pour les courses prochaines, un troupeau de taureaux sauvages, lorsque l'envie l'a pris de voir celle qu'il aime. Il savait l'endroit où campaient les bohémiens et il est venu... pour voir Carmen. — Carmen ! A ce nom José a bondi ; son rival ! le voilà ! celui qui lui a pris le cœur de sa Carmen, c'est cet homme !...
Le duel au couteau entre José et le toréro se déroulait, jadis, sauvage, féroce, avec des alternatives. José, d'abord vaincu et terrassé, était épargné par le toréro qui lui faisait grâce de la vie ; il se relevait, furieux, et reprenait aussitôt le combat ; la seconde fois, la chance tournait, Escamillo glissait, tombait, son couteau se brisait, et José allait l'égorger, lorsque intervenaient Carmen et les bohémiens. Toute cette scène sauvage a été supprimée avec raison. Après le premier ensemble du duo : « Enfin ma colère trouve à qui parler... », un simulacre de combat s'établit et l'on passe, immédiatement, au finale : José, vainqueur, va frapper. Carmen l'arrête. Ce finale est d'une superbe allure et d'une surprenante variété de tons et d'effets ; les supplications de Micaëla, les bravades et les provocations d'Escamillo, les sanglots douloureux, les rugissements d'amour de don José, le rire sarcastique et cruel de Carmen, s'y mêlent dans un tout harmonieux et grandiose.
Tandis que le torero s'éloigne, en narguant son rival, la troupe bohémienne se dispose à décamper ; mais Remendado vient de découvrir Micaëla, transie de peur ; il l'amène au milieu du campement. José la reconnaît : « Malheureuse ! que viens-tu faire ici ? » Et Micaëla d'essayer de toucher le cœur de celui qu'elle a aimé, d'essayer de le ramener au bien, de l'arracher à cette vie criminelle. Mais ses supplications sont vaines. José ne la suivra pas, il ne quittera pas Carmen. Quel beau déchaînement de passion, dans cette phrase : « Je te tiens, fille damnée », qui est la révolte tumultueuse des souffrances longtemps supportées, des jalousies inquiètes, des fureurs contenues. Comme ce cri est humain !... Rien ne pourra briser la chaîne qui rive l'une à l'autre ces deux existences, rien ! Mais Micaëla tente un dernier effort :
Hélas ! José, ta mère se meurt et ta mère
Ne voudrait pas mourir sans t'avoir pardonné.
— Ma mère !... elle se meurt..... Partons !...
puis, se tournant vers Carmen heureuse de cette détermination soudaine, lui montrant le poing : « Sois contente, je pars, mais nous nous reverrons. »
Et tandis que s'élève, de l'orchestre, lente et désolée, la lugubre menace de mort entrecoupée de funèbres sanglots, là-bas, dans la montagne, retentit, comme une dernière bravade, le chant vainqueur du toréro qui s'éloigne :
Toréador, en garde !
Et songe, en combattant,
Qu'un œil noir te regarde
Et que l'amour t'attend.....
Le prélude du quatrième acte est un véritable coup de lumière, un rayon du soleil espagnol, chaud, vibrant, plein de caresses et de sourires, de ce soleil radieux qui baise la joue des brunes manolas et leur fait entr'ouvrir leur mantille, tandis que. dans un soupir brûlant, s'accordent les guitares amoureuses. Il passe à travers l'orchestre comme un frisson de boléro, tantôt calme, apaisé, tantôt tourbillonnant et joyeux. C'est l'Espagne, dans ce qu'elle a de plus pittoresque...
En effet, nous voilà à Séville, maintenant ; sur la place des vieilles arènes ; au fond, l'entrée du cirque fermée par un large vélum. C'est le jour des courses de taureaux ; la foule bariolée envahit la place, attendant l'heure du combat ; des marchands de toute espèce, marchands d'oranges, de cigares, marchands d'eau, de programmes, d'éventails, circulent au milieu des groupes, mêlant leurs cris pittoresques, leurs appels, à la rumeur confuse de la foule, aux éclats de rire des belles filles, aux propos galants des amoureux endimanchés. Voici la Quadrilla ! La foule se range pour lui livrer passage ; hommes, femmes, enfants, tous acclament les toréros. Aux sons d'éclatantes fanfares, ceux-ci défilent, dans leurs costumes bariolés. En tête marchent les alguazils ; puis viennent les chulos, les banderilleros, les picadors, et, à chaque nouvelle entrée, les acclamations se font plus nombreuses, les fanfares plus sonores, plus éclatantes. Enfin, voici l'Espada, l'espada Escamillo, encore plus fier et plus insolent, dans son costume rouge resplendissant de broderies ; à ses côtés marche Carmen, Carmen radieuse et vêtue de ses plus beaux atours. Elle regarde son toréro, d'un regard chargé de voluptueuse tendresse, et, tandis que le peuple exulte d'une joie délirante, que l'alcade, suivi de ses alguazils, va prendre place dans le cirque, que la foule se rue à sa suite, les deux amants échangent d'une voix amoureuse leurs serments de tendresse, leurs promesses de triomphe et de volupté. Quel chatoyant tableau, pittoresque, grouillant de mouvement, de vie !...
Et José, qu'est devenu l'infortuné José ?... Sa mère est morte ; il a quitté son village et est revenu à Séville, à la poursuite de l'infidèle qu'il aime plus que jamais. Il est là, caché dans la foule ; Frasquita et Mercédès l'ont aperçu ; elles préviennent Carmen, mais l'indomptable fille ne craint rien ; elle domptera une suprême fois le malheureux qu'elle n'aime plus, et, loin de fuir, attend de pied ferme l'inévitable explication.
Elle laisse entrer la foule, et, quand elle est bien seule, elle va droit à José caché dans l'angle d'une porte. Alors commence cet admirable duo final qui est le chef-d'œuvre du chef-d'œuvre, la page la plus poignante, la plus profondément humaine dans sa simplicité douloureuse. Point d'éclat violent, tumultueux, emphatique ; la voix de la passion parle seule, et parle un langage d'une douleur indicible, d'un amour sans bornes qui veut se survivre à lui-même, qui essaye vainement de ranimer les étincelles éteintes, au fond du cœur de la bohémienne. José espère encore ; il est venu non pour frapper, mais pour pardonner ; il veut emmener sa Carmen et aller avec elle recommencer la vie, bien loin de ce pays maudit, sous d'autre cieux plus cléments. Mais Carmen le repousse : « Entre elle et toi, tout est fini ! » prononce-t-elle d'une voix dure. Et l'infortuné lutte toujours ; il prie, il supplie, il trouve de nouveaux accents plus déchirants, de nouveaux sanglots plus douloureux, pour toucher le cœur de l'infidèle qu'il adore ; Carmen, froide, impassible, cruelle, de cette cruauté inconsciente de la fille qui n'aime plus, le repousse de nouveau. Quelle gradation poignante dans l'expression des sentiments du malheureux ! Que de larmes, que de supplications, dans l'admirable phrase : « Mais moi, Carmen, je t'aime encore... » Quelle sincérité d'accent ! Quelle vérité dans cette douleur ! On ne peut entendre ces pages émouvantes, sans se sentir ému, sans vibrer à l'unisson des sentiments qui agitaient l'artiste quand il écrivait ces supplications, quand il notait ces sanglots d'une si saisissante réalité.
Mais les fanfares éclatent dans le cirque ; la foule acclame Escamillo vainqueur ; Carmen, joyeuse, veut se précipiter pour acclamer à son tour. José l'arrête : « Où vas-tu ?... Cet homme qu'on acclame, c'est ton nouvel amant ! » Mais Carmen n'écoute rien, elle veut aller rejoindre Escamillo : « Je l'aime », jette-t-elle à la face du malheureux José, « je l'aime, et devant la mort même je répéterais que je l'aime. »
Les fanfares éclatent de nouveau, plus sonores ; José tente un dernier effort, mais Carmen ne l'écoute plus ; elle veut passer, à tout prix : « Frappe-moi donc ou laisse-moi passer ! » Et, heureuse, savourant avec délice les cris de victoire qui saluent le triomphe de son nouvel amant, elle essaye encore d'échapper à l'infortuné. Alors, José, à bout de patience, à bout de supplications, voyant celle qu'il aime lui échapper pour voler aux bras de son rival, se précipite et frappe. Carmen tombe.
En ce moment le joyeux refrain du toréador se fait entendre, le peuple acclame la victoire définitive d'Escamillo, et tandis que, la course terminée, la foule, quittant le cirque envahit la scène et court au cadavre qu'elle vient d'apercevoir, José, au milieu des voix délirantes de l'orchestre gémissant la sombre menace de mort enfin réalisée, s'est précipité sur le corps de sa Carmen, et, d'une voix entrecoupée de sanglots :
Vous pouvez m'arrêter... c'est moi qui l'ai tuée...
O ma Carmen ! ma Carmen adorée.
Tel est le dénouement, rapide, brutal, d'une vérité saisissante, page musicale d'une intensité poignante, œuvre de très grand artiste et très grand musicien !...
CARMEN (suite).
Après avoir analysé dans ses détails la partition de Carmen, si l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur l'œuvre entière, on est surpris de la belle ordonnance, de la variété de tons, de la diversité des couleurs faite des nuances infinies d'une même gamme pittoresque, concourant à un but unique, à un ensemble saisissant de vérité et de vie. Mais, ce qui frappe surtout, c'est le rendu musical des caractères. Chaque personnage vit, agit, se meut, conservant sa physionomie distincte, sa personnalité musicale bien nette et bien tranchée, sans une défaillance, sans que la vérité du type soit, un seul instant, sacrifiée aux exigences d'un ensemble, d'une phrase bien venue musicalement, d'une réplique. De là cette exubérance de vie, de là cette sincérité d'accent qui produit une impression si vive.
Au premier plan trois personnages se détachent avec une vigueur surprenante : Carmen, la fille sans cœur ; José, le malheureux José, sans force et sans énergie, incapable de réagir contre le fatal amour qui l'entraîne aveuglément à sa perte ; Escamillo le bellâtre, le torero vainqueur, habitué aux tendres œillades, à qui rien ne résiste, femme ou taureau.
A côté de ces trois types, nettement et vigoureusement burinés, Micaëla jette un rayonnement poétique, une douce impression qui plane sur l'œuvre entière. Mlle Marguerite Chapuis incarna cette touchante figure. Cette jeune artiste, assez effacée jusqu'à ce jour, se mit au premier plan par cette belle création qui ne comporte que trois scènes, mais où elle se montra au-dessus de tout éloge. Elle devait quitter le théâtre bientôt après.
Dans sa nouvelle, Prosper Mérimée a fait, en Maître, en quelques mots chauds, en deux coups de burin rapides, le portrait de son héroïne l'indomptable Carmencita. C'est dans la bouche de José meurtrier, de José le bandit assassin attendant en chapelle l'heure de l'expiation finale, qu'il l'a placé :
« Elle avait un jupon fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin attachés avec des rubans de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, et elle s'avançait, en se balançant sur les hanches, comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. A Séville, chacun lui adressait quelque compliment gaillard sur sa tournure ; elle répondait à chacun en faisant les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était... » Galli-Marié s'était inspirée de cette eau-forte vigoureuse, elle avait pris modèle sur ce portrait d'une ressemblance qui donne le frisson de la vie au personnage évoqué. Œillades assassines, regards chargés de volupté qui livrent la victime pieds et poings liés, déhanchements lascifs, poings sur la hanche, rien ne manquait à la ressemblance ; et ce déploiement de perversités physiques, reflétant à merveille l'âme de cette bohémienne éhontée, cette crudité de tons dans le rendu du geste et de l'allure qui choquèrent bien des personnes et firent crier à l'immoralité, étaient indiqués par l'effronterie du personnage, et, j'ajouterai, nécessaires à la vérité du drame, à la compréhension psychologique de l'action, à l'explication de l'ensorcellement subit du Navarrais. On peut dire, sans être taxé d'exagération, que Carmen a trouvé, en cette artiste originale, une créatrice admirable. Dès son entrée en scène au premier acte, avec quelle puissance de relief ne posait-elle pas le personnage, dans ce récitatif de quelques mesures : « Quand je vous aimerai ?... »
Et, au courant de l'action, tour à tour caressante et féline, tendre, coquette, indomptable, elle a laissé un ineffaçable souvenir.
Merveilleusement costumée, d'après les dessins de Clairin, au point de vue plastique elle donnait aussi l'exacte impression de la brune héroïne de Mérimée. Et puisque nous parlons des dessins, ou plutôt des aquarelles de Clairin d'après lesquelles avaient été exécutés les costumes de Carmen, disons, en passant, que Detaille avait fourni l'aquarelle des uniformes des dragons d'Alcala, ces braves dragons que l'on trouva si étranges, avec leur veste jaune, leur pantalon rouge, leur casque de dragon et leur lance (*).
(*) Mérimée avait prévu la surprise des spectateurs de Carmen, dans sa Nouvelle il nous dit : « Toute la cavalerie espagnole est armée de lances. »
Don José, le brigadier José, était incarné par Lhérie, chanteur à la voix sonore, chaude, vibrante, mais artiste incomplet, inégal ; exécrable, absurde, ou excellent.
Dans Carmen, il était excellent, au-dessus peut-être de ses meilleurs rôles, tel qu'il ne se montra jamais, sans doute, au cours de sa carrière très remplie et très honorable. Il avait bien compris le personnage, son caractère faible, indécis, qui devient emporté, violent de cette violence aveugle et terrible des hommes faibles poussés à bout, et il le traduisit avec une vérité frappante. Avec quel charme profond, avec quelle sincérité d'impression, ne soupirait-il pas, au deuxième acte, l'admirable phrase du duo : « La fleur que tu m'avais jetée, etc... » ! il faisait courir dans la salle un frisson de voluptueuse tendresse ! Et le chef-d'œuvre final, le duo incomparable de Carmen et de José, avec quelle gradation de sentiments suppliants qui s'exaltent, peu à peu, jusqu'à ce cri admirable : « Et moi, Carmen, moi je t'adore... » qu'il rendait avec une passion douloureuse, pleine de sanglots, ne savait-il pas mettre en relief toutes ses beautés ! Et le finale du troisième acte : « Je te tiens, fille damnée... » qui est le déchaînement furieux de l'être faible qui a longtemps souffert, sans rien dire, et qui éclate enfin, qu'il rendait avec une fureur aveugle ; enfin la scène du combat à coups de navaja, qui a été supprimée, en grande partie, lors de la reprise à l'Opéra-Comique, où il se montrait ardent, féroce, puis, se voyant le plus faible, lâche jusqu'à l'assassinat. Le toréro c'était Bouhy.
On se rappelle avec quelle allure fièrement crâne il avait dessiné cette silhouette de bravache, avec quelle insolente fatuité, avec quelle morgue, avec quel art consommé, il disait les fameux couplets du second acte, ainsi que la belle phrase du quatrième acte : « Si tu m'aimes, Carmen... »
A côté de ces créateurs de talent qui fixèrent, avec un relief surprenant, les grands rôles de Carmen, il serait injuste d'oublier les artistes plus modestes qui tinrent avec bonheur les rôles secondaires : Potel et Barnolt, très vrais d'allures sous les traits des contrebandiers Dancaïre et Remendado ; Mlles Ducasse et Chevalier, charmantes toutes les deux et excellentes chanteuses dans les rôles, musicalement très importants, de Mercédès et de Frasquita ; Duvernoy, qui esquissa avec talent la rapide silhouette du brigadier Moralès, qui n'apparaît qu'au début du premier acte ; Dufriche, qui prêta au lieutenant Zuniga sa belle prestance et sa belle voix ; enfin, Nathan, consciencieux, sous l'accoutrement pittoresque de l'aubergiste Lillas Pastia.
Carmen avait, du reste, été montée avec un soin scrupuleux et une préoccupation artistique très grande, comme toutes les œuvres nouvelles mises en scène sous la direction de Camille Du Locle.
Ce directeur malheureux, qui ne sut pas mener son théâtre à la prospérité financière, resta toujours, il convient de le dire à son honneur, un directeur profondément artiste, sachant donner à chaque œuvre qu'il montait un cadre digne d'elle et une interprétation remarquable. Du Locle n'aimait pas Carmen, nous le savons, et ne croyait pas à son succès ; malgré tout, il sut prendre l'intérêt de l'œuvre et de l'auteur qu'il aimait sincèrement, et faire taire ses sentiments (*). Il entoura Carmen d'une mise en scène pittoresque, fit dessiner des costumes exacts, chatoyants, enfin, donna pour interprètes ses meilleurs pensionnaires. L'orchestre, réveillé de sa torpeur, de son doux somme d'après-dîner mollement rythmé par l'indulgent bâton de son chef, avait fini par s'habituer à cette musique si finement instrumentée ; ce n'avait pas été sans peine ; mais enfin le résultat était obtenu, et c'était l'important. Le soir de la première représentation, tout marcha bien de ce côté, sauf un léger accroc de la part de la grosse caisse qui, ayant mal compté ses pauses, lança un formidable coup de tampon pendant un pianissimo, tandis que Galli-Marié chantait. Le malheureux virtuose, parti deux mesures trop tôt, s'effondra piteusement derrière son gigantesque instrument... et la représentation continua sans encombre.
(*) Mais il démolissait de la main gauche ce qu'il édifiait de la main droite. A tous ceux qui venaient lui parler de l'œuvre nouvelle, il répondait de sa voix moqueuse et aigrelette : « C'est de la musique Cochinchinoise, on n'y comprend rien ! » C. Saint-Saëns : L'art du Théâtre, janvier 1905.
Mais les chœurs, qui somnolaient depuis longtemps aussi, ne furent pas si faciles à mettre en mouvement ; et cela se comprend sans peine. L'orchestre avait bien pu céder, peu à peu, à l'influence des œuvres soporifiques depuis longtemps interprétées, ou des chefs-d'œuvre du répertoire éternellement ressassés ; il ne fallut rien moins que la partition si délicatement instrumentée et les justes exigences de Bizet pour le tirer de sa torpeur. Mais, du moment où tous ces instrumentistes de talent furent décidés à apporter à l'exécution de la partition de Carmen le soin qu'on était en droit d'attendre d'eux, tout marcha bien. Il n'en fut pas de même des masses chorales. Malgré tout, elles ne purent suppléer, par la bonne volonté qu'elles finirent par déployer, le manque de discipline et l'insuffisance d'études ; aussi, le soir de la première ne brillèrent-elles pas, et ce fut là l'unique tache de cette interprétation très remarquable.
Quant aux décors, ils étaient d'une grande vérité et d'une couleur très pittoresque ; celui du premier acte, notamment, avec son corps de garde, sa manufacture de tabac et son pont praticable traversant la scène et masquant au fond, en partie du moins, les maisons et les rues de la ville. La Taverne de Lillas Pastia, encadrant la petite orgie bohème, ne manquait pas non plus de caractère. La scène avait été du reste admirablement comprise. Point de déploiement chorégraphique, point de corps de ballet ; c'était une orgie de bohémiennes et de soldats, une scène de taverne louche, où quelques filles avinées se tordent et se déhanchent, aux sons des sistres, des castagnettes et des tambourins. A la reprise de Carmen, en 1883, l'Opéra-Comique, ayant acquis un important corps de ballet, crut devoir l'utiliser dans cette scène, et l'orgie bohème, si vibrante jadis, devint une exhibition plastique et perdit son caractère.
La scène, ainsi comprise et rendue, prenait — malgré la présence du charmant bataillon féminin — une allure beaucoup plus morale, car elle avait au début des côtés réalistes troublants, et c'est peut-être la raison pour laquelle on l'avait apaisée ; mais, malgré tout, l'artiste, épris de couleur chaude et vibrante, regrettait et regrette encore la vie exubérante d'autrefois.
Le décor du troisième acte, représentant un site pittoresque dans la sierra, au milieu duquel les bohémiens ont établi leur campement, était d'un effet saisissant. Celui du quatrième, au contraire, était mesquin, étriqué. Il est vrai qu'il eût peut-être été difficile de le comprendre autrement. La scène représente une place de Séville ; au fond, se trouvent les murailles des vieilles arènes et l'entrée principale du cirque fermée par un long vélum. C'est sur cette place qu'a lieu le défilé de la Quadrilla. Ce défilé était, à l'origine, assez mal réglé. Les chœurs, qui sont en scène et qui figurent la populace excitée par le spectacle sanglant qui va se dérouler à ses yeux, se repliaient, à chaque entrée nouvelle, tournant le dos au spectateur, et lui masquant ainsi la vue des toréros ou des alguazils qui viennent d'entrer. Lors de la reprise, en 1883, le défilé fut bien mieux compris et mieux réglé. Le gracieux escadron volant des danseuses, mantille au front, jupe flottante, éventail en main, évoluait au sein de la foule, dégageant, à chaque entrée nouvelle, le milieu de la scène, et permettant ainsi de voir le cortège qui défile lentement au fond de la place et se rend au cirque (*).
(*) M. Albert Carré, à la belle reprise de Carmen, qu'il a faite en prenant la direction de l'Opéra-Comique, a modifié, d'une façon très heureuse, ce décor, ainsi que la mise en scène du défilé de la Quadrilla.
Carmen, nous l'avons vu, s'était un peu relevée vers la cinquième représentation ; le public, surpris par ces accents nouveaux pour lui, par cette musique vivante, tour à tour pittoresque, émue, passionnée, était un peu revenu de son premier effarement, et la pièce, qui semblait devoir rapidement disparaître de l'affiche, était arrivée, avec d'assez fructueuses recettes, à la trente-septième représentation. La mort si inopinée de Bizet, le déchaînement subit de sympathies que provoqua la presse entière, jusque dans les couches du public parisien les plus réfractaires à l'admiration des purs chefs-d'œuvre, le concert unanime d'éloges, les regrets profonds et sincères que cette épouvantable catastrophe souleva, allaient, sans doute, donner un regain de succès à cette œuvre dernière du Maître qui venait de mourir ; mais l'Opéra-Comique, dans une situation de plus en plus précaire, fermait ses portes quelques jours après, le 18 juin. Carmen avait été jouée le 13 pour la trente-septième et dernière fois (*).
(*) Certains critiques, qui ont, sans doute, beaucoup à se reprocher, ont essayé de nier l'insuccès de Carmen. M. Louis Ganderax, dans la préface de « Lettres de Georges Bizet », raconte que l'un d'eux, à la table de la Princesse Mathilde, affirmait hautement, un jour, « que la critique et le public ne se trompent guère, et que le premier soir, n'en déplaise à la légende, on rendit justice à Carmen ». Et comme M. Ganderax s'étonnait : « J'y étais ! » répondit-il avec une autorité accablante. Et M. Ganderax de répliquer froidement : « Je le sais ; je viens de relire votre article »... Et le brillant causeur changea brusquement de sujet. M. Arthur Pougin a écrit en 1903, dans le Ménestrel, un article : La légende de la chute de Carmen, où il cite ce propos de Galli-Marié : « L'insuccès de Carmen, à la création, mais c'est une légende !... nous l'avons jouée plus de quarante fois !... » Nous l'avons jouée plus de quarante fois ! En effet c'est un beau succès ! Galli-Marié n'est pas exigeante ! Il est vrai que son succès personnel fut considérable, ce qui peut lui faire illusion. M. Albert Carré pourrait dire, aujourd'hui : « Mon théâtre l'a jouée quatorze cents fois, et le succès est toujours plus grand, les recettes plus fructueuses. »
Au mois d'octobre suivant, Camille Du Locle fit une nouvelle tentative et rouvrit les portes de son théâtre, sans plus de succès, disons-le, car bientôt il dut l'abandonner et passer la main à une nouvelle direction. Néanmoins, il eut encore le temps de tenter une reprise de Carmen.
Le chef-d'œuvre, interprété par presque tous les artistes de la création, n'eut que treize représentations, cette fois.
Paris n'était pas encore mûr pour cette musique admirable ; ce ne fut que huit ans après, en1883, après qu'elle eut été acclamée par le monde entier, que Carmen, revenue parmi nous, au milieu des cris d'admiration et des trépignements d'enthousiasme, reçut, enfin, l'accueil qui lui était dû et qu'elle avait, hélas ! bien longtemps attendu (*).
(*) Voici quelques extraits des journaux qui, au lendemain de la première de Carmen, jugèrent et condamnèrent, hâtivement et sommairement, ce chef-d'œuvre. On y verra la confirmation de ce que M. Arthur Pougin appelle : La légende de la chute de Carmen. Voici, d'abord, Paul de Saint-Victor, dans le Moniteur. A tout seigneur tout honneur ! « M. Bizet, comme on sait, appartient à cette secte nouvelle dont la doctrine consiste à vaporiser l'idée musicale, au lieu de la resserrer dans des contours définis. Pour cette école, M. Wagner est l'oracle, le motif est démodé, la mélodie surannée ; le chant, dominé par l'orchestre, ne doit être que son écho affaibli. Un tel système doit nécessairement produire des œuvres confuses. La mélodie est le dessin de la musique ; elle perd toute forme si on l'en retire, et n'est qu'un bruit plus ou moins savant. » — Dans le Monde Illustré. un rédacteur, anonyme (c'est dommage), conclut ainsi : « Ce n'est que par-ci par-là, au milieu de cette partition embroussaillée, que nous avons découvert quelque bout de phrase accessible, mais l'orchestre bavarde tout le temps et dit une infinité de choses qu'on ne lui demande pas. » — Dans l'Illustration, Savigny (Henri Lavoix) parlant du duo du IVe acte, écrit : « Il y a là, véritablement, une belle page, mais comme elle est lente à venir, cette inspiration du musicien, et comme cette partition touffue manque d'ordre, de plan et de clarté ! » — Dans le Siècle, Oscar Comettant déclare : « Un semblable poème était peu fait pour inspirer un musicien.... Rossini s'en serait tiré par une prodigalité de mélodies spontanées, entraînantes, bien rythmées, jeunes, colorées, d'un tour nouveau..... on n'accusera pas M. Bizet d'une semblable prodigalité... M. Bizet, qui n'a plus rien à apprendre de ce qui s'enseigne, a malheureusement beaucoup encore à deviner de ce qui ne s'enseigne pas... M. Bizet n'a pas encore trouvé sa voie. Il atteindra le but, nous l'espérons, mais il lui faudra désapprendre bien des choses pour devenir un compositeur dramatique. » — Dans le Gaulois, François Oswald : « M. Bizet appartient à l'école du Civet sans lièvre ; il remplace, par un talent énorme et une érudition complète, la sève mélodique qui coulait à flots de la plume des Auber, des Adam, des Hérold et des Boieldieu... Mme Galli-Marié semble prendre plaisir à accentuer les côtés scabreux de son rôle si dangereux. Pour ceux qui aiment la note égrillarde, cette création lui fera honneur, car il est difficile d'aller plus loin sur la route des amours cavalières, sans provoquer l'intervention des sergents de ville. » Arrêtons-nous ; assez d'inepties ! Je pourrais citer d'autres articles : Johannes Weber (le Temps), B. Jouvin (le Figaro), Armand Gouzien (l'Évènement) ; à quoi bon ? La cause est jugée. Seul, Ernest Reyer, dans le Journal des Débats, fit, sans restrictions, l'éloge de Carmen et il terminait par ces mots prophétiques : Mais Carmen n'est pas morte, et, à l'Opéra-Comique, on en a vu bien d'autres qui sont revenues d'aussi loin. »
MORT DE BIZET.
Malgré son insuccès, Carmen, nous l'avons vu, avait vivement occupé l'opinion ; le nom de Bizet, longtemps à peu près inconnu du grand public, tandis qu'il jouissait au contraire d'une réputation sans égale dans le cercle beaucoup plus restreint des artistes et des amateurs, venait de conquérir, enfin, ses grandes lettres de notoriété. On avait beaucoup parlé du Maître, on s'était beaucoup occupé de lui, ne fût-ce que pour critiquer son œuvre ou la défendre ; le public, — et je parle ici non seulement du public payant, mais surtout et aussi, de l'élément habituel des premières représentations, — le public, dis-je, qui en fait de neuf n'aime que le réchauffé, car ce qui est véritablement nouveau et original l'effraye, avait repoussé Carmen ; mais cette œuvre puissante, tranchant vivement sur ses devancières par son incontestable originalité, le préoccupait visiblement, et, même, il s'était produit ce bizarre phénomène, que l'œuvre si froidement accueillie d'abord, le premier étonnement passé, la première surprise calmée, s'était relevée vers la cinquième ou sixième représentation. Bref, Carmen prenait une large place dans les préoccupations intelligentes du moment, et Bizet était l'artiste en vedette du jour,
Tout à coup, une rumeur étrange circule dans Paris ; dans la matinée du 3 juin, trois mois, jour pour jour, après la première représentation de Carmen, le bruit court que Bizet est mort, qu'il est mort dans la nuit, à Bougival, dans sa petite maison où il était allé passer l'été avec sa famille. Mort. Bizet ! mort, cet artiste au cœur généreux, à la franche et large poignée de main si sincère ! mort, ce robuste garçon, si fort, si solide, hier encore si plein de vie et de santé !... Ce n'est, par Dieu, pas possible ! la nouvelle est fausse !...
Cependant le monde artiste est en ébullition, le bruit fatal circule toujours ; les très nombreux amis de Bizet, inquiets, anxieux, vont aux renseignements. Partout la nouvelle est connue ; mais d'où vient-elle ? sur quelles bases certaines repose-t-elle ? qui l'a apportée à Paris? Autant de questions auxquelles nul ne peut répondre.
Quelques-uns songent alors à aller se renseigner à l'Opéra-Comique où, certainement, si elle est réelle, la catastrophe doit être connue... Hélas ! il n'est que trop vrai, Bizet est mort ! La nouvelle est arrivée dans la matinée, par un télégramme adressé à Camille Du Locle...
Cependant, d'instant en instant, les amis deviennent plus nombreux, à l'Opéra-Comique ; les admirateurs du Maître d'abord, bientôt les indifférents, les curieux, en quête de détails, arrivent à leur tour ; on ne sait à qui répondre ; Du Locle fait alors afficher, au foyer du théâtre, la fatale dépêche. La voici dans sa navrante simplicité :
Paris, Bougival, déposé le 3 juin à 10 heures
27 du matin.
Camille Du Locle, 37, rue Le Peletier, Paris,
La plus horrible catastrophe : notre pauvre Bizet mort cette nuit.
LUDOVIC HALÉVY.
Dans la soirée le fatal télégramme court Paris ; on se le répète ; on se questionne, on s'interroge ; on veut savoir des détails. Personne ne peut en donner de précis. Hélas ! qu'importe ? le cher grand artiste est mort, et c'est assez, pour ses amis, pour ceux qui, n'ayant pas le bonheur de le connaître, l'admiraient et l'aimaient pour les nobles et pures jouissances artistiques qu'il leur avait fait éprouver, pour ses admirateurs, — car, si l'artiste dramatique n'avait pu encore rallier de bien nombreux suffrages, le maître musicien était profondément admiré...
Le lendemain, les journaux du matin apportaient les détails du lamentable événement. Bizet était mort subitement, presque sans souffrances, dans les bras de sa pauvre jeune femme éplorée ; un abcès à la gorge, d'autres disent une embolie, aurait enlevé le Maître. On a dit, aussi, qu'il était mort d'un rhumatisme au cœur ; mais, pour être exact, avouons qu'on n'a jamais bien connu au juste la nature du mal terrible qui l'a si inopinément et si rapidement emporté (*). Cependant, voici une opinion qui me paraît bien approcher de la vérité, si elle n'est pas la vérité elle-même ; c'est l'opinion de l'ami le plus cher et le plus dévoué, qui a connu Bizet et l'a aimé d'une amitié fraternelle dès les jeunes années du Conservatoire, dès la classe de piano de Marmontel, qui a vécu à ses côtés, à la classe de composition d'Halévy, à Rome à la villa Médicis, puis dans la vie de luttes incessantes où le grand artiste fut si souvent et si injustement vaincu, le réconfortant de son admiration sincère, le réchauffant de son affection si grande : j'ai nommé Ernest Guiraud.
(*) Voici une consultation, sur la mort de Bizet, qui me fut donnée, à l'époque où parut la première édition de cet ouvrage, par un jeune et savant docteur de mes amis. Elle est basée sur les symptômes observés et communiqués par l'entourage. Mais le signataire de cette consultation n'a pas connu Bizet, ne lui a pas donné des soins et n'a pu, par conséquent, baser sa certitude sur un diagnostic personnel. Je la donne, à titre de document, telle qu'elle m'a été communiquée.
« Georges Bizet avait dépensé une somme énorme de travail pendant la composition et les répétitions de son œuvre. Chaque hiver il était sujet à des accès d'angine, fréquents, mais sans influence fâcheuse sur sa santé. Peut-être la dépression physique et morale, provoquée par l'insuccès imprévu de Carmen, détermina-t-elle une débilitation profonde de l'organisme.
La mort survint, presque subitement, la nuit, lorsque rien ne faisait prévoir le dénouement funeste d'une indisposition légère. Les symptômes observés permettent, sans aucune hésitation, d'attribuer cette catastrophe à un œdème de la glotte ou à des troubles cardiaques suraigus.
Les renseignements les plus précis indiquent que le compositeur était, depuis quelques années, atteint de diathèse rhumatismale.
Dr G. LEFEBVE. »
Mme Bizet-Straus, que j'ai vue récemment à ce sujet, partage l'opinion du docteur Lefebve et croit que c'est une crise cardiaque qui a emporté Bizet. Elle étaie son opinion sur les douleurs violentes et générales qui ont précédé la mort.
D'après Guiraud, Bizet serait mort d'une résorption purulente. Dès son jeune âge, Bizet avait beaucoup souffert d'angines, d'un caractère anodin, il est vrai, mais qui avaient inquiété au début (*). Cette affection avait pris, peu à peu, un caractère périodique qui n'effrayait plus personne. Chaque année, à l'approche du printemps, le mal se déclarait ; Bizet s'enfermait alors, gardait la chambre, se soignait, puis, rétabli au bout de quelques jours de repos, il recommençait ses travaux et reprenait le cours de ses affaires, sans plus s'inquiéter du mal disparu. Après son mariage, il fut pour quelque temps débarrassé, mais le mal revint bientôt. Vers la fin du mois de mars de l'année 1875, à la suite des fatigues occasionnées par les répétitions de Carmen, il fut atteint plus gravement que d'habitude (**). Vainement il se soigna, cette fois ; il ne put que bien lentement recouvrer une partie de ses forces, et il ne se rétablit pas complètement.
(*) Nous trouvons dans ses lettres de Rome à sa mère (Lettres de Georges Bizet, Calmann-Levy, édit.) la préoccupation constante de ce mal de gorge qui devait amener la catastrophe finale. Dès son entrée en Italie, le 4 janvier 1858, à Savone (États Sardes) où il vient d'arriver en voiturin, avec ses camarades prix de Rome, il écrit : « Je me porte très bien, sauf un affreux rhume, celui que j'avais déjà à Paris du reste : il est tenace en diable... » Le 27 mars, autre lettre : « J'ai attrapé un mal de gorge qui se porte beaucoup mieux que moi... » Quelques jours après : « Je vais beaucoup mieux, quoique ayant encore un peu de peine à avaler. L'angine que j'ai eue à Paris n'était que de la Saint-Jean à côté de celle-ci. Tout le monde me conseille de me faire couper les amygdales, cela demande réflexion.... » etc.
(**) M. Galabert ne veut pas que Bizet ait souffert de l'insuccès de Carmen. C'est, il me semble, étrangement diminuer l'artiste et le musicien que de le supposer indifférent à son œuvre, à cette Carmen où il a mis le meilleur de lui-même, qu'il a, selon la belle expression d'Alfred Bruneau, « écrite avec son sang et ses larmes ». Soyez-en convaincus, il a souffert. Et il faut qu'il en soit ainsi, car, s'il en était autrement, il ne serait pas l'artiste admirable que le monde entier acclame. Il faut le dire hautement, il a souffert ; mais il n'est pas mort de sa souffrance. Quelques jours avant sa mort, au contraire, l'espérance renaissait en son âme : Carmen se relevait à l'Opéra-Comique ; Vienne allait magnifiquement la monter ; il reprenait confiance et s'apprêtait à rentrer dans la lutte. Il n'est donc pas mort de son insuccès, comme on l'a dit, comme on le répète encore.
L'époque où il avait coutume d'aller à Bougival passer avec les siens les mois de la belle saison, était venue. Comme il était encore souffrant et restait enfermé, ne sortant que bien rarement pour les affaires indispensables, sa femme voulut retarder l'instant du départ et attendre qu'il fût complètement rétabli, ce qui ne pouvait tarder, espérait-elle. « Non, non, dit-il, partons ; je veux partir tout de suite ; l'air de Paris m'empoisonne ! »
Guiraud m'a raconté la dernière soirée passée en tête-à-tête avec son ami :
« C'était la veille de son départ pour Bougival ; j'étais allé le voir, le soir, après dîner ; il me demanda de lui faire entendre des fragments de Piccolino auquel je commençais à travailler. Je me mis au piano, mais à peine venais-je d'attaquer les premières mesures, qu'appuyant la main sur mon épaule : Attends, me dit-il, je n'entends rien de cette oreille ; je vais me mettre de l'autre côté. » Cela fut dit d'une voix grêle, sur un ton dolent qui me fit tressaillir. Je me retournai vivement ; ce n'était plus Bizet, l'ami plein de sève et de jeunesse que j'avais toujours connu ; il avait en ce moment un air maladif, un aspect souffreteux qui m'impressionna. J'eus une vision horrible, mais rapide et fugitive comme l'éclair... Bizet venait de changer de place, il s'était assis à ma gauche, près du piano ; il était tout à moi. J'avais recouvré tout mon sang-froid, et, sans rien laisser paraître de l'étonnement douloureux qui venait de m'étreindre, je commençai. Je jouai tout ce que j'avais composé ; il m'écoutait attentivement, me faisant part de ses réflexions, après chaque morceau, avec cette liberté d'allures, cette franchise charmante, cette sincérité admirable, qui le faisaient chérir de tous. Puis, le sujet épuisé, nous parlâmes d'autres choses, de choses indifférentes et de choses sérieuses, et les heures passaient, rapides... Minuit venait de sonner ; je me levai et lui serrai la main. Il avait allumé un bougeoir et venait m'éclairer, car le gaz de l'escalier était éteint. Je descendis ; mais, arrivé en bas, je me rappelai, soudain, une chose dont je m'étais promis de lui parler et que j'avais oubliée, dans le feu de la causerie ; je relevai la tête et la conversation reprit, à distance : lui toujours au haut de l'escalier, penché vers moi, son bougeoir à la main, enveloppé dans sa robe de chambre malgré la saison, moi, en bas, la tête en l'air. Nous devisâmes ainsi pendant vingt minutes, environ ; puis, après un dernier bonsoir échangé, je partis, ne songeant plus à l'étrange saisissement qui s'était un instant emparé de moi... Trois jours après, je recevais un télégramme... Mon pauvre Bizet était mort !... »
A Bougival, le pauvre artiste avait cru que le bon air de la campagne allait lui rendre la santé. La première journée s'était bien passée, il avait fait une excellente promenade avec sa femme et son ami le pianiste Delaborde. Mais la nuit qui suivit fut atroce ; il se réveilla en sursaut, oppressé, suffoqué, l'esprit hanté de funèbres visions. On va en hâte chercher le médecin, réveiller l'ami qui habitait dans le voisinage ; tous deux accourent. Mais le médecin, après avoir attentivement observé le malade, rassure les parents et les amis présents, déclare que Bizet ne court aucun danger, qu'il a besoin surtout de calme et de repos, et conclut en disant qu'il était inutile de le déranger si une nouvelle crise, de même nature, venait à se produire pendant la nuit...
La nuit suivante, même alerte... On hésite d'abord à aller réveiller le docteur, mais la crise prend un caractère plus aigu, le pauvre malade est si oppressé qu'il peut à peine respirer ; malgré la recommandation de la veille, on se hâte donc vers la demeure du médecin. On va aussi chercher Delaborde. Tous deux arrivent, plus lentement que la veille. Bizet reposait, calme, la tête légèrement inclinée sur son oreiller. Sa pauvre jeune femme l'avait cru d'abord endormi, puis évanoui ;... il était mort ; il s'était éteint, sans agonie, sans avoir pressenti la mort !...
Il était minuit. A cet instant même, à Paris, rue Favart, le rideau se baissait sur le quatrième acte de Carmen ; c'était la trente-troisième représentation du chef-d'œuvre qui venait de finir (*).
(*) Je dois ici rapporter un fait qui va faire sourire les sceptiques, et cependant bien des personnes pourraient l'affirmer, et Guiraud, qui me l'a conté, en a été un des témoins. Le soir de cette représentation du 3 juin, Galli-Marié était arrivée au théâtre dans un état de surexcitation et d'énervement indescriptible ; avant d'entrer en scène, cédant à cet état dont elle ignorait la cause, elle avait beaucoup de peine à retenir ses larmes. Camille Du Locle, qui croyait à quelque contrariété passagère, à quelque affection malheureuse, peut-être à quelque querelle d'amoureux, la consolait, en souriant : « Voyons, ma chère enfant, lui disait-il avec une bonté légèrement ironique, ce ne sera rien, calmez-vous, tout sera arrangé demain. — Mais non, répondait-elle, je vous assure que ce n'est pas ce que vous croyez ; je n'ai rien, je vous assure que je n'ai rien. » Et elle éclatait en sanglots. A cette même heure, Bizet agonisait à Bougival. — Autre pressentiment : Bizet, on s'en souvient, avait perdu, fort jeune, sa mère. La brave vieille bonne qui avait soigné son enfance, avait pris au foyer, par son dévouement et sa tendre sollicitude de tous les instants, la place de celle qui n'était plus. Cette brave fille avait, depuis longtemps, confié au Maître toutes ses économies. Trois jours avant son départ pour Bougival, Bizet, s'apercevant, pour la première fois, qu'il avait négligé de reconnaître le dépôt, disait à la vieille gouvernante : « Voyons, Marie, il faut pourtant que je vous fasse une petite reconnaissance ; s'il m'arrivait malheur !... — Oh ! monsieur Georges, vous plaisantez ! » Trois jours après, la brave femme pleurait son cher enfant !...
Ainsi donc, le Maître était mort sans avoir une seule fois connu le succès, le grand succès qui récompense si noblement, ce succès triomphal qui devait, quelques années après sa mort, accueillir et sacrer définitivement cette Carmen admirable. Il emportait, peut-être, le doute dans la tombe. Mais du moins, avant de mourir, il eut une suprême joie ; la veille du jour fatal était arrivé de Vienne le traité passé avec le Théâtre Impérial, où l'œuvre du jeune Maître devait, la première des pièces françaises, être représentée dans le courant de l'hiver de l'année suivante.
Après Carmen, c'était le Cid, c'était l'Opéra, c'était l'Institut, c'était la gloire, c'était le bonheur ! Hélas ! tout venait de s'évanouir comme dans un songe ; gloire, jeunesse, bonheur, rêves d'un jour, fumée !... De tout cela il ne restait plus rien, plus rien qu'une pauvre veuve éplorée et qu'un petit enfant en deuil pleurant auprès d'un cercueil ! . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Les obsèques eurent lieu le surlendemain, samedi 5 juin, à midi, à l'église de la Trinité. Mme Bizet, dont le désespoir était indescriptible, avait été conduite à Saint-Germain chez son cousin Ludovic Halévy. Le corps fut transporté directement à l'église.
Si la beauté des tristes cérémonies funèbres consiste, non dans la pompe déployée, mais dans l'émotion sincère des assistants, dans les regrets unanimes qu'éveille la mémoire de celui qui s'en va, dans les larmes, jamais monarque puissant, tribun aimé des foules, n'eut de plus splendides funérailles. Tout Paris était là, le Paris qui pense, le Paris des lettres et des arts où Bizet ne comptait que des amis. Plus de quatre mille personnes, entassées dans l'étroite nef et dans les bas côtés de l'église, témoignaient par leur recueillement profond, par leur émotion contenue, combien leur était chère la mémoire de l'ami, combien leur était sensible la perte que venait de faire le grand Art français. Mais quand les voix émues de Duchesne et de Bouhy s'élevèrent, chantant Pie Jesu, personne ne songea plus à cacher ses larmes, à étouffer ses sanglots (*). Il y eut un moment d'émotion indicible, dont rien ne saurait donner une idée...
(*) Nous avons dit la douleur de l'assistance composée d'illustrations en tout genre. Ajoutons que MM. Lhérie, Duchesne, Bouhy, ainsi du reste que les musiciens de l'orchestre Pasdeloup, étaient si profondément émus en interprétant les œuvres du jeune grand musicien que nous pleurons tous, qu'ils en ont doublé l'émotion des assistants et des assistantes, aussi nombreuses que les hommes à cette funèbre cérémonie. On remarquait entre autres figures attristées, atterrées même, celles de Mme Galli-Marié et de Mlle Chapuis, les deux remarquables interprètes de Carmen. » (Le Ménestrel, dimanche 13 juin 1875.)
L'orchestre des Concerts Pasdeloup, au grand complet, avait tenu à dire un dernier adieu au Maître (*) ; avec les artistes de l'Opéra-Comique, il s'était chargé de la partie musicale de la funèbre cérémonie. A. Bazille, au grand orgue, avait préludé par une improvisation sur les Pêcheurs de perles ; l'orchestre avait ensuite exécuté Patrie, la belle ouverture, dernière œuvre symphonique ; puis, Duchesne et Bouhy chantaient, des larmes dans la voix, le Pie Jesu adapté par Guiraud sur la musique du duo des Pêcheurs de perles, et l'émotion des assistants était à son comble.
(*) Pasdeloup était à Caen où il était allé diriger le festival, donné par la Société des Beaux-Arts, à propos d'un concours régional, lorsque la triste nouvelle lui parvint. Le même jour il arrivait à Paris, et quelques heures lui suffisaient pour organiser la solennelle et touchante manifestation du lendemain. Chaque membre des Concerts populaires s'empressait de répondre à l'appel de son digne et vaillant chef, et c'est ainsi que cette brillante phalange symphonique rendit au Maître que la cruelle mort venait de nous enlever, l'hommage spontané de sa profonde admiration.
La cérémonie s'acheva lentement ; les chants des prêtres alternaient avec les mille voix gémissantes de l'orchestre, avec les voix émues des chanteurs ; Lhérie chanta l'Agnus Dei, l'orchestre fit ensuite entendre l'Andante qui forme la seconde partie du prélude de l'Arlésienne, puis l'Adagietto. Pendant l'absoute, Bazille improvisait sur l'orgue une grande fantaisie sur les motifs de Carmen.
L'office était terminé ; le cortège traversait lentement l'église ; en tête : Gounod, Ambroise Thomas, Camille Doucet, Camille Du Locle, tenant les cordons du poêle ; derrière eux, menant le deuil : le pauvre vieux père de Georges Bizet, morne, accablé, appuyé sur le bras de Ludovic Halévy ; Léon Halévy, Guiraud, Massenet, Delaborde, Paladilhe, les yeux gonflés de larmes, et tous les amis, tous les admirateurs du Maître. L'orchestre exécutait la Marche funèbre de Chopin. Au dehors, la foule immense se découvrait avec respect.
Parmi les fleurs, les bouquets, sous lesquels disparaissait le cercueil, une couronne entre toutes attirait l'attention ; c'était la couronne de deuil que les jeunes concurrents pour le grand prix de Rome, en loge en ce moment, avaient envoyée, en témoignage de leurs regrets et de leur admiration profonde pour le Maître, chef incontesté de la jeune École Française, dont ils ne pouvaient suivre le convoi...
L'inhumation eut lieu au cimetière Montmartre, dans un caveau provisoire, en attendant la sépulture définitive dans le monument qu'allaient élever, à la mémoire du cher grand artiste, ses amis et ses admirateurs (*).
(*) Ce monument a été élevé depuis.
Après un De profundis de plain-chant dit par Thierry et les chœurs de l'Opéra-Comique, Jules Barbier, le premier, prit la parole. Il parla, en termes émus, de l'artiste, du musicien que l'Art Français venait de perdre, en pleine sève ; que la mort brutale venait de nous ravir ainsi, en pleine jeunesse, à 36 ans, alors que, débarrassé des entraves qui avaient ralenti sa marche à ses débuts, maître de lui-même et du public, il allait donner libre essor à son génie.
Après lui, Camille Du Locle parla de l'ami, si généreux, si dévoué. « Ainsi donc, s'écriait-il en terminant, ainsi donc, le chemin que, depuis l'enfance, il suivait avec tant d'énergie et de volonté, ce chemin conduisait à cette tombe !... Il marchait à la tête de cette jeune pléiade d'où sortiront les maîtres de demain ; il est tombé à la veille du triomphe. Après avoir conquis, dès longtemps, les lettrés et les délicats, il marchait à la conquête de la foule, non pas en descendant vers elle, mais en l'obligeant à s'élever jusqu'à lui. »
Enfin, vint le tour de Gounod qui aimait Bizet d'une amitié de grand frère et qui en était aimé et admiré.
Il ne put prononcer que quelques paroles, l'émotion lui brisait la voix (*). . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
(*) Gounod s'est avancé ensuite, et n'a dit que quelques mots émus, parlant de l'homme et des regrets qu'il laisse. Pour en donner une idée, le Maître a rappelé, avec de véritables larmes, cette touchante pensée que Mme Bizet exprimait hier devant lui : « Des six années de bon heur que le mariage m'a données, il n'est pas une heure, pas une minute par laquelle je ne serais heureuse de passer encore. » (Le Figaro, 5 juin 1875.)
Le soir venu, tout le personnel de Favart se réunissait de nouveau pour rendre, sous un nouvel aspect, les devoirs à Georges Bizet. On représentait Carmen et tous les artistes pleuraient en scène. Cette soirée a été si déchirante qu'il faut renoncer à en parler. Seul, un grand peintre en pourrait reproduire l'émouvant tableau (*) »...
(*) Le Ménestrel, 13 juin 1875.
Alors commença l'apothéose du feuilleton, précédant de quelques années l'apothéose de la scène, qui ne devait avoir lieu, pour le Maître, qu'après la marche triomphale de Carmen à travers l'Europe, après les acclamations enthousiastes du Monde entier.
Pendant huit jours la presse entière ne tarit pas sur le compte de l'artiste qui n'était plus ; elle chanta ses louanges, sur tous les modes, avec un ensemble merveilleux. Ceux qui s'étaient montrés les plus acharnés étaient les plus empressés et les plus chauds, maintenant. Il y avait bien encore, par-ci par-là, quelque « farouche Wagnérien » ou quelque « fervent adepte d'un novateur audacieux et génial », mais ils disparaissaient sous les fleurs dont on couvrait la mémoire de l'artiste regretté, du Maître, comme l'appelaient, avec ostentation, ses détracteurs de la veille les plus obstinés.
N'est-il pas véritablement triste de songer que la mort, seule, a pu faire rendre une justice tardive à ce grand musicien, à ce très grand artiste ? Après Djamileh, presque tous les critiques de bon sens et de bonne foi, qui jugent sans parti pris, — même certains de ceux qui, au début de la carrière du jeune Maître, au lendemain des Pêcheurs de perles, avaient porté les jugements les plus erronés sur l'avenir qui semblait lui être réservé, — s'étaient ralliés et avaient, avec franchise, loué l'artiste qui, débarrassé enfin de toute influence, parlait avec cet art exquis, subtil et pénétrant, fait de rayons lumineux et d'ombres vaporeuses et transparentes, une langue poétique bien personnelle ; mais combien en était-il encore qui niaient l'évidence et s'obstinaient dans leur erreur !
« Si dans les œuvres d'imagination, dit Bénédict Jouvin (*), l'artiste véritable est celui qui sollicite, avant tout autre, le suffrage des esprits délicats et des intelligences exclusivement amoureuses du beau et du grand, la condition d'un faiseur d'opéras est, malheureusement, d'avoir d'autres maîtres à servir et à contenter : pour plaire au plus intraitable, qui est le public, la prudence fait à l'infortuné musicien une nécessité de dérober à ce tyran des qualités qu'il sera toujours tenté de prendre pour des défauts, à la scène. Les foules entrent involontairement en défiance contre un compositeur loué, le malheureux, pour son savoir et pour son style. N'essayez pas de leur vouloir prouver que le savoir est au musicien qui prend la plume ce que les jambes et les bras sont à l'homme qui veut marcher et agir, et que le style ne répond point, en musique, à ce qu'on entend par correction grammaticale, mais qu'il est la faculté, interdite aux organisations vulgaires ou médiocres, d'élever l'idée jusqu'aux sublimes mouvements d'une âme fortement émue. Vous n'aurez pas raison du préjugé si fort accrédité au théâtre qui traduit l'assemblage de ces deux mots dont s'écartent les foules : un savant musicien par le synonyme de pédant ou d'impuissant. » Tout cela est bel et bon, mais, enfin, en quoi consisterait donc le rôle de la presse musicale, si ce n'est à étouffer l'erreur, à déraciner le préjugé, à contribuer, dans la large mesure de ses moyens, à l'éducation esthétique du public, à lui apprendre à aimer, à admirer les chefs-d'œuvre, sans se préoccuper d'autre chose ; à lui dire, à lui redire sans cesse, pour l'en bien pénétrer, que les beaux mouvements, les élans de passion et d'amour, ne sont pas incompatibles avec le savoir, bien loin de là, que le savoir est indispensable au musicien, car c'est lui qui féconde, enfin, qu'un « savant musicien » peut être un artiste de génie, et que, bien au contraire, l'artiste le plus extraordinairement doué ne sera jamais rien, sans le savoir, — cette science pour laquelle il montre une si injuste défiance ?
(*) Le Figaro, 5 juin 1875.
« Vous n'aurez pas raison du préjugé, dit Jouvin ; le public ne vous croira pas. » Je le lui dirai, je le lui redirai sans cesse, et il faudra bien, à la fin, qu'il écoute et qu'il croie. Du reste, ne vaut-il pas mieux répéter ces vérités essentielles, ces vérités primordiales, au risque de n'être jamais cru, que de perpétuer l'erreur et de raconter les inepties qui s'imprimaient encore après Carmen, trois mois à peine avant la mort de Bizet, quitte à se signaler, ensuite, parmi les thuriféraires les plus empressés, les admirateurs les plus fervents, les panégyristes les plus enthousiastes ? . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Le 31 octobre suivant, à la réouverture des Concerts de l'Association artistique, sous la direction d'Ed. Colonne, au théâtre du Châtelet, eut lieu une simple et bien touchante manifestation.
L'orchestre des Concerts Pasdeloup avait rendu hommage à la mémoire du Maître, en offrant, spontanément, son concours pour la cérémonie des obsèques, à l'église de la Trinité ; l'orchestre des concerts du Châtelet voulut, à son tour, témoigner ses regrets et sa profonde admiration. Tonte la dernière partie du concert du dimanche 31 octobre, le premier de la saison, fut consacrée à la « Mémoire de Georges Bizet ».
Devant un nombreux auditoire, ému et recueilli, s'associant de tout cœur à la touchante manifestation des musiciens, fut exécuté un lamento pour orchestre, spécialement écrit par Massenet pour cette commémoration funèbre. Galli-Marié, l'admirable interprète de Carmen, vint ensuite, toute vêtue de noir, un bouquet à la main, réciter, avec une émotion profonde, les belles strophes de Louis Gallet : Souvenir, à la mémoire de l'ami et de l'artiste que l'Art Français avait perdu. « L'orchestre soutenait cette déclamation, en faisant entendre, comme dans un lointain mystérieux, une des phrases les plus expressives de l'Arlésienne (*). » Patrie, la belle ouverture symphonique, termina dignement cette triste cérémonie (**).
(*) Le Ménestrel, 6 novembre 1875.
(**) La première partie du concert du 31 octobre 1875 se composait de la Symphonie en la de Beethoven, de l'intermède d'Orphée de Gluck, enfin, du quatrième Concerto pour piano de Camille Saint-Saëns.
L'APOTHÉOSE.
Nous ne reprenons pas les chefs-d'œuvre, ce sont « les chefs-d'œuvre qui nous reprennent », a dit Janin. Et en effet, Carmen nous a repris, s'est emparée de nous ; nous l'avons enfin applaudie, acclamée, comme nous eussions dû le faire au premier jour. Mais que cette prise de possession définitive a été lente à s'accomplir !... Ce n'est qu'après huit ans que nous avons, enfin, rendu pleine et entière justice au chef-d'œuvre du Maître ; ce n'est qu'après son voyage triomphal à travers le monde, après les acclamations de tous les peuples civilisés, que nos yeux se sont ouverts à la vraie lumière et que nous avons mêlé notre voix au concert d'enthousiasme...
Nous voilà au bout de la route ; il ne nous reste plus maintenant, qu'à suivre la marche du chef-d'œuvre et à signaler ses principales étapes glorieuses, avant d'arriver à l'éclatante reprise du 21 avril 1883, à l'Opéra-Comique, reprise qui fut l'apothéose du musicien de génie et le commencement de l'immortalité (*). Car elle vivra, cette œuvre, elle ne subira pas les fluctuations de la mode et les transformations du goût ; elle restera debout, comme sont restées debout les œuvres immortelles des grands Maîtres !...
(*) La première manifestation sympathique s'était produite à Londres. un mois à peine après la mort du maître regretté, où Mlle Chapuis était allée chanter la Rosine du Barbier, au théâtre de Drury-Lane. Des dilettanti français et anglais, en adressant à la jeune artiste un superbe bouquet aux couleurs tricolores, après son grand succès de la leçon de chant, eurent la touchante idée de faire placer, sur l'un des rubans, au milieu d'une couronne de laurier en argent, l'inscription suivante :
Micaëla.
Carmen. Georges Bizet. Regrets !
On se rappelle en effet que Mlle Marguerite Chapuis était la touchante créatrice du rôle de Micaëla.
Vienne fut la première capitale qui monta Carmen. Nous l'avons vu, le traité, signé par la direction de l'Opéra Impérial, arrivait à Bougival au moment où Bizet agonisait. Le mourant avait eu, du moins, cette consolation suprême de savoir son œuvre acceptée par l'un des principaux théâtres étrangers, et l'espérance que l'accueil qu'elle recevait là-bas, la vengerait, en partie du moins — car les applaudissements français touchent par-dessus tout nos cœurs français — de la réserve que lui avait témoignée le public parisien...
A la date du 4 août, le Musikalisches Wochenblatt nous annonçait, déjà, que les répétitions avaient commencé et étaient poussées avec activité : l'impresario Jauner n'avait rien négligé pour mettre l'œuvre de notre regretté compatriote dans un cadre digne d'elle, et avait confié les rôles aux premiers artistes de sa troupe. Pour donner plus de développement à la scène Bohême qui ouvre le second acte, où avait été placé le ballet, on avait intercalé la Danse bohémienne de la Jolie fille de Perth. De plus, les récitatifs, remplaçant les scènes parlées, avaient été écrits par Guiraud, et Carmen, transformée, ainsi, en grand opéra... Mais, au dernier moment, tout fut modifié ; la version Viennoise tint à la fois de l'opéra-comique et du grand opéra ; les récitatifs, en effet, ne furent utilisés qu'en partie. On garda le dialogue pour les scènes familières qui s'accommodent mieux de prose que de musique.
La première représentation eut lieu le samedi 23 octobre, avec un grand succès que tous les journaux allemands constatèrent. Le rôle de Carmen était très remarquablement tenu par Mlle Ehnn, la Galli-Marié Viennoise, bien secondée par Mlle Kupfer (Micaëla), M. Muller (don José) et M. Scaria (Escamillo). « Ce qui a beaucoup contribué à la bonne interprétation de l'ouvrage, dit l'Écho, c'est que tous les petits rôles étaient tenus par des artistes de valeur. » Le Musikalisches Wochenblatt, à la suite du compte rendu de la pièce, publiait une biographie de Georges Bizet, précédée d'un très beau portrait du pauvre grand artiste que la mort implacable venait de ravir à l'Art français dont il était un des champions des plus nobles et des plus vaillants...
Pendant que le succès de Carmen, grossissant de jour en jour, dépassait à Vienne les plus optimistes espérances, une première reprise du chef-d'œuvre était tentée à la salle Favart. L'Opéra-Comique, dont la situation financière, fort précaire à cette époque, faisait redouter, à tous les amis de l'Art, un irréparable malheur, avait dû fermer ses portes le 18 juin, contrairement à ses habitudes. Dès la réouverture, en octobre, Camille Du Locle reprit le cours des représentations de Carmen, interrompues par la fermeture du théâtre. Ce n'était donc pas, à véritablement parler, une reprise.
« Lundi dernier (*) on reprenait Carmen, salle Favart, nous dit le Ménestrel (**), et tous les amis du regretté Georges Bizet s'y étaient donné rendez-vous. Bien que comble, la salle était imprégnée d'une atmosphère de deuil : « Mourir si tôt et après une partition qui en promettait tant d'autres remarquables ! » Telle était la douloureuse pensée qui traversait l'esprit de chacun ou venait expirer sur les lèvres de tous »
(*) Lundi 15 novembre.
(**) Le Ménestrel du 21 novembre 1875.
On le voit, c'était à une idée pieuse, plutôt qu'à un véritable sentiment d'admiration pour l'œuvre elle-même, qu'avait obéi la direction, et le public s'était, de son côté, associé surtout à ce sentiment de regret... Tous les principaux artistes de la création avaient tenu à reparaître dans leurs rôles : Galli-Marié, Lhérie, Bouhy ; Mlle Chapuis elle-même, — qui chantait, en ce moment, Rose de Mai dans le Val d'Andorre, — avait voulu venir rendre, sous les traits de Micaëla, un dernier hommage à la mémoire du Maître regretté. Le lendemain, elle cédait le rôle à Mme Franck-Duvernoy. Quant aux personnages secondaires, c'étaient toujours les mêmes vaillants artistes qui les interprétaient, à l'exception, cependant, de Mlles Chevalier et Ducasse qui avaient cédé les rôles des deux bohémiennes Frasquita et Mercédès à Mlles Nadaud et Lina Bell... Carmen n'eut, cette fois, que treize représentations, encore les quatre dernières se traînèrent-elles à quinze et vingt jours d'intervalle les unes des autres (*). Cela ne témoigne certes pas de l'empressement du public et de l'état satisfaisant des recettes. L'heure de la justice n'avait pas encore sonné...
(*) La neuvième représentation eut lieu le 17 décembre, la dixième le 27, la onzième le 17 janvier, la douzième le 3 février, enfin la treizième et dernière le 15 février 1876.
A Bruxelles, dans les premiers jours de l'année suivante (*), au théâtre de la Monnaie, Carmen reçut un accueil des plus favorables, non pas enthousiastes, certes, les Bruxellois étant trop proches parents des Parisiens pour comprendre complètement, à première audition, une œuvre si vivante, si nettement originale. Le Guide musical le constate, du reste, avec beaucoup de sincérité (**). « Le succès, dit-il, n'a rien eu de l'enthousiasme... La musique de Bizet est trop personnelle, trop originale, trop en dehors, pour qu'elle ne déroute pas, tout d'abord, quelque peu, le public habitué aux formules mille fois rebattues de l'opéra moderne, mais il a été franc, spontané, unanime, et le mérite supérieur de l'œuvre n'a été méconnu de personne. »
(*) 8 février 1876.
(**) Le Guide musical, 10 février 1876.
Comme à l'Opéra Impérial de Vienne, MM. Stoumon et Calabresi, les directeurs du théâtre de la Monnaie, avaient intercalé, dans la scène Bohème du second acte, la danse bohémienne de la Jolie fille de Perth, et adopté la version semi-récitée, semi-déclamée, qui avait déjà servi aux pensionnaires de M. Jauner. C'est Mlle Dérivis qui créa, cette fois, le rôle de Carmen avec des moyens insuffisants, — car le rôle de la bohémienne était un peu grave, un peu trop accentué pour elle, — mais, malgré tout, avec beaucoup de bonheur et de succès ; le baryton Morlet et le ténor Bertin lui donnaient excellemment la réplique, sous les traits de don José et d'Escamillo. La pièce était très luxueusement encadrée et montée avec beaucoup de soin. « Somme toute, dit le Guide musical, en terminant le très élogieux article qu'il consacre au chef-d'œuvre de notre Bizet, somme toute, la direction de la Monnaie a remporté là une victoire dont elle peut être fière et dont les fruits heureux la récompenseront de son intelligence et de ses sacrifices... »
A Paris, nous l'avons vu, Carmen n'avait pu se maintenir, l'année précédente ; les amis du Maître, ne pouvant encore ériger, par l'éclatante reprise de ses chefs-d'œuvre, un impérissable monument à son génie et forcer l'admiration réfractaire, s'étaient réunis, pour élever, au cimetière du Père-Lachaise, un modeste tombeau à l'artiste si regretté, s'en rapportant, pour le reste, au temps, ce souverain maître qui calme les effervescences, met chaque chose à sa place, érige les chefs-d'œuvre sur le piédestal, précipite les œuvres vides dans le chaos obscur et sans nom de l'oubli, et rend à tous une justice, tardive bien souvent, mais définitive. Les amis de Bizet et les membres de sa famille avaient seuls été admis à souscrire, et, cependant, la somme recueillie excédait de beaucoup les frais du monument. Il est vrai que deux de nos plus grands artistes français, Paul Dubois et Charles Garnier, voulant payer un tribut d'admiration à leur ami regretté, avaient offert leur concours tout affectueux et désintéressé (*).
(*) L'excédent des sommes reçues fut versé à la caisse de secours de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Une brochure, contenant les deux discours de MM. Émile Perrin et Jules Barbier lors de l'inauguration du monument, avec un frontispice reproduisant le tombeau de Bizet, fut adressé à chaque souscripteur.
L'inauguration du monument avait d'abord été fixée au 3 juin, jour anniversaire de la mort, mais les travaux n'étant pas encore terminés, la cérémonie fut remise au 10. C'est ce jour-là que furent découverts l'œuvre de Garnier et le buste si beau de Paul Dubois.
Après une messe de bout de l'an, célébrée dans la chapelle du Père-Lachaise, les nombreux assistants, appartenant presque tous au monde des Arts et du Théâtre, « se sont groupés, nous dit le Ménestrel, autour du monument dû à la collaboration de Charles Garnier et de Paul Dubois, et ont admiré l'élégant mausolée dont les lignes simples et sévères se profilent, avec un rare bonheur, sur l'immense panorama de Paris. Au-dessus du tombeau, sculpté dans le marbre, se détachent une lyre de bronze enlacée par une couronne de laurier et le buste de Georges Bizet, d'une ressemblance frappante et véritablement vivante. Pour toute inscription, le titre des ouvrages de Bizet et cette simple épitaphe : A Georges Bizet sa famille et ses amis (1838-1875). Deux discours ont été prononcés : l'un par Emile Perrin, au nom de l'Opéra-Comique, l'autre par Jules Barbier, au nom de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. La famille Halévy présidait à cette touchante cérémonie (*) ».
(*) Le Ménestrel du dimanche 11 juin 1876.
Un retour d'opinion, insensible d'abord, mais qui devait aller bientôt en s'accentuant, et préparer, rendre inévitable, la reprise triomphale de Carmen, commençait, cependant, à s'opérer dans l'esprit du public parisien. C'est aux Concerts Symphoniques du dimanche que ce mouvement surtout se manifesta. On y vit figurer Patrie et l'Arlésienne, — qui du reste n'avaient jamais complètement quitté l'affiche, — enfin, le 5 novembre de cette même année, Colonne fit entendre, pour la première fois, la Danse bohémienne de la Jolie fille de Perth aux Concerts du Châtelet. Jusqu'ici cette page si colorée n'avait guère été exécutée qu'aux concerts du Grand-Hôtel et de la salle Herz ; c'est la première fois qu'elle figurait sur les programmes des grands Concerts Symphoniques du dimanche... (**)
(*) Depuis lors, elle fut aussi exécutée aux Concerts du Cirque d'été, dirigés par M. E. Broustet.
(**) Ce délicieux petit chef-d'œuvre fait partie du Recueil de vingt mélodies (Choudens éditeur). C'est le n° 4 du Recueil.
Dans les réunions mondaines, une admirable artiste, femme du monde, Mme la générale Bataille, faisait fanatisme avec une des plus délicieuses mélodies du Maître, les Adieux de l'Hôtesse arabe (*), qui est bien, certainement, une des inspirations les plus poétiques, les plus naïvement touchantes, qui soient tombées de la plume d'un musicien de génie. Mais, ce qui est autrement caractéristique, c'est l'artiste mis à sa vraie place, partout, même dans les sphères officielles ; c'est Bizet mis au rang des Maîtres, même dans le Clan des politiciens, ces ennemis des Arts. « Réception au Ministère de l'Intérieur, nous dit le Ménestrel du 10 mars 1878 ; l'orchestre était dirigé par Danbé... Il a fait entendre successivement du Mozart, du Weber, du Mendelssohn, du Schubert, du Schumann, puis du Berlioz et du Bizet. » C'était le commencement de la justice (*) !...
(*) Le 14 décembre, la suite d'orchestre l'Arlésienne était exécutée, pour la première fois, à Genève, salie de la Réformation, sous la direction de M. Hugo de Senger.
Cependant l'année 1877 avait marqué un arrêt dans la marche de Carmen à travers l'Europe. Bruxelles fut la seule ville importante qui reprit, au cours de cette année, le chef-d'œuvre, qui n'avait jamais du reste complètement quitté le répertoire du théâtre de la Monnaie ; mais, créé à l'origine par Mlle Dérivis, le rôle de la Carmencita fut alors repris par Galli-Marié d'abord, par Minnie Hauk ensuite...
Dès le commencement de l'année 1878, Carmen triomphe simultanément à Angers, où le rôle de la Bohémienne est interprété avec talent par Mme Lelong, à Marseille, où elle alterne avec le Cinq-Mars de Gounod, et à Lyon ; puis, dans les premiers jours du mois de mars, elle obtient un éclatant succès au Théâtre Italien de Saint-Pétersbourg.
Mais tout cela n'était rien auprès de la surprise que semblait nous ménager Londres, pour la saison de cette même année 1878. Carmen était annoncée, à la fois, à Covent-Garden, avec Adelina Patti et Nicolini, et à Her Majesty's, avec Minnie Hauk et le ténor Campanini. Malheureusement, après réflexion, Adelina Patti avait trouvé le rôle écrit trop bas pour sa voix, et trop dépourvu de virtuosité ; elle y renonça (*). L'œuvre de Bizet ne fut donc pas donnée à Covent-Garden, mais à Her Majesty's, où elle fut représentée le 22 juin pour la première fois. Elle obtient un succès colossal (**). Minnie Hauk (Carmen), Campanini (don José), del Puente (Escamillo), et Mlle Valeria (Micaëla), étaient les interprètes remarquables du chef-d'œuvre français, converti, pour la circonstance, en partition Italienne.
(*) Elle s'est enfin décidée ; le 15 juillet 1885 elle l'a interprété à Londres, en compagnie du ténor Engel, avec un très grand succès.
(**) Il est curieux de voir les efforts que fit la presse entière pour tromper la pudibonderie, bien connue, du public anglais, et atténuer le caractère un peu cru de la Gitana... En fin de compte, toutes les hardiesses furent imputées à la nécessité absolue, aux exigences de la couleur locale, et tout fut dit...
Entre temps, les vaillants artistes allaient à Dublin, faire entendre Carmen, et Carmen, à Dublin comme à Londres, allait aux nues. Les Irlandais, enthousiastes, ne pouvant acclamer le Maître, acclamaient la principale interprète et, l'attendant en foule compacte à la sortie du théâtre, entouraient sa voiture et la reconduisaient triomphalement jusqu'à son hôtel...
Et à cette même époque, Paris conviait le monde entier à sa grande Exposition universelle. Des concerts étaient organisés, au palais du Trocadéro, où les grands orchestres étrangers venaient interpréter les œuvres musicales de leurs pays, tandis qu'une admirable phalange Symphonique Française, sous la direction de Colonne, faisant applaudir, à côté de nos chefs-d'œuvre consacrés, les œuvres moins connues de nos jeunes musiciens. Bizet eut sa part dans cette apothéose de la musique Symphonique ; aux Concerts français furent exécutées et acclamées la Suite d'Orchestre de l'Arlésienne et la Danse bohémienne de la Jolie fille de Perth. Mais ce fut surtout au concert du 10 octobre, au Cirque d'hiver, que la gloire du cher grand artiste reçut la plus éclatante consécration !
Pasdeloup, ayant voulu, à son tour, faire entendre aux étrangers accourus en foule son excellent orchestre des Concerts populaires, imagina un programme où les trois Écoles musicales étaient représentées par leurs plus grands Maîtres. Haydn et Beethoven représentaient l'École Allemande ; Rossini et Verdi l'Ecole Italienne ; Berlioz et Bizet la jeune et vaillante École Française, si vivante et si profondément artiste, Berlioz, avec la Symphonie fantastique, Bizet, avec son admirable ouverture : Patrie (*). Et Berlioz et Bizet ne furent pas les moins fêtés, les moins applaudis, les moins acclamés !...
(*) Programme du concert du 10 octobre 1878 aux concerts populaires du Cirque. Offerts aux étrangers de l'Exposition.
1° Patrie, ouverture Georges Bizet.
2° Symphonie en ut mineur Beethoven.
3° Entracte de la Traviata Verdi.
4° Symphonie fantastique Berlioz.
5° Sérénade Haydn.
6° Ouverture de Sémiramis Rossini.
Cette fin de l'année 1878 fut, du reste, particulièrement favorable à la gloire du Maître qui, émergeant enfin, complètement, des nuages qui l'avaient un instant voilée en partie aux regards des profanes, apparaissait, radieuse, dans l'azur étoilé du firmament de l'Art.
Carmen venait de franchir l'Océan et de faire une apparition triomphale à l'Académie de musique de New York (*).
(*) Le Puck, journal illustré de New York, publia pour la circonstance une grande chromolithographie où figuraient, en groupe, les principaux artistes de la troupe de M. Mapleson : Minnie Hauk, sous l'habit de Carmen, les castagnettes à la main, chante sa chanson bohème du deuxième acte que scande vigoureusement l'archet magique du maestro Arditi ; Signor Campanini lui donne la réplique sous les traits de don José, tandis que la basse Foli, en costume de Méphisto, sourit ironiquement en pinçant sa guitare. Dans un coin, la prima dona de la troupe, Mme Gerster, prise en débarquant d'une assez sérieuse indisposition, apparait, pâle et défaite, la tête enveloppée de serviettes, tenant à la main une tasse de tisane. Au bas, un médaillon encadre le portrait de Georges Bizet.
M. Mapleson avait dédoublé sa troupe d'opéra Italien de Her Majesty's, et, tandis qu'une partie, avec Mme Trebelli, continuait à la représenter à Londres, l'autre, avec Minnie Hauk la diva américaine, et le ténor Campanini, sous les auspices du Maestro Arditi, venait de révéler, au Nouveau Monde surpris et charmé, la Carmen de notre cher et regretté Bizet.
L'année suivante, une nouvelle compagnie s'organisait avec Marie Roze, et, simultanément avec la troupe de Her Majesty's — qui faisait toujours florès à New York, — parcourait la Californie en y promenant le chef-d'œuvre. A San Francisco, le succès tint du délire, les journaux Californiens en font foi... (*)
(*) Tous les journaux californiens : The Morning call, le Daily alla California, le San Francisco chronicle, le Daily evening bulletin, le Daily evening post, sont unanimes.
Et dans notre vieille Europe, Carmen triomphait encore, triomphait toujours, marchant sans cesse à de nouvelle conquêtes, à de nouveaux enthousiasmes.
Au Théâtre Royal de Gand, c'est Mlle Dérivis qui personnifie la bohémienne ; au Théâtre Impérial de Vienne, c'est Pauline Lucca, qui, sous les traits de Carmen, récolte de nombreux bravos. Puis, successivement, le chef-d'œuvre français est acclamé au théâtre de Hanovre, où il alterne avec Béatrice et Benedict de Berlioz ; à Naples, au théâtre Bellini, où Galli-Marié, qui s'est italianisée pour la circonstance, incarne à nouveau la bohémienne ; enfin, à Mayence et à Londres, où Minnie Hauck remporte de nouveaux triomphes.
Carmen apparaît ensuite à Bordeaux, avec Galli-Marié ; à Naples, où elle est interprétée, cette fois, par Minnie Hauk ; à Florence, avec Mme Pozzoni ; enfin, à l'Opéra Impérial de Berlin, avec Pauline Lucca, où elle obtient un éclatant succès... (*)
(*) L'Opéra Impérial de Berlin fit, en 1881, sa clôture annuelle, pour 2 mois, le 14 juin. Du 24 août 1880 au 14 juin 1881, 226 représentations avaient été données. Les journaux allemands publiaient le tableau du répertoire qui avait défilé devant les habitués du théâtre, avec le nombre de représentations de chaque ouvrage. Carmen tenait la tête de la liste avec 23 représentations, puis venaient : Lohengrin 13 représentations, le Czar et le Charpentier de Lortzing 11, Tannhäuser 9, la Reine Saba de Goldmarck 8, Néron de Rubinstein 8, Der Freischutz 6, etc.
Une nouvelle troupe s'était, pendant ce temps, constituée en Amérique, sous la direction de M. Max Strakosch, avec Mlle Anna de Belocca pour étoile, troupe voyageuse, allant de ville en ville, et jouant Carmen, à New York, à Boston, à Philadelphie, à Chicago, à la Nouvelle-Orléans et dans tous les grands centres de l'Union, tandis que Marie Roze, toujours en Californie, obtenait, de son côté, de nouveaux succès (*). L'année suivante, une quatrième troupe nomade, conduite par M. Maurice Grau, parcourait, avec Mlle Maria Dérivis, le même itinéraire et rencontrait partout le même enthousiasme...
(*) Voici qui est bien américain et qui prouve une fois de plus l'enthousiasme des Yankees pour la partition de Bizet. D'après le Courrier des Etats-Unis, Minnie Hauk, la cantatrice américaine, créatrice de la version italienne de Carmen, voulait intenter un procès au New York Herald sous prétexte que ce journal mettait les mérites de Marie Roze, dans le rôle de Carmen, au-dessus des siens. L'affaire n'eut malheureusement pas de suite : un pareil procès eût été curieux.
En Europe, nouvelles reprises, nouveaux bravos.
Tandis que Mlle Stella Bonheur et le ténor Mazzi créaient, avec un très grand succès, les rôles de Carmen et de don José au théâtre del Verme de Milan, l'infatigable Galli-Marié, transformée en prima dona italienne, se faisait applaudir, successivement, à l'Opéra de Madrid, au théâtre Beethoven de Barcelone, à Dieppe, où elle redevenait Française pour la saison d'été, puis, à l'automne, à Gênes, où elle reprenait la version italienne (*), et à la Pergola de Florence. Et le chef-d'œuvre était repris, pour la dixième fois peut-être, à Londres, au théâtre de Her Majesty's, avec une nouvelle étoile, Mlle La Rue, au Théâtre Italien de Saint-Pétersbourg (**), à Covent-Garden, où il apparaissait, pour la première fois, avec Pauline Lucca. Enfin, une jeune et charmante artiste, à peine échappée de notre Conservatoire national, Mlle Frandin, le créait, avec beaucoup de succès, dans les premiers jours de février 1882, au théâtre Khédival du Caire (***).
(*) « A Gènes, à la 1re représentation de Carmen, dix rappels et le bis de la Habanera, ont consolé Galli-Marié de la maladresse de son partenaire, un ténor trop convaincu, qui lui a traversé la joue d'un bon coup de couteau, sans le vouloir, cela va sans dire. Et ce n'est qu'étendue sur la scène que la pauvre Carmen a senti les gouttes de sang lui couler le long de la figure. Elle s'est relevée aussitôt et a eu le courage de continuer la représentation un morceau de taffetas rose sur la joue. Grande émotion dans la salle, désespoir du ténor, du directeur. On a dû courir toute la ville pour trouver du collodion. La nuit venue, la fièvre s'est déclarée et il a fallu éponger la blessure jusqu'au jour. Le lendemain, la plaie s'est heureusement fermée et tout promet que ce déplorable accident n'aura aucune suite fâcheuse. Mme Galli-Marié a pu continuer à chanter Carmen et va répéter Mignon. » (Le Ménestrel, 4 décembre 1881.)
(**) Voici qui prouve bien le gros succès obtenu par Carmen en Russie. A la date du 7 janvier 1882 le Ménestrel publiait une correspondance de Saint-Pétersbourg d'où je découpe la phrase suivante : « Ce qu'il y a de positif, malheureusement, c'est que la saison théâtrale Russe 1881-82 est désastreuse. Jusqu'ici, Carmen, seule, a vu s'humaniser les roubles. »
(***) Je ne puis aussi passer sous silence le vif succès obtenu de nouveau à Vienne par Carmen et par sa charmante interprète, Mlle Cécile Ritter, dans les premiers jours de l'année 1883.
Et Carmen était partout, — encore n'ai-je indiqué ici que ses principales étapes glorieuses, — partout, sauf à Paris, qui semblait refuser à l'un de ses fils la gloire qui lui était due et que le monde entier lui prodiguait... Cependant, les temps étaient proches. Le mouvement d'opinion, que j'ai signalé, s'était accentué de jour en jour ; le nom de Bizet revenait sans cesse sur les programmes des Concerts ; l'Arlésienne, Patrie, s'y succédaient, Roma avait fait une brillante apparition sur l'affiche des Concerts populaires, et la danse bohémienne de la Jolie fille de Perth avait reparu sur celle des Concerts du Châtelet. Mais les directeurs des concerts Symphoniques, ne s'en tenant plus à ces pages consacrées, avides d'œuvres nouvelles, s'étaient mis à fouiller dans le passé du Maître regretté. Colonne avait été le plus heureux, et, le dimanche 12 décembre 1880, il avait produit, avec succès, un prélude important, écrit par le Maître pour la Coupe du roi de Thulé, le seul morceau qui ait échappé à la destruction, et l'avait fait figurer au programme sous le titre : Marche funèbre, — prélude que devait, à son tour, deux ans après, au concert spirituel du Vendredi-Saint de l'année 1882 (*), exécuter l'orchestre des Concerts populaires, — puis, de nouveau, le 8 janvier 1882, il fit entendre la charmante petite Suite d'Orchestre Jeux d'enfants, qui avait inauguré ses concerts de l'Odéon, et qui fut accueillie comme elle l'avait été à ses débuts.
(*) Programme du concert Colonne du 12 décembre 1880 : 1° Ouverture du Roi Lear, Berlioz. — 2° Symphonie (1re audition), P. Lacombe. — 3° Scènes pittoresques, Massenet. — 4° Concerto en Sol mineur, Mendelssohn. — 5° Marche funèbre (1re audition), Georges Bizet. — 6° Fragment du Septuor, Beethoven. — « Le coloris de la marche de G. Bizet a paru un peu cru et violent, surtout dans le motif principal qui la commence et la termine ; mais on y a remarqué, au milieu, une phrase mélodique accompagnée par la harpe, pleine de sentiment, et, en somme, c'est une composition digne du grand talent de ce musicien regretté. » (Le Ménestrel du 19 décembre 1880)
Mlle Emma Thursby avait, l'année précédente (*), obtenu un très grand succès au Cirque d'hiver, avec la Tarentelle (**), qui est une de mélodies les plus colorées du Maître ; en cette année 1882, le 29 octobre, le violoniste Sarasate soulevait des nombreux bravos, aux Concerts du Châtelet, avec une suite de violon sur Carmen, qu'il dut faire entendre une seconde fois le dimanche suivant.
(*) Le 27 mars 1881.
(**) La Tarentelle est le n° 20 du Recueil de vingt mélodies (Choudens édit.).
Mais ceci n'était pas tout ; c'était Carmen que le public parisien voulait de nouveau entendre, maintenant. L'œuvre, si froidement accueillie jadis, avait trouvé à l'étranger le succès le plus sincère, le plus spontané qu'ait jamais rencontré partition française ; le bruit des applaudissements venus des quatre coins du monde, les bulletins de triomphe que publiaient sans cesse les journaux, souvent même les quotidiens, avaient produit lentement un revirement complet. Le public parisien, dont les arrêts, en matière d'œuvres nouvelles, toujours confirmés par l'étranger, avaient jusqu'ici fait la loi, avait assisté surpris à cette progression incessante de triomphes ; puis il avait commencé à douter de la justice de l'arrêt rendu par lui, un peu inconsidérément, sans doute, cette fois ; enfin, la transformation s'étant accomplie, il se ressouvenait des belles pages de l'œuvre, retrouvait le souvenir des scènes qui l'avaient charmé autrefois, mais qu'il n'avait pas pris la peine d'admirer, englobant toutes ces belles choses dans la réprobation dont il avait frappé l'œuvre entière. L'état de l'opinion était tel, vers la fin de l'année 1882, et la reprise de Carmen devenait si nécessaire, pour satisfaire le besoin de justice tardive qui s'était emparé du public parisien, que la direction de l'Opéra-Comique crut devoir satisfaire au vœu unanime, bien qu'elle ne crût pas au succès ; au succès pécuniaire du moins.
La reprise fut décidée... — Elle eut lieu le 21 avril 1883... (*)
(*) Le théâtre des Arts, de Rouen, devança d'un mois la salle Favart. Dans les premiers jours du mois de mars, en effet, sous la direction Pezzani, Carmen fut représentée d'une façon très remarquable par trois artistes parisiens: Mlle Mendès, MM. Furst et Paravey.
Tous ceux qui ont pu assister à cette soirée du 21 avril, en garderont longtemps le souvenir.
Jusqu'au quatrième acte, jamais triomphe n'avait été plus complet ; jamais émotion plus spontanée et plus sincère ne s'était emparée d'une salle de spectacle. On aurait bissé tous les morceaux, si l'on avait pu. Et cependant, ce n'était plus la Carmen alerte, vive, de 1875 ; elle avait perdu une partie de son relief, une grande partie de son charme. Mlle Isaac n'avait ni l'allure décidée, ni le côté mordant, à l'emporte-pièce, qui convient à ce rôle de la Carmencita. Cantatrice de très grand talent, douée d'un soprano brillant, la nouvelle Carmen mettait certainement en lumière, avec beaucoup de talent, les côtés vocaux du rôle, qu'étouffait, autrefois, le mezzo un peu sourd de Galli-Marié ; mais ce n'était plus la Carmen rieuse et coquette d'autrefois, bonne fille, donnant son cœur pour un oui, pour un non, mais implacable dans ses haines, cruelle dans ses caprices. Ce n'était plus la bohémienne de Mérimée, la fille « au jupon rouge trop court qui laissait voir ses bas de soie blancs avec plus d'un trou », qui « s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue ».
On avait pris à tâche, du reste, d'atténuer tous les effets un peu violents, un peu crus, d'adoucir les situations et les caractères. C'est ainsi que le bouchon louche du « marchand de friture » Lillas Pastia, où quatre bohémiennes se contorsionnaient, au milieu du bruit des voix et de la fumée des cigares, sous les yeux des officiers et des bohémiens, était devenu une taverne honnête où des danseuses pudiquement vêtues s'ébattaient. De même, la scène du duel au couteau était supprimée, en grande partie du moins.
Tout cela avait été fait pour essayer de mettre l'ouvrage au ton de l'Opéra-Comique, « le théâtre des familles... le théâtre des entrevues matrimoniales ».
La musique, elle-même, avait subi des atténuations ; les mouvements avaient été ralentis, l'allure du rythme, alourdie. En un mot, malgré l'enthousiasme du public du 21 avril — et c'est peut-être cet enthousiasme qui fit qu'il ne s'en aperçut qu'imparfaitement — la Carmen de 1883 était une Carmen diminuée. Mais, ce dont il s'aperçut, ce public emballé, applaudissant à tout rompre, c'est de la préparation insuffisante de la pièce.
Carvalho ayant eu la main forcée par les abonnés, la critique, les ministres, le directeur des Beaux-Arts, s'était hâté, pour s'en débarrasser, de monter cette Carmen, au succès de laquelle il ne croyait pas. Les répétitions avaient été insuffisantes ; les deux premiers actes étaient complètement prêts ; le troisième, à peu près ; le quatrième, pas du tout. Avec ce quatrième acte, incohérent, mal su, mal réglé, le succès triomphal fit place à l'étonnement, à la stupeur. Le public murmura d'abord, puis se fâcha. Des protestations s'élevèrent dans toute la salle ; ce fut une déroute complète à la fin. Les amis de Bizet, tout haut, très excités, accusaient violemment Carvalho d'avoir comploté la perte d'un chef-d'œuvre qu'il ne pouvait souffrir. La rumeur devint menaçante dans les couloirs, et prit même les proportions d'une émeute. « Nous nous demandions si la partie n'était pas encore perdue, » a écrit Ludovic Halévy. Non ! C'était l'éclatante revanche qui commençait. Le lendemain, la presse entière acclamait, et prononçait, unanimement, pour la première fois, le mot de chef-d'œuvre, accablant Carvalho sous les reproches les plus vifs et les plus mérités, l'accusant d'avoir refusé les répétitions nécessaires, pour tuer, définitivement, cette Carmen « tant dédaignée et tant redoutée ». Le public, à son tour, protestait par sa présence et ses applaudissements. La recette montait, montait, et la clôture annuelle du théâtre vint seule interrompre cet étonnant succès.
Carvalho était un homme loyal ; il reconnut ses torts et se promit de les réparer. Il aimait Bizet, il se mit à aimer Carmen. Son erreur lui était démontrée par l'évidence d'un succès colossal, obtenu dans d'aussi piteuses conditions.
Il profita donc des vacances pour remonter brillamment l'ouvrage, et, le 27 octobre 1883, Carmen, la vraie Carmen, séduisante, ayant retrouvé son allure cavalière, sa truculence, sa couleur, reparut sur la scène de l'Opéra-Comique, aux applaudissements sans fin d'un public enthousiaste. Galli-Marié était revenue prendre possession de son rôle de la Carmencita.
« Ce soir-là, a dit Ludovic Halévy, ce fut le triomphe complet, absolu, de Bizet. »
La pièce était maintenant magnifiquement interprétée ; les atténuations s'étaient effacées ; la musique avait repris ses mouvements, et cette Carmen acclamée, conservant encore un peu, cependant, de cette patine qui fond les couleurs, les marie et les estompe légèrement — la patine des chefs-d'œuvre — marcha triomphalement, à partir de ce jour, sans obstacle, à la conquête de l'avenir !...
Nous allons maintenant suivre pas à pas, rapidement, pour conclure, non plus la marche de Carmen à travers le monde, mais son ascension triomphale au cœur de Paris, au théâtre de l'Opéra-Comique, dont elle n'a — depuis cette troisième et définitive reprise du 27 octobre 1883 — jamais quitté l'affiche (*).
(*) Distributions de Carmen :
1875 1883
Don José Lhérie. Stéphane.
Escamillo. Bouhy. Taskin.
Le Dancaïre. Potel. Labis.
Le Remendado. Barnolt. Barnolt.
Moralès. Duvernoy. Collin.
Zuniga. Dufriche. Maris.
Lillas Pastia. Nathan. Bernard.
Un guide. Teste. Teste.
Carmen. Mmes Galli-Marié. Mmes Isaac.
Micaëla. Chapuis. Merguillier.
Frasquita. Ducasse. Dupuis.
Mercédès. Chevalier. Chevalier.
LA MILLIÈME DE CARMEN.
A la reprise du 21 avril 1883, les quatre principaux rôles de Carmen étaient tenus par Mlle Isaac (Carmen), Mlle Merguillier (Micaëla), Stéphane (Don José), Taskin (Escamillo). A la reprise du 27 octobre, Galli-Marié est venue reprendre possession de son rôle ; Mlle Bilbaut-Vauchelet, gracieuse et charmante, remplace Mlle Merguillier dans Micaëla ; le ténor Mauras, Stéphane dans Don José. L'interprétation est ainsi excellente. Ce sont ces artistes qui mènent Carmen à sa première étape glorieuse. Le samedi 22 décembre de cette même année 1883, a lieu, en effet, la Centième représentation de Carmen.
Ce soir-là, on installe, sur la cheminée du grand foyer du théâtre, le buste en marbre de Georges Bizet, par Paul Dubois.
Ce buste, fait de souvenir après la mort du maître, prit, quelque temps après, sa place définitive à gauche de la cheminée, où il resta jusqu'à l'incendie de l'Opéra-Comique le 25 mai 1887...
Voici maintenant, rapide, le palmarès triomphal des diverses étapes qui mènent sans un arrêt, sans une défaillance, le chef-d'œuvre à sa millième représentation, à son apothéose définitive.
Au cours de l'année 1884, Carmen est jouée quatre-vingt-six fois. Dès le début de l'année, Galli-Marié avait dû quitter Paris, pour aller remplir, à Rome, un engagement contracté avant son retour à l'Opéra-Comique ; elle est remplacée par un jeune premier prix du Conservatoire, Mlle Castagné. Cette charmante artiste joue Carmen jusqu'au 5 mai — trente représentations environ — époque à laquelle Galli-Marié revient prendre possession de son rôle.
En 1885, Carmen est jouée soixante-trois fois. Le 22 juin de l'année précédente, Mme Rose Delaunay avait remplacé Mlle Bilbaut-Vauchelet, dans le rôle de Micaëla ; le 9 septembre 1885, elle est remplacée, à son tour, par Mlle Patoret. Mouliérat joue don José (12 septembre) ; Bouvet, Escamillo (11 octobre).
En 1886 : quarante représentations. Mme Deschamps joue Carmen, et Lubert, Don José (22 mai) ; Soulacroix, Escamillo (13 juin) ; Cobalet, Escamillo (21 septembre) ; Mlle Molé, Micaëla (17 octobre).
En 1887 : trente-six représentations, seulement. Le 19 mai, Carmen est jouée, pour la dernière fois, sur la scène de l'ancienne salle Favart qui brûle six jours après (25 mai). L'Opéra-Comique émigre place du Châtelet. Jules Barbier, nommé directeur provisoire, s'empresse de remonter Carmen, qui, pour la première fois, le 16 octobre, apparaît sur l'affiche du Théâtre des Nations.
En 1888, Carmen est jouée quarante fois. Mme Vaillant-Couturier reprend le rôle de la Carmencita. Au cours de cette année, M. Paravey, nommé directeur de l'Opéra-Comique, poursuit les représentations du chef-d'œuvre, qui est joué quarante-six fois, en 1889, avec Mlle Nardi.
En 1890, où Carmen est jouée quarante-trois fois, un événement se produit, qui prouve bien l'admiration du public et le sentiment de son injustice passée, qu'il s'efforce de réparer. Le Comité de la Presse Parisienne ayant ouvert une souscription pour élever un monument à Bizet (*), cette souscription obtient un succès considérable. En quelques jours des sommes importantes sont réunies. Une représentation de gala est organisée par le Comité ; elle a lieu le 11 décembre. Jean de Reszké joue don José ; Lasalle, Escamillo ; Galli-Marié, Carmen ; Melba, Micaëla. Les autres rôles sont tenus par Lorrain, Collin, Grivot, Barnolt, Mlles Chevalier et Auguez. Au quatrième acte, un divertissement, tiré de la Jolie fille de Perth, est dansé par Rosita Mauri, Mlles Chabot, Violat, Chasles, Blanc et les corps de Ballet de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. Un public enthousiaste acclame le chef-d'œuvre, et la recette atteint 42.000 francs.
(*) Ce monument se trouve au foyer de l'Opéra-Comique.
En 1891, Carvalho redevient directeur de l'Opéra-Comique ; Carmen est jouée quarante-sept fois. Le 30 mars, Mlle Fouquet débute dans le rôle de la Carmencita ; le 10 septembre, Mme Tarquini-d'Or reprend le rôle avec succès ; enfin, le 21 octobre, a lieu la cinq centième de Carmen, avec Lubert (don José), Belhomme (Escamillo), Mlle Nardi (Carmen), Mlle Molé (Micaëla).
En 1892 : Carmen est jouée vingt-cinq fois, avec Mme Sigrid Arnoldson (5 mai), Mlle Chevalier, la créatrice de Mercédès (19 juin), Mme de Beridez (28 juin). Le 4 décembre, Mme Calvé prend possession du rôle qu'elle joue trente-huit fois, en 1893.
En 1894, où Carmen est jouée quarante-six fois, c'est Mlle Charlotte Wyns (3 février) qui incarne, avec talent, l'indomptable Carmencita, jusqu'au 17 octobre, où Emma Calvé reprend le rôle qu'elle a momentanément abandonné.
En 1895 : trente-neuf représentations. Les ténors Leprestre (12 septembre) et Maréchal (7 octobre) jouent, à tour de rôle, don José ; Carmen, c'est maintenant Mlle Nina Pack (6 janvier). Cette charmante artiste continue à interpréter le rôle de la bohémienne pendant le cours de l'année 1896 (trente-neuf représentations), jusqu'au 23 juin 1897, où Mme de Nuovina apparaît, pour la première fois, sous la mantille de Carmen. Trente-sept représentations en 1897. A la fin de cette année 1897, Carvalho meurt. Du Locle, Carvalho, Jules Barbier, Paravey, Carvalho iterum ! cinq directeurs, — les uns hostiles ou indifférents, les autres admirateurs surtout des belles recettes, — se sont succédé ! Les directeurs passent. Carmen reste, triomphante, applaudie, non seulement à l'Opéra-Comique, mais dans le monde entier, où toutes les artistes de talent l'interprètent et la font acclamer.
En janvier 1898 M. Albert Carré est nommé directeur de l'Opéra-Comique. C'est l'année des grandes migrations. Mlle Zélie de Lussan joue Carmen (7 février) ; Engel, don José (25 février) ; Mlle Guiraudon, Micaëla, et Saléza, don José (13 avril).
Le 24 juin, dernière représentation de Carmen au théâtre des Nations. Expulsé de la place du Châtelet, l'Opéra-Comique émigre et se réfugie rue de la Douane, au théâtre de la République. La nouvelle salle n'est pas encore prête ; il faut vivre, en attendant. On joue Carmen, pour la première fois, le 26 octobre, avec le ténor Beyle.
Le 4 novembre, Delvoye joue Escamillo ; le 13 novembre, dernière représentation au théâtre de la République, avec Mlle Thévenet.
La nouvelle salle attend ; la troupe voyageuse, guidée par son nouveau directeur, va s'y installer. L'inauguration a lieu le 7 décembre ; le second acte de Carmen figure au programme de gala. Le lendemain, 8 décembre, le nouvel Opéra-Comique ouvre ses portes, avec Carmen, présentée au public, toujours empressé et enthousiaste, dans des décors neufs, des costumes pittoresques, une mise en scène rajeunie et, en partie, renouvelée, avec beaucoup de goût, par M. Albert Carré.
Mlle Georgette Leblanc paraissait, pour la première fois, sous les traits de Carmen. Les autres rôles étaient tenus par : Beyle (don José), Bouvet (Escamillo), Bernaërt, Thomas, Dufour, Barnolt, Durand, Mlles Guiraudon (Micaëla), Marié de l'Isle (Mercédès), Eyreams (Frasquita), Chasles (la Gitane). A signaler encore, en cette fin d'année si mouvementée, où Carmen est jouée trente-deux fois, Mlle Jenny Passama et Miss Fanchon Thompson, qui interprètent le rôle de la bohémienne, la première le 13, la seconde le 28 décembre.
En 1899, Carmen est jouée trente-six fois. Mlle Marié de l'Isle paraît sous les traits de la Carmencita (2 juillet). Plusieurs ténors, plusieurs barytons, se produisent dans les rôles de Don José et d'Escamillo ; plusieurs jeunes chanteuses, dans celui de Micaëla. Signalons, parmi ces dernières, Mlles Marie Thierry (21 février) et Mastio (15 décembre).
En 1900 : cinquante-six représentations. Deux nouvelles Carmen : Mmes Bressler-Gianoli (18 juillet) et Delna (22 septembre) ; Dufrane joue pour la première fois le rôle d'Escamillo (24 septembre).
En 1901: Rien de bien saillant dans les interprétations nouvelles ; Carmen est jouée quarante fois. Vingt-neuf fois en 1902, avec Alvarez dans le rôle de José (30 octobre) ; trente-cinq fois en 1903, avec Cossira, Sizes et Clément, tour à tour, dans don José, et Mlles Claire Friché (22 mai) et Cortez (18 septembre) dans Carmen.
En 1904, le chef-d'œuvre de Bizet est joué quarante et une fois. C'est l'année de la Millième !
D'abord le 4 juin, Carmen est donnée, en matinée, pour la représentation de retraite du ténor Léon Achard. Représentation brillante ; interprétation de choix. Les principaux rôles sont tenus par : Alvarez (don José), Soulacroix (Escamillo), Jean Perrier (Zuniga), Charlotte Wyns (Carmen), Aïno Ackté (Micaëla).
Enfin, le 23 décembre, a lieu la millième représentation de Carmen, avec Emma Calvé, admirable, et se surpassant elle-même ce soir-là.
Devant une salle des plus brillantes, où les moindres places étaient occupées par tout ce que Paris compte de lettrés, d'écrivains, de musiciens, d'artistes, « la millième de Carmen revêtit le caractère d'une réparation. Il semblait que les auditeurs voulussent ce soir effacer, par leur enthousiasme, l'injustice funeste commise, il y a trente ans, envers ce pauvre et bon Bizet qui mourut de ne pas avoir été compris. Et lorsque Mme Bartet, de la Comédie-Française, vint, après le spectacle, dire, avec cet art dont elle possède le secret, les vers sonores où Jean Richepin nous montrait Paris, cruel sans savoir, faisant gravir au musicien méconnu le plus dur des Calvaires et l'y mettant en croix, toute l'assistance fut comme secouée d'émotion (*) ». Et Alfred Bruneau écrivait, quelques jours après cette millième inoubliable (**) : « La partition s'anime d'une telle intensité de vie, elle est à la fois si douloureuse et si heureuse, si spirituelle et si passionnée, si violente et si tendre, qu'elle semble justifier, hélas ! la brusque mort prématurée de notre grand musicien. Bizet l'a écrite avec son sang et ses larmes, et il s'est arraché le cœur pour le laisser après lui vibrant, palpitant et chantant, dans ces pages de magnifique réalisme qui surprirent le public au point que celui-ci tenta criminellement de les déchirer. »
(*) Musica (Charles Joly, février 1905).
(**) L'art du Théâtre (janvier 1905).
C'est, on le voit, la réhabilitation complète, l'amende honorable de la critique artiste, essayant de faire oublier les inqualifiables turpitudes de ses devanciers.
Non, Bizet n'est pas mort de l'insuccès de Carmen ; non, il ne s'est pas arraché le cœur ; son cœur, il l'avait gardé, ferme et vaillant, pour écrire de nouvelles œuvres, vibrantes, douloureuses, passionnées. La mort implacable est venue le surprendre, en pleine sève, en pleine vie. Une crise aiguë, violente, l'a emporté en quelques heures, et il est parti, non pas avec le doute, car il savait ce que valait son œuvre, et qu'on lui rendrait, plus tard, une justice qu'il commençait à entrevoir, mais, certainement, sans avoir pu soupçonner, espérer, rêver même, ce triomphe suprême, unanime, absolu. Aujourd'hui, Carmen est devenue l'œuvre populaire par excellence. Ouvriers, commerçants, bourgeois, communient dans l'admiration de ce chef-d'œuvre avec les artistes, les lettrés, les intellectuels eux-mêmes, et l'un de ces derniers, non des moindres, Nietzsche, le surhomme, revenu de Wagner, de ses pompes, de ses œuvres, s'attachant à Bizet avec ferveur, s'exprimait ainsi sur Carmen, qu'il appelait, lui aussi, sa Carmen adorée : « Une pareille œuvre perfectionne. A la considérer, on devient soi-même chef-d'œuvre. Toutes les fois que j'ai entendu Carmen, je me suis apparu plus philosophe, meilleur philosophe qu'auparavant. Je deviens aussi meilleur musicien, meilleur auditeur ; Bizet me rend fécond. Tout ce qui est bon me rend fécond. Je n'ai pas d'autre gratitude, pas d'autre preuve non plus de ce qui est bon. » Et dans sa brochure Le Cas Wagner, il écrivait : « J'entendais, hier, — le croirez-vous ? — pour la vingtième fois, le chef-d'œuvre de Bizet. Je l'entendis jusqu'au bout, avec la douceur du recueillement. Comme un ouvrage pareil rend plus parfait ! On devient soi-même un chef-d'œuvre. Je ne sais pas de circonstance où l'esprit tragique, qui est l'essence de l'amour, s'exprime avec une semblable âpreté, revête une forme aussi terrible que dans ce dernier cri de don José :
Oui, c'est bien moi qui l'ai tuée,
O ma Carmen, ma Carmen adorée ! »
Voilà de la grande et belle critique et qui venge noblement Bizet !...
Nous ne compterons plus, après cette millième triomphale, les représentations de Carmen (*). La quatorze centième est proche ; qu'importe ? L'ouvrage est définitivement classé et ne quittera plus le répertoire. Il fait désormais partie de la grande famille des chefs-d'œuvre que l'on reprend toujours, que l'on admire sans cesse (**).
(*) Parmi les artistes qui ont interprété, en ces dernières années, Carmen à l'Opéra-Comique, nous citerons Mlles Germaine Bailac et Bréval, qui, toutes les deux, ont été des plus remarquables.
(**) Après la voix du grand philosophe, voici la voix du peuple qui s'élève à son tour. Un journal quotidien illustré : Excelsior, ayant, dans les premiers jours de janvier 1911, institué un referendum musical, où il invitait ses lecteurs à désigner les dix œuvres préférées « et que l'on aimerait voir représenter le plus souvent à l'Opéra-Comique », le résultat a été le suivant : 1° Carmen, avec 26.116 suffrages. Venaient ensuite : Manon 20.524, Louise 15.408, Lakmé 14.374, Werther 13.597, Mignon 12.329, Mireille 10.943, le Barbier de Séville 9.002, la Vie de Bohème 6.592, la Traviata 5.150.
ŒUVRES DIVERSES. — ŒUVRES POSTHUMES.
Indépendamment des œuvres dont nous avons parlé, au fur et à mesure de leur production, Bizet a publié de nombreuses compositions de moindre importance, les unes pour piano et chant, les autres pour le piano seul.
Les œuvres vocales sont en petit nombre ; ce sont, d'abord : les Feuilles d'album, — dont il a déjà été question, à propos d'une lettre du Maître, — publiées par l'éditeur Heugel, et qui comprennent six mélodies : 1° A une fleur, 2° Adieux à Suzon, 3° Sonnet de Ronsard, 4° Guitare, 5° Rose d'amour, 6° le Grillon ; puis le Recueil de vingt mélodies, édité par Choudens. Ce recueil est formé des œuvres vocales composées par Bizet aux différentes époque de sa vie, contrairement aux Feuilles d'album, qui furent composées d'une seule haleine, pendant la période d'enfantement fiévreux de la Jolie fille de Perth. Certaines des mélodies qu'il contient, publiées d'abord séparément, furent écrites au début de la carrière de l'artiste, — de ce nombre : les Adieux de l'hôtesse arabe, — d'autres, au contraire, sont de beaucoup postérieures, d'autres, enfin, sont extraites des œuvres dramatiques, telles : J'aime l'amour, qui n'est autre que les voluptueux couplets d'Haroun, de Djamileh :
Tu veux savoir si je préfère
La mauresque aux yeux languissants...
telles, encore, le n° 9 : Pastorale, qui est un arrangement, pour une seule voix, du joli chœur en fa dièse mineur de l'Arlésienne, enfin, la Sérénade, extraite des Pêcheurs de perles (*). Quant aux morceaux de piano, ils sont beaucoup plus nombreux. Ce sont : 1° les Chants du Rhin, six lieder pour piano (l'Aurore — le Départ — les Rêves — la Bohémienne — les Confidences — le Retour. Paris, Heugel) ; 2° Jeux d'enfants, douze pièces (l'Escarpolette — la Toupie — la Poupée — les Chevaux de bois — le Volant — Trompette et tambour — les Bulles de savon — les Quatre coins — Colin-maillard — Saute-mouton — Petit mari, petite femme — le Bal. Paris, Durand-Schœnewerk). Les numéros 2, 3, 6, 11 et 12 de cette série, orchestrés par le Maître, formèrent la Petite Suite d'Orchestre exécutée pour l'inauguration des concerts Colonne, à l'Odéon, le 2 mars 1873.
(*) Un second volume de Mélodies a été publié. Il contient tous les fragments qui ont été recueillis après sa mort et ont pu être utilisés. Il porte le titre : Mélodies, 2e Recueil. Œuvres posthumes.
Bizet, au cours de sa carrière, a aussi publié plusieurs morceaux détachés ; j'ai déjà signalé les Grandes variations chromatiques et le Nocturne ; il a encore donné Danse bohémienne, et Venise, romance sans paroles (Choudens), ainsi que de nombreuses transcriptions pour piano, chez Heugel : six transcriptions sur Mignon, six transcriptions sur Don Juan, neuf transcriptions à quatre mains sur Hamlet. On lui doit aussi les réductions, pour piano seul, des partitions d'Hamlet et de l'Oie du Caire, et les arrangements, pour piano à quatre mains, des partitions d'Hamlet et de Mignon. Enfin, on lui doit encore une série de cent cinquante transcriptions pour piano, publiées, au début de sa carrière, sous le nom de Pianiste chanteur (Heugel) (*).
(*) « Fort jeune encore, il publia, au Ménestrel, une série de réductions au piano des chefs-d'œuvre classiques du théâtre, faite avec cette sûreté de main et cette habileté profonde à faire tenir dans les dix doigts tout ce que disent les vingt instruments des orchestres. Ce fut un succès de traduction, qui lui valut l'estime de tous ceux qui, voulant interpréter au piano quelque œuvre mélodique d'opéra, se trouvaient livrés jusque-là à de boiteuses transcriptions indigentes d'harmonies et disloquées par des arrangements maladroits. » Armand Gouzien (l'Évènement du 6 juin 1875).
Il a laissé, par contre, fort peu de manuscrits.
Semblable à un prodigue possesseur d'une mine de sequins, féconde et inépuisable, qui jetterait son or sans compter, certain de retrouver toujours un fonds que rien ne peut tarir, Bizet détruisait tout ce qui ne satisfaisait pas pleinement ses sévères exigences, même, parfois, ce qui ne trouvait pas immédiatement place dans une œuvre méditée. Nous l'avons vu, au début de sa carrière, retirer de l'Opéra-Comique, puis détruire sa partition de la Guzla de l'Émir ; plus tard, faire subir le même sort à Ivan le Terrible, grand opéra en cinq actes complètement écrit et orchestré ; les deux premiers actes de la Coupe du roi de Thulé ont, sans doute, été traités avec la même rigueur. Quant à Griselidis, l'opéra de Sardou auquel Bizet travaillait en 1871, et qu'il déclarait « très avancé en février de cette même année, il n'a été détruit qu'en partie ; un des principaux fragments a trouvé place dans Carmen, c'est la romance de Micaëla : « Je dis que rien ne m'épouvante... » ; d'autres, moins importants, ont été retrouvés dans les papiers du Maître, après sa mort.
Les journaux avaient, à maintes reprises, malgré la modestie de Bizet et son peu d'amour pour les réclames hâtives et bruyantes, annoncé que l'auteur de Carmen mettait la dernière main à un grand ouvrage en cinq actes, de Édouard Blau et Louis Gallet, d'après Corneille, le Cid, qui devait être représenté à l'Opéra. Après la mort du Maître, l'on s'étonna de ne plus entendre parler de cette œuvre, que l'on croyait terminée ; on ne comprenait pas que Guiraud, qui avait écrit pour l'Opéra Impérial de Vienne les récits de Carmen, ne mît pas la dernière main à la partition, si elle était restée inachevée, ou, du moins, si elle était terminée, comme on l'affirmait, ne rendît pas à l'œuvre posthume de l'ami les soins pieux que rendirent à l'Africaine les fidèles de Meyerbeer.
Hélas! l'œuvre dernière du pauvre Bizet était bien terminée, mais elle était complètement perdue pour ses nombreux admirateurs !
Avec son admirable talent, son incroyable facilité de travail et sa mémoire prodigieuse, Bizet avait une façon de procéder qui laissait peu de traces, avant la composition de la partition définitive. Il n'écrivait rien, composait, vivait avec son œuvre dans une intimité constante, jusqu'au jour où, enfin satisfait, il la laissait jaillir, nouvelle Minerve, tout armée de son cerveau.
Alors il procédait directement à l'Orchestre, sans jamais avoir recours à une première réduction au piano. Pour le Cid, il avait tracé sa partition ; il avait écrit les parties vocales, depuis la première note jusqu'à la dernière, et avait même esquissé des dessins d'orchestre, sur la portée de la flûte, de la première clarinette ou des premiers violons. Il allait enfin se mettre à l'œuvre et achever d'écrire sa partition dont les moindres détails étaient arrêtés dans son esprit, quand la mort l'a surpris. Voilà pourquoi nous n'avons pas applaudi le Cid ; voilà pourquoi l'œuvre est irrévocablement perdue.
Quelques amis ont eu cette rare bonne fortune d'entendre le Maître leur en jouer des fragments, à Bougival, dans sa petite maison de campagne au bord de la Seine, et Guiraud nous a affirmé que ces fragments, très importants, étaient d'une grande beauté, et que, dans son esprit, le Cid était une œuvre puissante, qui aurait porté bien haut le nom, aujourd'hui illustre, de l'artiste regretté.
Au moment de sa mort, Bizet travaillait encore à un Oratorio : Geneviève, patronne de Paris, et à Clarisse Harlowe, l'opéra-comique, en trois actes, de Philippe Gille. Il avait aussi en main le livret des Templiers, un grand opéra en cinq actes, de Léon Halévy, mais Clarisse surtout le préoccupait. Il préparait son œuvre, se disposant à en commencer l'exécution dès qu'il aurait terminé sa partition du Cid.
Les nombreux fragments de Clarisse — trouvés dans les papiers du Maître — prouvent cet état de préparation de l'œuvre qu'il méditait, tandis que le passage suivant d'une lettre adressée à Guiraud, et où il est question de Clarisse, indique un état encore plus avancé : « Ma femme dit que c'est bon, mais je n'en sais absolument rien. J'attends ton avis pour m'en faire un. Je suis toujours le même ! Hier mon acte m'a paru mauvais, médiocre ce matin et excellent tout à l'heure. Je le lâche et reste sur cette dernière impression qu'un nouvel examen modifierait évidemment. (*) » Un acte, au moins, était donc terminé et arrêté dans le cerveau de Bizet ; les fragments retrouvés après sa mort ne sont sans aucun doute que des notes des croquis destinés à servir de points de repère à sa prodigieuse mémoire. Certains ont dû servir à la composition de l'acte dont il est question, les autres auraient peut-être été utilisés ; tous, ou presque tous, ne sont que des notes tracées d'une main rapide, sur deux ou trois portées, d'une façon presque incompréhensible, avec une écriture véritablement hiéroglyphique. Fort souvent les phrases musicales ne sont indiquées que par les quatre premières mesures, suivies de nombreux etc. ; les harmonies et les basses sont à peine tracées. Le Cid terminé, le Maître aurait repris tous ces motifs qu'il se serait assimilés, les aurait développés, toujours sans rien écrire, enfin, aurait recommencé pour Clarisse — ou du moins pour les deux actes qui lui restaient à composer — cet admirable travail d'enfantement, d'où la nouvelle œuvre serait un jour sortie, prête à paraître en scène, séduisante et parée.
(*) Lettre à Ernest Guiraud.
Avec un soin pieux Guiraud a repris tous ces fragments, ainsi que ceux de Griselidis et ceux plus rares de Geneviève et des Templiers ; il les a complétés, interprétant la pensée du Maître toutes les fois que les abréviations venaient interrompre l'idée musicale, tirant parti de tout, même de la moindre phrase, harmonisant ce qui n'était qu'ébauché. Comme les librettistes avaient repris leurs livrets, l'éditeur Choudens a commandé de nouvelles paroles et les fragments, ainsi complétés et mis au point, ont pu être publiés...
Reste Noé. Noé, on l'a vu au courant de cette étude, est un grand opéra biblique, en trois actes et quatre tableaux, de de Saint-Georges, laissé inachevé par Halévy, repris, harmonisé, — en se servant de toutes les indications de l'auteur de la Juive, — et instrumenté par Bizet. Noé, on le sait, était destiné au Théâtre-Lyrique ; la partition, terminée et complètement orchestrée, était livrée le 15 novembre 1869, ainsi que l'exigeait le traité intervenu entre la direction et Bizet ; l'œuvre allait entrer en répétitions, lorsque les empêchements que nous avons signalés survinrent : pas de basse, pas de chanteuse, de taille à pouvoir prendre corps à corps les deux grands rôles de Noé. Bizet aima mieux attendre que de livrer à une exécution insuffisante l'œuvre dernière d'Halévy, qui était bien aussi un peu la sienne. Survint la débâcle du théâtre, puis la guerre, puis la Commune... Noé ne fut pas représenté.
Tous les efforts de Mme veuve Halévy ont été stériles. Jusqu'à sa mort cette femme courageuse a conservé l'espoir de faire produire à la scène cette œuvre posthume des deux Maîtres Français. Efforts inutiles ! L'Opéra s'est toujours montré, sinon ouvertement hostile, du moins peu empressé. Elle avait alors tendu ses espérances vers le Théâtre-Lyrique de la Gaîté, dont Albert Vizentini était directeur. L'existence éphémère de ce théâtre n'a pas permis la réalisation de cette pensée si éminemment artistique. Le Théâtre-Lyrique a croulé ; les entreprises qui ont depuis lors tenté la restauration de cette scène ont à peine vécu l'espace d'une soirée. Aujourd'hui, Mme veuve Halévy est morte ! Noé ne sera probablement jamais représenté (*).
(*) Ainsi que nous l'avons vu, il a été représenté, avec grand succès, sur la scène du théâtre Grand-ducal de Carslruhe, le 6 avril 1885, sous la direction de Felix Mottl. L'année suivante, il fut repris sur plusieurs autres scènes allemandes, avec le même succès.
La partition a été publiée par l'éditeur Choudens. Certains fragments avaient été égarés dans les différentes migrations de l'ouvrage ; ils ont été remplacés par des emprunts faits aux œuvres de Bizet. Le Ballet, complètement perdu, a été formé par quelques-unes des plus savoureuses pages de Djamileh : la Marche des esclaves, le Gazel, le Pas de l'Almée, etc., et par l'une des Mélodies, la seizième du recueil : la Coccinelle ; l'Hymne à Dieu, qui forme le second tableau du troisième acte, également perdu, a été remplacé par le Chant d'Amour, le n° 17 du recueil. La Mélodie, d'abord exposée par le soprano, reprise par les personnages en scène et par les chœurs, s'harmonise admirablement avec la situation, et termine la partition de Noé sur une note très poétique.
Parmi les œuvres publiées après la mort de Bizet — en même temps que les fragments d'opéras, édités sous le titre de Mélodies, 2e Recueil, œuvres posthumes — se trouvent : Vasco de Gama, Ode Symphonique, qui est, on s'en souvient, le second envoi de Rome du Maître ; Roma, qui n'est que la Symphonie Souvenirs de Rome, dans laquelle a trouvé définitivement place le Scherzo du troisième envoi de Rome ; enfin le Prélude de la Coupe du Roi de Thulé, exécuté aux concerts Colonne d'abord, aux Concerts populaires ensuite, sous le nom de Marche funèbre, titre qu'il a conservé dans l'édition.
Parmi les œuvres qui n'ont pas été publiées, il faut citer deux pièces, qui devaient faire partie du recueil des vingt mélodies et qui, je ne sais pour quelle raison, ne parurent pas. Ce sont : Vœu, poésie de Victor Hugo (les Orientales, n° 22) : « Si j'étais la feuille qui roule. » et le Colibri, poésie d'Alexandre Glan (Rimes et Idées. Dentu, 1868). Les manuscrits de ces deux mélodies font partie de la riche collection d'autographes de M. Charles Malherbe, bibliothécaire de l'Opéra.
Dans cette même collection, se trouvent également deux œuvres qui ont été gravées, mais, tirées simplement en épreuves, n'ont pas été mises dans le commerce : l'Esprit Saint, hymne avec accompagnement de piano et orgue expressif (non obligé), dédié à Mlle Krauss, paroles sans nom d'auteur : « Quel feu s'allume dans mon cœur. » N° du cotage G. H. 346 (3), et la Mort s'avance, méditation sur deux préludes de F. Chopin, cantique de l'abbé Pellegrin, chœur mixte avec accompagnement d'orchestre. N° du cotage G. H. 337. Ces deux dernières œuvres proviennent du fonds Hartmann.
Il faut encore mentionner trois ouvrages, dont parle M. Edmond Galabert, dans la préface de son livre : Lettres à un ami. D'abord, un chœur d'orphéon « qu'on lui avait demandé de la Belgique où il avait été appelé comme membre du Jury d'un concours ». Ce chœur, pour voix d'hommes (composé en 1865), était sur une pièce des Contemplations, de Victor Hugo : « Écoutez, je suis Jean ; j'ai vu des choses sombres... » Ensuite, une cantate et un hymne, envoyés au concours ouvert, à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1867, entre tous les musiciens français. Bizet et Guiraud prirent part à ce double concours, sous des noms d'emprunt, en déguisant leur écriture et en donnant des adresses d'amis de province. La Cantate de Bizet était, paraît-il, fort belle ; elle ne fut même pas mentionnée... pas plus que celle de Guiraud. Ce fut Camille Saint-Saëns qui obtint le prix.
Ces trois ouvrages n'ont laissé aucune trace ; Bizet les a probablement détruits.
L'HOMME ET L'ARTISTE.
Georges Bizet avait été un enfant rose et blond, aux traits un peu bouffis, mais à la figure intelligente et éveillée. En grandissant, sa physionomie avait pris du caractère ; ses traits, arrondis, étaient devenus plus fermes, donnant à sa figure une grande expression d'énergie, tempérée par la confiance et la bonté, qui furent, avec la franchise, les caractéristiques de sa nature.
Dans les derniers temps de sa vie, ce caractère de bonté énergique et confiante s'était encore accentué ; ses traits avaient pris plus de fermeté ; un collier de barbe d'un blond ardent, bien fourni, encadrait l'ovale un peu court de son visage. Sa myopie, très prononcée, n'altérait en rien la franchise et la netteté de son regard, de ce clair regard, éclairant, avec sa bouche souriante, cette physionomie ouverte qui attirait toutes les sympathies.
Sous cette écorce, un peu rude peut-être au premier aspect, se cachait un esprit d'élite, fin et délicat, accessible à toutes les manifestations, même les plus subtiles, de l'intelligence humaine, un cœur d'or, loyal et franc, bon et généreux, une âme tendre, ouverte à toutes les grandes sensations. D'un commerce agréable, Bizet ne compta jamais que des amis, admirant en lui le musicien, qui, suivant la belle expression d'un chroniqueur célèbre (*), fut « un laborieux et un inspiré », aimant l'homme bon et dévoué dont l'amitié était solide, comme son noble amour pour l'Art, comme sa robuste et inaltérable conscience artistique. Tous ceux qui l'ont connu rendent témoignage des nobles qualités de son cœur, de sa générosité, de l'élévation de son esprit, de la délicatesse de ses sentiments. Il avait la notion justement inflexible du Vrai et du Beau ; sa nature rigide ne connut jamais les faiblesses, les compromis ; il alla toujours droit devant lui. Poussé par la tournure particulière de son esprit vers l'imprévu original, ennemi des conventions admises, des ornières tracées où se contentent de patauger les médiocres, il aimait, au cours des causeries intimes, envisager les questions sous des faces nouvelles et curieuses ; il abondait alors en saillies toujours fines et spirituelles, en aperçus ingénieux, en mots heureux. Que de fois ne l'a-t-on pas entendu soutenir des thèses franchement paradoxales ! et avec quelle verve, avec quel entrain, avec quel esprit ! Toujours maître de lui et de sa parole, plein de finesse et d'à-propos, il ne se servit jamais que d'armes courtoises, criblant ses contradicteurs de ses traits acérés, traits légers, dont les blessures ne furent jamais mortelles, que pour les imbéciles qu'il ne put jamais souffrir. Mais il ne fallait pas toucher à ses Dieux ! Il aimait l'Art pour lui-même et le respectait, et il exigeait un respect égal de tous ceux qui l'entouraient. Dans sa jeunesse, à son retour de Rome, il avait traversé une période de fougue et d'exaltation artistique des plus curieuses. A cette époque, il n'entendait pas raillerie sur ce chapitre sacro-saint. Pour un mot malsonnant, pour un geste irrespectueux, il mettait flamberge au vent et se constituait le champion de la bonne cause, s'escrimant d'estoc et de taille, sans qu'il y eût provocation, outrage, et, le plus souvent, contre des moulins à vent imaginaires.
(*) Albert Wolff, le Figaro du 20 avril 1883.
Ses amis intervenaient aussitôt et le calmaient, ce qui était facile une fois la première exaltation passée ; le bon cœur du brave garçon reprenait alors le dessus et imposait silence à ses sentiments trop tumultueux.
La plus étrange de ces estocades légendaires, — estocade avortée dans l'œuf, grâce à d'amicales interventions, — est bien, certainement, celle qui eut pour théâtre la table d'hôte d'un hôtel de Bade, pendant l'été de 1862.
Paris avait envoyé une députation de ses artistes à l'inauguration de la salle de spectacle dont l'opulent fermier des jeux, Benazet, venait de doter la petite ville allemande alors dans toute la splendeur de sa vogue éclatante. Berlioz et Reyer, appelés par l'Impresario à l'honneur d'inaugurer le minuscule théâtre, — le premier, avec Béatrice et Benedict, comédie shakespearienne, dont il avait écrit le dialogue et la musique, le second, avec cet Érostrate, dont le succès, qui fut très grand à Bade, devait se changer en déroute complète à Paris, à l'Opéra, — étaient partis, escortés de quelques amis. Parmi eux, Charles Gounod et Georges Bizet, ce dernier dans toute la fougue généreuse de ses vingt ans, dans toute son admiration exubérante et intolérante.
Gounod venait de perdre, à l'Opéra, une œuvre longtemps caressée, œuvre bien chère entre toutes : la Reine de Saba. La blessure avait été cruelle ; son cœur avait saigné à la perte de cette fille bien-aimée, mais il avait fini par en prendre son parti, sinon gaiement, du moins assez philosophiquement pour ne laisser rien paraître des sentiments qui l'agitaient, intérieurement, peut-être.
Ce voyage d'outre-Rhin avait été un puissant dérivatif ; en applaudissant ses camarades, Gounod en était venu à oublier presque complètement son infortune. Mais Bizet n'oubliait pas si facilement, lui ! L'ami blessé, dans son admiration profonde pour l'œuvre de son grand ami, était seul à se souvenir. Seul, Georges Bizet portait, à Bade, le deuil de la Reine de Saba, assassinée par un public imbécile. Il pensait, tout haut, le répétant à qui voulait l'entendre, avec sa fougue et son exubérance passionnée, que l'œuvre de Gounod était des plus nobles et des plus belles ; que la royale amante de Salomon avait trouvé, en l'auteur de Faust, un chantre inspiré, dont les philistins du parterre n'avaient pas su comprendre la poésie si exquise ; et il accusait le public d'avoir refusé d'entendre, au lieu de glorifier.
Dans la petite colonie parisienne, venue à Bade à la suite de Berlioz et de Reyer, se trouvait un poète d'opéras, librettiste médiocre, homme aimable, au demeurant, et de mœurs très pacifiques : Émilien Paccini.
A vrai dire, Paccini servait un peu de tête de Turc à ses compagnons de voyage, qui s'aiguisaient l'esprit, souvent, à ses dépens. C'est là son excuse. Eurent-ils la dent trop cruelle, certain jour, à table d'hôte ?... Je ne sais. Toujours est-il que Paccini, poussé à bout sans doute, et croyant son droit de réponse illimité, s'avisa de déclarer, que le cas de la Reine de Saba était un cas tout naturel ; que nulle injustice n'avait été commise, et que l'œuvre de Gounod avait reçu l'accueil qu'elle méritait.
A peine avait-il prononcé ces paroles imprudentes, que, se dressant d'un bond, — comme un diable surgit du fond d'une boîte à surprise, — Bizet, rouge de colère et d'indignation, l'œil allumé, le geste menaçant, foudroyait sous un torrent de paroles le librettiste confondu.
La conversation venait de passer, sans transition, du plaisant au sévère. Il allait falloir en découdre, car il y avait eu, bel et bien, provocation ; Bizet, à bout d'arguments, n'avait trouvé rien de mieux pour convaincre son adversaire,
Des témoins furent constitués, de part et d'autre. On essaya bien d'arranger l'affaire, mais que voulez-vous donc faire avec deux diables d'hommes, dont l'un entend prouver, l'épée ou le pistolet au poing, que la Reine de Saba est un chef-d'œuvre, tandis que l'autre, s'entêtant dans son idée, maintient mordicus le contraire ?
Gounod dut intervenir et calmer les champions prêts à en venir aux mains. Ce ne fut pas mince besogne ; Bizet ne voulait rien entendre.
Avec une diplomatie très subtile et très déliée, l'auteur de Faust parvint à persuader à son jeune ami, que lui seul avait été atteint, que la Reine de Saba, toujours debout, restait intacte sur son piédestal.
Paccini, qui ne demandait qu'à pouvoir battre honorablement en retraite, s'empressa, alors, de faire toutes les concessions possibles, et l'affaire n'eut pas de suites.
Ce trait n'accuse-t-il pas, chez Bizet, le sentiment le plus noble et le plus rare, dans le caractère de l'artiste : l'admiration ; le sentiment le plus touchant, dans le cœur de l'homme : l'amitié, allant jusqu'au dévouement le plus complet, le plus absolu ?...
Bizet se maria ; ses allures provocatrices et batailleuses se calmèrent ; il devint un mari attentif, plein de prévenances pour sa jeune femme qu'il aimait tendrement ; et alors, au souvenir des rodomontades évanouies, ce n'était pas sans un sourire qu'il avouait, avec sa franchise charmante, tout ce qu'il y avait de vain dans ces coups d'estoc frappant dans le vide, et où il ne voyait, maintenant, qu'un trop-plein de jeunesse, une grande exubérance de vie et de sentiments.
« Je n'ai pas connu, dit Reyer (*), de musicien qui fût « plus sûr de lui et d'une mémoire aussi prodigieuse. Certes, il ne s'en vantait pas, mais tout le monde le savait. » Son goût délicat, son jugement sûr, sa sincérité, étaient aussi bien connus de tous ; ses aînés, ses rivaux, tenaient en haute estime ses suffrages ; les plus jeunes écoutaient avidement ses conseils. Il louait, avec abondance de cœur, tout ce qui lui paraissait digne d'être loué, sans parti pris d'Ecole, alors même que l'œuvre soumise à son appréciation était d'une forme et d'un esprit contraires à ses propres idées ; les œuvres médiocres, mauvaises même, trouvaient en lui un juge plein d'indulgence, critiquant avec justice, sans passion, sans véhémence.
(*) Les Débats, 13 juin 1875.
Certains musiciens, que les faveurs obstinées du public poursuivaient sans cesse, avaient, cependant, le don d'exciter sa verve satirique ; il trouvait alors, pour les atteindre, des traits d'une acuité extraordinaire ; parfois, souvent même, ils servaient de cible à sa bonne humeur.
Clapisson fut de tous le plus maltraité.
Avec son incroyable faculté d'assimilation, Bizet avait imaginé, un soir, dans une réunion d'amis, un plaisant monologue où il le mettait en scène, avec une verve incroyable. Assis au piano, il imitait, avec une vérité surprenante, la voix, le geste, l'allure, la musique de Clapisson. Oui, la musique de Clapisson ! Et je vous laisse à penser s'il était impitoyable. Tout ce que l'illustre auteur de la Fanchonnette avait produit de plus plat, de plus vide, défilait, commenté musicalement, sous les doigts vengeurs du monologuiste improvisé.
Le monologue eut un tel succès, que, dès lors, il n'y eut plus de soirée intime chez Bizet, ou chez ses amis, sans l'Enterrement de Clapisson... (*)
(*) C'est au début de sa carrière, quelque temps après son retour de Rome, qu'il imagina cette curieuse boutade. Sur un canevas qu'il s'était tracé, il donnait libre carrière à son imagination satirique et à sa verve d'improvisateur. Il figurait l'Enterrement de Clapisson, accompagnant son récit des motifs les plus plats du pseudo grand homme, traités en Marche funèbre. C'était, d'abord, le défilé du cortège : les membres de l'Institut suivant gravement le corbillard ; puis, l'arrivée au cimetière, les discours académiques du baron Taylor, d'Ambroise Thomas, etc. ; enfin le départ des invités retournant, guillerets, à leurs petites affaires. Venait ensuite la seconde partie, la plus importante : l'Apothéose. Restée seule, après le départ des invités, l'âme de Clapisson, vêtue de l'habit à palmes vertes, l'épée en verrouil, désertait le cimetière et s'envolait au séjour des Élus ! Le Père Éternel, entouré des musiciens célèbres, venait à la rencontre du nouvel arrivant, pour lui faire honneur. Beethoven prenait le premier la parole (c'était le discours de réception), il attaquait la symphonie en Ut mineur. A la 5e mesure, Clapisson l'interrompait et lui jouait un motif de la Fanchonnette. Beethoven, un instant interloqué, reprenait bientôt sa symphonie interrompue, mais Clapisson ne le laissait pas continuer ; de nouveau les motifs de la Fanchonnette couvraient sa voix. Alors c'était une véritable lutte ; tandis que la main gauche de l'improvisateur continuait à faire entendre les passages les plus célèbres de la sublime symphonie, la main droite ricanait les motifs les plus canailles de Clapisson s'efforçant d'imposer silence à Beethoven. Beethoven, en effet, finissait par se lasser ; alors la Fanchonnette régnait en souveraine maîtresse, partant en fusée dans une apothéose grotesque, au milieu des éclats de rire des assistants.
Mais, un beau soir, Bizet refusa de renouveler la plaisanterie ; Clapisson venait de mourir.
Ce qu'il avait pu faire du vivant du médiocre musicien, arrivé aux honneurs, applaudi de ses contemporains, il pensa qu'il ne devait plus le continuer devant une tombe. Désormais, c'était à la postérité à juger.
Elle s'est montrée impitoyable. Tandis qu'elle jetait le voile de l'oubli sur ce Médiocre, applaudi de son vivant, choyé du public et de l'Institut qui l'avait préféré à Berlioz, elle élevait au contraire et exaltait la mémoire du pauvre grand musicien, mort à trente-six ans sans avoir connu une seule fois le vrai succès, ces applaudissements de tout un peuple, qui devaient saluer, quelques années plus tard, l'admirable partition de Carmen. Aujourd'hui, la justice est complète ; chacun a été remis à sa place par le temps ce redresseur de torts ; Berlioz est le grand Berlioz, et la dernière œuvre, le chef-d'œuvre, de notre cher Bizet, a trouvé parmi nous le tribut d'admiration qui lui était dû...
La publication en 1908 des Lettres de Georges Bizet (Impressions de Rome, 1857-1860) a mis en verve certains critiques, qui se sont évertués, — sans convaincre personne, d'ailleurs, — à essayer de diminuer Bizet, et à le présenter comme un vulgaire « fort en thème », un « bon élève » ayant toujours suivi, sagement, la voie qu'il s'était tracée, faisant de la musique, non pas pour « déverser le trop-plein de ses rêves », mais, « pour être joué, sans plus ! »... « Qu'il y a loin de ces visées modestes, s'écrie l'un d'eux, à la gestation de l'œuvre qui vous possède et que l'on nourrit de son sang, à la création idéale d'un ouvrage qui ne sera peut-être jamais joué, peut-être, même, jamais terminé !... » En d'autres termes, notre critique reproche au Maître d'avoir édifié, de main d'habile ouvrier, avec un talent incomparable, une œuvre puissante et forte, émouvante, passionnée, et de n'avoir pas été un de ces ratés dont les conceptions, qualifiées sublimes, sont tellement au-dessus des moyens de réalisation dont ils disposent, qu'ils restent toute leur vie en panne avec leur génie ! Que de choses étranges peuvent suggérer, à des esprits enclins au paradoxe, des lettres écrites à sa mère par un jeune homme de vingt ans, cherchant sa voie, admirant, un peu au hasard, peut-être, et sans trop d'esprit critique, c'est certain, mais avec toute l'ardeur, toute la générosité de sa nature loyale et exubérante ; lettres écrites avec abondance de cœur, où il se livre, se montre tel qu'il est, parle de ses rêves, de ses ambitions, de ses espérances, sans se douter que, plus tard, longtemps plus tard, des commentateurs, froidement, les scruteront à la loupe, pour essayer d'en tirer des conclusions fâcheuses pour sa mémoire ! Mais, hâtons-nous de le dire, ces dissonances dans le concert d'éloges sont heureusement fort rares. La grande Presse Musicale, qui fut si injuste pour Bizet vivant, a fait amende honorable à sa mort ; elle l'a unanimement proclamé grand musicien, Maître, dans le sens profond du mot. Et, depuis lors, elle a saisi avec empressement toutes les occasions de lui exprimer son admiration très grande et très sincère : la reprise de Carmen en 1883, la reprise de l'Arlésienne, à l'Odéon, en 1885, la souscription ouverte par le Comité de la Presse Parisienne, et la représentation de gala qui l'accompagna, en 1890, enfin, la millième de Carmen, en 1904. Elle pense aujourd'hui, comme nous, que Bizet, grand musicien, eût été le maître de notre théâtre contemporain. Sa musique nerveuse et colorée, robuste et saine, est évocatrice de visions plastiques éblouissantes, inoubliables, non de fantômes vaporeux, et c'est à ce signe certain, que sa prédestination dramatique, et uniquement dramatique, nous est révélée. Elle ne possède ni l'intériorité de la musique symphonique pure, ni le calme recueillement de la musique de chambre, mais elle est vivante, passionnée, tumultueuse aussi, parfois, et elle agit directement, elle entraîne ! Elle a le relief, la couleur, le charme, la vigueur, la puissance. Elle ne cherche pas l'effet, mais l'atteint toujours par la netteté et la vivacité du rendu ; par ce je ne sais quoi de nerveux, de ramassé, qui est en elle, et qui se détend, tout à coup, qui jaillit ; par une force impérieuse et supérieure, qui s'impose, maîtrise, subjugue.
Possédant aussi la clarté, la précision, la logique, qualités bien françaises, elle est l'expression dramatique la plus parfaite, la plus pure, du génie latin.
C'est dans le sillon lumineux qu'elle a ouvert, que d'autres maîtres se sont élancés, que d'autres œuvres, les plus remarquables, les plus belles de ces trente dernières années, ont surgi, s'inspirant de la même esthétique, de la même netteté, de la même clarté : d'abord, la belle partition le Roi d'Ys de Lalo, puis Manon et Werther de Massenet, enfin, la séduisante Louise de Charpentier...
***
Georges Bizet avait été décoré de la Légion d'honneur, au commencement de l'année 1875. Il faisait partie de la promotion du 1er janvier, mais cette promotion, ayant été retardée, pour je ne sais quel motif, ne parut à l'Officiel que vers la fin du mois suivant, dans la seconde quinzaine de février.
Ce ne fut donc que pendant les dernières répétitions de Carmen, — quelques jours avant la première, — que le Maître arbora le ruban rouge.
Après la mort de Bizet, le Conseil municipal de Paris, à la demande de plusieurs de nos confrères de la Presse Artistique, voulant glorifier le souvenir du jeune Maître si prématurément ravi à notre admiration, a donné son nom à une rue de Paris. Cette rue — rue Bizet — se trouve dans le XVIe arrondissement, à Passy, quartier des Bassins ; elle a 300 mètres de longueur et s'amorce, d'un côté, à l'avenue Marceau, de l'autre, au n° 56 de l'avenue d'Iéna...
Il existe peu de portraits de Georges Bizet.
Le premier en date se trouve à Rome, dans la salle à manger de la villa Médicis.
On sait que, sur les murs de cette salle à manger, s'alignent les portraits des pensionnaires, et que ces portraits sont généralement l'œuvre du peintre lauréat de l'année, qui devient ainsi l'historien à la fresque de ses camarades de la Villa. Souvent ces portraits ne sont que des ébauches plus ou moins poussées ; c'est le cas du portrait de Georges Bizet, que le grand prix de peinture de l'année 1857, Sellier, n'avait pas eu le temps de terminer.
Il existe un autre portrait de Bizet jeune homme, peint, à Rome, à la même époque, par Giacomotti. Ce portrait, qui était la propriété du vieux père de Georges Bizet, a figuré en 1883 à la première exposition des portraits du Siècle, à l'École des Beaux-Arts.
Vient ensuite l'admirable buste de Paul Dubois, qui nous montre le musicien dans sa maturité, tel qu'il était au moment de sa mort. Ce buste, qui a été fait de souvenir après la mort de Bizet, est un chef-d'œuvre de vie, de ressemblance. Il a été exécuté en marbre pour le foyer de l'Opéra-Comique, coulé en bronze pour le tombeau du Père-Lachaise.
Je signalerai aussi l'excellente photographie d'Étienne Carjat. C'est la seule qui reproduise les traits de Bizet au moment de Carmen, c'est-à-dire à la veille de sa mort...
On a très peu écrit sur Bizet disions-nous, dans la première édition de cet ouvrage. En dehors des articles de journaux rendant compte de ses différentes œuvres et des articles nécrologiques, nous ne pouvions signaler, à cette époque, que deux études, assez incomplètes, quoique fort intéressantes en raison des fragments de correspondance qu'elles renferment : Georges Bizet, Souvenirs et correspondances de M. Edmond Galabert, et l'étude que Marmontel consacra au Maître, dans son ouvrage Symphonistes et Virtuoses.
Depuis cette époque, quelques publications nouvelles sont venues apporter leur intéressante contribution. Ce sont : la brochure de M. Camille Bellaigue, publiée à la librairie Delagrave, brochure offerte par l'auteur et l'éditeur aux souscripteurs du monument de Georges Bizet ; Portraits et Etudes, suivis de Lettres inédites de Georges Bizet (Paris, Fischbacher, 1894) qui contient les lettres de Bizet à Paul Lacombe ; Les Lettres de Georges Bizet (Impressions de Rome ; 1857,1860, La Commune, 1871). Ces lettres, publiées par la Revue de Paris, ont été réunies en volume et publiées, par la librairie Calmann-Lévy, avec une préface de Louis Ganderax ; enfin : Lettres à un ami (1865-1872), avec une introduction de M. Edmond Galabert, également publiées par la maison Calmann-Lévy. Ce dernier ouvrage complète heureusement la brochure Georges Bizet, Souvenirs et Correspondance, que nous avons souvent citée.
M. Arthur Pougin, dans le supplément à la Biographie générale des Musiciens, de Fétis, a consacré un long article à Georges Bizet. Parmi les articles nécrologiques les plus intéressants, nous citerons ceux de Victor Wilder au Ménestrel, de Reyer aux Débats, de Joncières à la Liberté, de J. Weber au Temps, et de B. Jouvin au Figaro. N'oublions pas aussi l'article d'Albert Wolff, publié au Figaro, le 20 avril 1883, deux jours avant l'éclatante reprise de Carmen. Cet article est devenu l'un des chapitres les plus intéressants de la Gloire à Paris, le dernier volume du célèbre chroniqueur.
VOCALES ET INSTRUMENTALES
DE
GEORGES BIZET
OPÉRAS (Choudens, éditeur)
les Pêcheurs de perles, opéra en trois actes, paroles de Michel Carré et Cormon.
la Jolie fille de Perth, opéra en quatre actes, paroles de de Saint-Georges et J. Adenis.
Djamileh, opéra-comique en un acte, poème de Louis Gallet.
l'Arlésienne, drame en trois actes, d'Alphonse Daudet.
Carmen, opéra-comique en quatre actes, paroles de Henri Meilhac et Ludovic Halévy.
CHANT ET PIANO
Recueil de vingt mélodies (Choudens, éditeur) : 1° Chanson d'avril. — 2° le Matin. — 3° Vieille chanson. — 4° Adieux de l'hôtesse arabe. —5° Rêve de la bien-aimée. — 6° J'aime l'amour. — 7° Vous ne priez pas. — 8° Ma vie a son secret. — 9° Pastorale. — 10° Sérénade. — 11° Berceuse. — 12° la Chanson du fou. — 13° Absence. — 14° Douce mer. — 15° Après l'hiver. — 16. la Coccinelle. — 17° Chant d'amour. — 18° Je n'en dirai rien. — 19° l'Esprit saint. — 20° Tarentelle.
Feuilles d'album : Six mélodies (Heugel et Cie, éditeurs) : 1° A une fleur. — 2° Adieux à Suzon. — 3° Sonnet de Ronsard. — 4° Guitare. — 5° Rose d'amour. — 6° le Grillon.
MUSIQUE D'ORCHESTRE
l'Arlésienne (Suite d'orchestre) : Prélude. — Menuet.— Adagietto. — Carillon (Choudens, éditeur).
Patrie (ouverture dramatique) (Choudens, éditeur).
Petite Suite d'orchestre (Nos 2, 3, 6, 11 et 12 des Jeux d'Enfants) (Durand-Schœnewerk, éditeur).
PIANO (œuvres originales)
les Chants du Rhin (Six lieder pour piano) (Heugel et Cie, éditeurs). 1° l'Aurore. — 2° le Départ. — 3° les Rêves. — 4° la Bohémienne. — 5° les Confidences. — 6° le Retour.
Venise, romance sans paroles (Choudens). — la Chasse fantastique, caprice (Heugel). — Marine. — Variations chromatiques. — Nocturne (Hartmann). Ces trois dernières pièces sont aujourd'hui la propriété de la maison Heugel.
PIANO (transcriptions)
Partitions transcrites pour piano solo (Heugel) : Don Juan, de Mozart. — l'Oie du Caire, de Mozart. — Mignon, d'A. Thomas. — Hamlet, d'A. Thomas.
Six transcriptions chorales pour piano seul (Choudens) : 1° Faust, chœur des Soldats. — 2° Ulysse, chœur des Servantes. — 3° Ulysse, chœur des Porchers. — 4° Philémon et Baucis, chœur des Bacchantes. — 5° la Reine de Saba, chœur des Sabéennes. — 7° Mireille, chœur des Magnanarelles.
Six transcriptions sur Mignon, d'Ambroise Thomas (Heugel) : 1° Danse bohémienne. — 2° Romance de Mignon. — 3° Duo des Hirondelles. — 4° Adieu, Mignon, mélodie. — 5° Polonaise de Philine. — 6° O Printemps, mélodie.
Six transcriptions sur Don Juan, de Mozart (Heugel) : 1° Duettino : La ci darem la mano. — 2° Air de Zerline : Batti, batti. — 3° Trio des Masques. — 4° Sérénade. — 5° Air de Zerline : Vedrai carino. — 6° Air d'Ottavio : Il mio tesoro.
le Pianiste chanteur (Heugel). Six séries de transcriptions, 150 morceaux ; 1re et 2e séries : les Maîtres Français. — 3e et 4e séries : les Maîtres Italiens. — 5e et 6e séries : les Maîtres Allemands.
PIANO A QUATRE MAINS (œuvres originales)
Jeux d'Enfants, douze pièces pour piano à quatre mains (Durand-Schœnewerk) : 1° l'Escarpolette, rêverie. — 2° la Toupie, impromptu. — 3° la Poupée, berceuse. — 4° les Chevaux de bois, scherzo. — 5° le Volant, fantaisie. — 6° Trompette et Tambour, marche. —7° les Bulles de savon, rondino. — 8° les Quatre Coins, esquisse. — 9° Colin-Maillard, nocturne. — 10° Saute-mouton, caprice. — 11° Petit mari, petite femme, duo. — 12° le Bal, galop.
PIANO A QUATRE MAINS (transcriptions)
Partitions transcrites à quatre mains : Faust, de Ch. Gounod (Choudens). — Mignon, d'A. Thomas (Heugel). — Hamlet, d'A. Thomas (Heugel).
Don Juan ; ouverture à quatre mains (Heugel). — Patrie, ouverture à quatre mains (Choudens). — 1re Symphonie, de Ch. Gounod, réduite à quatre mains (Colombier). — Méditation de Ch. Gounod sur le premier prélude de Bach, à quatre mains (Heugel).
Douze transcriptions concertantes, 3e et 4e séries de l'Art du chant de S. Thalberg (Heugel). — Nos : 13 Sérénade, du Barbier de Séville (Rossini). — 14 Duo, de la Flûte enchantée (Mozart). — 15 Barcarolle, de Giani di Calais (Donizetti). — 16 Trio des Masques et duetto, de Don Juan (Mozart). — 17 Sérénade, de l'Amant jaloux (Grétry). — 18 Romance du Saule, d'Othello (Rossini). — 19 Casta diva, cavatine de Norma (Bellini). — 20 Mon cœur soupire, des Noces de Figaro (Mozart). — 21 Quatuor d'Euryanthe (Weber). — 22 David sur le rocher blanc (air gallois). —23 Chanson et chœur, des Saisons (Haydn). — 24 Fenesta vascia (chanson napolitaine).
Neuf transcriptions à quatre mains sur Hamlet, d'A. Thomas (Heugel) : 1° Prélude de l'Esplanade. — 2° Marche Danoise. — 3° Valse d'Ophélie. — 4° Danse villageoise. — 5. Pas des chasseurs. — 6° Pantomime. — 7° Valse-Mazurke. — 8° Pas du bouquet. — 9° Bacchanale.
Six études en forme de canon, pour piano à pédales, de R. Schumann, transcrites pour piano à quatre mains (Durand-Schœnewerk).
ŒUVRES POSTHUMES (Choudens, éditeur)
Noé (partition piano et chant). Opéra biblique en trois actes et quatre tableaux, poème de de Saint-Georges, musique d'Halévy et Georges Bizet.
Mélodies (2e recueil, piano et chant), fragments retrouvés depuis la mort du Maître.
Vasco de Gama. Ode symphonique (partition orchestre).
Roma. Symphonie (partition orchestre) : 1° Introduction-Allegro. — 2° Andante. — 3° Scherzo. — 4° Carnaval.
Marche funèbre (partition orchestre), prélude de la Coupe du roi de Thulé.
Don Procopio. Opéra bouffe en deux actes, version française de MM. Paul Berel et Paul Collin ; récitatifs de M. Charles Malherbe.

Jeux d'enfants : le Volant (fragment), manuscrit de Georges Bizet
TABLE DES MATIÈRES
I. Les premières années. — Le Conservatoire.
II. Rome. — Les Envois. — Don Procopio.
III. Le Retour. — Les premiers travaux. — Bizet wagnérien.
V. Ivan le Terrible. — Période fiévreuse. — Nouvelle incursion au pays de l'Opérette.
VII. Bizet critique. — Noé. — Musique de piano. — Concours de la Coupe du Roi de Thulé.
XI. De 1873 à 1875. « Patrie ! » Ouverture.
XVIII. Œuvres diverses. — Œuvres posthumes.