
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE
Publiés sous la Direction de PAUL LANDORMY
CARMEN
DE BIZET
Étude historique et critique
Analyse Musicale
par
CHARLES GAUDIER
Professeur agrégé des Lettres au Lycée Janson-de-Sailly
Paris, Librairie Delaplane
Paul MELLOTTÉE, éditeur
48, rue Monsieur-le-Prince
1922
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE
Publiés sous la Direction de PAUL LANDORMY
EN VENTE :
Faust de GOUNOD, par Paul Landormy, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur agrégé de l'Université. 1 vol. in-18 raisin, broché.
Samson et Dalila de SAINT-SAËNS, par Henri Collet, docteur ès lettres, compositeur de musique. 1 vol. in-18 raisin, broché.
Louise de CHARPENTIER, par André Himonet, critique musical. 1 vol. in-18 raisin, broché.
Manon de MASSENET, par Joseph Loisel, professeur agrégé au Lycée Rollin. 1 vol. in-18 raisin, broché.
Carmen de BIZET, par Charles Gaudier, professeur agrégé des Lettres au Lycée Janson-de-Sailly. 1 vol. in-18 raisin, broché.
EN PRÉPARATION :
La Tosca de PUCCINI, par Jean Belime, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur agrégé de l'Université. 1 vol. in-18 raisin, broché.
La Damnation de Faust de BERLIOZ.
La Walkyrie de RICHARD WAGNER.
Lohengrin de RICHARD WAGNER.
Pelléas et Mélisande de CLAUDE DEBUSSY.
Les Symphonies de BEETHOVEN.
AVANT-PROPOS
Dans l'enseignement de la littérature l'explication des auteurs tient une place considérable. Pourquoi un texte musical ne serait-il pas « expliqué » à la façon d'un texte de prose ou de poésie ? Pourquoi Faust ou la Walkyrie ne donneraient-ils pas lieu à des commentaires du même ordre que ceux dont le Cid ou Andromaque furent si souvent l'occasion ?
On comprend la pensée qui inspira l'entreprise de celle collection.
Voici de petits volumes dont chacun est consacré à l'élude d'un des Chefs-d'œuvre de la Musique.
Ils seront tous conçus sur le même plan.
On y trouvera une biographie de l'auteur, des indications historiques sur la genèse de l'œuvre, une analyse littéraire (s'il y a lieu) et une analyse musicale avec de nombreuses citations à l'appui, enfin un memento bibliographique.
En publiant ces Guides de l'amateur au théâtre et au concert on espère servir à la fois les intérêts du grand public et ceux de la Musique elle-même.
PAUL MELLOTTÉE, éditeur.
Les citations musicales de cet ouvrage sont empruntées à la partition chant et piano de Carmen éditée par la maison CHOUDENS, 30, boulevard des Capucines, Paris.
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.
Copyright 1922, by Paul MELLOTTÉE.
CARMEN
Table des matières
II. EVOLUTION MUSICALE DE BIZET
III. « CARMEN » : HISTOIRE DE L'ŒUVRE
IV. LE LIVRET
I
LA VIE DE BIZET
La vie de Bizet fut courte, simple et tout unie. Après des succès précoces et une entrée triomphale dans la carrière musicale, il mena une existence de labeur incessant, soit qu'il dût assurer sa vie matérielle par des travaux subalternes, soit qu'il eût la fièvre et la joie d'une création artistique presque ininterrompue. Cette brève existence ne fut pas malheureuse, car Bizet était d'humeur gaie et eut l'orgueil de voir ses œuvres sollicitées, attendues, escomptées, la satisfaction de se savoir encouragé, apprécié par ses maîtres et ses amis. Toutefois il eut continuellement à souffrir les sarcasmes d'une critique acerbe, mesquine et sotte ; si bien qu'on ne sait pas encore au juste si sa mort prématurée ne fut pas la conséquence d'une cruelle déception, et comme la chute d'un grand essor.
Premières années de Bizet. — Georges Bizet (sur les registres de l'état civil, ses prénoms sont Alexandre-César-Léopold) naquit à Paris le 25 octobre 1838. Son père enseignait le solfège et le chant ; sa mère, bonne pianiste, était la belle-sœur de Delsarte, alors le plus fameux des professeurs de chant.
L'on raconte que Georges fut initié par sa mère à la musique en même temps qu'à l'alphabet, et qu'il apprit le solfège en écoutant a travers les portes les leçons de son père. A neuf ans, il possédait si bien le piano et l'harmonie que son père n'avait plus rien à lui enseigner, et le faisait admettre, malgré sa jeunesse, comme auditeur, au Conservatoire, dans la classe de Marmontel. En 1849, il a un premier prix de solfège, et on le présente comme un prodige au vieux Zimmermann, élève de Cherubini et héritier de ses traditions, qui avait été un excellent professeur de fugue et de contrepoint, et qui, resté seulement professeur de piano au Conservatoire, enseignait la fugue chez lui.
Soit avec Zimmermann, soit avec son suppléant, le jeune Charles Gounod, Bizet travailla la technique musicale, sans négliger le piano, puisqu''en 1851 il remporte un second prix, en 1852 un premier prix, dans la classe de Marmontel. En 1854, nous lui voyons attribuer deux seconds prix d'orgue et de fugue, en 1855 deux premiers prix. Réclamé, accueilli avec ravissement par Halévy, dès 1853, dans sa classe de composition, il concourt en 1856 pour Rome, et se place, avec sa cantate David, en tête des concurrents : mais, vu sa jeunesse, il n'a que le second grand prix. En 1857, enfin, avant d'avoir accompli sa dix-neuvième année, il obtient la première récompense pour sa cantate Clovis et Clotilde, que le public acclame, le 3 octobre, à la séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts. Entre temps, à l'insu de ses maîtres, il avait trouvé le moyen d'écrire et de présenter au concours d'opérette, organisé par Offenbach, directeur des Bouffes-Parisiens, le Docteur Miracle, qui lui valut un premier prix ex æquo avec Charles Lecocq, et qui fut joué avec succès au printemps de 1857.
Bizet à Rome (janvier 1858 - août 1861). —Le séjour à Rome et les voyages en Italie qu'il permit, furent une des grandes joies de la vie de Bizet. Nous avons l'écho de cette joie dans ses Lettres de Rome, qui ont été recueillies : joie de voir le Midi, la mer, la nature, « chose tellement inconnue pour moi qu'il m'est impossible d'analyser les impressions que je ressens » (29 décembre 1857) ; joie de voir en Italie « une architecture horrible, des églises peintes comme des monuments de carton » (4 janvier 1858) ; joie de voir Florence, « un paradis », et de découvrir Raphaël, Andrea del Sarto ; mais joie mitigée par la constatation que l'Italie n'est plus qu'un passé resplendissant : « Pas un homme de talent, ni musicien, ni poète, ni peintre, absolument rien. Il est curieux de voir un pays si glorieux tomber dans un abrutissement pareil » (19 janvier 1858). Déception devant Rome, « pays complètement perdu pour l'art », et devant ses cérémonies religieuses, « d'indignes farces », mais extase en présence de Michel-Ange, et volupté de vivre sans soucis, avec de bons camarades, sous un ciel radieux, devant l'unique panorama de la Ville Eternelle, de la campagne romaine et des monts Sabins.
Joie surtout de composer. On peut dire qu'alors la musique ou les ébauches musicales jaillissent de lui comme une sève exubérante. Il commence par un Te Deum, qui n'obtient pas le prix Rodrigues en 1858. Son premier envoi officiel à l'Institut est une farce, Don Procopio, dans le genre du fameux Don Pasquale de Donizetti, et où le rapporteur de l'Académie, Ambroise Thomas, voit « une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi, une propension marquée vers le genre comique », tout en regrettant (dans un message officieux adressé à Bizet, personnellement) que le jeune auteur n'ait pas composé la Messe réglementaire, car « les natures les plus enjouées trouvent dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes un style indispensable même dans les productions légères ». Ce Don Procopio, retrouvé en 1895 dans les papiers d'Auber, et réclamé par Weckerlin pour la bibliothèque du Conservatoire, a été mis au point par Charles Malherbe, et joué, non sans succès, le 6 mai 1906, sur la scène de Monte-Carlo.
Le deuxième envoi de Rome (1860) était un Vasco de Gama, vaste symphonie descriptive avec chœurs, d'après Camoens. Le troisième (1861) est une Suite d'Orchestre (Scherzo, Andante et Marche Funèbre), qui fut exécutée à la séance solennelle de la distribution des prix avec un vif succès. Le Scherzo devait plus tard entrer définitivement dans la symphonie Souvenirs de Rome (1869) et le thème de la Marche Funèbre accompagner l'entrée de Leïla, au 3e acte des Pêcheurs de Perles. A côté de ces envois, que d'ébauches, d'esquisses, de projets ! C'est une Esmeralda, d'après V. Hugo, un Amour Peintre, d'après Molière, un Chant Séculaire, d'après Horace, et, chose curieuse, un Tonnelier de Nuremberg, d'après Hoffmann, avec le concours de chant que Wagner devait illustrer dans les Maîtres Chanteurs (le poème de Wagner est de 1861-62 ; la partition de 1867). Rien de tout cela ne fut réalisé, mais le jeune cerveau de Bizet était toujours en ébullition ; son activité, son ingéniosité, ses velléités donnaient les plus légitimes espérances, et Edmond About, qui le fréquentait à Rome, lui disait dès avril 1858 : « Si vous ne prenez pas une des plus belles places du monde musical, vous démentirez évidemment toutes les chances et toutes les prévisions. » About était un peu plus clairvoyant que le vieux « podagre » (comme aurait dit Berlioz) Carafa ; celui-ci, qui, en même temps qu'Halévy, enseignait la composition au Conservatoire, avait remis à Bizet une lettre d'introduction auprès de Mercadante, le dieu de la musique italienne. Avant de se présenter chez Mercadante, à Naples, Bizet ouvrit la lettre et lut cet étrange compliment : « Monsieur Bizet, malgré ses premières récompenses, ne sera jamais un compositeur dramatique, parce qu'il n'a pas d'enthousiasme pour un sou. » (Lettre de Bizet, 19 janvier 1860.)
Bizet compositeur (1862-1875). — Revenu à Paris pour voir mourir sa mère, en septembre 1861, Bizet se trouva pour la première fois en face des tracas matériels de la vie et aux prises avec la nécessité de gagner son pain. Il eut, heureusement, moins de misères et d'avanies que le Jean-Christophe à Paris de M. Romain Rolland.
Il aurait pu être pianiste, car il était extraordinairement doué. Enfant, il avait, au dire de Marmontel, le brio, l'éclat, la fougue ; puis, il s'était heureusement modifié, et, tout en restant « virtuose habile, intrépide lecteur », il avait acquis « une sonorité ample, une variété de timbres et de nuances, qui donnait à son jeu un charme inimitable,... un toucher suave et persuasif ». Berlioz (Journal des Débats, 8 octobre 1863) affirme qu'il était un incomparable déchiffreur, qu'aucune réduction d'orchestre au piano, à première vue, ne l'arrêtait, et que, depuis Mendelssohn et Liszt, on avait vu peu de lecteurs de sa force. Reyer avoue (Journal des Débats, 13 juin 1875) n'avoir jamais connu de musicien qui fût plus sûr de lui, et d'une mémoire aussi prodigieuse. Il paraît qu'un soir de 1861, chez Halévy, Liszt exécuta une de ses récentes œuvres inédites avec une effarante virtuosité, et déclara qu'il ne connaissait que deux pianistes capables de la jouer : Hans de Bulow et lui-même. Bizet reproduisit de mémoire le passage le plus curieux et le plus difficile, puis joua tout le morceau sur le manuscrit, sans une hésitation, sans une défaillance. Liszt conclut que le plus audacieux et le plus brillant des trois pianistes capables d'un tel tour de force était le plus jeune, Bizet.
Mais l'opinion publique, ni celle des confrères, n'est favorable à ceux qui veulent être à la fois auteurs et interprètes ; aussi Bizet renonça-t-il aux succès pianistiques pour se vouer à la composition ; mais, comme il fallait vivre, il se mit gaiement à un métier, qui n'était qu'un jeu pour lui, un jeu fastidieux : la transcription musicale ; il fournit ainsi à l'éditeur Heugel les trois séries du Pianiste Chanteur, d'après les opéras célèbres ; plus tard il réduira au piano Mignon, Hamlet, et d'autres partitions.
Il composait, à titre d'ancien prix de Rome, un acte pour l'Opéra-Comique, la Guzla de l'Emir, sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier, quand le directeur du Théâtre-Lyrique, Carvalho, très dévoué aux jeunes, et riche d'une subvention de cent mille francs que lui accordait le ministère des Beaux-Arts à condition de monter chaque année l'œuvre d'un nouveau venu, lui confia un livret de Carré et Cormon : les Pêcheurs de Perles. Bizet se hâta, et son œuvre fut jouée le 29 septembre 1863 ; elle surprit un peu par ses néologismes, fit acclamer l'auteur, qui vint saluer sur la scène après le dernier acte, mais déclencha les sarcasmes de la presse, laquelle fut acerbe pour ce jeune homme de vingt-cinq ans et pour la « nouvelle école ». Si Berlioz trouvait dans les Pêcheurs un riche coloris, d'autres croyaient constater une analogie indiscrète avec certains effets mélodiques de Félicien David ; quelques-uns renvoyaient Bizet à Wagner, d'autres à... Grisar. Au total, dix-huit représentations. La même année, le 11 janvier 1863, le brave Pasdeloup avait offert au public des Concerts Populaires le Scherzo, envoi de Rome, et le public avait sifflé ; mais huit jours après, le même Scherzo était accueilli favorablement à la Société nationale des Beaux-Arts.
Déçu, mais non découragé, Bizet entame aussitôt un grand opéra en cinq actes et dans le style dramatique de Verdi : Ivan le Terrible ; la partition terminée, reçue au Lyrique, est retirée, puis brûlée par son auteur en 1865. Tout en faisant ses réductions pour piano et en orchestrant de la musique de danse, avec, pour se venger, « un orchestre plus canaille que nature », Bizet publie quelques mélodies, et bâcle en six mois la Jolie Fille de Perth, dont il est ravi, mais dont le public du Lyrique fut un peu moins satisfait, puisqu'elle n'eut, à partir du 26 décembre 1867, que vingt et une représentations.
Un moment, Bizet touche à la critique musicale, dans la Revue Nationale et Etrangère, où, sous la direction de Crépet, collaboraient Baudelaire, Laboulaye, Jules Ferry, Henri Brisson. Après un article, qui parut le 3 août 1867, signé du pseudonyme Gaston de Betzi, Bizet se retire, parce qu'il n'avait pas le droit d'éreinter le critique Azevedo, et parce qu'on lui demandait quelques coupures dans un article sur Saint-Saëns. Il revient et à son métier et à ses travaux, termine et orchestre Noé, l'opéra-biblique de feu son maître Halévy, essaie une Coupe du Roi de Thulé, publie quelques compositions pour piano. Sa plus grande préoccupation, entre 1867 et 1869, est la symphonie Souvenirs de Rome, qui fut exécutée par l'orchestre Pasdeloup le 28 février 1869, et accueillie par les applaudissements du public, le silence de la presse. Toutefois, Bizet avouait à Saint-Saëns qu'il était plus doué pour le théâtre que pour la symphonie ou la musique de chambre.
Après son mariage avec Geneviève Halévy, la fille de son maitre (3 juin 1869), Bizet travaille avec plus d'acharnement encore : il médite un Calendal, une Grisélidis, une Clarisse Harlowe ; il ébauche même, mais n'achève pas. Il écrit la charmante partition de Djamileh, pour les nouveaux directeurs de l'Opéra-Comique, du Locle et de Leuven, qui voulaient renouveler leur répertoire et rajeunir le genre « éminemment national » en y mêlant un peu de poésie, de rêverie et de symphonie. Représentée le 22 mai 1872, Djamileh n'eut que dix représentations ; mais cette fois Bizet a « la certitude absolue d'avoir trouvé sa voie », d'autant qu'il est discuté et approuvé par la critique intelligente, raillé et bafoué par les sots.
Carvalho veillait toujours sur Bizet. Ayant quitté le Lyrique pour le Vaudeville, il n'oubliait pas la musique, et rêvait de restaurer l'ancien mélodrame, l'opéra sans chanteurs, où la symphonie tour à tour forme un cadre au spectacle, et révèle l'âme des acteurs, l'Egmont de Beethoven ou le Manfred de Schumann. De cette fantaisie est éclose l'Arlésienne, qui fut jouée le 1er octobre 1872. Le public ne fut pas sensible au coloris ni au pathétique du drame d'Alphonse Daudet ; il n'entendit pas ou n'apprécia pas l'exquise partition de Bizet, parfois si resplendissante de lumière et de verve, souvent si mélancolique et si touchante. Quinze représentations. Mais la critique était conquise, et, en appelant des spectateurs du Vaudeville aux habitués des concerts dominicaux, Bizet faisait acclamer ses Suites sur l'Arlésienne chez Pasdeloup, chez Colonne et au Conservatoire.
Le 3 mars 1875, c'est Carmen dont nous dirons l'histoire dans un chapitre spécial. Malgré d'étranges discussions, de singulières incompréhensions et de sottes malveillances, Bizet était le musicien dramatique le plus en vue de cette époque où Massenet n'avait encore donné à la scène que Don César de Bazan (1872) et les Erynnies (1873), où Lalo songeait seulement à son Roi d'Ys.
Mort de Bizet. — Le 3 juin 1875 au matin, trois mois exactement après la première de Carmen, Paris apprenait avec le plus douloureux émoi une nouvelle effroyable : Bizet venait de mourir subitement, pendant la nuit, dans sa villa de Bougival oh il allait passer l'été avec sa femme et son fils.
Le mystère de cette mort brutale n'a pas été complètement élucidé. On a parlé d'embolie, d'œdème de la glotte. Bizet étant sujet périodiquement à de bizarres angines, à des ulcérations de la gorge — il en est souvent question dans les lettres de Rome et dans les lettres de 1865 à 1874 — on a pu croire aussi à un phlegmon. Les oppressions et les suffocations qui, la veille et la nuit de sa mort, le tourmentèrent, permettent de diagnostiquer un accident cardiaque. Bizet avait-il une maladie de cœur ? c'est probable. Et dans ce cas, l'injustice dont on fit preuve envers Carmen lui porta-t-elle le coup fatal ? c'est possible. On en est réduit aux conjectures, car Bizet avait une foncière bonne humeur, le sentiment précis de sa valeur, une vaillante énergie, beaucoup de ressort ; la discussion l'affermissait plus qu'elle ne l'abattait, et l'on peut douter qu'il ait pris au tragique quelques ineptes propos, et une mésentente avec le public, qui, au surplus, ne devait pas durer, puisqu'à l'heure même où il mourait s'achevait la trente-troisième représentation de Carmen, et que l'étranger lui demandait de traiter.
Les obsèques eurent lieu le 5 juin à la Trinité ; Pasdeloup et son orchestre collaboraient à la cérémonie. L'inhumation provisoire fut faite au cimetière Montmartre, où des discours furent prononcés par Jules Barbier et du Locle, quelques mots par Gounod. L'année suivante, le 10 juin 1876, était inauguré, au Père-Lachaise, le très simple monument de Charles Garnier, surmonté du buste de Bizet, par Paul Dubois. Maintes admiratrices de Carmen y viennent encore déposer d'humbles bouquets de violettes...
L'homme. — Tous ceux qui ont fréquenté Bizet sont d'accord sur sa valeur morale. Ce gros garçon réjoui, ardent, enthousiaste, était un bourreau de travail ; il avait une âme naïve, tendre et pure. Sa correspondance avec ses élèves, Edmond Galabert et Paul Lacombe, le montre parfois plein d'indulgence et d'illusions, toujours complaisant et dévoué. Il a le mépris de tout ce qui est intéressé et bas, et malheureusement il discerne pas mal de vilenie dans le monde de la musique, ne fût-ce qu'au Conservatoire, où les professeurs de chant ne font que du « chantage » avec leurs élèves. Il voudrait, dit-il, « remoraliser les arts ». Il a peut être, écrit-il à Mme Halévy, en 1871, un « caractère peu flexible », mais il a « peu d'affection pour ce qu'on appelle le monde, et moins d'estime que d'affection ». Ce qu'on nomme « honneurs, dignités, titres lui causerait un profond dégoût, si cela ne lui était profondément indifférent ».
Son maître, admirateur et ami, Marmontel, a laissé de ses qualités morales l'éloge le plus ému et le plus touchant : il avait, dit-il, « les nobles et généreuses qualités du cœur, l'élévation et la délicatesse des sentiments. D'un jugement sain et droit, d'une conscience rigide, Bizet ignorait les compromis ; il avait au suprême degré le sentiment du juste et l'horreur de l'intrigue. Bizet était bon, généreux, dévoué, fidèle à toutes ses affections ; son amitié, sincère et inaltérable, était solide comme sa conscience ».
II
L'ÉVOLUTION MUSICALE DE BIZET (DU PRIX DE ROME A « CARMEN »)
« Je tiens ma voie ; maintenant, en marche ! Il faut monter, monter, monter toujours ! » (Lettre à Edmond Galabert, octobre 1867.)
Nous avons vu Bizet, dès son arrivée à Rome, « marquer une propension » pour le genre comique et y manifester, au dire d'Ambroise Thomas, « une touche aisée et brillante ». Bizet avait commencé, là-bas, par manquer un Te Deum destiné au concours Rodrigues ; « c'est difficile en chien, c'est difficile en diable », s'écrie-t-il dans ses lettres, « je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse » (17 avril 1858). « Je suis décidément fait pour la musique bouffe et je m'y livre complètement » (25 juin 1858).
Malgré ce départ, et quelques retours accidentels à la plaisanterie musicale, Bizet n'avait pas cette humble vocation. Nous allons voir par ses œuvres, et surtout par sa correspondance, que son goût musical ne cessa d'évoluer, et de la façon la plus heureuse, jusqu'à Carmen, son chef-d'œuvre.
Bizet et la musique italienne. — Dans ses lettres de Rome, il se confie à sa mère avec une parfaite bonhomie et sans aucune dissimulation. Certain de sa facilité, il n'en fait pas prétexte à vantardise, et ne se croit pas arrivé avant d'avoir tenté. Il s'observe, il observe les autres, il étudie, il travaille. Un des premiers progrès qu'il constate en lui, c'est qu'il n'est plus un simple improvisateur, incapable de revenir sur l'œuvre écrite de premier jet, de « recommencer ». Il fait bon marché de son habileté et de sa « triture musicale » et ne veut rien faire sans « idée ». Son idéal, d'ailleurs, n'est pas encore très élevé : « Mozart et Rossini, écrit-il le 8 octobre 1858, sont les deux plus grands musiciens. Tout en admirant de toutes mes forces Beethoven et Meyerbeer (!), je sens que ma nature me porte plus à aimer l'art pur et facile que la passion dramatique . . . Raphaël est le même homme que Mozart ; Meyerbeer sent comme sentait Michel-Ange. » Sourions en passant de l'accouplement Beethoven-Meyerbeer, et de la comparaison Meyerbeer-Michel-Ange. Il fut un temps où, en France, l'auteur des Huguenots passait pour un penseur et un musicien, pour le maître puissant du pathétique. Bizet viendra bientôt à résipiscence ; et déjà à celle époque il voit en Verdi « un homme de génie, mais engagé dans la plus déplorable route qui fut jamais ».
En 1858, toutefois, Bizet a un penchant pour le gracieux ; il avoue (lettre du 31 décembre 1858) préférer nettement Raphaël à Michel-Ange, Mozart à Beethoven, Rossini à Meyerbeer. Sans doute il admire le Jugement dernier, la Symphonie Héroïque et ... le quatrième acte des Huguenots, mais n'est complètement heureux, n'éprouve un bien-être, une satisfaction complète qu'aux toiles de Raphaël, aux Noces de Figaro, et au... second acte de Guillaume Tell. Verdi a « des élans de passion merveilleux », mais il lui manque « la qualité essentielle qui fait les grands maîtres : le style ». Avec les semaines, Rossini grandit de plus en plus : il devient même « le plus grand de tous » ; il a toutes les qualités : « l'élévation, le style, et enfin le motif » (19 mars 1859). Par motif, Bizet veut dire « l'idée », et il répète sans cesse que, dorénavant, il ne veut plus rien faire « de chic », mais « avoir des idées avant de commencer un morceau », avoir surtout une entière franchise d'inspiration, et non écrire « pour ménager la chèvre et le chou ».
Chemin faisant, ses découvertes se multiplient : voici Gounod, qui, après Faust, est « le musicien le plus extraordinaire que nous ayons maintenant. (excepté Rossini et Meyerbeer) et le plus complet des compositeurs français (octobre 1859). Tandis que Verdi dégringole, « le Bal Masqué : c'est infect », Gluck apparaît : « Orphée ! quelle merveille ! » Les vieux musiciens superficiels et simplets l'ennuient : Boieldieu et Niccolo « n'existent pas pour lui » ; Haydn l'endort ainsi que Grétry. En revanche Mozart l'émeut, agit directement sur lui, le rend malade, et, les jours de sirocco ou de nervosité, il ne peut toucher à Don Juan, aux Noces, ni à Cosi fan tutte (23 juin 1860).
Telles sont les préférences et les idées de Bizet, autour de la vingtième année : il se proposerait volontiers comme idéal un italianisme délicat, rapproché de Mozart. Tel il se montre dans ce Scherzo envoyé de Rome à l'Institut en 1861, et qui fut sifflé aux concerts Pasdeloup, le 11 janvier 1863 ; pourquoi ? peut-être tout simplement parce que le nom inconnu de Bizet détonnait sur le programme entre ceux de Mozart, d'Haydn et de Beethoven.
Le « wagnérisme » de Bizet. — De 1863 à 1875, Bizet va se voir affublé, stigmatisé, de l'étiquette « wagnérien ». La « rengaine Wagner » lui sera sortie à chaque œuvre nouvelle. Et par qui ? Par des gens à qui certainement Wagner était totalement inconnu, pour qui il était une sorte d'épouvantail, un personnage aussi dangereux (et aussi irréel) que le Putois d'Anatole France. Notons que, en 1863, Wagner était simplement l'auteur de Rienzi (1842), du Vaisseau Fantôme (1843), de Tannhäuser (1845), de Lohengrin (1850). Les Parisiens l'eussent certainement ignoré s'il n'avait été fait grand bruit de l'insuccès des concerts organisés par lui en 1860 à la salle Ventadour, et de la chute de Tannhäuser, sifflé à l'Opéra en 1861, et retiré après trois représentations. Cependant tout musicien « de la jeune école » un peu novateur, un peu ennemi d'Auber, était qualifié de « wagnérien » et le Faust de Gounod avait paru en 1859 une œuvre effroyablement « wagnérienne » à l'ineffable Scudo, le critique de la Revue des Deux Mondes.
Qu'est-ce qu'être « wagnérien » en musique, abstraction faite des théories philosophiques, poétiques et dramatiques de Richard Wagner ? Nous renvoyons le lecteur à la forte et sobre analyse qu'a donnée de l'art wagnérien M. Paul Landormy, dans son Histoire de la musique. Tenons-nous-en à ceci : Wagner, extérieurement, rompt, avec la forme ancienne de l'opéra, composé « de morceaux détachés les uns des autres et recousus tant bien que mal, véritable habit d'Arlequin sans continuité et sans suite », selon l'expression de M. Landormy. Wagner fait (et fera davantage par la suite) un emploi systématique du leitmotiv, c'est-à-dire de motifs, de thèmes caractéristiques, qui circuleront dans tout l'ouvrage, évoluant et vivant, évoquant avec netteté un sentiment ou une idée. Wagner, surtout, veut que la musique soit un perpétuel commentaire du drame : pas de bel canto, ni d'airs de bravoure, ni de morceaux à effet, ni de fioritures, mais une déclamation expressive, toujours appropriée au sentiment ; et un accompagnement orchestral qui ne soit plus une humble et simple guitare, mais une mélodie continue assurant la liaison entre les parties du drame, utilisant pour la traduction de tous les sentiments et l'évocation de l'âme intérieure, que la parole ne peut rendre, le pouvoir suggestif le la symphonie, la variété infinie des timbres et des instruments. Wagner ne sera d'ailleurs en pleine possession de ses ressources que quand il songera à Tristan (1865), aux Maîtres chanteurs (1868) et à la Tétralogie (1876). On se moquait surtout de lui, en France, parce qu'un de ses manifestes portait ce titre : l'Œuvre d'Art de l'Avenir (1849).
Nous ne savons pas au juste de quand date l'initiation de Bizet à Wagner. Apocryphe est l'anecdote racontée par Victorin Joncières, de Bizet assistant au concert Wagner du 25 janvier 1860 à Paris, et répondant aux diatribes de Scudo contre Wagner : « Vous êtes un crétin, voici ma carte », car, ce jour-là, Bizet était à Rome. Incertaine, l'anecdote rapportée par Jouvin, dans le Figaro du 8 octobre 1863 : à Bade, Berlioz, Reyer, Bizet chantaient devant lui les louanges de Wagner, et pour convaincre sa méfiance, Bizet lui aurait dit : « Wagner, c'est Verdi avec du style », au grand dépit de Reyer indigné par cette irrévérencieuse comparaison. Et Bizet se serait excusé : « Il faut bien mentir un peu dans l'intérêt de la bonne cause ! »
Il est bien certain que, jusqu'en 1867, Bizet n'a pas suivi Wagner, et l'a même peu connu. Malgré « une orchestration trop chargée, des harmonies piquantes, et une recherche mal entendue de l'originalité », comme dit alors la critique, en murmurant le mot « wagnérien », les Pêcheurs de Perles de 1863 ne rompent pas avec l'italianisme ni avec l'ancien opéra-comique. Dans la Jolie Fille de Perth (1867), pour le public et, pour la cantatrice Nilsson, à la voix de rossignol, Bizet a écrit des romances langoureuses et des airs à roulades. Il était donc peu wagnérien, et Reyer lui fit grief gentiment, à mots couverts, de son éclectisme, de son style composite. Johannès Weber, le grave critique du Temps, lui reprocha plus crûment de sacrifier à Baal, c'est-à-dire à l'école des conventions et des flonflons. « Lors de l'apparition des Pêcheurs de Perles, ajoute-t-il, je ne fus pas peu surpris d'entendre décrier M. Bizet comme wagnérien. Ce n'est pas sa partition qui m'eût semblé justifier ce reproche. Wagner, c'est Croquemitaine avec qui l'on fait peur aux grands enfants quand ils ne veulent pas goûter aux drogues qu'on veut leur faire avaler. » Et Johannès Weber, à d'autres commentaires ironiques sur la wagnérophobie, ajoutait quelques sarcasmes sur telles roucoulades de la Jolie Fille, « capables de faire fuir M. Richard Wagner jusqu'au fond de la Cochinchine ». Oui, en fait de wagnérisme, Bizet avait fait jusqu'alors des concessions aux traditions, aux habitudes, au mauvais goût, et il en convint, alors, dans une admirable lettre à Weber, qui n'a été publiée par celui-ci que dans le Temps du 15 juin 1875 : « J'ai fait cette fois encore des concessions que je regrette... Je ne crois pas plus que vous aux faux dieux... L'école des flonflons, des roulades, du mensonge, est morte, bien morte ; enterrons-la sans larmes, sans regret, sans émotion, et en avant ! »
Ainsi donc, jusqu'en 1867, Bizet n'apparaît ni wagnérien ni wagnérophile, et il se laisse aller à un italianisme complaisant. Peut-être en voulait-il intérieurement à ses modèles quand il écrivait à Gounod (avril 1863) qu'il déplorait que les lois ne permissent pas l'assassinat de certains musiciens ; et peut-être Gounod traduisait-il sa pensée en répondant : « Elles le permettent, et les lois divines le commandent. Dans vingt ans, Wagner, Berlioz, Schumann compteront bien des victimes. De très illustres sont déjà tombées sous les coups de Beethoven. Voilà un grand assassin. Tâchons d'être dans le camp des assassins. » Cependant, dans cet unique article qu'il écrit le 3 août 1867 pour la Revue Nationale et Etrangère, Bizet l'ait l'apologie de la « musique tout court », qui n'est « ni allemande, ni italienne, ni française ». L'artiste « n'a pas de nom, pas de nationalité ; il est inspiré ou ne l'est pas ; il a du génie ou il n'en a pas... Nommez-vous Rossini, Auber, Gounod, Wagner, Berlioz, Félicien David, ou Pitanchu, que m'importe ? Faites-moi rire ou pleurer..., charmez-moi, éblouissez-moi, transportez-moi, et je ne vous ferai certes pas la sotte injure de vous classer, de vous étiqueter comme des coléoptères ». Suit un éloge de Verdi. Voilà de l'éclectisme.
« Je suis éclectique », telle est la profession de foi de Bizet, et il ajoute (Lettre à Paul Lacombe, 11 mars 1867) : « J'ai vécu trois ans en Italie et je me suis fait non aux honteux procédés musicaux du pays, mais bien au tempérament de quelques-uns de ses compositeurs. De plus, ma nature sensuelles se laisse empoigner par cette musique facile, paresseuse, amoureuse, lascive et passionnée tout à la fois. Je suis allemand de conviction, de cœur et d'âme..., mais je m'égare quelquefois dans les mauvais lieux artistiques. Et, je vous l'avoue tout bas, j'y trouve un plaisir » Cet aveu nous fait quelque peine ; heureusement Bizet l'a corrigé par celui-ci : « Je mets Beethoven au-dessus des plus grands, des plus fameux. La Symphonie avec chœurs est pour moi le point culminant de notre art... Dante, Michel-Ange, Shakespeare, Homère, Beethoven, Moïse. Ni Mozart avec sa forme divine, ni Weber avec sa puissance, sa colossale originalité, ni Meyerbeer avec son foudroyant génie dramatique, ne peuvent, selon moi, disputer la palme au Titan, au Prométhée de la musique. C'est écrasant. »
Après 1867, Bizet semble plus troublé par Wagner. Il a parfois contre lui des mouvements d'humeur : « Du génie, certes, écrit-il à Lacombe en 1868, mais quel poseur ! quel raseur ! quel goujat ! Selon lui le Faust de Gounod est de la musique de cocottes ! » Il regimbe encore parfois : « Pièce mal faite », écrit-il à son élève Galabert à propos de Rienzi, joué le 1er avril 1869 au Lyrique, « tapage..., des morceaux détestables..., des morceaux admirables..., un souffle Olympien... Les bourgeois sentent qu'ils ont affaire à un grand bougre. » (C'est à cet élève Galabert qu'il a révélé Wagner en lui jouant au piano Tannhäuser et Lohengrin). Il admire un peu moins Verdi, un peu moins Gounod, médiocrement Ambroise Thomas, dont l'Hamlet, toutefois, « efface les faiblesses musicales de cet homme honorable et excellent ».
En 1871, la dévotion à Wagner commence à s'affirmer : « Wagner n'est pas mon ami, écrit-il à Mme Halévy le 29 mai 1871, et je le tiens en médiocre estime, mais je ne puis oublier les immenses jouissances que je dois à ce génie novateur. Le charme de cette musique est indicible, inexprimable. C'est la volupté, la tendresse, l'amour. Ce n'est pas la musique de l'avenir, ce qui ne veut rien dire, c'est la musique de tous les temps parce qu'elle est admirable. » Et Bizet formule un principe, qui aurait bien dû être celui de tous les gounodistes, wagnériens, debussystes et franckistes : « Il est bien entendu que, si je croyais imiter Wagner, malgré mon admiration, je n'écrirais plus une note de ma vie : imiter est d'un sot. Il vaut mieux faire mauvais d'après soi que d'après les autres. Et plus le modèle est beau, plus l'imitation est ridicule. » Sans doute, alors, écrivant à Mme Halévy, lui dit-il mollement que la Juive, telles parties des Huguenots ou de Guillaume Tell n'ont rien à craindre du temps, mais il exécute brutalement Boieldieu : « La Dame Blanche est un opéra détestable, sans talent, sans idée, sans esprit, sans invention mélodique, sans quoi que ce soit au monde. C'est bête, bête, bête ! c'est une jocrisserie prudhommesque qui ne peut plus amuser que les sapeurs, les bonnes d'enfants et les concierges. » Et dorénavant Bizet jouera à sa belle-mère « Wagner et Schumann ».
Cette admiration pour Wagner transparaît peu dans les œuvres. Djamileh pourtant excita l'indignation des timorés. Il faisait bon, raconte Adolphe Jullien, se promener, le mercredi 22 mai 1872, vers les 10 heures, au foyer de l'Opéra-Comique : « C'est indigne ! — C'est odieux ! — Quelle cacophonie ! — Quelle audace ! — Voilà où mène le culte de Wagner, à la folie ! — Ni tonalité, ni mesure, ni rythme ! — Ce n'est plus de la musique ! — C'est du macaroni ! — Plus wagnérien que Wagner ! » Que de mots et que de bruit pour une jolie piécette, très mélodique, et qui n'avait comme nouveauté que d'être peu scénique et d'être curieusement ciselée ! Mais en France, à cette époque, ne pas suivre les ornières où tout le monde avait passé, équivalait à un brevet de wagnérisme.
Non, Bizet n'a jamais été « wagnérien ». En 1874, en pleine maturité de son âge et de son génie, il pratique, il admire Beethoven et Wagner ; il y prend des leçons de sérieux et de goût, mais il ne s'anéantit pas en eux, ne s'aliène même pas, et nous verrons que dans Carmen il n'a pas le courage de rompre totalement avec la musique qu'alors on réclamait. Carmen est une œuvre encore éclectique, une œuvre de compromis. Dans ses belles parties, elle est de Bizet et de Bizet seul.
S'il fallait à l'heure actuelle discuter encore le grief de wagnérisme, à propos de Carmen, nous n'aurions qu'à rappeler le « cas Wagner » de Nietzsche. Lorsque Frédéric Nietzsche, l'admirateur de Wagner, son ami intime, de 1868 à 1876, le confident de ses pensées, l'analyste pénétrant et l'apologiste enthousiaste du génie wagnérien, fut subitement désenchanté dans son amitié et son engouement, aux répétitions de la Tétralogie, à Bayreuth, en 1876 ; lorsque, guéri de Wagner, « qui n'avait été qu'une de ses maladies », il s'aperçut subitement que l'art wagnérien était un art de décadence, le style flamboyant de la musique », et brûla ce qu'il avait adoré, il garda d'abord le silence. Mais, quelques années après, quand Wagner était mort et que le wagnérisme se répandait impétueusement dans toute l'Europe, non seulement Nietzsche essaya de détruire l'idole (le Cas Wagner. — Nietzsche contre Wagner, 1888), mais à Wagner il opposa Bizet, le Bizet de Carmen : « A entendre un pareil chef-d'œuvre, on devient soi-même un chef-d'œuvre », un philosophe, tout au moins. L'orchestration de Bizet est la seule qu'il supporte. Cette musique lui semble parfaite : « Elle approche avec une allure légère, souple. Elle est aimable, elle ne met point en sueur... Elle est riche, elle est précise. Elle construit, organise, achève. Par là elle forme un contraste avec le polype dans la musique, avec la mélodie infinie..... A-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques ? Et comment sont-ils obtenus ? Sans grimaces, sans faux-monnayage, sans le mensonge du grand style..... Avec Carmen on prend congé du Nord humide, de toutes les brumes de l'idéal wagnérien. Cette musique possède ce qui est le propre des pays chauds, la sécheresse de l'air, sa limpidezza. » Et, se laissant emporter par sa rhétorique, son antithèse, et sa haine, Nietzsche voit dans Carmen la musique latine, la musique méditerranéenne, par opposition à la musique germanique et nuageuse de Wagner.
L'étude précise de Carmen nous permettra de discerner ce qui, dans la partition, revient à Wagner, aux Italiens, ou à la tradition, surtout ce qui revient au génie de Bizet.
III
« CARMEN »
HISTOIRE DE L'ŒUVRE
La genèse de « Carmen ». — Aussitôt après la représentation de Djamileh (22 mai 1872), Bizet se déclare content d'être rentré dans la voie qu'il n'aurait jamais dû quitter, et dont il ne sortira plus jamais (Lettre à Lacombe, juin 1872). « Ce qui me satisfait, écrit-il également à Galabert, c'est la certitude absolue d'avoir trouvé ma voie. Je sais ce que je fais. » Et à ses deux disciples, il annonce qu'on vient de lui commander trois actes pour l'Opéra-Comique. « Meilhac et Halévy seront mes collaborateurs. Ils vont me faire une chose gaie, que je traiterai aussi serré que possible... Ce sera une gaîté qui permettra le style. » Quelques mois plus tard, Bizet recevait le livret de Carmen.
Quand il projetait ainsi de « mettre du style » dans l'Opéra-Comique, il faisait bon marché de la musique puérile, facile, niaise, canaille, qui avait sévi au temps de Boieldieu, d'Adam, d'Herold, d'Auber ; il songeait peut-être à l'opiniâtre et inconcevable succès que remportait, depuis 1866, la fade et sentimentale Mignon d'Ambroise Thomas ; il ne pouvait oublier que son maître et ami Gounod avait tout de même rénové et relevé le genre « éminemment national », par sa probité musicale, son sentiment mélodique, sa tendre inspiration. Il avait applaudi au succès de Faust (1859), de Mireille (1864) et de Roméo (1867). Il voulait toutefois « élargir le genre », y mettre plus d'expression, de vérité, d'humanité, de couleur, et aussi plus de musique, comme Saint-Saëns allait essayer de renouveler le « Grand Opéra » avec Samson et Dalila. Les ennemis de Bizet ne lui pardonneront pas ce mépris de la forme opéra-comique, et son zèle pour la « confusion des genres ».
Nous n'avons pas de renseignements sur l'élaboration de Carmen. Les lettres de Bizet à Lacombe nous apprennent qu'il avait terminé le premier acte en mai ou juin 1874, et était « assez content » de lui ; que la pièce allait être terminée pour entrer en répétition au mois d'août et passer fin novembre ou commencement décembre 1874, et que Bizet a mis deux mois pour orchestrer les douze cents pages de sa partition. Il semble que Bizet ait conçu et réalisé son œuvre par un travail ininterrompu, pendant les six premiers mois de 1874.
La première de « Carmen ». — Elle eut lieu le 3 mars 1875.
Rarement « première » fut plus attendue, et opinion publique plus travaillée en sens contraire.
Les uns escomptaient un écroulement, l'écroulement d'un musicien outrecuidant et d'une théorie prétentieuse, qui ne tendaient à rien de moins qu'à discréditer un genre bien français, aimable, pimpant et frais, et les musiciens qui l'avaient porté à son plus haut point de splendeur. Les autres s'attendaient à une révélation, la révélation d'un tempérament et d'un génie nouveaux, d'un système dramatique et musical sans précédents en France.
La salle était comble. L'accueil fut glacial. Il n'est pas vrai, malgré l'affirmation d'Henri Rochefort (Figaro, 2 janvier 1908), que Carmen « fut sifflée à tel point qu'on put à peine entendre la proclamation du nom des auteurs ». Le nom de Bizet fut salué, au contraire, avec sympathie, mais la pièce parut longue, languissante, et se déroula parmi l'indifférence et l'ennui. Le public ne distingua que le charmant prélude du second acte, où dialoguent si plaisamment la clarinette et le basson (il fut bissé), le quintette des contrebandiers, dont la gaîté parut de bon aloi et bien ancien répertoire », les couplets d'Escamillo. Ce fut tout. Le contact ne s'établit pas. Personne ne fut pris.
Bizet, après le premier acte, se promenait rue Favart où il rencontra Vincent d'Indy et d'autres jeunes musiciens, qui l'entourèrent et le félicitèrent de tout, ce qu'il y avait de vie dans ce premier acte. Il leur répondit doucement : « Vous êtes les premiers qui me disiez cela, et je crains bien que vous ne soyez les derniers. »
Le reste de la soirée, il reçut dans le cabinet du directeur, au fur et à mesure, les nouvelles de la salle : réserve, étonnement, gêne du public. Il comprit l'insuccès et fut navré. À un critique, il dit : « Dites-moi la vérité vraie ; vous savez que je suis un homme auquel on n'est pas forcé de dire que tout ce qu'il fait est admirable ! » Mais nous ne sommes pas très bien fixés sur ses pensées, ses paroles et ses actes. Selon son zélé biographe, Ch. Pigot, après la représentation, il aurait erré toute la nuit au bras de son ami Guiraud et « déversé dans son sein toutes les amertumes de son cœur ». Mais Edm. Galabert n'a pas entendu de Guiraud pareils propos, et Ludovic Halévy, le collaborateur de Bizet, le cousin germain de Mme Bizet, a raconté, dans un article du Théâtre (1er janvier 1905), que Bizet et lui rentrèrent chez eux (ils habitaient la même maison), à pied, silencieux, accompagnés de Meilhac.
Quelles étaient les causes de cet insuccès momentané ? D'abord, le bruit qui courait, que les gens « autorisés » n'avaient pas confiance. Le directeur de l'Opéra-Comique, du Locle, aimait bien Bizet, mais il était épouvanté par le livret de Carmen, et il aurait, dit-on, prié un ministre, qui lui demandait une loge pour la première, d'assister à la répétition générale, pour s'assurer s'il pouvait amener ses enfants à un tel spectacle. Du Locle n'était pas moins épouvanté par la musique de Bizet ; si l'on en croit Saint-Saëns, il la traitait de « cochinchinoise », et il ajoutait « On n'y comprend rien. » Le ministre de l'Instruction publique ayant, lui-même, le 2 mars, donné à Bizet le ruban de la Légion d'honneur, on avait dit malignement qu'il s'était hâté de le faire la veille, sachant que ce serait impossible le lendemain.
La grande cause d'étonnement, ou même de scandale, c'était la prétendue immoralité du livret, que la musique était loin de sauver. Le public fit la moue. Il avait trouvé déjà déplaisante Carmen dans la nouvelle de Mérimée ; mise sur la scène, vue en chair et en os, malgré les précautions de Meilhac et Halévy, elle sembla encore plus cynique. Ce n'était pas un personnage de théâtre, et encore moins d'Opéra-Comique. La transition était trop brusque entre ces êtres frustes et brutaux d'une part, et d'autre part les gentils bergers, les aimables courtisans, les bonshommes en sucre ou en carton, que l'on avait accoutumé d'applaudir salle Favart.
Quant à la musique, on la jugea trop peu mélodique, trop pleine d'imprévu, d'audaces harmoniques, de wagnérisme. C'était un « civet sans lièvre ». Si quelques critiques, comme nous le verrons, protestèrent, inversement, contre les concessions au public, l'opinion immédiate semble avoir été que cette musique était obscure, incompréhensible, ennuyeuse.
L'interprétation parut irréprochable. Quelques malins prétendirent même qu'elle avait relativement sauvé la pièce. Mme Galli-Marié, que l'on croyait vouée aux roucoulades et aux larmes, depuis qu'elle jouait sans trêve Mignon, avait, avec quelque vulgarité peut-être, mais avec un puissant réalisme, essayé de figurer Carmen selon l'esprit de Mérimée et selon le pittoresque andalou. Ses costumes avaient été composés sur des aquarelles de Clairin. Elle « se balançait sur les hanches comme une pouliche des haras de Cordoue », telle que l'avait vue Mérimée, mais au grand scandale du public et des critiques ; elle était voluptueuse, lascive, ensorcelante tour à tour, ou farouche, effrontée, cynique ; en un mot elle n'affadissait ni n'ennoblissait le personnage et ne le rendait pas galant, courtois, conventionnel comme un Espagnol d'opéra-comique.
Le ténor Lhérie, qui n'avait pas une très bonne voix, mais était intelligent et capable de comprendre un caractère, fut intéressant dans la partie dramatique de son rôle, et fit frissonner, malgré tout, dans la phrase « de la fleur », dans la scène violente qui clôt le troisième acte, et dans le tragique duo final ; mais on ne lui sut qu'un gré médiocre de ses dons pathétiques, qui paraissaient déplacés sur la scène de l'Opéra-Comique. Une approbation unanime alla à Bouhy pour la façon dont il avait « campé » son torero et dit les couplets d'Escamillo, quoiqu'il fût, selon certains critiques, un peu efféminé, un peu « blond ». La sympathie des auditeurs ne pouvait que se donner à la charmante Mlle Chapuy (la future générale André) à cause de son talent, et parce que le rôle de Micaëla flattait toutes les habitudes de la maison.
L'orchestre fut à peu près impeccable. Les chœurs, un peu somnolents, chantèrent, paraît-il, assez mal les ensembles (qui sont quelquefois vétilleux), prirent peu de part à l'action, comme c'était leur habitude et le désir des auteurs précédents.
Les décors étaient pittoresques, et sensiblement analogues à ce qu'ils sont encore maintenant sur toutes les scènes : au 1er acte, la placette, avec son corps de garde en auvent, son pont praticable, ses ruelles en escalier et ses maisons à encorbellement ; au 2e acte, le bouge sombre de Lillas Pastia (et non son patio, tel qu'on le voit aujourd'hui à l'Opéra-Comique) avec un monde grouillant de drôles patibulaires, et des gitanes dansant sur les tables ; au 3e acte, un terre-plein dans un site sauvage de la Sierra ; au 4e acte enfin, la place de Séville, sous un soleil resplendissant, et, dans le fond, la plaza avec son portail fermé par un vélum.
Le défilé des deux cuadrillas était mal réglé. Aujourd'hui encore, il est difficile de ne pas l'étriquer et de ne pas laisser prendre aux choristes qui le contemplent une attitude fausse ou guindée.
En somme, Carmen fut plutôt bien servie par ses interprètes.
L'opinion de la presse. — Depuis que Carmen est devenue la pièce favorite du public et des connaisseurs, maints critiques ont rougi de s'être fourvoyés et ont voulu faire croire que l'accueil des journaux et revues avait été plutôt favorable. Malheureusement les textes sont là ; de loin, ils paraissent même fort amusants.
Consultons les livres qu'on trouve dans toutes les bibliothèques, et d'abord le populaire Dictionnaire des Opéras de Clément et P. Larousse (révisé par Arthur Pougin) : « Le style du romancier », y est-il dit, « exact et froid comme une photographie, le cynisme de sa pensée, m'ont toujours fait regarder le succès de ses œuvres littéraires comme un symptôme alarmant. de démoralisation... Elles sont dépourvues de toute inspiration lyrique : M. Bizet en a fait la cruelle expérience. Son opéra renferme de beaux fragments, mais l'étrangeté du sujet l'a lancé dans la bizarrerie et l'incohérence... La recherche du pittoresque et de la couleur locale a beaucoup trop préoccupé M. Bizet ; ... il a voulu donner des gages aux doctrinaires qui s'intitulent les apôtres de la musique de l'avenir, en rompant avec ce qu'on regardait jusqu'ici comme les traditions du goût : la satisfaction de l'oreille, l'harmonie... Il sera nécessaire de refaire le livret, d'en retrancher les vulgarités, de lui ôter ce caractère de réalisme qui ne convient pas à une œuvre lyrique, de faire de Carmen une bohémienne capricieuse et non une fille de joie, et de Don José un ensorcelé d'amour, mais non un être vil et odieux... Les deux rôles du toréador et de Micaëla sont excellents. »
(Sur l'exemplaire de ce Dictionnaire qui est à la bibliothèque du Conservatoire, un lecteur justement indigné a noté : « Celui qui a écrit cette page est un imbécile. »)
Dans le supplément à la Biographie Universelle des Musiciens de Fétis, supplément rédigé en 1878 sous la tutelle du fâcheux Arthur Pougin (qui avait traité de « farouche wagnérien », en 1872, l'auteur de Djamileh), nous lisons : « Bizet, dont les tendances wagnériennes n'étaient un mystère pour personne, et qui, pendant de longues années (?), afficha le mépris le plus complet pour la forme et le genre de l'opéra-comique..., Bizet devait se montrer le plus mortel ennemi de l'opéra-comique et professer le plus profond dédain pour les musiciens qui l'avaient porté à son plus haut point de splendeur... Dans les Pêcheurs de Perles et la Jolie Fille de Perth, ouvrages conçus dans le style wagnérien, il avait sacrifié à une sorte de mélopée traînante et indéfinie, parsemée d'audaces harmoniques un peu trop violentes... On se disait, avant Carmen, Bizet voudrait-il se décider enfin à faire de la musique théâtrale, ou bien, s'obstinant dans les théories antidramatiques de Richard Wagner, voudrait-il continuer à transporter à la scène ce qui lui est absolument hostile, c'est-à-dire la rêverie, la poésie extatique et l'élément symphonique pur ?... Carmen n'est pas un chef-d'œuvre, certes, mais c'est une promesse brillante... La partition est inégale, mais très étudiée et très soignée. » Et Pougin déplore chez Bizet une préoccupation exagérée de symphoniste, « pas assez de souci de la nature et de la limite des voix ».
Dans le Ménestrel du 7 mars 1875, le même Arthur Pougin, qui occupait toutes les voies d'accès à la musique, faisait naturellement entendre son antienne obstinée : « Bizet, l'un des plus farouches intransigeants de notre jeune école wagnérienne, s'est assoupli et a dépouillé le vieil homme... Il a écrit une musique très claire et très compréhensible, parfois tendre et mélancolique, parfois pleine d'entrain et de gaîté, toujours accessible et souvent même aimable... C'est une œuvre des plus honorables, des plus distinguées,... un remarquable essai. » Par la suite, le Ménestrel nota avec bienveillance le succès croissant de Carmen : « Les beautés ne s'en sont révélées qu'après plusieurs auditions, dit H. Moreno, et les vrais amateurs de musique y allaient chaque soir à la découverte de quelque nouvelle ingéniosité instrumentale, car, sous ce rapport, la partition de Carmen n'est rien de moins qu'un riche écrin. »
La « rengaine Wagner », un peu délaissée par Pougin, apparut sous d'autres plumes. Paul de Saint-Victor, dans le Moniteur, estima que Bizet appartenait à « cette secte nouvelle dont la doctrine consiste à vaporiser l'idée musicale, au lieu de la resserrer dans des contours définis. Pour cette école, dont M. Wagner est l'oracle, le motif est démodé, la mélodie surannée ; le chant, soufflé et dominé par l'orchestre, ne doit être que son écho affaibli. Un tel système doit nécessairement produire des œuvres confuses ». F. de Lagenevais, dans la Revue des Deux Mondes, jette un pleur sur l'ancien opéra-comique, la Dame Blanche, Fra Diavolo, la Part du Diable. « La symphonie et l'opérette l'ont tué. » Il trouve joli le duo et la phrase « Là-bas, là-bas dans la montagne... », déclare aimer les couplets du torero, trouve le quintette d'une originalité piquante, et captivant par l'imprévu des harmonies, la variété des timbres de l'orchestre : « Les voix tombent on ne sait d'où. » Bizet « sera un homme de théâtre ». En attendant, Carmen, « une créature inculte, une bête fauve,... un abominable rôle », ne devait pas être mise en scène ; elle n'est pas supportable. Quant à la musique, « la Habanera ne produirait pas d'effet sans la pantomime dont l'accompagne Galli-Marié ». Trop de symphonie : « J'en veux à M. Bizet de ses divagations instrumentales... La ligne serpentine a son mérite, mais celle qui mène au but est la ligne droite. » Pierre Véron (dans le Charivari) déplorait que Bizet « se fût fourvoyé à la remorque d'un wagnérisme atrophiant ». Un certain François Oswald, dans le Gaulois, risquait la fameuse comparaison du « civet sans lièvre » et expliquait loyalement que Bizet remplaçait par l'érudition la « sève mélodique qui coulait à flots de la plume des Auber, des Adam, des Herold et des Boieldieu ».
S'il y avait matière à critique, plus juste et plus clairvoyant était le reproche de concessions au public, que l'on sent dans le compte rendu affectueux de Johannès Weber (le Temps), dans les commentaires un peu hautains de Reyer (Journal des Débats), qui se délecte surtout aux jeux d'instrumentation, dans le jugement sévère d'Adolphe Jullien, qui voit dans Carmen « une longue suite de compromis,... des défaillances voulues,... de justes aspirations aussitôt réprimées », en somme une abjuration de Bizet, qui, par ailleurs, sait remarquablement manier l'orchestre, a de curieuses combinaisons d'instruments et de jolis accouplements de timbres.
Les Annales du Théâtre et de la Musique, de Noël et Stoullig, résumaient en fin d'année les diverses opinions en jugeant le sujet peu convenable au théâtre, le personnage de Carmen « horriblement déplaisant », la musique pleine de concessions et de banalités, l'instrumentation excellente, Galli-Marié très pittoresque : « Quelle vérité, mais quel scandale »
En somme critique nettement hostile, ou ironique, ou dédaigneuse. Quand le succès s'avèrera, beaucoup se déjugeront, ou même se renieront.
Après la première. — Malgré l'étonnement du public et l'hostilité de la presse, Carmen ne fut pas ce qu'on appelle « un four ». Loin de là. Le nombre des représentations consécutives fut même très honorable : 33 du 2 mars au 3 juin, jour de la mort de Bizet ; puis 4 encore jusqu'au 18 juin, date où le théâtre de du Locle dut fermer ses portes. Soit 37 représentations en trois mois et demi. Une nouvelle série de 13 représentations, plus espacées, fut donnée du 15 novembre 1875 au 15 février 1876. Peu d'œuvres nouvelles ont 50 représentations en un an. C'était, pour le moins, un succès de curiosité et d'estime.
Cependant, l'Opéra de Vienne, dont le directeur, Jauner, avait donné à Bizet la joie de signer un traité quelques jours avant sa mort, représentait Carmen dès le 23 octobre 1875, mais sous une forme quelque peu impure : puisque Carmen avait paru si peu « opéra-comique », on avait pensé en faire un « grand opéra », et Guiraud avait transformé les dialogues en récitatifs. Toutefois ce ne fut ni la première ni la seconde version qu'on donna aux Viennois, mais un mélange des deux, le directeur ayant estimé que le dialogue en prose convenait mieux que la musique à certaines scènes familières. En outre, puisque Bizet n'avait pas jugé expédient de recourir aux bons offices des ballerines, on intercalait, sans son assentiment, au second acte (par la suite au quatrième acte) la danse bohémienne de la Jolie fille de Perth. L'interprète principale, Mlle Ehnn, était, paraît-il, remarquable ; et, au quatrième acte, l'entrée du cirque formait un tableau si pittoresque qu'il fit courir tout Vienne.
A Bruxelles, Carmen est jouée le 8 février 1876 : « Le succès, dit le Guide musical, n'a rien eu de l'enthousiasme ; la musique de Bizet est trop personnelle, trop originale, trop en dehors, pour qu'elle ne déroute pas le public habitué aux formules mille fois rebattues de l'opéra moderne ; mais il a été franc, spontané, unanime. » La version donnée était le texte mi dialogues, mi récitatifs, avec danses, qui avait finalement prévalu à Vienne. La principale interprète, Mlle Dérivis, était quelconque. Carmen ne fut maintenue à la Monnaie que par Galli-Marié et l'Américaine Minnie Hauck, qui reprirent le rôle.
En 1878, la province s'empara de Carmen : Angers, puis Marseille, puis Lyon, puis Bordeaux.
A Londres, Carmen faillit être jouée simultanément sur deux scènes, Covent Garden et Her Majesty's ; mais la fameuse Adelina Patti, qui devait jouer à Covent Garden, trouva le rôle de Carmen écrit trop bas et dépourvu de virtuosité ; elle l'éloigna d'elle avec dédain. (Plus tard, en 1885, quand Carmen était devenue célèbre, elle se ravisa, et pour qu'il ne fût pas dit qu'un beau rôle lui échappait, elle condescendit jusqu'à ramasser Carmen pour la hausser à sa taille.) En 1878, donc, ce fut seulement à Her Majesty's qu'on donna, le 22 juin, une Carmen fortement italianisée de langage, d'accents et de gestes, avec Minnie Hauck. La presse anglaise, favorable, essaya d'atténuer le caractère un peu... « excentrique de la gitana, et de désarmer certaines susceptibilités analogues à celles qu'avaient naguère éveillées Don Juan et la Traviata. On mit les hardiesses de Carmen sur le compte de la couleur locale.
Minnie Hauck conduisit Carmen à Dublin, à New York, et un peu dans toute l'Europe ; c'est elle qu'on se dispute, ainsi que Galli-Marié, à Naples, Florence, Gand, Mayence, Hanovre, en cette année 1878. Le 10 mars 1878, Carmen réussit brillamment au théâtre italien de Saint-Pétersbourg. Des troupes nomades, avec les impresarii Strakosch et Grau, font des tournées à travers les Etats-Unis. A Berlin, Carmen s'installe si bien qu'en 1880-81 nous la voyons venir en tête des ouvrages représentés avec 23 représentations. (Lohengrin ne vient qu'au second rang avec 13.) Presque partout, d'ailleurs, à l'étranger, c'est la version italienne qui est offerte, même avec Galli-Marié.
La reprise du 21 avril 1883. — Le triomphe de Carmen étant européen, et même mondial, Paris ne pouvait guère bouder. Sa mauvaise humeur dura plus de huit ans, bien que Bizet ne fût plus contesté, et que son nom figurât sur tous les programmes de concerts symphoniques.
Le scrupule qui retenait le directeur de l'Opéra-Comique a été impitoyablement décelé par un journaliste pince-sans-rire, H. Moreno (Ménestrel, 29 avril 1883) : « Les entrevues matrimoniales, qui représentent 20 % des recettes, étaient fort incommodées ; les jeunes fiancées ne trouvaient plus dans leurs corbeilles de noces assez d'éventails pour y cacher leur rougeur ; l'amour légitime réclamait un double bandeau. »
Carvalho se décida cependant, mais avec quelles précautions ! Plus de pouliche des haras de Cordoue, mais une Carmen bourgeoise, honnête, femme du monde, sous les traits rassurants de Mme Adèle Isaac, aux allures distinguées, à la claire voix de soprano, qui ne sombrait pas dans un médium canaille, mais émaillait le rôle de notes aiguës judicieusement pointées. Plus de bouge sombre hanté de drôles picaresques ou sinistres, mais Lillas Pastia devient propriétaire d'une vaste et claire auberge où évoluent de 60 à 100 nobles visiteurs et une vingtaine de danseuses. L'effréné duel à la navaja est devenu une placide discussion. Le reste à l'avenant. Carmen expurgée et affadie. Le plus grave, c'est que Carvalho, ne croyant pas au succès, avait saboté la reprise. On parla alors de « conspiration Carvalho » pour étrangler Carmen. Non ! mais, faute de répétitions, l'exécution de l'orchestre et des chœurs fut au-dessous du médiocre, et la distribution des rôles était malencontreuse.
Peu importait. La presse cria au chef-d'œuvre méconnu, et ne s'expliqua pas pourquoi cette musique, toute de clarté, de franchise, de couleur, de sensibilité, de charme, n'avait pas conquis le public, pourquoi une éloquence a ce point pathétique ne l'avait pas remué. Pendant l'été, Carmen eut un tel succès auprès du public (et de telles recettes), que le timide Carvalho sentit ses yeux se dessiller. Ravi, car, au fond, il avait toujours aimé Bizet, l'avait même pressenti, compris, dès son retour de Rome, il remonta Carmen à frais nouveaux, soigneusement, et lui restitua, avec Galli-Marié, sa couleur primitive et tout son sens. Cette réparation du 27 octobre 1883 fut « un triomphe absolu », déclare Ludovic Halévy. La centième eut lieu cette même année, le 22 décembre.
« Carmen » de 1883 à 1921. — Que de chemin parcouru entre cette centième et la seize-centième avec laquelle s'est terminée l'année 1920 ! Chaque année c'est une moyenne de 40 représentations à Paris, tandis que Carmen est le point d'appui du répertoire, en province et à l'étranger. Alors que les opéras-comiques de Boieldieu, d'Herold, d'Adam, d'Auber ont disparu de l'affiche, n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif de curiosité, n'existent plus que pour l'historien de la musique, Carmen est demeurée vivante ; en elle n'est mort ou languissant que ce qui était concession ou compromis ; sa puissance tragique et son ingéniosité orchestrale s'imposent à tous les publics. Un journal, Excelsior, ayant fait en janvier 1911 un referendum sur les dix œuvres préférées de ses lecteurs, au théâtre de l'Opéra-Comique, Carmen est arrivée la première, avec 26.116 suffrages, Manon la seconde avec 20.524, Louise la troisième avec 15.408 ; venaient ensuite, et dans cet ordre, Lakmé, Werther, Mignon, Mireille, le Barbier, la Vie de Bohème et... la Traviata. Si peu de valeur absolue qu'ait un classement aussi étrange, n'en retenons que l'hommage à Carmen.
Toutes les chanteuses illustres ont tenu à honneur de jouer Carmen, ou ont pensé se faire valoir par ce rôle séduisant, ou se sont permis de le déformer en le conformant à leurs moyens vocaux et en lui imposant certaines lubies personnelles. Après Galli-Marié et Adèle Isaac, ont pris possession du rôle, Mmes Castagné (1884), Blanche Deschamps (1886), Vaillant-Couturier (1888), Nardi (1889), Fouquet (1891), Arnoldson et Calvé (1892), Charlotte Wyns (1894), Nina Pack (1895), de Nuovina (1897), Marié de l'Isle (1899), Bressler-Gianoli (1900), Claire Friché, Delna (1901). C'est Mme Emma Calvé qui chantait la millième, le 23 décembre 1904. Depuis cette date tous les soprani, mezzi, contralti, falcons et dugazons de France ont chanté Carmen ; citons parmi les plus notoires Mmes Bréval, Bailac, Chenal, Mérentié, Raveau, Mary Garden. Oserons-nous dire que le public parisien est souvent bien naïf, qu'il accepte tout, et qu'il a perdu la notion de la véritable Carmen ?
D'abord il est absurde de faire jouer Carmen par une vieille dame calme, rassise, molle et fatiguée. Pour jouer ce rôle, « c'est le diable au corps qu'il faut avoir », comme disait Voltaire à Mlle Dumesnil, son interprète de Mérope. Il est encore absurde de faire chanter par une soprano et par une voix claire ce rôle sombre, amer, dont la tessiture est incontestablement le medium de la voix, mais exige un medium rond, homogène, susceptible d'inflexions âpres ou veloutées. C'est une autre absurdité de le faire chanter par de lourdes contralti dont les voix de poitrine écrasent lourdement et vulgairement tous les sons graves, font des effets de rogomme. C'est un paradoxe ridicule d'avoir recours à des femmes, épaisses, énormes, telles que l'excellente chanteuse que nous appelions jadis « maman Carmen », ou à de hautes et imposantes statues. Bien que chacune des cantatrices que nous avons nommées ait pu avoir dans Carmen des trouvailles intéressantes, bien que nous professions une réelle admiration pour certaines d'entre elles, dans d'autres rôles, Carmen ne reste pas liée dans notre souvenir à la première Margared du Roi d'Ys, ni à la créatrice des Troyens, ni à l'illustre Brunnhild de la Walkyrie, ni à l'énigmatique et poétique Mélisande, ni à la plus célèbre des Tosca. Si Mmes de Nuovina et Calvé furent des comédiennes intéressantes, émouvantes, Mmes Marié de l'Isle et Bressler-Gianoli furent, à notre avis du moins, les Carmen les plus complètes à tous égards. Nous ne voyons Carmen que sous l'aspect d'une femme jeune, mince, souple, agile, osant gesticuler et danser, jamais assise ni indifférente à l'action, animée, primesautière, violente, fière, servie par une voix chaude et timbrée, expressive et prenante.
Le rôle de Don José n'a pas toujours eu non plus un très grand bonheur. Les ténors d'autrefois le considéraient volontiers comme une « panne », parce qu'il n'est pas exclusivement « vocal » et peu fertile en cavatines. Il présente en réalité une difficulté : au premier acte, le rôle est celui d'un niais, scéniquement et musicalement ; il faudrait le sauver par un peu de fierté, de nerf et de fougue, au lieu de l'affadir. Mais à partir du second acte, quel admirable rôle pour un ténor à voix généreuse et expressive, qui se résoudrait il se donner tout entier, à clamer la souffrance, la menace, la fureur, au lieu de se réserver et de ténoriser ! Lhérie, malgré les aspérités de sa voix, était, paraît-il, pathétique, mais sans ampleur. Stéphane, le Don José de 1883, était un ténor fatigué. Depuis, MM. Mouliérat, Lubert, Leprestre, Maréchal, Engel, Saléza, Salignac, Alvarez, Clément, Léon Beyle, Ch. Fontaine, Lapelleterie, et bien d'autres ont laissé de très bons souvenirs. Saléza fut un Don José qu'on ne peut oublier. Aujourd'hui, le jeune ténor Charles Friant est remarquable de fougue et de sincérité. Le public l'acclame à juste titre.
Le rôle d'Escamillo est flatteur. En réalité les couplets fameux sont peu accessibles aux basses chantantes, et les barytons les relèvent volontiers d'un demi-ton, pour les rendre plus aisés et plus « brillants ». Quel que soit le chanteur, les couplets sont bissés. De tous les Escamillo que nous avons entendus, Taskin, Bouvet, Cobalet, Soulacroix, Delvoye, Ghasne, Baugé, etc., le plus sonore, le plus éclatant, le plus superbe, était sans contredit Dufranne, l'admirable créateur de Golaud, dans Pelléas et Mélisande.
Les chanteuses légères ne dédaignent pas de chanter Micaëla. Elles en sont récompensées par les acclamations et les bis qui ne peuvent manquer de saluer l'air du troisième acte, surtout quand elles le couronnent d'un si bémol aigu. Toutes se conforment aux convenances de l'ancien opéra-comique, dont le rôle semble échappé. Citons parmi les plus charmantes Micaëla, après Mlle Chapuy, la créatrice, Mmes Merguiller, Bilbault-Vauchelet, Rose Delaunay, Molé, Guiraudon, Mastio, Marie Thiéry, Vallin, de Gastardi, Coiffier.
Terminons par le rappel de la distribution des rôles de Carmen aux dates les plus mémorables de son histoire :
|
|
03 mars 1875 (première) |
21 avril 1883 (reprise) |
23 décembre 1904 (millième) |
|
Carmen |
Mmes Galli-Marié |
Mmes Adèle Isaac |
Mmes Emma Calvé |
|
Micaëla |
Chapuy |
Merguillier |
Marie Thiéry |
|
Frasquita |
Ducasse |
Dupuis |
Tiphaine |
|
Mercédès |
Chevalier |
Chevalier |
Costès |
|
Don José |
MM. Lhérie |
MM. Stéphanne |
MM. Clément |
|
Escamillo |
Bouhy |
Taskin |
Dufranne |
|
Le Dancaïre |
Potel |
Labis |
Cazeneuve |
|
Le Remendado |
Barnolt |
Barnolt |
Mesmaecker |
|
Zuniga |
Dufriche |
Maris |
Vieuille |
|
Moralès |
Duvernoy |
Collin |
Soulacroix |
IV
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte Ingenerò la sorte. (Leopardi)
[Le sort engendra en même temps deux frères : l'Amour et la Mort.]
La « Carmen » de Prosper Mérimée. — Mérimée avait visité l'Espagne en 1830 ; il avait applaudi avec fureur les taureaux dans les corridas, mais non les toreros ; il avait fait « mille folies », avoua-t-il, parcouru campagnes et montagnes en s'arrêtant aux plus modestes et aux plus sales « posadas », fréquenté les indigènes de toute origine et de tout acabit, avec une préférence romantique pour les irréguliers, les « hors la loi ». Il semble, d'après ses confidences, que Carmen ait quelques traits d'une gitana qu'il rencontra près du Generalife et essaya d'apprivoiser. Toutefois, bien que l'on connaisse les scrupules de Mérimée archéologue, son goût du document et sa passion de l'exacte vérité, il est impossible d'affirmer que Carmen soit une histoire vécue, et non une aventure imaginée.
Carmen parut en 1845 et fit scandale ; après Colomba et l'élection à l'Académie française, on s'attendait à un Mérimée classique et moral ; et voici que, sous une couleur ardente et un pittoresque savoureux, on lisait une histoire d'êtres veules, sans foi ni loi. La netteté précise, dure et brutale d'un style aux arêtes coupantes, la froideur impassible du récit, rendaient l'impression plus désagréable, à une époque on l'on se délectait aux romans fluides et émollients de George Sand, aux romans exubérants et luxuriants de Balzac. L'amoralité, le cynisme de Mérimée pèsera d'avance sur le livret de Meilhac et Halévy, sur la partition de Bizet.
Tout l'intérêt psychologique de Carmen est dans une conception sombrement pessimiste de l'amour, passion fatale, inexplicable, cruelle, germe de la folie et de la mort. L'amour, tour à tour candide et cynique, gracieux et féroce, tendre et implacable, a pour moyen la guerre, et pour base la haine des sexes. Chez Racine, il fait d'Oreste une loque, un fou, un meurtrier, et le condamne à mort ; dans le roman de Pierre Louÿs, il fait de l'homme un « pantin ». L'amour de Carmen, pour peu de joie, donnera à Don José tous les tourments de la jalousie et de la fureur, l'avilira, fera de lui une épave lamentable. Un tel amour, exécrable mais inéluctable, ne se dénoue que dans la mort.
Mérimée commence par présenter de façon pittoresque ses deux héros : le bandit José Navarro, qu'il rencontre dans un cirque de la Sierra, aux environs de Cordoue, et à qui le lient quelques cigares, un repas partagé, l'hospitalité commune dans une « venta » et un bon avis sur une dénonciation possible par son domestique aux lanciers du village voisin ; la Carmencita, aperçue au moment où elle vient de prendre son bain de l'Angelus, avec d'autres Cordouanes, dans le Guadalquivir, parfumée de jasmin, vêtue de noir, petite, jeune, bien faite, offrant la bonne aventure, bohémienne et « servante du diable ». C'est plus qu'il ne faut pour piquer la curiosité du galant touriste, qui suit la gitana dans son borgne logis, se laisse séduire à cette beauté étrange et sauvage, à ces yeux voluptueux et farouches, tandis que Carmen paraît surtout intéressée par la belle montre en or, à sonnerie, du payllo, de l'étranger. L'entrevue se termine par l'inopportune arrivée du Navarro, qui rudoie Carmen, et congédie sans façon le galant, lequel n'a réussi qu'à être prestement soulagé de sa montre.
Quelque temps après, en prison, à la veille d'être garrotté, José raconte à Mérimée sa lugubre histoire ; ce gars des provinces basques, déraciné du pays natal après une rixe, s'était engagé dans un régiment de dragons, à Séville. Bon soldat, brigadier irréprochable, sérieux et timide, un jour qu'il était de garde à la Manufacture des tabacs, il a vu Carmen : jupon rouge fort court, bas de soie blancs et troués, mignons souliers de maroquin rouge, épaules nues, une fleur de cassie dans le coin de la bouche, les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne. Il s'est détourné ; mais Carmen l'a provoqué et lui a lancé sa fleur de cassie juste entre les deux yeux. Cette fleur, il l'a ramassée. Ce sera le philtre d'amour. Dès lors son destin est marqué.
A la suite d'une bagarre et de quelques coups de couteaux distribués par elle à ses camarades, dans la manufacture, Carmen est arrêtée et sera conduite en prison par José. Son minois enjôleur, ses « balivernes » et quelques habiles mensonges affolent le malheureux soldat ; d'un coup de poing Carmen le renverse aisément et disparaît dans une ruelle étroite. Un mois de prison pour José, qui restera seul avec la fleur de cassie et ses souvenirs... Honnête soldat, il ne tentera d'ailleurs pas de s'évader, bien que Carmen, reconnaissante, lui envoie à cet effet, dans un pain, une lime et une pièce d'or.
Cassé de son grade et redevenu simple soldat, José, de garde devant la porte de son colonel, revoit sa gitanilla parée comme une châsse, pomponnée, attifée, tout or et ruban, qui vient participer à une soirée. Il l'aperçoit qui danse la romalis dans le patio du palais ; il entend les galanteries des freluquets ; il comprend qu'il l'aime pour jamais. En sortant, elle l'invite au faubourg de Triana, chez Lilas Pastia « où l'on mange de la bonne friture ». Il court la retrouver, se promène avec elle par les rues de Séville où elle fait des emplettes folles : pain, saucisson, nougats, gâteaux, manzanilla ; puis leur collation se fait dans une chambrette où Carmen se livre à mille excentricités, croque des bonbons, danse en faisant claquer comme des castagnettes des morceaux d'assiettes cassées. Dès lors il est son rom (son mari) ; elle est sa romi (sa femme). Après cette équipée, elle disparaît d'ailleurs prestement.
José ne la revoit que quelques semaines après : de garde devant une brèche du mur d'enceinte, il se laisse persuader par elle de laisser passer des contrebandiers. Leurs amours recommencent, mêlées de disputes, de coups, d'infidélités, de ruptures. Après une rixe où, pour Carmen, il tue un lieutenant, José déserte et se fait contrebandier dans l'espoir de ne plus la quitter.
Pendant des mois, c'est la vie aventureuse, Carmen aimante ou féroce, riante ou dédaigneuse : c'est la contrebande, le vol à main armée, l'assassinat, les batailles avec douaniers ou soldats, les fugues, les disparitions fréquentes de Carmen. Un beau jour, voilà que Carmen revient avec son vrai rom, un sinistre et crapuleux bohémien, Garcia le Borgne, qu'elle a fait évader du pénitencier. José ne sera plus que son minchorro, son « caprice », jusqu'au jour où il se débarrassera de Garcia dans un duel loyal au couteau, et redeviendra le rom. Toutes ces marques d'amour ne l'empêchent pas de subir affronts et avanies : il court sans cesse après Carmen, qu'il retrouve généralement en la galante compagnie de riches étrangers, d'ailleurs destinés à être volés et tués par José et sa bande, quand ils passeront dans la Sierra. Il faut convenir qu'ils poussent un peu loin, l'une le cynisme, l'autre la lâcheté. Après une dernière escapade de Carmen avec le picador Lucas, le dénouement menace.
Dans une gorge sombre de la Sierra, José somme Carmen de changer de vie et de le suivre n'importe où : « Je te suis à la mort, mais je ne vivrai plus avec toi », répond-elle ; « tu veux me tuer, mais tu ne me feras pas céder... Je ne t'aime plus... Tout est fini entre nous... Comme mon rom, tu as le droit de tuer ta romi, mais Carmen sera toujours libre : calli (libres) elle est née, calli elle mourra ». Et elle jette dans les broussailles la bague d'amour que José lui avait donnée naguère. Alors, froidement, il la frappe de deux coups de couteau. Elle tombe sans crier. Il l'ensevelit dans un bois et va se livrer, à Cordoue.
Telle est l'histoire atroce, dont les personnages seraient répugnants, s'ils n'étaient transfigurés, José par son amour, sa pitoyable faiblesse, l'ensorcellement dont il est victime, l'effroyable martyre qu'inflige la passion à une âme naïve et tendre, mais sans volonté ; Carmen par une singulière fatalité de sang et de race, par la tyrannie d'un tempérament passionné et fantasque, une étrange soumission aux lois des romis, un sauvage amour de la liberté, une fière bravoure devant la mort, et une sorte de désintéressement dont elle fait sa grande vertu : « Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ? »
La « Carmen » de Meilhac et Halévy. — Avoir songé à Carmen pour un livret d'opéra-comique, semble une gageure, un paradoxe, à une époque où l'opéra-comique était essentiellement sentimental, gracieux et gai.
Les librettistes n'ont pas absolument trahi Mérimée. Carmen et Don José, dans leur scénario, sont assez ressemblants, et ils s'expriment souvent par les phrases mêmes de Mérimée. Toutefois les aventures galantes et cruelles de Carmen ont été réduites au minimum : le lieutenant Zuniga n'est pas pour José un rival sérieux, et l'illustre espada Escamillo, le grand caprice de Carmen, remplace à lui seul Garcia le Borgne, Lucas le picador, et tous les Anglais, étrangers ou Andalous que gruge ou met à mal Carmen. Ce torero est d'ailleurs plat et conventionnel, très « ancien opéra-comique ». Et comme il faut un personnage sympathique, Meilhac et Halévy se sont souvenus d'un rêve de José, qui revoit le pays natal et voudrait en finir avec l'aventure de mort où il se sent engagé. De ce rêve ils ont extrait Micaëla, le bon ange qui veille — infructueusement — sur José, comme Alice sur Robert le Diable, et dont la grâce vertueuse, tendre et blonde, contraste avec la sauvagerie cynique, haineuse, et brune de Carmen. Naturellement aussi il y aura dans la pièce deux personnages comiques, le Dancaïre et le Remendado.
PREMIER ACTE
Le premier acte se déroule sur une place de Séville : à gauche, corps de garde ; à droite, la porte de la manufacture ; au fond, un pont praticable, des ruelles en escalier, des maisons à encorbellement, des fenêtres à jalousies. Les soldats oisifs contemplent placidement les allées et venues de la foule bigarrée : amoureux qui causent ou passent, mendiants, moines faisant la quête, promeneurs désœuvrés, petits métiers. Un metteur en scène adroit et fantaisiste peut donner à ce peuple grouillant un aspect aussi pittoresque que plaisant. M. Albert Carré n'y a pas manqué.
Survient une jeune personne en jupe bleue, corsage de velours noir, nattes blondes tombant sur les épaules : c'est la jeune Navarraise Micaëla qui veut parler au brigadier don José. Mais celui-ci ne doit prendre la garde que dans quelques instants, ainsi que l'en avertit le galant brigadier Moralès ; donc Micaëla, au lieu de l'attendre au corps de garde, ce qui serait « peu prudent », reviendra ultérieurement.
Clairon à la cantonade, auquel répond un clairon sur la scène. C'est la relève de la garde. La garde montante arrive, précédée d'une bande de gamins marchant au pas, d'une allure martiale et allègre. Les deux brigadiers se passent la consigne, selon les formes, et la garde descendante se retire, précédée du chœur des gamins.
Une conversation du brigadier don José avec le lieutenant Zuniga, fraîchement arrivé à Séville, apprend au spectateur que la manufacture de tabacs est peuplée d'aimables Sévillanes, légères et provocantes, mais que José n'y fait guère attention, car il rêve à certaine jupe bleue et à certaines nattes blondes. Puis José, moins préoccupé des évolutions de la foule que son prédécesseur Moralès, s'assied à l'écart et met toute son attention à confectionner une chaîne de laiton « pour attacher son épinglette ».
Il est deux heures ; la cloche sonne ; les curieux accourent, car voici venir les cigarières, qui, tout en fumant et en jetant des œillades provocatrices, rétorquent aux propos galants « c'est fumée ! » Elles ne les écouteront probablement qu'à leur sortie.
Un peu après elles, ménageant son entrée, car il faut qu'un « premier rôle » ait une « entrée » sensationnelle, paraît Carmen : teint basané, cheveux d'ébène et crépus, railleuse, décidée, en un costume qui varie suivant la fantaisie plus ou moins documentée des interprètes, lesquelles ne se croient pas toutes obligées de se conformer aux indications de Mérimée, et dont quelques-unes ont demandé des indications pittoresques à tel peintre espagnol comme Zuloaga. Carmen porte dans sa chevelure et aux lèvres des roses ou des pavots rouges, et non une fleur (ou plutôt une grappe) de cassie, car la cassie est une sorte de mimosa qui se prêterait mal au rôle que jouera « la fleur » dans le drame. La bande émoustillée des hidalgos galants s'empresse autour d'elle et lui demande un tour de faveur dans le programme de ses amours ; mais il n'y a rien à espérer pour aujourd'hui, dit-elle ; et elle explique allégoriquement, sur un air d'habanera, que l'amour ne se commande pas : c'est un oiseau rebelle, il est fantasque, il est enfant de Bohème ; on aime souvent qui ne vous aime pas, et malheur à celui qu'on a choisi : « Si je t'aime, prends garde à toi ». Le chœur approuve ce sage avis, qui, sous une forme plaisante, annonce tout le futur drame. Cependant Carmen, qui a remarqué le beau don José, indifférent et affairé, a essayé par ses chants d'éveiller sa curiosité, de forcer son attention. N'ayant pas réussi, elle se pique au jeu, interpelle le brave garçon, et, riant de sa naïveté, lui lance en pleine figure la fleur qu'elle tenait aux lèvres. Eclat de rire général et perplexité de José.
Heureusement, Micaëla revient, qui cherche José pour lui donner des nouvelles de sa mère, la vieille paysanne navarraise, installée depuis peu dans un village d'Andalousie relativement proche, et qui a pardonné à son fils l'algarade de son départ. Par Micaëla, la mère envoie à son fils... un baiser : troublante commission dont s'acquitte avec grâce la candide messagère. Attendri, José revoit sa mère, son village, et, comme de juste, retourne à sa mère, par Micaëla, ses tendresses et un baiser. Les auteurs de la Belle Hélène ont-ils écrit sérieusement ce duo si « croix de ma mère » ?
Soudain tumulte ; don José pourrait dire comme Ruy Blas :
J'étais tourné vers l'ange et le démon paraît !
Les cigarières se ruent sur la place en piaillant, gesticulant, s'égratignant, se menaçant, et surtout émettant un flot de paroles, car il n'est pas bon bec que de Paris. Pourquoi tout ce bruit ? Carmen s'est moquée d'une camarade hâbleuse ; les deux femmes se sont prises aux cheveux, et Carmen, avec son couteau, a tracé une croix de Saint-André sur la joue de sa rivale. Femmes et passants se divisent en deux groupes hostiles et hurlent aux oreilles du lieutenant Zuniga.
José va quérir la délinquante qui comparaît devant le lieutenant, mais répond à l'interrogatoire en fredonnant insolemment. Elle ira donc en prison, et don José la gardera en attendant que l'ordre soit rédigé.
Sur ce, la foule, cigarières, curieux, soldats, tout le monde disparaît comme par enchantement, et sur la place déserte, Carmen, ligotée sur une chaise, reste seule avec don José. Naturellement elle lui lance des œillades significatives et de doux propos ; elle lui conte même qu'elle est navarraise et sa payse ; mais, devant son incrédulité, elle n'insiste pas et confesse qu'elle est bohémienne : peu importe, puisqu'il l'aime ; la preuve — inutile de nier — c'est la fleur qu'elle lui a jetée et, qu'il a ramassée, gardée sur son cœur. José lui défend de parler ; donc, en se balançant sur sa chaise dont il l'a déliée, elle chante une séguedille encore plus provocante et troublante, où elle lui déclare qu'elle est libre, qu'elle l'aime et l'attend au premier soir dans la taverne de Lillas Pastia.
Les soldats et la foule reviennent alors, on ne sait pourquoi. I.es dragons escortent Carmen vers la prison. Mais comme elle a les mains libres, elle pousse faiblement José qui tombe lourdement. La foule ravie de ce bon tour protège sa fuite en empêtrant les dragons peu empressés à la poursuite.
DEUXIÈME ACTE
La taverne borgne de Lillas Pastia. —En 1875, le décor représentait le sombre intérieur de la posada. En 1883, c'était une hôtellerie de l'aspect le plus engageant. Le dernier décor de M. Albert Carré nous montre le patio de l'auberge, en plein air, sous un velum, le soir.
C'est grande réjouissance. Au rythme des guitares et des tambourins dansent bohémiens et bohémiennes, tandis que, tendrement accolées à de galants officiers — dont Zuniga — Carmen et ses amies Frasquita, Mercédès, chantent des chansons scintillantes et colorées. Puis Lillas Pastia, fidèle observateur des règlements de police, veut congédier la bruyante assemblée. Les fêtards récalcitrent. Justement passe le cortège sonore du torero Escamillo. Qu'il entre ! ce sera l'occasion d'une beuverie complémentaire, et, pour le public, l'occasion de revoir un type classique de personnage avantageux, d'entendre un air de bravoure. Escamillo, sensible à la politesse de ses hôtes, fait en effet, en deux couplets, un cours solennel de tauromachie. Carmen en est séduite. Ce que voyant, Escamillo prend une attitude désinvolte et un air incendiaire ; il lui propose son amour, auquel nulle, Espagnole ou Zingara, ne saurait résister. Puis il s'en va avec une parole d'espoir, suivi par toute l'assistance dans sa marche aux flambeaux.
A ce moment précis, l'existence énigmatique de Carmen se présente sous un nouvel aspect : entre temps, quand elle n'est ni cigarière, ni amante, ni danseuse, elle est affiliée à une troupe de contrebandiers : avec ses deux amies, elle a pour office spécial d'espionner, et au besoin d'amadouer les douaniers. Les deux chefs de bande sont le Dancaïre (le joueur, le ponte, celui qui joue pour les autres et avec leur argent) et le Remendado (le tacheté). Les voici justement qui viennent requérir pour la nuit même les services des trois femmes, car, assurent-ils, « quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie, il est toujours bon d'avoir des femmes avec soi ». C'est bien aussi leur avis, à elles, et elles sont obéissantes, mais Carmen est... amoureuse. Stupeur, incrédulité ! oui, elle attend ce soir même José, qui doit sortir de la prison où l'a conduit pour un mois sa complaisance trip visible. Elle veut lui prouver sa reconnaissance, et elle a de lui quelque curiosité. Elle laissera donc en plan ses complices, à moins que...
Précisément José s'annonce de loin par un chant martial et guilleret. Le voici. Ils vont faire médianoche, croquer oranges et bonbons, boire du manzanilla. Il est bien un peu naïf : n'a-t-il pas refusé de s'évader avec la lime et la pièce d'or qu'elle lui avait envoyées ? Elle a pour lui un peu d'ironie méprisante. Mais enfin il est là, il est beau, elle l'aime, et puisqu'elle a dansé la romalis pour les autres, elle va la danser pour lui seul. Pas de chance : on entend sonner la retraite ; il faut qu'il rentre au quartier. La fille fantasque et indisciplinée n'en peut croire ses oreilles : vexée, elle le raille, l'injurie, lui lance à la figure casque, sabre et fourniment. Le pauvre José, piteux, fait alors le candide aveu de sa tendresse : il s'est enivré de la fleur qu'elle lui a jetée ; il n'a cessé de la voir en rêve ; il l'a maudite parfois ; il l'aime maintenant et confesse : « j'étais une chose à toi ». Alors une suggestion du Dancaïre germe diaboliquement dans l'esprit de Carmen ; s'il l'aime, il n'a qu'à la suivre là-bas, là-bas, dans la montagne, à mener avec elle la vie errante et libre ; elle le cajole, elle l'enjôle, elle le grise en se promettant elle-même et en faisant miroiter la liberté favorable à leurs amours. Il se débat, pleure, se ressaisit pourtant, lui dit adieu. Mais, comme le lieutenant Zuniga vient en ce moment même retrouver Carmen, la jalousie détermine ce que n'avait pu la séduction. José se dispute et se bat avec son lieutenant ; les bohémiens interviennent dans la rixe, désarment et éconduisent Zuniga. Mais le sort est révolu : José désertera, il aura la liberté, et l'amour de Carmen.
TROISIÈME ACTE
Un terre-plein, parmi les rochers de la Sierra. Il fait encore nuit. Les contrebandiers arrivent lourdement chargés, en devisant sur leur périlleux métier. Quelques-uns vont aller aux renseignements pour savoir si l'on peut faire entrer à Séville les marchandises amenées de Gibraltar. Les autres se couchent et se reposent. José, contrebandier, est songeur : le village n'est pas loin où habite sa mère avec Micaëla ; l'amour de Carmen est à sa période de lassitude, de décroissance, d'âpreté, de haine.
Leur conversation, où l'une est gouailleuse, l'autre menaçant, avertit que le câble va rompre, et que l'épreuve sera tragique. Mais bah ! dit Carmen, arrive qui plante ! Il la tuera : elle mourra. Et pendant que les insouciantes Frasquita, Mercédès font les cartes pour se découvrir un avenir d'amour et de fortune, Carmen, plus crédule encore, et plus fanatique, lit nettement dans les cartes : la mort. N'importe : elle ne fera rien pour déjouer le sort, surtout aucune concession à don José. Elle a trop d'orgueil.
Les incidents qui vont suivre exaspéreront don José, à la grande joie de Carmen : elle accepte joyeusement d'aller parler, avec ses deux amies, aux douaniers qui gardent la brèche, et d'occuper leur galante attention, pendant que les camarades feront passer leurs ballots. Pendant ce temps, José furieux montera la garde autour du campement.
Une péripétie invraisemblable, sur ces entrefaites, amène Micaëla dans ce repaire de bandits. Depuis quelques années, à l'Opéra-Comique, on ajoute au livret une explication tout à fait nécessaire : le paysan poltron, qui guide la jeune fille, nous fait savoir qu'elle cherche José pour lui porter un nouveau message de sa mère (comment sait-elle qu'il est ici ?) et qu'elle a eu très peur en apercevant un troupeau de taureaux conduits par Escamillo (élégante façon de nous annoncer l'arrivée également invraisemblable de celui-ci). Malgré son émotion, Micaëla confie au public, dans une très douce cantilène, ses angoisses sur elle-même et sur don José, dont elle sait qu'il est un jouet entre les mains de Carmen. Une prière au Seigneur pour implorer sa protection termine cette naïve confidence. Un coup de feu ! Micaëla s'enfuit.
Et l'on voit débouler Escamillo poursuivi par José. Présentations. José s'excuse, sentinelle diligente, d'avoir tiré sur cet intrus. Que ne l'a-t-il touché ! car Escamillo lui confie sur-le-champ qu'il est amoureux à la folie, et de Carmen ; et c'est pour elle qu'il est dans ce lieu plein d'imprévu. Comment l'a-t-il dénichée ? Mystère. Don José prend mal la chose. Les deux rivaux se provoquent, se battent comme des sauvages à coups de navaja.
Autrefois, comme il convient aux duels de théâtre, il y avait deux manches : la première se terminait par une maladresse de José qui laissait tomber sa navaja ; grand seigneur, Escamillo lui faisait grâce, et le duel recommençait ; la deuxième manche, seule maintenue, se termine par une glissade malencontreuse d'Escamillo, que sans scrupule José va frapper, quand, opportunément, surviennent les bohémiens ; de sa propre main Carmen détourne la navaja de José. Hautain, et sûr de lui, le suffisant torero se retire. Mais comme la première manche du combat est maintenant supprimée (pour abréger un spectacle quelque peu ridicule), il ne dit plus à José : « Nous sommes manche à manche et nous jouerons la belle » comme le porte le texte du livret et de la partition, mais : « Je prendrai ma revanche et nous jouerons la belle », ce qui est d'ailleurs absurde, car si la revanche finit mal pour l'un d'eux, la belle est improbable.
La fureur de José, la haine de Carmen sont à leur comble, et toute la fin de l'acte est menée avec une effroyable intensité dramatique. Micaëla, découverte derrière un rocher, supplie José de venir au chevet de sa mère mourante, et Carmen, narquoise, invite son amant à partir. A deux reprises, José saisit Carmen, la brutalise, la renverse, lui crie qu'il la devine, qu'elle veut rejoindre son nouvel amant, mais qu'il restera, lui José, et que la chaîne qui les lie, les liera jusqu'au trépas. On entend au loin la voix sonore et béate d'Escamillo que Carmen écoute avec une allégresse non dissimulée. José lui barre le chemin, tandis que Micaëla le supplie encore. « Sois tranquille, je pars, mais nous nous reverrons », dit-il sinistrement à Carmen.
QUATRIÈME ACTE
Le décor de cet acte a souvent varié, car les directeurs ingénieux ont cherché à le mettre en harmonie avec le sauvage dénouement du drame. A la première, et selon les indications des auteurs, la scène représentait une place de Séville ; au fond, les arènes, l'entrée du cirque étant fermée par un long velum. Puis on s'est étonné que le duo final pût se dérouler ainsi sur la place publique, et vers 1900, M. Albert Carré avait fait faire un décor voûté et sombre qui représentait une sorte de vomitoire de la plaza : c'est par là qu'entraient les toreros et le public. Une toile de fond, représentant la foule attentive, était truquée de façon à permettre une agitation de mouchoirs et d'éventails (des papiers multicolores soulevés par un judicieux courant d'air) aux différentes phases de la corrida. Aujourd'hui l'Opéra-Comique est revenu à un décor de place publique, analogue au décor primitif.
En attendant l'arrivée des cuadrillas, grande agitation des vendeurs et vendeuses de programmes, éventails, oranges, lorgnettes, vin, eau de neige ; promenades de señoras et de caballeros impatients. Aucun ballet, bien qu'en province on croie encore nécessaire d'ajouter parfois cet épisode conventionnel à un acte dont tout l'intérêt dramatique est dans le brutal contraste du brillant cortège des toreros et des aficionados, avec l'âpre duel à mort des deux amants. Ni Meilhac, ni Halévy, ni Bizet n'avaient prévu ce ballet. Et dire qu'en 1915, dans un théâtre qui devrait être le Conservatoire des œuvres lyriques, on corsait ce spectacle et l'audition, en juchant, après le ballet, sur un banc, une chanteuse de coplas, qui dévidait ses refrains, soutenue sur la guitare par une duègne très « goyesca ». Etrange conception que celle d'un régisseur, qui, sans respect du texte, et d'un pareil texte, veut ainsi prouver son zèle intempestif et son originalité de mauvais aloi !
Mais voici le défilé, étincelant sous le soleil de feu : l'alguazil conspué par la foule, les hardis chulos, les crânes banderilleros, les lourds picadors, et enfin l'espada, frénétiquement acclamé. Escamillo, car c'est lui, est au bras de Carmen pâmée. Ils se séparent après de tendres mots. Carmen n'entrera pas à la plaza. Elle attendra dehors la fin de la corrida. Elle sait que José la guette. Tant pis !
Alors c'est l'atroce dénouement : José oublie tout, José implore ; qu'elle le suive au loin, et ils commenceront une autre vie. Mais Carmen est inflexible : elle ne l'aime plus et veut être libre. Nouvelles supplications, mêlées de promesses et de menaces. Nouveau refus, sec et péremptoire. José pleure, s'avilit ; il évoque les souvenirs passés ; il subira toutes ses volontés. Carmen ne cède pas. Au loin la foule acclame Escamillo. Carmen se précipite... José lui barre le passage. Elle lui crie au visage qu'elle aime son rival. Au paroxysme de la rage José la somme de le suivre. Elle jette à la volée sa bague, seul souvenir de leurs amours. Alors damnée ! Il se précipite sur elle et l'abat à ses pieds. Le livret indique qu'avant de recevoir le coup Carmen se dérobe et essaie de gagner le cirque ; don José, après poursuites et feintes, la rejoint à l'entrée et lui plante sa navaja entre les épaules. Une tradition, qui vient de Mme Bréval, et qui est plus conforme au caractère de Carmen, supprime ces courses folles : Carmen, impudente, mais brave et résignée, se croise les bras et ricane devant la dernière menace de don José ; elle le nargue et l'insulte du regard pendant qu'il approche d'elle ; il la frappe au cœur dans un spasme de fureur, et elle tombe, la haine encore dans les yeux.
Eperdu, José s'agenouille, lui donne un dernier baiser et se laisse arrêter : « C'est moi qui l'ai tuée, Carmen, ma Carmen adorée ! »
V
(1) Nous renvoyons au texte de la partition piano et chant (Choudens, éditeur) en priant le lecteur de ne pas tenir compte des récitatifs, qui, comme nous l'avons dit, sont, non pas de Bizet, mais de Guiraud.
« Dans notre musique contemporaine, Pelléas et Mélisande est à l'un des pôles de notre art, Carmen à l'autre pôle. Celle-ci, tout en dehors, toute lumière, toute vie, sans ombres, sans dessous. L'autre toute intérieure, toute baignée de crépuscule, toute enveloppée de silence. C'est ce double idéal, ce sont ces alternatives de soleil fin et de brume légère, qui mont le doux ciel lumineux et voilé de l'Ile-de-France. » (Romain Rolland, Musiciens d'aujourd'hui, p. 206.)
Il ne faut pas s'attendre à trouver dans la partition de Bizet une musique spécifiquement espagnole.
Le terroir espagnol est riche en musique populaire, vocale ou dansante. Tous les voyageurs étrangers ont raffolé de ses tonadillas si mélodiques, si chantantes, de ses sardanes, aragonaises, séguidilles, jotas, fandangos, rondallas, où la danse est tour à tour si mélancolique et furibonde. Maints thèmes ou rythmes de danse espagnole ont fait la fortune de nos ballets d'opéra. Rimski-Korsakov, Debussy, Ravel, Laparra ont trouvé dans le folklore transpyrénéen des pages poétiques et colorées. Longtemps l'Espagne a laissé perdre ses richesses ou ne les a pas exploitées elle-même ; elle se contentait d'envoyer à travers le monde ses fades guitaristes et ses banales cantilènes. En ces dernières années seulement Pedrell, Albeniz, Granados, Manuel de Falla ont su et voulu utiliser les idées et rythmes si spéciaux, si curieux, qu'ils trouvaient à profusion autour d'eux.
Bizet n'a pas vécu tra los montes ; il ne s'est pas imprégné de l'atmosphère musicale qui enveloppe l'Andalousie ; il n'a pu remonter aux sources de la musique populaire ; il a seulement consulté des recueils de mélodies, de danses, quelques opéras espagnols, dont il a vite compris et aisément assimilé le caractère, la couleur, l'accent. Toutefois, si l'on trouve dans Carmen des pages évocatrices de l'Espagne (habanera, séguidille, chanson bohémienne, prélude du 4e acte, marche triomphale), si Bizet a judicieusement emprunté quelques motifs que nous indiquerons, s'il en a brillamment pastiché quelques autres, il n'en est pas moins certain qu'il a plutôt tenté de faire « humain » que de faire « pittoresque », et que Carmen est avant tout de la musique expressive, de la musique bien française, — latine, méditerranéenne, si l'on veut.
Il ne faut pas s'attendre non plus à trouver dans Carmen du « wagnérisme ». Dans un chapitre précédent, nous avons étudié le prétendu wagnérisme de Bizet, ou plutôt nous l'avons vainement cherché dans ses doctrines et dans ses œuvres. Si « wagnérien » veut dire tout simplement « révolutionnaire », Carmen n'est pas une œuvre révolutionnaire : sa coupe ne diffère pas de celle de l'opéra-comique traditionnel ; c'est une succession de chœurs, d'airs, de duos, trios, quintettes, etc., parfois moins arbitrairement amenés et plus naturellement placés que dans telles œuvres précédentes, mais nettement détachés et facilement détachables. Il y a loin de là à la « mélodie continue » de Wagner.
Le mérite de Bizet n'est pas dans une innovation de plan ou de méthode, mais dans le bonheur de l'expression musicale, dans la stricte appropriation de la phrase musicale à la phrase poétique, et surtout à la situation, au sentiment. Le plus souvent, Bizet a su trouver la forme adéquate au drame poignant qu'il avait choisi de traduire ; l'on peut dire même qu'il a été admirablement inspiré toutes les fois qu'il a traduit Mérimée, parfois banal et vulgaire quand il traitait Meilhac et Halévy. Le génie propre, indiscutable, de Bizet se révèle tout entier dans la scène finale du 4e acte, où l'on peut dire que les personnages ne chantent pas pour chanter, mais laissent pleurer ou crier leur âme, et qui aboutit, par une progression surprenante, à la plus formidable explosion de passion et de fureur que l'on connaisse dans la musique dramatique.
Le « Thème conducteur » de « Carmen ». — La clef musicale de Carmen, c'est un thème à double aspect, une phrase typique, ou si l'on veut un « leitmotiv », comparable en quelque façon à ces motifs que Richard Wagner faisait circuler dans ses premiers drames, comme Lohengrin, pour évoquer un état d'âme, avant d'en faire la trame même de ses développements lyriques.
Premier aspect du thème. — Sous son premier aspect, ce motif caractéristique apparait subitement, brutalement, à la fin du prélude, après le déchaînement joyeux des fanfares de fête :

Une phrase simple, d'une mesure, cinq notes, clamée fortissimo par violoncelles, bassons, pistons, clarinettes graves, trois fois répétée en des tons divers et suivant une échelle descendante, ponctuée par un pizzicato âpre et rageur des contrebasses, timbales, harpes et cors, tandis qu'un trémolo frissonnant des violons baigne le motif d'une atmosphère gémissante.
L'étrangeté, la beauté sinistre de cette phrase provient de cet intervalle inattendu de seconde augmentée qui sépare les deux croches médianes du groupe (do ♯ - si b ; sol - fa naturel ; fa ♯ - mi b).
Une seconde fois le thème avec son triple groupe est réexposé sur un ton plus élevé et plus douloureux. Puis, plus pressant encore, plus tragique, plus poignant, il prend une allure ascendante, haletante, et est interrompu à l'improviste par un immense accord piqué de septième diminuée, dont la dissonance et la brutalité font l'effet d'un coup de massue, et qui annonce le tragique dénouement du drame :

Ce thème de fatalité, ce thème de mort, qui pèsera sur don José, nous le retrouverons, sous sa forme lamentable (page 55), au moment où Carmen provoquera l'attention de José et lui jettera la fleur qui sera le germe et le symbole de cette inéluctable passion ; et il circule encore dans l'ensemble symphonique qui clôt cette scène.
Mélancolique et pitoyable, il est murmuré par la voix gémissante du cor anglais (page 189) pour amener la déclaration pathétique de José qu'on appelle communément « romance de la fleur » et qui est en réalité un aveu naïf, humble et tendre de l'amour le plus touchant.
S'il ne fait pas le fond de la menace violente et des imprécations qui terminent le troisième acte, il souligne sinistrement la trop claire promesse de José : « Je pars, mais nous nous reverrons » (page 309), présenté alors de façon plus sourde et plus monotone par les « bois ».
Enfin il prend tout son sens, toute son ampleur à l'approche de la mort, quand il se déchaîne en un immense unisson d'orchestre pour amener la conclusion du drame (page 359 et suivantes). Il ne cesse alors de marteler les cris de rage de José : « Ainsi, le salut de mon âme, je l'aurai perdu... pour que tu t'en ailles, infâme, entre ses bras rire de moi ! » Et il retentit encore après le meurtre, sous les paroles entrecoupées du meurtrier affolé et pitoyable : « Vous pouvez m'arrêter... »
Deuxième aspect du thème. — Sous son autre aspect : trait rapide, doubles croches, rythme binaire, sons aigus des violons stridents, le motif accompagne ou évoque Carmen et sa séduction diabolique. Parfois brillant, toujours sarcastique, sous une sorte d'éclat de rire dont il a l'apparence, il cache le défi, la menace mais l'on ne peut s'y tromper, il est bien le thème de mort.
Le voici tel que scintillant, sémillant, et ponctué par les bois, il accompagne l'entrée de Carmen (page 40) :

Il réapparaît, pour rappeler à don José l'étrange apparition de Carmen, au milieu de son duo élégiaque avec Micaëla, naturellement évoqué par la phrase : « Qui sait de quel démon j'allais être la proie ? » (page 66). Ici les trois groupes de 5 notes se répètent à l'octave et en triples croches.
Il se fera encore plus saccadé, plus inquiet, plus crispé, au troisième acte, avant l'air « des cartes », quand Carmen lira clairement l'avenir de mort, et il se terminera par une sorte de gamme chromatique descendante du plus lugubre effet (page 256).
Par la suite on ne l'entendra plus, parce qu'il se fondra dans le thème de mort dont il n'était qu'une déformation rythmique.
Ce simple et court emploi d'un thème caractéristique, expressif, et heureusement trouvé, suffit à mettre une sorte de continuité et d'unité dans la partition : la mort planera sans cesse.
Le Prélude. — Le Prélude, sorte de raccourci du draine, débute franchement, allégrement dans le ton sonore de la majeur, par l'air de marche qui accompagnera, au quatrième acte, le défilé des cuadrillas sur la place de Séville :

Violons et bois s'en donnent à cœur joie, tandis que les cuivres rythment à contre-temps. C'est sonore, brillant, vulgaire, mais cela a un mérite, c'est d'être ensoleillé ; et si Bizet n'a pas emprunté à l'Espagne cet air de marche, l'Espagne le lui a emprunté, et l'a même adopté pour les défilés de ses courses. Comme au quatrième acte, dans ce prélude, une place d'honneur est faite à l'espada que l'on croit voir entrer, au rythme, d'abord discret, des fameux couplets du second acte :

Après une ascension de tous les instruments, en tierce, par une gamme de double octave, la phrase se déploie avec éclat, fatuité et ampleur. Reprise de la marche. Puis, subitement, coupant court à la joie, c'est cet arrêt de mort, dont nous avons parlé plus haut.
Admirons avec quelle audace (scandaleuse en 1875) Bizet a terminé son prélude par le coup de massue que nous avons indiqué, par cet accord dissonant, qui produit un effet de malaise et d'inquiétude, au lieu de le terminer normalement, selon l'attente des auditeurs, dans le ton. Le prélude de Carmen, à dessein, n'est pas équilibré ; l'effet de sa brutale clausule n'en est que plus remarquable.
ACTE I
Suivant l'usage, le premier acte commence par un ensemble vocal. Après un court exorde où flûtes et clarinettes dessinent de brillants festons, les dragons, placidement assis devant le corps de garde, chantent un chœur aimable, dont la phrase initiale « sur la place chacun passe, chacun vient, chacun va » et l'accompagnement des cordes graves se modulent sur un chromatisme à la fois railleur et nonchalant qui évoque de façon piquante le désœuvrement de la faction :
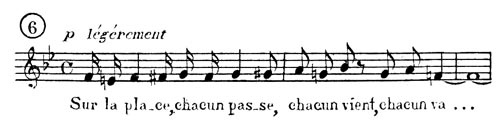
Les violons annoncent par des triolets aigus et sautillants l'entrée gracieuse de Micaëla, dont la conversation avec Moralès est traitée non sans quelque frivolité : Moralès va jusqu'à débiter deux petits couplets d'une fadeur et d'un poncif tout à fait appropriés aux sornettes que Bizet avait à mettre en musique. Seul le motif alerte des clarinettes et des voix, qui caractérise la relève de la garde, est amusant et frais.
Le chœur des gamins est précédé d'un double appel de clairon derrière la scène et à l'orchestre. Puis deux « piccolo », deux fifres aigus, sur lesquels tranchent de temps à autre des sonneries de clairon, font entendre une marche en ré mineur dont le contour mélodique est d'apparence simple et populaire, mais dont le travail harmonique est des plus ingénieux avec ses modulations risquées, ses altérations inattendues et ses broderies capricieuses (page 20) :

C'est un badinage charmant. Toutes les fois que Bizet trouve l'occasion de manifester sur un thème très simple sa virtuosité, sa science, et de donner à une idée banale, même triviale, un développement raffiné et précieux, il s'offre avec joie cet amusement d'élite. Le public, qui applaudit si cordialement le chœur, devrait plutôt admirer son infrastructure, sa préparation et sa conclusion orchestrales.
Encore un hors-d'œuvre : le chœur des cigarières. Après les galants compliments des ténors et des basses, toujours imprégnés de ces modulations chromatiques chères à Bizet, et une ritournelle qui dessine les volutes de la fumée, les voix des femmes font entendre, en une sorte de chœur fugué, une lente mélopée aux molles inflexions (page 341 :
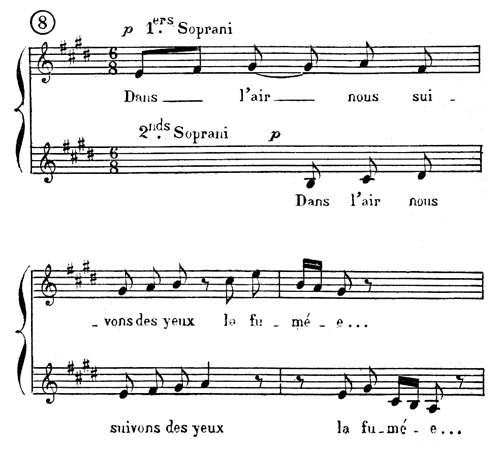
Le déroulement de la mélodie est interrompu par un court intermède de gai papotage :

« Le doux parler des amants... », disent les soprani d'une voix qui sautille avec les violons ; « c'est fumée », répondent obstinément à ce propos et à d'autres les contralti avec la flûte, la clarinette et le basson. Tout ce dialogue est très spirituel, et le chœur finit mélancoliquement par la reprise du thème de la fumée sur le hautbois, et son écho sur les cors.
L'entrée de Carmen se fait sur le motif scintillant et provocant dont nous avons indiqué plus haut le sens et donné le texte (Ex. 3). Et puisqu'un « récitatif d'entrée » s'imposait, selon l'usage, il faut reconnaître qu'à la déclaration galante des ténors (interrompue par le retour obstiné du motif diabolique sur la flûte), Carmen répond par une phrase fort heureusement venue dans sa forme ironique et décidée : « Peut-être jamais ! peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. »
La habanera a toute une histoire. Il fallait un air d'entrée, qui fût un succès pour la chanteuse, mais qui, tout de même, fût caractéristique du personnage et significatif du drame en puissance. Bizet avait composé une chanson mêlée de chœurs dont nous n'avons pas le texte. Galli-Marié lui demanda... autre chose. Selon Guiraud, Bizet aurait refait jusqu'à treize fois cette malencontreuse chanson, puis, devant le refus imperturbable de son exigeante interprète, il aurait pris d'urgence un autre parti. Il avait entre les mains l'album « Fleurs d'Espagne », du maestro Yradier, chantées (dit le frontispice) par Mmes Malibran, Viardot, Patti, Alboni, Carvalho, Trebelli, etc., et publiées avec traduction française chez Heugel en 1864. Yradier, « maître de chant de l'impératrice des Français », mort en 1865, s'était spécialisé dans la chanson havanaise, andalouse, mexicaine, aragonaise, madrilène, et dans la musique facile. Bizet lui a pris une chanson havanaise, el arreglito (le petit arrangement, la promesse de mariage), et en a fait sa célèbre habanera. La mélodie espagnole est chantée sur des paroles (de Tagliafico) qui, par leur sens et leur prosodie, sont d'une prodigieuse niaiserie, mais elle contient toute la habanera de Carmen : même ton de ré mineur, même dessin chromatique, même motif des couplets (page 43) :
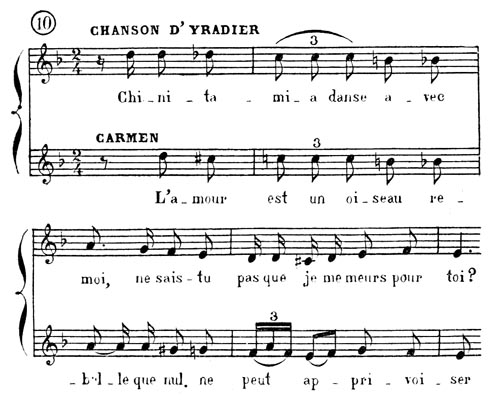
Même ton de ré majeur, même motif du refrain :
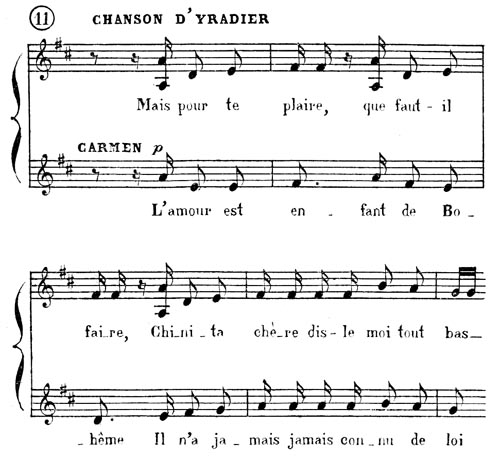
Il n'est pas jusqu'à la transition entre le couplet et le refrain (L'amour ! L'amour !) qui ne soit indiquée par Yradier ; et même l'avis fortissimo des chœurs, « prends garde à toi », se trouve intégralement dans le texte espagnol, sur ces mots « le bal commence ».
Pourtant quelle différence entre l'original et l'imitation ! A quoi tient l'effet commun, banal, béat, béta, de la chanson d'Yradier, l'effet enjôleur et musical de cette habanera libertine, spirituelle, voluptueuse ? A l'accompagnement, sans doute, on se glissent quelques frôlements délicats de secondes et de septièmes ; mais aussi à des nuances imperceptibles : au prolongement de la succession chromatique, dans la première phrase, et à ce séduisant triolet qui remplace quatre doubles croches saccadées ; à l'ingénieuse modification, qui, dans le refrain, évite la triple répétition du même groupe de notes ; à la clausule « Si je t'aime, prends garde à toi », qui, au lieu de venir mécaniquement, indifféremment, stéréotypée, est è la fois une parole, un geste, un jeu de scène, un sentiment, de la musique vivante.
Au reste, si nous osions donner un conseil aux interprètes, pour conserver à cette aimable habanera son vrai caractère, il ne faudrait pas l'appuyer, y faire des effets de voix grave ou canaille, mais chanter gaîment, en se jouant, « l'amour est enfant de Bohème », avec séduction et malice « prends garde à toi ». Cette chanson de danse, duettée avec les chœurs, qui prennent part allégrement à la plaisanterie, loin de contenir tout le drame futur, n'en est qu'un exorde badin. Carmen est d'humeur gaie ; elle a vu José affairé, indifférent ; elle l'agace, le raille et essaie de l'émoustiller. La situation ne devient sérieuse que quand le thème fatal paraît, pendant la provocation directe de Carmen, tristement soupiré par clarinettes, altos et violoncelles (page 55), et dans cette ample conclusion lyrique où tout l'orchestre chante à l'unisson (page 56) une grande phrase à la Weber, qui est comme une explosion de passion, suivie du motif fatal qui s'efface insensiblement.
Le duo de don José et de Micaëla a ravi jadis les amateurs de doux sentiments et de musique chantante, mais non de bel canto, car on trouvait la partie de ténor haut perchée et mal écrite. Avouons notre opinion : la fadeur de la musique ne le cède en rien à la fadeur des propos, Bizet a mis à cette scène la musique qu'elle méritait. La coupe du duo est d'une astuce un peu simple : récit de Micaëla, ensemble vocal, récit de don José, ensemble vocal. La ligne mélodique est exagérément banale. A la rigueur, les ténors pourraient sauver ces pages en mettant dans leur chant moins de guimauve et plus d'énergie. Toutefois, tranchons le mot : cette scène détonne, et l'on en rougit un peu pour Bizet. C'est la faute de Meilhac et Halévy, et celle du public d'alors.
Le chœur de la dispute des cigarières est, heureusement, traité d'une autre main. Rien n'est plus spirituel et plus cocasse que le papotage tumultueux et vain où s'évaporent les colères superficielles et minaudières de ces dames. L'orchestre accompagne d'un ronronnement des cordes tout à fait amusant l'histoire si dramatique de la Manuelita et celle de la Carmencita, et, de temps à autre, il éclate en cris joyeux (page 79) :

Si toutes nos choristes pouvaient détailler nettement les paroles et les notes, si elles pouvaient chanter juste, ce chœur serait un des plus agréables spécimens que nous connaissions de musique comique, qui reste de la musique. L'explication effrontée de Carmen par un fredonnement vulgaire au nez de Zuniga est également pleine d'esprit et de naturel (page 90) :
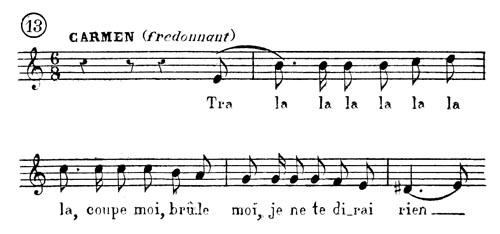
Il n'est pas probable que la Séguedille ait été empruntée par Bizet au folklore ni à quelque œuvre espagnole. La chanson a cependant un parfum de terroir, cet accent si spécial de l'art flamenco, dont on ne sait s'il est d'origine gitane ou andalouse. Le motif en est annoncé par une flûte aux sons coulés tendrement, puis gaîment piqués (page 95) :

Les violons font à la voix un accompagnement de guitares très vraisemblable ; la flûte se gausse encore délicatement, quand Carmen affirme « mon amoureux, il est au diable ! » :
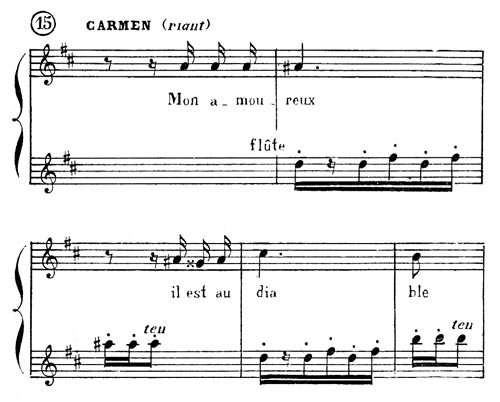
puis elle souligne de sons graves l'appel « qui veut mon âme, elle est à prendre » :
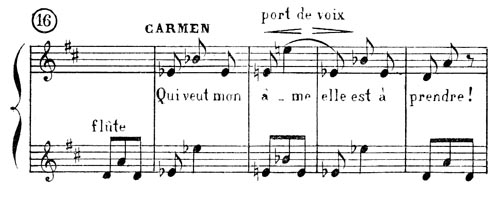
redevient sémillante quand Carmen « pense à certain officier... » et narquoise à l'idée de la séguedille qui sera dansée chez Lillas Pastia. Cette chanson si variée, que Carmen débite le plus naturellement du monde, assise et se balançant sur sa chaise, les mains liées derrière le dos, contient, sous un coloris curieux, un monologue plaisant, une invite galante avec œillades et ports de voix, quelque tendresse et émotion, un ordre impérieux. et, après la lamentable capitulation de José, un accent joyeux et âpre de triomphe. C'est un admirable exemple de tonadilla, de ces mélodies à expression variée, malléables, plastiques ; et, encore une fois, c'est de la musique vivante où l'on ne chante pas pour chanter.
Le final est un divertissement musical des plus délicats : sur le thème de la dispute des femmes (la Manuelita disait...) Bizet a composé la plus amusante des fugues à 4 parties : violoncelles, puis altos, puis seconds violons, puis premiers violons ; le développement n'a rien de laborieux ni de factice, et l'orchestre se divertit, autant que Carmen, du bon tour qu'elle va jouer à ses rivales, aux dragons et au pauvre don José.
ACTE II
Le prélude célèbre de ce deuxième acte, qu'aujourd'hui on ne remarque plus assez, mais qui autrefois était vivement apprécié, et eut, a la première, l'honneur imprévu d'un bis, est un badinage symphonique sur l'air des dragons d'Alcala, que chantera tout à l'heure don José. Deux bassons narquois exposent le thème et en font la paraphrase. Après un développement sonore où dans un fouillis harmonique très savoureux s'égaient flûtes et clarinettes, une clarinette et un basson s'amusent à un jeu paradoxal de contre-point dont l'effet comique est irrésistible (page 110) :

La descente chromatique, nasillarde et lourdaude, des bassons est plaisamment bouffonne. A la fin la flûte, le hautbois, la clarinette et le basson se repassent le thème de la façon la plus simple et la plus gracieuse. Si cet interlude n'est pas tout à fait celui qu'on attendrait au seuil du second acte, du moins est-il, en soi, symphoniquement, instrumentalement, fort spirituel.
La chanson bohème accompagnée de danses, romalis ou flamenca, est l'épisode le plus coloré de Carmen. Son effet musical est scénique et sûr. Pourtant, primitivement, il fut fraîchement accueilli, non pas seulement à cause de son allure un peu tumultueuse et débraillée, mais parce qu'il constituait comme un assassinat de l'harmonie, de la consonance : ces guitares obstinées et monotones, qui se frottent comme elles peuvent à des modulations imprévues, ce chromatisme constant, ces accouplements de notes discordantes, ces audaces, ou plutôt ces trouvailles harmoniques, choquaient les puristes, les puritains, qui eussent voulu de l'ordre et de la régularité, même dans les improvisations tziganes.
La chanson commence à l'orchestre, dans le ton inquiet et triste de mi mineur, avec une allure douce et modérée, par une ritournelle mélancolique des flûtes en tierce, sur des pincés de harpe et des pizzicati de violoncelles et altos qui contrefont les guitares (page 112) :

Puis, insensiblement, des dissonances s'introduisent qui mêlent une sorte de sauvagerie a cette sérénité presque douloureuse : il suffit de quelques do ♯ de la flûte heurtant obstinément les ré ♯ des cordes (ou réciproquement) pour produire cette sensation de dureté. De temps en temps, on entend strider, aux hautbois et clarinettes, le motif en fa majeur, puis les flûtes le reprennent doucement en écho mineur. Dans ce bouge sombre, et parmi ces danses ardentes, cette musique est à la fois énigmatique et poignante ; on la dirait faite avec le souvenir mélodique des chansons ancestrales, celles que chantaient les aïeux au pays lointain qui fut le berceau de la tribu vagabonde.
Carmen entonne le chant tzigane, tandis que les guitares raclent encore plus imperturbablement leur mi naturel contre le fa naturel de la voix (page 114) :

Encore modérée d'allure, la mélodie est pourtant entraînante, prenante, sauvage, et son refrain trivial, repris par l'assistance avec des claquements de mains, fait circuler comme un désir fou de la danse. Au second couplet, le rythme s'accentue : sur un âpre et gigantesque pizzicato de tout l'orchestre, les voix clament et les danses évoluent follement. Au troisième couplet, enfin, c'est un tourbillon vertigineux ; Carmen, énervée, égarée, possédée, secoue toutes les langueurs par son chant enfiévré dont les volutes animent cette foule grouillante et surexcitée. Elle même, la première, se laisse prendre à la griserie du rythme et du chant, et mène la flamenca. (Car, si est véritablement Carmen, elle donne de sa personne, au lieu de rester presque impassible, assise sur une chaise, comme elle le fait, hélas ! trop souvent, pendant cette orgie de rythmes et de sons.)
Escamillo fait son entrée au milieu des vivats, et immédiatement il a les honneurs d'un « air de bravoure ».
Les librettistes le proposaient ; le public le souhaitait. Bravement Bizet y est allé de deux couplets avec refrain, qui déchainent infailliblement au théâtre un enthousiasme véhément. Le bis est de rigueur.
Convenons, d'accord avec le sentiment général, que Bizet a trouvé avec un rare bonheur la phrase sonore, arrogante, béate, où s'étale avec complaisance la fatuité du bellâtre « m'as-tu vu ? » Après tout un torero ne doit pas avoir une âme très délicate ni très nuancée, et son langage doit être trivial. Il l'est.
Convenons aussi que ces couplets et leur refrain, lancés à toute volée par une voix claquante, font de l'effet quoi qu'on en ait, surtout quand les barytons les haussent d'un demi-ton, pour les faire mieux « sortir » (page 131) :
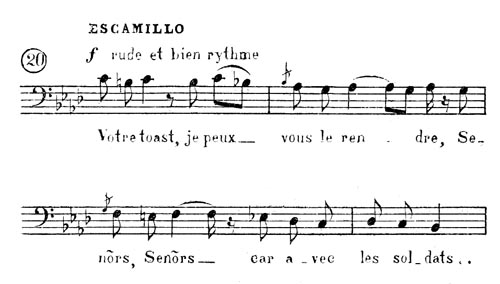
A la décharge de Bizet, n'oublions pas le sévère jugement que lui prêtait Ch. Lamoureux sur cet épisode : « Puisqu'ils veulent de l'ordure, en voilà ! »
Et, comme le musicien ne perd jamais ses droits, même quand il sacrifie à la foule et aux conventions, notons quelques amusettes, quelques nuances où s'est diverti Bizet.
Le ton des couplets est le ton énergique, mais ca peu rogue, de fa mineur. Or tandis que la phrase initiale se déroule et se termine normalement, avec des ré b sous les mots « car avec les soldats », sa reprise immédiate introduit, dans la chute finale, sous les mots « du haut en bas », un ré naturel si imprévu, que nous avons souvent entendu des barytons le négliger et terminer cette phrase comme la première.
Chaque couplet est suivi d'un refrain, dont nous avons cité le thème, lors de son apparition dans le prélude (exemple 5), et ce refrain est répété par tous les assistants. La seconde reprise de ce refrain par l'ensemble des voix, au lieu d'être identique à la première, contient une curieuse digression, une sorte de jeu de scène et de paradoxe vocal musicalement si étrange et périlleux, qu'on le supprime dans les théâtres de province, et qu'on ne le maintient guère qu'à l'Opéra-Comique : Frasquita, Mercédès, puis Carmen (page 143) disent successivement à Escamillo ce simple mot « l'amour » ; et Escamillo répond à chacune par le même mot, avec une mimique et une expression appropriées, indifférent pour Frasquita et Mercédès, enjôleur pour Carmen. Le mot est donc répété six fois. Cinq fois les voix tombent bizarrement d'une septième ; la voix de Carmen fait une chute de neuvième tout à fait remarquable ; et cette série de transitions hardies, presque baroques, ramène tant bien que mal dans le ton du refrain (fa majeur) :
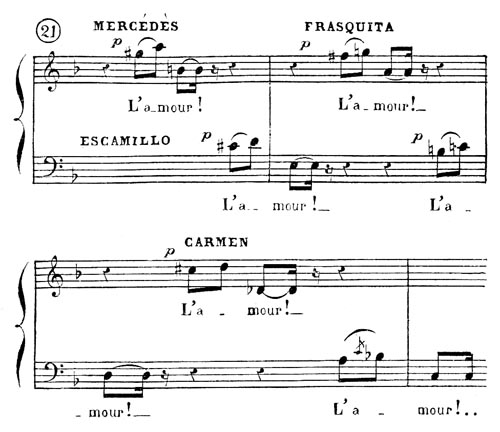
Le quintette des trois femmes, avec le Dancaïre et le Remendado, a été, dès l'origine, un des morceaux les plus appréciés de la partition. Il est construit sur un 6/16 sémillant et alerte, avec infiniment d'esprit, et constitue le hors-d'œuvre le plus véritablement comique de Carmen. Mais ce comique est toujours musical ; les ensembles présentent une division des voix toujours ingénieuse, variée, gentiment sonore, avec des oppositions très plaisantes de voix unies. Partout un chromatisme chatoyant, une instrumentation légère. Rien n'est plus charmant que la supplication ironiquement pathétique du Dancaïre et du Remendado dont les voix en tierce disent suavement « Carmen, mon amour, tu viendras », tandis que Carmen, butée, obstinée, rageuse, répète (page 161) :

Rien n'est plus plaisant que l'affirmation de Carmen « amoureuse... à perdre l'esprit ! » sur un récitatif grandiloquent, et le commentaire sautillant des deux compères : « la chose, certes, nous étonne ».
Qu'on compare ce quintette au quintette des Anglais, dans Lakmé, qui paraît en avoir été imité, on remarquera la différence d'esprit, de science, et même de distinction dans le comique.
La chanson des dragons d'Alcala, qui se chante dans la coulisse, est simple et gaie ; elle est de mise, car l'ingénu don José est tout heureux d'être enfin libre. La phrase par laquelle Carmen, après un insinuant exorde de flûte, invite José à la regarder danser pour lui seul la romalis, pastiche plaisamment le récitatif de « grand opéra », et doit être dite avec une solennité comique ; accompagné par les castagnettes et les pizzicati des cordes, l'air de danse chanté est pimpant et cajoleur (page 180) :

et les deux pistons qu'on entend de loin évoquer la retraite, le contrepointent avec habileté. Les imprécations et les basses injures de Carmen furieuse sont un chef-d'œuvre d'expression violente et populacière (page 184) :

Les protestations de José, penaud et encore timide, leur font une opposition mélodique et tendre du plus heureux effet :

Et voici la détresse, l'incertitude, la destinée de don José annoncées, sur le cor anglais, par le thème fatal, sur lequel frissonne toujours le trémolo douloureux des violons, et que scande sèchement, avec une sorte d'arrachement, le pizzicato des cordes graves. Alors c'est la fameuse phrase à qui messied tout à fait la dénomination romance de la fleur, car elle n'est rien moins qu'une romance, et les chanteurs devraient bien résister à la tentation de la sucrer, de la ténoriser : c'est un aveu naïf et tendre, mais sous lequel on sent les larmes, le désespoir ; la passion suppliante doit seule y parler (page 190) :

Sans doute le ton de ré b est généralement celui qui convient aux cantilènes suaves, mais un contre-temps incessant et haletant des flûtes, des clarinettes, marque les palpitations de l'âme apeurée et frémissante, et sous les reproches que se fait don José « je m'accusais de blasphème »... on entend murmurer si mélancoliquement les instruments tristes, cor anglais, hautbois, clarinette, que la voix doit gémir et crier, si l'artiste se préoccupe de traduire le sentiment de José au lieu de chercher un succès vocal. La meilleure preuve que Bizet voulait émouvoir et troubler, et non assurer à son ténor l'applaudissement et le bis, c'est ce plaintif gémissement qui succède à l'aveu « et j'étais une chose à toi » : bien que la conclusion « Carmen je t'aime » se fasse normalement, et même après un long arrêt et un « soufflet » sur la sensible pour finir dans le ton, l'orchestre nous égare dans une série d'accords de la mineur, ut majeur, fa majeur, qui sont très loin de la résolution en ré b, et qui, murmurés pianissimo par les sons grêles de la flûte, du cor anglais et de la clarinette, peignent admirablement, sous la phrase vocale, en apparence assurée, le désarroi, le flottement de l'âme désemparée : curieuse trouvaille expressive et musicale, mais qui jadis scandalisa les oreilles habituées aux cadences régulières et banales (page 193) :

Rien n'est plus simple, plus caressant, que la réponse de Carmen, l'invite « là-bas, là-bas dans la montagne », qui, chantée par une voix ronde et veloutée, a un charme tendre et enjôleur :

les protestations plaintives de José, qui l'entrecoupent, loin de rompre la ligne mélodique si souple et féline, l'ont un écho délicat et touchant : ni fioritures, ni effet ; la prosodie est d'une justesse parfaite et le très court unisson qui termine la scène, loin d'être factice et conventionnel, arrive naturellement, nécessairement. Une flûte narquoise, après ce moment de fusion des cœurs, commente la fraîcheur de l'idylle (page 200).
L'algarade du lieutenant Zuniga, qui vient troubler cette harmonie — déjà harcelée par les remords de José, — est encore pour Bizet prétexte à un amusant badinage : Carmen se moque de Zuniga sur un pizzicato de flûte et de cordes tout à fait railleur, mais la raillerie devient burlesque quand le Dancaïre et le Remendado se mettent à fuguer le même motif, sur l'accompagnement bouffon d'un basson goguenard qui se livre à des gargouillis et à des ricanements saccadés, d'un effet vraiment humoristique (page 206) :

L'ensemble qui termine le second acte n'est que la paraphrase de l'invitation de Carmen « là-bas... dans la montagne », paraphrase assez sonore et ample, mais qui ne se distingue pas du final conventionnel, avec grand effet d'ensemble.
ACTE III
Le prélude est d'une rare suavité : sur un accompagnement piqué des harpes, la flûte chante une belle phrase mélodique, de. grand souffle, tendre, mélancolique, qui se déploie amplement (p. 225) :

Au moment on cette phrase retombe, la clarinette, plus grave, la reprend, pendant que la flûte lui fait un riche contrepoint de broderie chatoyante et somptueusement variée : les deux instruments duettent avec un charme et une grâce inexprimables. Puis c'est le cor anglais et le basson qui reprennent ce dialogue, avec des sonorités plus sombres et plus inquiètes, pendant que les violons poussent comme des soupirs douloureux. Après un crescendo passionné on flûtes et violons déclament largement sur la répétition du thème initial par le basson et le cor anglais, la sérénité revient doucement ; les violons descendent insensiblement, tandis que le motif s'élève à nouveau sur la flûte et finit très haut, très doux. Cet interlude a la grâce et la tendresse d'une page de Mozart. Nous ne reprocherons pas à Bizet de l'avoir composé pour l'Arlésienne et de l'avoir utilisé dans Carmen (car quels reproches semblables ne faudrait-il pas faire à Haendel ou à Gluck ?) mais nous avouerons que ce régal délicat est un peu inattendu à ce moment du drame et pour annoncer le sombre troisième acte.
L'arrivée des Bohémiens se fait au son d'une marche étrange et douce, dont le dessin est tracé par la flûte mélancolique sur le rythme des altos et violoncelles (page 227) :

Marche hasardeuse, inquiète, car elle est dans le ton d'ut mineur mais fait se succéder les la b et les la naturel avec la plus tranquille indifférence tonale et les plus curieux effets de sonorité. Le chœur des bohémiens est mystérieux comme la marche, avec son accompagnement par couches chromatiques ; aucune harmonie sereine et rassurante ; et, pour finir, une prodigieuse dégringolade harmonique des voix et des instruments (bois, cors, cordes) : pendant que les ténors procèdent en tierces majeures, qui descendent mollement par degrés chromatiques, la voix des basses fait avec eux une série d'accords de septième (avec suppression de la tierce) dont chacun, au lieu de se résoudre naturellement, est suivi d'une quinte augmentée. C'est sur une de ces quintes que s'arrête la descente, en porte à faux. L'effet est des plus curieux, des plus audacieux, et ce jeu harmonique n'est pas seulement savoureux en lui-même ; il est parfaitement descriptif d'un état d'âme aventureux et approprié à cette marche en montagne, dans la nuit (page 230) :

Le trio des cartes, qui est célèbre (mais malheureusement n'est pas toujours chanté très d'aplomb, au théâtre), oppose d'une façon conventionnelle, mais scénique, les commérages futiles et joyeux des rieuses Frasquita et Mercédès à la sentence de mort que Carmen lit elle-même dans les cartes. Le motif diabolique, ici particulièrement strident (page 256), est exposé par la flûte, mais se termine par une descente chromatique et rageuse des cordes, qui fait le plus lugubre effet, et aboutit à un sinistre accord dissonant de septième diminuée, suivi, après les mots « pour tous les deux, la mort », d'un autre accord dissonant asséné par les cuivres, et qui semble le coup brutal du sort. L'air des cartes lui-même, en fa mineur, est d'une sombre et belle déclamation lyrique ; la monotonie lourde et traînante de son accompagnement marque l'oppression de l'idée qui dorénavant pèsera sur Carmen (page 257) :

Les grondements de timbales qui le soulignent vers la fin marquent comme un tremblement, et, après un dernier accord de septième diminuée, la chute sur un ut de la voix et de la basse, sèche, dure, nue, fait l'effet d'un choc brutal. A partir de ce moment, la partition, qui s'est progressivement assombrie, ne perdra plus son caractère tragique.
L'ensemble en sol b « quant aux douaniers, c'est notre affaire » avait été écrit pour l'Arlésienne. D'une allure décidée, d'une franche carrure, il est construit dans le style d'un morceau à effet. Cependant, remarque-t-on assez, sous l'unisson brillant des soprani, le dessin libre d'ingénieux contrepoint que trace la voix de Carmen ?
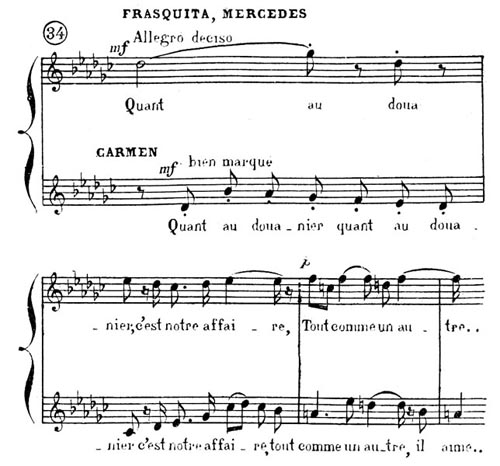
Il en est presque toujours ainsi, chez Bizet : lorsque le livret et les convenances lui imposent un morceau de coupe et de style traditionnels, il cherche quelque subtilité musicale qui puisse attirer l'attention des délicats, pendant que le gros public ne saisira que l'effet d'ensemble. Au beau milieu du chœur, on entend même (pas en province, on ce passage est supprimé) une curieuse transition, une descente de la naturel à ré b par cinq tons entiers, qui devait paraître étrange et audacieuse à une époque où la gamme hexatone était un épouvantail (page 272) :

Nous retombons dans la plus désolante banalité avec l'air de Micaëla. Encore une fois, honnis soient les librettistes qui y ont sollicité Bizet. La ritournelle de clarinette qui amorce ce récitatif est des plus vulgaires ; heureusement la ritournelle de cor qui introduit l'air lui-même est plus pittoresque ; on l'entend volontiers reparaître entre les deux couplets, puis pour renforcer la phrase finale, et pour révoquer en écho (page 279) :

Cet air (destiné d'ailleurs à une Griselidis projetée) a-t-il assez, avec sa phrase carrée de 16 mesures, la coupe traditionnelle de toutes les cavatines et romances sentimentales ! est-il assez banal dans son développement agité, banal dans son second couplet si filandreusement étiré, banal dans ce long et doucereux point d'orgue sur la sensible qui le termine, avant que la voix ne retombe, par une cadence parfaite, sur la tonale ! Et qu'est-ce, quand les chanteuses (c'est la règle, en province) intercalent entre le ré et le mi b de la fin un si b aigu qui fait pâmer les amateurs de bel canto ! Non, le duo du 1er acte et cet air, tout le rôle de Micaëla ne sont pas musicalement défendables.
La rencontre de José et d'Escamillo, tant qu'elle est une conversation dégagée et libre, est d'une déclamation forte et sobre quand elle devient le duo de bravoure qui précède tous ces duels classiques, elle évoque un peu trop une situation analogue de Faust, et manque d'originalité. En revanche, le remerciement d'Escamillo à Carmen, après l'opportune intervention de celle-ci et un chant reconnaissant de violoncelle avec basson, est d'une ligne si bizarre et si imprévue, de modulations si hardies, qu'il effraie beaucoup de barytons et n'est pas toujours chanté juste :

Ses adieux sont suivis d'une reprise par l'orchestre du motif « toréador, en garde » enchevêtré d'un dessin énigmatique et troublé des basses, qui laisse une curieuse impression de désarroi.
C'est que la situation est une des plus pathétiques qui soient : à la prière langoureuse, mais émouvante de Micaëla, s'opposent les sarcasmes de Carmen, qui invite José à déguerpir (page 302) :
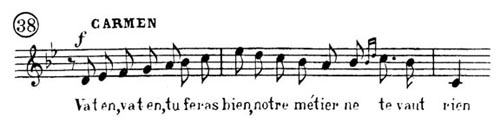
José riposte par les hurlements de fureur, pendant que l'orchestre se déchaîne. Sa première phrase de détresse

se termine sinistrement par cet accord de septième diminuée, brusque et sec, qui semble comme le leitmotiv de son aveuglement fatal ; la seconde (« je te tiens, fille damnée... ») se termine sur l'accord de la tonique qui prend ici un caractère impérieux, péremptoire, brutal : « Je ne partirai pas. » Quand un ténor, ici, ne songe plus ni à chanter, ni à ménager sa voix, mais à vivre son rôle, à vociférer sa haine et sa jalousie féroces, la scène est d'un tragique inégalable : nous avons vu des ténors, emportés par le mouvement dramatique et musical, secouer Carmen avec furie, la renverser farouchement, la heurter frénétiquement contre le sol ; nous avons vu des Carmen se relever effarées et meurtries ; nous avons même vu des choristes, emportés par l'émotion et le feu de l'action, gesticuler et vivre.
La conclusion de cette scène effroyable est d'une brève simplicité : dernière prière de Micaëla, cri douloureux de José songeant à sa mère, évocation du motif fatal, gémi deux fois dans le même ton, par les bois, comme un sanglot, chant d'Escamillo alerte et joyeux, au loin. L'émotion est à son comble.
ACTE IV
Le prélude du 4e acte, le plus adéquat à l'action des trois interludes, n'est pas aussi gai que son début agité, saccadé, tourbillonnant pourrait le faire croire. Le tumulte des guitares et des tambourins de fête laisse bien en dehors une phrase que le hautbois soupire avec une poignante mélancolie, comme le gémissement d'une âme blessée, et dont la flûte et la clarinette unies font un commentaire navré (page 311) :

Ce motif revient avec insistance ; il s'affirme, dans un ensemble fortissimo des cordes, avec un caractère plus âpre et mélodramatique puis le hautbois, de plus en plus mélancolique, le murmure encore à mi-voix, et les doux triolets montants de la flûte terminent dans une sorte de rêve inquiet et las ce prélude à un jour de fête. Combien de mélodies et de danses espagnoles, que l'on croit joyeuses et débridées, ont ce caractère d'amertume et de mélancolie ! Il faut, pour s'en rendre compte, feuilleter les albums de Granados ou d'Albeniz. Bizet, cette fois-ci, s'est inspiré franchement du folklore espagnol, mais le chant populaire dont il a fait usage, avant d'être populaire en Espagne, était un polo que chante avec guitare un étudiant, sous la fenêtre de sa bien-aimée dans El criado fingido (le domestique supposé), comédie musicale composée en 1804 par le fameux chanteur Manuel Garcia, le père de la Malibran et de Mme Viardot.
Le 4e acte se divise en deux parties qui font contraste : l'une, toute de joie, de lumière et de sonorités, l'autre, toute de fureur et de drame. C'est une erreur de développer l'une aux dépens de l'autre, comme on le fait généralement à l'étranger, en province, comme on l'a fait même à l'Opéra-Comique. Pour allonger la fête à Séville, et pour utiliser le corps de ballet, n'a-t-on pas tiré de l'Arlésienne et de la Jolie fille de Perth des airs de danse qui ont permis toute une chorégraphie... andalouse ? Sans doute la danse bohémienne de la Jolie fille est admirable de mélancolie troublante, puis d'agitation fiévreuse, puis de rythme vertigineux, mais Bizet n'a pas cru à propos de l'utiliser ni de faire durer un quart d'heure de plus une scène, qui, à cet endroit du drame, doit être brève. A plus forte raison ne doit-on pas ajouter là les divers hors-d'œuvre dont nous avons parlé en faisant l'analyse du livret.
Donc, chœur de la foule bariolée, grouillante, criarde, des promeneurs et des vendeurs ; puis au loin on entend une marche, celle qui avait servi de thème au prélude du premier acte, annoncée confusément par les bassons, appuyée par les clarinettes, puis par les hautbois et les flûtes en un crescendo joyeux. C'est l'arrivée de la cuadrilla ; les chulos acclamés par un chœur de belle carrure et de grand élan, les banderilleros salués par les soprani, dont les voix paraissent toujours grêles et mal assurées, les picadors accueillis par un chœur tumultueux et fugué dont l'exécution est vétilleuse. L'orchestre redouble d'éclat, dans un imposant tutti, pour saluer l'espada, qui entre au son de la marche triomphale, tandis que les chœurs entonnent à pleins poumons le refrain d'Escamillo. Vivat général. Echange de tendresses un peu poncif entre Escamillo et Carmen (p. 341) :

altos et violoncelles chantent à l'envi d'Escamillo cette phase d'amour ; les violons la reprennent à l'envi de Carmen, qui semble n'avoir jamais été si tendre ni si langoureuse. Un charmant babillage des flûtes en tierce sur les tierces montantes des bassons, forme un accompagnement à la fois guilleret et inquiétant aux avis de Frasquita et Mercédès à Carmen, car don José rôde par là. Carmen l'attendra vaillamment, mais non sans que l'orchestre laisse voir quelque trouble et un sombre pressentiment sous son apparente désinvolture.
C'est enfin la scène grandiose, atroce, le point culminant du drame, la scène la plus touchante, la plus émouvante, la plus poignante que Bizet ait écrite, et qui ait peut-être été écrite dans toute la musique dramatique, une scène simple, sobre et forte, où nul ne chante pour chanter, où l'orchestre et les voix souffrent, gémissent, menacent, agissent, une scène déchirante, que les artistes ne peuvent mener de sang-froid, et que les auditeurs ne peuvent entendre et voir sans avoir le cœur serré, une scène d'une si grande beauté que personne n'ose la contester, une scène où l'on est en face de la vie. Nulle part ailleurs la déclamation n'a plus de puissance expressive : dès les premiers mots de José, Carmen lui signifie sèchement sa froide décision (page 347) :

Supplication plaintive de José, que commente le chant émouvant des violons (page 348) :

Réponse dure et coupante de Carmen :

Exaltation douloureuse de José ; répliques de Carmen, toujours plus décevantes et péremptoires : duo où les voix se mêlent, mais pour s'opposer, car les cœurs ne battent plus à l'unisson ; stupeur navrante de José : « tu ne m'aimes donc plus ! », et réponse des cordes par un raclement farouche ; dernière supplication par laquelle s'unissent et la voix de José et l'éloquence des violoncelles :

Cris de désespoir et d'affolement. On entend au loin, dans la plaza, la fanfare des courses et les cris qui saluent Escamillo : Carmen veut le rejoindre ; duel, véritable corps a corps ; les contrebasses raclent sinistrement, obstinément une gamme chromatique montante et descendante qui soutient lugubrement les ripostes acérées des deux adversaires. Nouvelles acclamations dans la plaza. Mors éclate, immense, sonore, étouffant tout, le motif de honte, de déchéance et de mort ; c'est l'orchestre tout entier qui l'assène. José vocifère, ordonne, grandit démesurément, domine Carmen épouvantée et traquée, subjuguée malgré son indépendance et sa révolte. Il lui barre le chemin et la frappe. Puis toute son énergie s'affaisse, se détend ; il n'est plus qu'un être lamentable, une loque, un enfant, et tandis que retentit encore, implacable et justicier, le motif du sort, qui obsède les oreilles et les yeux comme le symbole de l'antique Fatalité, José murmure, brisé, cette pauvre phrase naïve et douloureuse (page 363) :

qui bouleverse et fend le cœur, ahurit et déconcerte l'esprit, cette humble phrase où Nietzsche découvre « tout l'esprit tragique qui est l'essence de l'amour ».
***
Telle est cette œuvre, faite de génie, faite d'âme, par un musicien averti, consommé, maître de sa technique et de sa forme, mais chez qui le savoir-faire ne prédomine jamais sur l'émotion sincère et créatrice, musique « nerveuse, chaude, souple, selon l'expression si juste de M. Paul Landormy, qui traduit le drame d'une façon tellement immédiate, qu'elle semble faire corps avec lui », musique la plus directement, la plus franchement dramatique et vivante que nous ayons sur notre théâtre, musique qui vous étreint, chaque fois qu'on la réentend, et que l'on n'oublie pas.
Il y a si peu, chez Bizet, d'art, de système, de procédé, que Carmen est restée une œuvre unique ; elle n'a pu servir de modèle, puisqu'elle est faite d'émotion et de vérité. Bizet n'a pas fait école, encore que certains véristes italiens eussent bien voulu découvrir son secret, car son secret est son génie. L'artiste vrai, l'artiste original, selon un mot connu de Chateaubriand, n'est pas celui qui n'imite personne, c'est celui que personne ne peut imiter.
Bizet meurt trop tôt, observe Claude Debussy (cf. M. Croche, antidilettante, page 136), « et quoique laissant un chef-d'œuvre, les destinées de la musique française sont remises en question : la voilà encore, telle une jolie veuve, qui, n'ayant autour d'elle personne d'assez fort pour la conduire, se laisse aller dans des bras étrangers qui la meurtrissent ».
Les documents les plus intéressants sont ceux qui émanent de Bizet lui-même, ses Lettres (Rome, 1857-1860. — La Commune, 1871) publiées par Louis Ganderax dans la Revue de Paris (1907-1908) et en un volume (Delagrave, 1909) ; les Lettres à un ami, Edmond Galabert, publiées par celui-ci (Calmann-Lévy, 1909) ; les Lettres à Paul Lacombe (1866-1874) et quelques billets à Ernest Guiraud, publiés par Hugues Imbert dans son volume Portraits et Etudes (Fischbacher, 1894). On trouvera encore quelques lettres dans le volume de Marmontel, Symphonistes et virtuoses (1881).
La source de tous renseignements est le beau livre, pieux et admiratif, de Ch. Pigot, Georges Bizet et son œuvre (Delagrave, 1886. — Nouvelle édition, 1911). On lira avec intérêt l'étude un peu acerbe et ironique, signée par M. Henry Gauthier-Villars, Bizet, dans la collection « Les musiciens célèbres » de la librairie Laurens (1911). A l'étranger, deux livres intéressants, celui de Mastrigli, Giorgio Bizet (1888), en italien, et celui de Weissmann, dans la collection « die Musik » publiée à Berlin chez Marquard.
A côté de ces livres, d'importantes études : celle de Camille Bellaigue : Georges Bizet, sa vie et son œuvre (Revue des Deux Mondes, 1889. — Recueillie dans l'Année Musicale, 1889-1890. Delagrave, 1890) ; celle de René Brancour (conférence faite à Nancy et publiée dans la Revue Musicale, 1909).
Les articles de Reyer dans les Débats ont été réunis dans le volume Quarante ans de Musique (1910) ; ceux d'Adolphe Jullien, dans le volume Musiciens d'aujourd'hui (1re série, 1892). Trois articles intéressants de Wilder dans le Ménestrel de juillet 1875.
Outre les articles de journaux et revues que l'on retrouverait à leur date, signalons les commentaires auxquels a donné lieu la millième de Carmen : les articles de Gustave Charpentier et Gabriel Fauré (Figaro, 23 et 24 décembre 1904), les articles d'Alfred Bruneau et G. Pioch (Musica, janvier 1905), l'article de Ludovic Halévy (le Théâtre, 1er janvier 1905), de A. et J. Charlot (l'Art du Théâtre, janvier 1905).
Il faut lire également les affectueuses lettres de Gounod à Bizet (Revue de Paris, décembre 1899).
Le Cas Wagner et Nietzsche contre Wagner ont été traduits par Henri Albert dans le volume de Nietzsche qui contient le Crépuscule des Idoles (Mercure de France).
Enfin, sur Bizet, et pour replacer Bizet dans son entourage et dans son temps, nous renvoyons à l'Histoire de la musique de Paul Landormy (Delaplane) et à l'ouvrage de Julien Tiersot : Un demi-siècle de musique française (Alcan, 1918).
La partition chant et piano de Carmen est éditée par la maison Choudens, 30, boulevard des Capucines, à Paris.
Table des matières
II. EVOLUTION MUSICALE DE BIZET
III. « CARMEN » : HISTOIRE DE L'ŒUVRE
IV. LE LIVRET