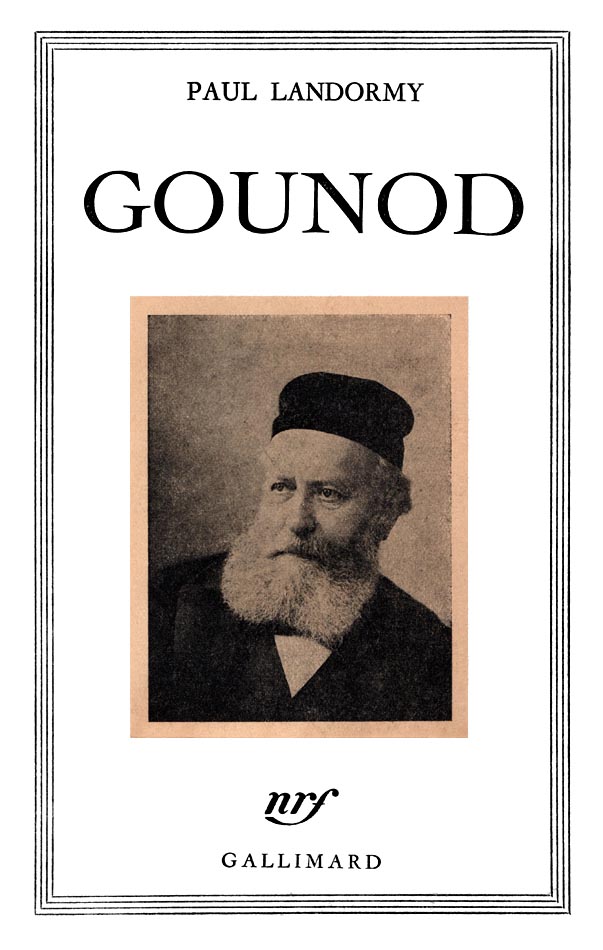
PAUL LANDORMY
GOUNOD
Gallimard
1942
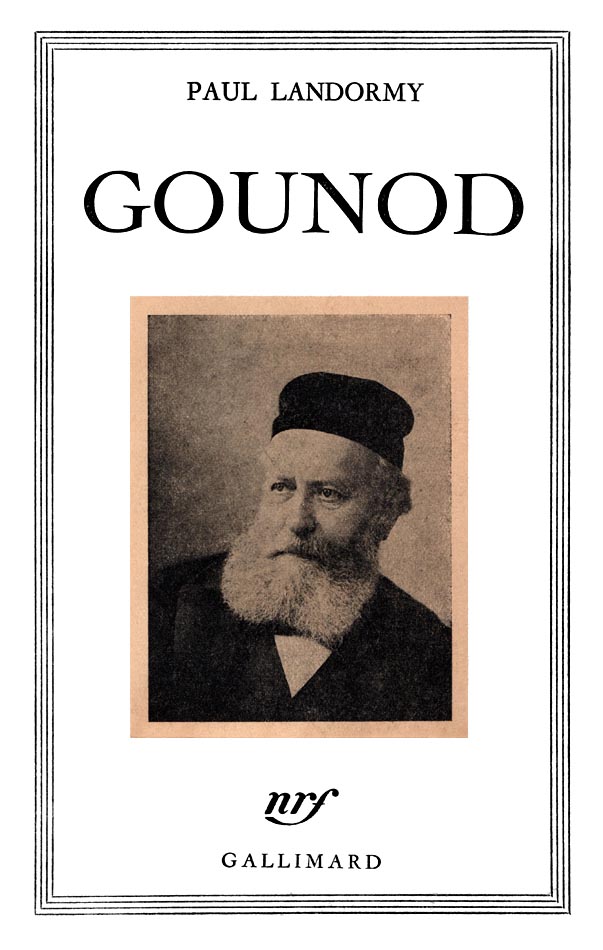
TABLE
Les deux premières pièces
Chapitre I. — La famille de Gounod. — Son enfance. — Sa jeunesse. — Rome.
Chapitre II. — Retour à Paris. — Sapho. — Ulysse. — La Nonne sanglante.
Chapitre III. — Faust.
Chapitre IV. — Le Médecin malgré lui. — Philémon et Baucis. — La Reine de Saba. — Mireille.
Chapitre V. — Roméo et Juliette.
Chapitre VI. — Voyage à Rome. — Faust à l'Opéra.
Chapitre VII. — Trois années à Londres.
Chapitre VIII. — Cinq-Mars. — Maître Pierre. — Polyeucte. — Le Tribut de Zamora.
Chapitre IX. — Rédemption. — Mors et Vita.
Chapitre X. — Les dernières années.
Chapitre XI. — Gounod dans l'histoire.
A la mémoire de Pol Plançon
Les deux premières pièces que je vis représenter à l'Opéra, — j'avais alors sept ans, — furent l'Africaine et Faust. Immense joie, éblouissement, extase ! Je ne perdis pas un seul instant de vue le spectacle, sinon pour contempler la fosse de l'orchestre qui m'attirait presque autant que la scène. Il me fallait reconnaître chaque instrument ou groupe d'instruments qui jouait à son tour. Quant à la musique elle ne m'étonnait nullement. Je l'entendais constamment jouer et chanter dans ma famille dont Meyerbeer et Gounod étaient les dieux. Ils étaient les dieux incontestés du jour. Ces deux noms, très contrastants, résumaient le goût de toute une époque : Meyerbeer avec ses gros effets, son coloris voyant, sa rhétorique pompeuse et son pathétique écrasant ; Gounod avec sa tendresse caressante, ses nuances délicates et sa suavité. Le public confondait dans une même admiration ces deux compositeurs si divers et ne s'apercevait pas que l'art sans sincérité de l'un représentait déjà le passé tandis que l'art tout spontané de l'autre ouvrait le retour à la véritable tradition française et les portes de l'avenir.
Que ces représentations de l'Opéra d'alors sont déjà loin de nos habitudes d'aujourd'hui. La salle éclairée par cet affreux lustre au gaz, si lourd, si encombrant qui enfumait le plafond et sous lequel, aux fauteuils, on ne s'asseyait jamais sans la crainte d'une rupture de chaîne et d'une chute intempestive. La rampe, — au gaz aussi, naturellement, — d'un éclairage terne et peu varié. Le chef, devant le trou du souffleur, en avant de son orchestre, auquel il tournait par conséquent le dos. Très mauvaise position pour diriger les instrumentistes, mais excellente pour repêcher les chanteurs égarés. Je me rappelle Altès, l'étriqué, avec ses gestes d'automate, raide et sans vie, le bras droit seul agissant, comme détaché du reste du corps immobile sur le fauteuil magistral. Une seule exception dans tout le répertoire : lors du fameux unisson des cordes au début du dernier acte de l'Africaine, Altès déplaçait ce fauteuil mobile d'un quart de tour à gauche pour faire face aux premiers violons ; c'était tout ; et il n'en continuait pas moins de battre la mesure comme un automate. Une fois l'unisson terminé, il reprenait la position normale et n'en bougeait plus. Une marionnette !
Pour Faust, le chef le plus habituel était Madier de Montjau, un agité celui-là, un gros gaillard aux bras interminables qui fouettaient l'air à grands coups d'archet, d'un archet qui semblait atteindre les quatre coins de la salle. Dans ce temps-là, ce n'était pas avec la mince et courte baguette d'aujourd'hui que l'on conduisait l'orchestre, c'était avec un archet de violon, pour bien marquer la tradition qui exigeait que le chef fût un violoniste. Taffanel, le premier, je crois, releva de leur discrédit à cet égard les instruments à vent.
De cette époque date mon affection pour Gounod, affection qui ne cessa de s'approfondir, tandis que je me détachais de plus en plus de ce Meyerbeer dont on m'avait tellement chanté les louanges et dont je finis par reconnaître la médiocre valeur. Affection qui s'augmentait de ce fait que la figure du compositeur ne m'apparaissait pas indécise et lointaine. Voici pourquoi : J'avais perdu mes parents de très bonne heure. Je fus élevé par des amis dévoués, ma marraine et son mari, mon tuteur. Celui-ci était professeur dans un lycée et il se trouva qu'il fut demandé pendant quelque temps à Saint-Cloud pour donner des leçons au fils de Gounod, Jean. Chaque fois qu'il y allait, ou presque, il voyait le père qui le retenait après la leçon et lui faisait déchiffrer la dernière mélodie parue (il avait une jolie voix et il était bon musicien). Il en rapportait un exemplaire revêtu d'une charmante dédicace. On me montra plus tard ces précieux souvenirs que je contemplais avec respect et une sorte d'affectueuse gratitude. Gounod était pour moi un peu l'un des nôtres. Je n'admettais point qu'on en dît du mal.
Cependant, la réputation de Gounod passait par bien des états successifs. Tout d'abord il ne fut pas universellement compris. On le jugea trop savant et sans mélodie. Première appréciation de courte durée. Ce fut ensuite l'engouement. Après quoi vint le dénigrement par les compositeurs de musiques plus complexes ou plus raffinées. Gounod était jugé dès lors trop simple, trop facile, vraiment fade et presque banal. On le méprisait. Enfin, la musique « difficile » eut son temps et l'on en revint, vers 1918, avec les « Six » notamment, au goût d'une certaine simplicité dont on trouvait le modèle idéal chez Gounod. Ce « retour » à l'auteur de Faust marque une tendance assez générale encore chez les jeunes d'aujourd'hui.
En attendant les variations ultérieures, profondes ou seulement apparentes, du goût des délicats, le nom de Gounod est devenu presque tout de suite et il est resté l'un des plus populaires parmi ceux de tous nos musiciens. Nul auteur n'a été plus joué en France et dans tous les pays. Son Faust fait encore recette à notre Opéra ; toutes les fois qu'on l'affiche on est sûr de remplir la salle et d'attirer un public qui semble se renouveler indéfiniment. Les gens qui, dans toute leur vie, ne sont allés qu'une fois à l'Opéra, pour admirer la salle, l'escalier et le foyer, ont vu Faust.
Qu'est-ce donc qui fait le prestige de ce compositeur incomparable ? Ce n'est pas surtout la grandeur, ce n'est pas la puissance. C'est le charme. Et, plus encore, c'est la simplicité, c'est l'intimité, la familiarité qui ne va pas cependant sans beaucoup d'art, sans un art très relevé et une science parfaite. Il y a dans Gounod des pages, nous le verrons, qui rappellent Mozart, lui aussi intime et familier parfois, mais d'une familiarité si délicate et alliée à une telle perfection.
Et puis Gounod a le don de toucher en nous en même temps des fibres très diverses. Il a une manière très heureuse de mélanger sans cesse le profane et le sacré. Il ne peut parler d'amour sans une certaine gravité, sans un certain détachement des faiblesses de la chair, qui donne à ses effusions les plus tendres un caractère presque religieux. Et d'autre part quand il écrit pour le temple, quand il entre dans le douzaine de la musique religieuse, c'est pour nous émouvoir par des phrases qui font allusion à l'amour humain presque autant qu'elles expriment l'amour de Dieu, et qui traduisent l'adoration du Créateur presque dans les mêmes termes que l'adoration des créatures.
Musicien universel en vérité à la fois par la pluralité de ses dons et par le privilège qu'il possède de satisfaire toutes les catégories d'auditeurs, par ce qu'il apporte d'aliment à nos façons diverses de sentir.
Homme de piété autant que de musicalité ; sorte d'apôtre de l'art en même temps que de la religion. Il faillit devenir prêtre. Il y a en lui de l'homme d'église, comme aussi de l'homme de théâtre. C'est ce que nous comprendrons mieux en parcourant sa vie et ses œuvres, en suivant d'un peu près le cours de son existence et de sa production et en tâchant de pénétrer son âme.
***
Nous allons prendre un chemin par où d'autres ont déjà passé, et nous tenons à signaler ici trois auteurs et trois ouvrages d'importance : celui de Camille Bellaigue d'abord, écrit avec amour et dans une connaissance tout à fait intime de son sujet ; en un sens, c'est un livre définitif ; celui de J.-G. Prodhomme et A. Dandelot (2 volumes), auquel il faut toujours en revenir pour l'exactitude du détail, car c'est le recueil le plus complet qu'on puisse imaginer de documents sur Gounod, sur sa famille, sur sa vie et sur ses œuvres, travail considérable qui dispense désormais d'une foule de recherches ; celui enfin de P.-L. Hillemacher, qui est un court et vivant tableau habilement brossé par un témoin, d'une grande partie de la vie artistique du compositeur. Mais ces trois excellents ouvrages datent de bien des années déjà. Et il n'est pas de livre de critique ou d'histoire qui n'ait quelque chose de transitoire. Tous doivent être repris un jour ou l'autre et accordés à de nouveaux états de l'opinion. Ce que nous avons justement voulu essayer d'établir, en reconnaissant d'ailleurs tout ce que nous devons à nos devanciers, c'est ce qu'est devenue la figure de l'auteur de Faust pour un homme de 1940, très éloigné d'être resté un homme de 1900 ou de 1920.
LA FAMILLE DE GOUNOD. — SON ENFANCE. — SA JEUNESSE. — ROME.
Gounod, voilà un nom, avec sa désinence en od, qui sent le Jura, la Franche-Comté. Au XVIIe siècle, il y eut à Besançon toute une dynastie de Gounot, orfèvres, peut-être les ancêtres de notre Gounod. Mais à coup sûr l'auteur de Faust descendait d'un Antoine Gounod et d'un Nicolas, son fils, « fourbisseurs du Roi », d'un François Gounod, son petit-fils, dessinateur et peintre, qui habitèrent au Louvre de 1630 à 1806. Sous l'ancien régime, en effet, depuis Henri IV, et sous la Révolution, la grande galerie du bord de l'eau logeait des artistes et des gens de lettres : le sculpteur Pajou, les peintres Verney, Greuze, Fragonard, Isabey et bien d'autres. Le métier de « fourbisseur » qui était celui des premiers Gounod, consistait essentiellement à « fourbir, monter, garnir et au besoin dorer, ciseler et damasquiner les épées », mais comprenait naturellement bien d'autres petites habiletés annexes.
François-Louis Gounod, le père de notre compositeur, naquit au Louvre le 26 mars 1758. Dessinateur et peintre, il concourut plusieurs fois pour le prix de Rome, mais n'arriva jamais à gagner qu'une seconde récompense. Un de ses camarades, premier prix, étant mort à Rome, on accorda à François le privilège de toucher la pension vacante et il fut envoyé à l'Académie de France comme surnuméraire. Il avait surtout du talent, — et un talent remarquable, universellement réputé, — comme dessinateur, plutôt que comme peintre. A la mort de son père, le 31 janvier 1795, on lui conserva son logement au Louvre. Quelque temps auparavant, il était entré à l'Ecole polytechnique en qualité de « dessinateur pour la figure, puis maître de dessin ». Il n'y resta que seize mois. Il préférait sa liberté. Le 24 novembre 1806, François Gounod, âgé alors de 47 ans, épousait Victoire Lemachois, fille d'un avocat de Versailles. C'était une très bonne musicienne. C'était aussi une âme courageuse. A Rouen, dès l'âge de 11 ans, pour aider à la vie de famille que la Révolution avait rendue précaire, elle donnait des leçons de piano, retenant sur ses modestes gains ce qu'il lui fallait pour prendre des leçons elle-même : pour aller en prendre une tous les trois mois, à Paris, avec Adam, le père d'Adolphe Adam et le « grand-père » du Chalet.
La mère de Victoire Lemachois, au dire de son petit-fils, « à la fois poète et musicienne, composait, chantait, jouait la tragédie comme Mademoiselle Duchesnois et la comédie comme Mademoiselle Mars ». C'est peut-être de ce côté de son ascendance que Charles Gounod tenait les aptitudes artistiques les plus nettes et les plus profondes.
Sous l'Empire, François Gounod fut pensionné, comme « délogé du Louvre ». Sous la Restauration, il devint dessinateur du cabinet du duc de Berry, dès le 1er octobre 1814 et, bientôt après, maître de dessin des Pages de la Chambre du Roi. Mais il fut un professeur assez irrégulier, assez négligent. C'était un rêveur. Et puis, il avait la santé délicate.
Charles Gounod raconte de son père le trait suivant : « M. Denon, alors conservateur du musée du Louvre, et en même temps, je crois, surintendant des musées royaux de France, avait pour mon père beaucoup de sympathie et faisait grand cas de son talent comme dessinateur et comme graveur à l'eau-forte. Il proposa un jour à mon père l'exécution d'un recueil de gravures à l'eau-forte destiné à reproduire la collection composant le Cabinet des Médailles, et lui assumait en retour et jusqu'à l'achèvement de ce travail, un revenu annuel de dix mille francs. Pour un ménage qui n'avait rien, c'était, dans ce temps-là surtout, une fortune ; et il y avait à faire vivre un mari, une femme et deux enfants. Mon père refusa net, se bornant à quelques portraits et à des lithographies qu'on lui commandait, et dont plusieurs sont des œuvres de premier ordre, conservées encore aujourd'hui dans les familles pour lesquelles elles avaient été exécutées. »
Mais même dans l'exécution de ces portraits et de ces lithographies, François Gounod faisait preuve d'une certaine mollesse, d'une certaine veulerie. C'était toute une affaire pour lui d'aller jusqu'au bout de l'ouvrage. Et il fallait que Mme Gounod, que sa femme vînt à son secours. « Que de fois elle a dû charger et nettoyer elle-même la palette ! Et ce n'était pas tout. Tant qu'il ne s'agissait que du côté humain du portrait, de l'attitude, de la physionomie, des éléments d'expression du visage, les yeux, le regard, l'être intérieur en un mot, c'était tout plaisir, tout bonheur ! Mais quand il fallait en venir au détail des accessoires, manchettes, ornements, galons, insignes, etc., oh ! alors la défaillance arrivait ; l'intérêt n'y était plus ; il fallait de la patience ; c'est là que la pauvre épouse (heureusement si bien douée) prenait la brosse et endossait la partie ingrate de la besogne, achevant, par l'intelligence et le courage, l'œuvre commencée par le talent et abandonnée par la crainte de l'ennui. »
Charles Gounod, le compositeur, n'avait heureusement pas hérité de son père cette mollesse au travail. Il fut toute sa vie courageux comme sa mère et travailla souvent au détriment de sa santé, qu'il eut faible, comme son père.
Le fils nous fait encore du père le portrait que voici : « Au nombre des impressions qui me sont restées de lui, je distingue surtout son attitude de lecteur attentif, assis, les jambes croisées, au coin de la cheminée, portant des lunettes, habillé d'un pantalon à pieds en molleton, d'une veste à raies blanches, et coiffé d'un bonnet de coton tel que le portaient, d'habitude, les artistes de son temps et que je l'ai vu porter encore, bien des années plus tard, par mon illustre et regretté ami et directeur de l'Académie de France, à Rome, M. Ingres. »
Et il ajoute : « Pendant que mon père était ainsi absorbé dans sa lecture, j'étais, moi, couché à plat ventre au beau milieu de la chambre et je dessinais, avec un crayon blanc sur une planche noire vernie, des yeux, des nez et des bouches dont mon père avait lui-même tracé le modèle sur ladite planche. Je vois cela comme si j'y étais encore, et j'avais alors quatre ans ou quatre ans et demi tout au plus. Cette occupation avait pour moi, je m'en souviens, un charme si vif que je ne doute nullement que, si j'avais conservé mon père, je fusse devenu peintre plutôt que musicien. »
Le 4 mai 1823, François Gounod mourait, laissant sa femme seule avec ses deux enfants, Urbain, né en 1807, qui devait être architecte et mourir jeune, Charles, notre Gounod, né le 17 juin 1818.
Qu'est-ce que Charles ne dut pas à cette excellente mère ? Il l'eut d'abord pour nourrice, — « bonheur, indique-t-il lui-même, de plus en plus rare... L'allaitement contient plus d'éducation qu'on ne croit. S'il n'est pas, comme la langue, une transmission d'idées, il est, très probablement du moins, le véhicule d'une foule d'instincts, d'aptitudes, d'inclinations qui ajoutent autant de plus à la ressemblance de l'enfant avec sa mère, et, si ces instincts, ces inclinations, ces aptitudes sont aidés, couvés, fécondés par une culture spéciale et assidue, ils deviennent des facultés directives et productrices qui déterminent ce qu'on nomme une vocation, c'est-à-dire la marque d'une tendance et le gage d'une destinée. » Il sait tout ce qu'il doit à cette mère admirable qui n'hésita pas un instant à prendre le rude métier de professeur de piano pour élever ses enfants. « Certaines âmes, disait Gounod, sont une démonstration vivante de la multiplication des pains dans le désert. » Une mère courageuse et bonne en même temps que véritablement artiste. Elle fut d'abord le professeur du petit Charles ; elle lui apprit la langue musicale dans un âge où il ne prononçait pas encore un seul mot. « Ma mère, qui avait été ma nourrice, m'avait certainement fait avaler autant de musique que de lait. Jamais elle ne m'allaitait sans chanter et je peux dire que j'ai pris mes premières leçons sans m'en douter et sans avoir à leur donner cette attention si pénible au premier âge et si difficile à obtenir des enfants. Sans en avoir conscience, j'avais déjà la notion très claire et très précise des intonations et des intervalles qu'elles représentent, des tout premiers éléments qui constituent la modulation, et de la différence caractéristique entre le mode majeur et le mode mineur, avant même de savoir parler, puisqu'un jour, ayant entendu chanter dans la rue (par quelque mendiant sans doute) une chanson en mode mineur, je m'écriai : « Maman, pourquoi il chante en do qui plore ? »
Un ami de Mme Gounod, le musicien Jadin, fit un jour avec le petit Gounod l'expérience suivante : Il le plaça, le visage tourné vers le mur, dans un coin de la chambre. Il se mit lui-même au piano et improvisa une suite d'accords et de modulations, lui demandant à chaque modulation nouvelle : « Dans quel ton suis-je ? » L'enfant ne se trompa pas une seule fois. Jadin fut émerveillé. La mère triomphait.
Nous avons dit que, de son vivant, le père de Gounod avait été appelé par le roi Louis XVIII aux fonctions de professeur de dessin des Pages. A cette occasion, le roi lui avait permis d'occuper pendant le temps qu'il passait à Versailles, un logement situé dans les vastes bâtiments du n° 6 de la rue de la Surintendance, laquelle s'étendait de la place du Château à la rue de l'Orangerie. A la mort de son mari, en 1823, Mme Gounod conserva le droit de séjourner dans ce logement aux vacances de chaque année. Cette faveur lui fut continuée jusqu'en 1830, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de Louis-Philippe. Ainsi, Gounod pouvait passer l'été au bon air et, à Versailles, il retrouvait son frère qui faisait ses études au lycée de cette ville.
Les études, il fallait y songer pour le petit Charles. Il les commença à Paris dans la pension d'un certain M. Boniface, rue de Touraine, près de l'Ecole de médecine. Il y avait là comme maître de solfège un jeune homme de seize ou dix-sept ans, qui s'appelait Duprez, et qui n'était autre que le futur illustre ténor de l'Opéra. « Duprez, conte Gounod, s'étant aperçu que je lisais la musique aussi aisément qu'on lit un livre et même beaucoup plus couramment que je ne la lirais sans doute aujourd'hui, m'avait pris en affection toute particulière. Il me prenait sur ses genoux et quand mes petits camarades se trompaient, il me disait : « Allons, petit, montre-leur comment il faut faire. » Le petit Gounod avait alors sept ou huit ans. De la pension Boniface, il passa par plusieurs autres institutions avant qu'il fût décidé qu'il entrerait (à onze ans) au lycée Saint-Louis, où il avait obtenu un « quart de bourse » (octobre 1829).
Charles Gounod fut loin d'être un mauvais élève, mais il était d'une légèreté terrible et se faisait souvent punir pour sa « dissipation » (plutôt cependant à l'étude qu'en classe). Il fut une fois mis au « séquestre », c'est-.à-dire dans un véritable cachot où il devait vivre de pain et d'eau jusqu'à ce qu'il eût achevé un énorme pensum, 500 ou 1.000 lignes à copier. On n'y allait pas par quatre chemins dans ce temps-là. Mais le petit Gounod avait de tels remords de la faute commise qu'il éclata en sanglots et s'écria : « Va, tu n'es qu'un misérable, et tu n'es pas même digne de manger ce pain-là ! » Et il laissa son pain. C'est que chaque punition retardait le moment où sa « bourse » serait augmentée, deviendrait « demi-bourse », puis « bourse entière », allégeant ainsi progressivement la charge de sa mère.
Il y avait au lycée Saint-Louis une chapelle où tous les dimanches on exécutait une messe en musique. Mompou en était le maître de chapelle. Il distingua tout de suite la voix très jolie et très juste de l'enfant qui devint soprano solo du petit ensemble choral composé de deux premiers dessus, deux seconds, deux ténors et deux basses. A ce propos, Gounod nous confie : « Une imprudence de Mompou me fit perdre la voix. Au moment de la mue, il continua à me faire chanter, en dépit du silence et du repos commandés par cette phase de la transformation des cordes vocales, et, depuis lors, je ne retrouvai ni cette force, ni cette sonorité, ni ce timbre que je possédais étant enfant et qui constituent les véritables voix : la mienne est restée couverte et voilée. J'eusse fait, je crois, sans cet accident, un bon chanteur. » Avec ses moyens restreints, Gounod sut cependant charmer. Il avait une façon délicieuse de chanter.
Au cours de ses années d'études, Gounod eut deux grandes joies ou plutôt deux immenses illuminations. On ne sait pas dans quel ordre, car dans ses souvenirs autobiographiques, Gounod se contredit sur ce point. Toujours est-il qu'Otello de Rossini et Don Juan, de Mozart, furent les deux plus grandes émotions de son enfance. « La Malibran, déclare-t-il lui-même, fut pour lui le chemin de Damas, Rossini le précurseur, Mozart le Messie. » Deux concerts spirituels, la Symphonie Pastorale et la IXe Symphonie complétèrent ces profondes impressions.
Elles eurent enfin leur effet. Le petit Gounod voulut écrire à son tour son Otello ou son Don Juan. Il voulut devenir un grand compositeur et, au lieu de faire ses devoirs, il noircissait, à bride abattue, du papier à musique. Ce qui ne l'empêchait pas, quand il le voulait bien, de réussir d'excellents thèmes ou de charmants vers latins et de se placer parmi les premiers de sa classe.
Mais un beau jour, il n'y tint plus, il prit son courage à deux mains et il adressa à sa mère une supplique longuement motivée dans laquelle il déclarait « son goût très prononcé pour la carrière des arts » et il demandait l'autorisation de se consacrer définitivement à la musique. Mme Gounod, bouleversée, alla consulter M. Poirson, proviseur du lycée Saint-Louis. Pour rien au monde, elle ne voulait que son fils fût musicien. « Soyez tranquille, madame Gounod, répondit M. Poirson, j'en fais mon affaire. » L'excellent homme, très sceptique sur les aptitudes du jeune Gounod, le fit venir dans son cabinet et lui imposa une petite épreuve : il lui donna à mettre en musique les paroles de la romance de Méhul : « A peine au sortir de l'enfance... » Le petit Gounod se tira si joliment d'affaire que son juge en fut émerveillé et que, prenant dans ses mains le front de l'artiste en herbe : « Va, mon enfant, lui dit-il, et fais de la musique ! » Mme Gounod n'était pas tout à fait convaincue. Elle conduisit son fils chez un bon maître, le compositeur Reicha, mais en lui faisant à l'oreille cette prudente recommandation : « Rendez-lui la vie dure, je vous en prie ! Montrez-lui de préférence les côtés ardus de cet art charmant !... Si vous me le renvoyez musicophobe, je vous bénirai ! » Reicha ne put triompher d'une vocation irrésistible. Le voulut-il d'ailleurs ? Au bout d'un an de leçons, interrogé par Mme Gounod, il lui répondit : « Hélas ! madame, le mieux est de se résigner. Cet enfant a le don, il connaît ce qu'il veut et où il va. Rien ne le rebute, rien ne le décourage. Il sait maintenant tout ce que je peux lui enseigner. Seulement il ne sait pas ce qu'il sait. »
Le jeune Gounod n'en continuait pas moins ses études au lycée. Il ne le quitta qu'aux grandes vacances de 1835. Il avait dix-sept ans et prit dès lors plus de temps pour son travail musical tout en préparant son baccalauréat de philosophie qu'il passa l'année suivante. Cependant, Reicha était mort (28 mai 1836). Mme Gounod alla trouver Cherubini, directeur du Conservatoire. Cherubini confia Gounod au jeune Halévy, qui faisait la classe de contrepoint et de fugue. Au mois d'octobre de la même année, Halévy présentait son élève au maître de Berlioz, au célèbre Lesueur, dont le jeune musicien désirait recevoir des leçons de composition. Dirigé par ces deux excellents guides, au bout d'un an d'études, Gounod remportait le second prix de Rome avec une cantate dont le sujet était Marie Stuart et Rizzio. Le 6 octobre 1837 Lesueur disparaissait. Paer lui succédait. En 1838, au concours de Rome, Gounod n'obtenait aucune nomination. Pour le consoler, sa mère l'emmena faire un voyage en Suisse. De retour à Paris, il se mit au travail avec une nouvelle ardeur et quand revint l'époque impatiemment attendue du concours de Rome il entra en loge avec un grand espoir. Cette fois, il emporta le premier prix. Il avait 21 ans. Il justifiait ainsi de très bonne heure par un succès significatif les ambitions qui avaient si fort effarouché sa mère.
Les artistes qui avaient remporté les autres grands prix la même année que Gounod étaient : pour la peinture, Hébert, pour la sculpture, Gruyère, pour l'architecture, Le Fuel, pour la gravure en médailles, Vauthier. Ils devinrent ses amis.
***
L'enfance et la première jeunesse de l'artiste sont terminées. Années calmes et heureuses auprès d'une mère disposée à toutes les gâteries et toutes les indulgences.
Vie peut-être un peu molle dans la société continuelle d'une femme et sans aucune difficulté à jamais surmonter que celles d'études littéraires et musicales entreprises d'ailleurs avec goût ou même avec enthousiasme. La maladie, la misère, les obstacles opposés par les circonstances à la réalisation des plus chers desseins ont souvent pour effet de tremper les caractères et de fournir même un aliment au génie. Cette préparation à son art, indirecte et par opposition, a manqué à Gounod. Il n'a reçu qu'une leçon de son premier milieu : celle de la tendresse. Elle a développé en lui bien plus le sentiment que la volonté, elle ne l'a pas tourné vers le culte de la force, de la puissance. Elle l'a mené sur une route facile où il n'avait qu'à se laisser aller et où son favorable destin lui permit de continuer de s'abandonner. Génie essentiellement aisé, et qui n'eut pas à conquérir ses succès de haute lutte, en les arrachant à un sort contraire.
Gounod devait maintenant partir pour l'Italie. Mais, avant de se mettre en route, avant même d'avoir obtenu son prix, il avait eu l'occasion de faire entendre à un service anniversaire de la mort de Lesueur un Agnus Dei dont Berlioz écrivait quelques jours après : « On a remarqué surtout un Agnus à trois voix égales avec chœur, de M. Gounod, le plus jeune des élèves de Lesueur, que nous trouvons beau, très beau. Tout y est neuf et distingué : le chant, les modulations, l'harmonie. M. Gounod a prouvé là qu'on peut tout attendre de lui. » Il y avait dans ce jugement d'un aîné qu'il savait être un grand artiste de quoi gonfler d'orgueil le cœur d'un débutant.
Et, encore avant son départ, avant de quitter sa mère bien-aimée, Gounod eut la joie de lui faire entendre sa première messe, dédiée à son maître Lesueur, le jour de la Sainte-Cécile à Saint-Eustache. Au retour de l'église, il trouva une lettre de son proviseur, M. Poirson, qui s'était fait une joie de venir entendre l'œuvre de son ancien élève : « Bravo, écrivait-il, cher homme que j'ai connu enfant ! Honneur au Gloria, au Credo, surtout au Sanctus ! C'est beau ; c'est vraiment beau, religieux ; Bravo et merci, vous m'avez rendu bien heureux. »
Gounod partait avec deux autres prix de Rome : l'architecte Hector Le Fuel et le graveur Vauthier. Le 5 décembre 1839, munis des 600 francs que l'administration des Beaux-Arts mettait à leur disposition pour leurs frais de voyage, les trois jeunes gens prenaient à huit heures du soir la malle-poste qui partait de la rue Jean-Jacques Rousseau à destination de l'Italie. A Marseille, ils frétèrent un voiturin qui, de son train cahotant, les secouant pas mal, mais leur laissant le loisir de contempler tout le pittoresque du voyage, par Monaco, Menton, Sestri, Gênes, Florence et l'Ombrie, les amenait à Rome le 27 janvier 1840.
Du directeur de l'Académie de France à Rome, de M. Ingres, qui avait connu son père, Gounod reçut le plus cordial accueil.
La première impression que Gounod ressentit en présence de la Ville Eternelle fut de tristesse d'avoir quitté sa mère et de mélancolie d'avoir à séjourner dans cette ville si différente de tout ce qu'il imaginait et qu'il ne comprenait pas encore. « J'étais trop jeune alors, confesse-t-il, non seulement d'âge, mais encore et surtout de caractère ; j'étais trop enfant pour savoir et comprendre au premier coup d'œil le sens profond de cette ville grave, austère, qui ne me parut que froide, sèche, triste et maussade, et qui parle si bas, qu'on ne l'entend qu'avec des oreilles préparées par le silence et initiées par le recueillement. »
Ingres aida Gounod à sentir du fond de son cœur la beauté, la grandeur de Rome. Ingres conçut bientôt une vive amitié pour ce jeune garçon dont tout le rapprochait, le souvenir de son père qu'il avait bien connu et apprécié, un même goût pour la musique aimée de même tendresse dans ce qu'elle a de plus délicat et de plus féminin, peut-on dire, notamment dans la façon dont Mozart l'avait servie, un même culte du dessin, pour lequel Gounod avait hérité des aptitudes de son père. Une circonstance commença de les rapprocher. Gounod rentrait un jour d'une excursion, un album sous le bras. Il se trouve nez à nez avec M. Ingres qui rentrait aussi et qui, apercevant l'album, questionna son pensionnaire. Gounod, en rougissant, montre à son directeur une petite figure de sainte Catherine qu'il venait de copier d'après une fresque attribuée à Masaccio, dans la vieille basilique de Saint-Clément, non loin du Colisée. « Mais il dessine comme son père ! » s'écrie M. Ingres, qui décide immédiatement que Gounod « lui fera des calques ». Et désormais, ils passaient leurs soirées l'un près de l'autre, Gounod dessinant d'après de vieilles gravures, une centaine de figures, monuments et paysages pour son directeur.
Un jour, M. Ingres lançait à Gounod cette boutade : « Si vous voulez, je vous fais revenir à Rome avec le grand prix de peinture. » (*)
(*) On dit que M. Jean Gounod possédait six paysages peints à l'huile sur papier par son père, datant du séjour du compositeur à Rome.
C'est dans une de ces soirées intimes sans doute que M. Ingres dessina ce merveilleux portrait du jeune Gounod, si différent du patriarche à grande barbe qu'a popularisé plus tard la photographie, ce portrait si fin, si souple, si délicat, si gracieux qui nous conserve l'image authentique du compositeur à 22 ans, avec son large front plein de belles pensées musicales et ses yeux profonds qui parlent.
Sans doute, de temps en temps, Gounod quittait la table et le dessin, se levait, allait au piano, et sans être pianiste, jouait pour son directeur quelque page de Gluck ou de Beethoven ou chantait comme il sut le faire, c'est-à-dire comme personne, quelque air de ce Don Juan auquel on revenait toujours. « Je te fais mon compliment, lui écrivait sa mère (février 1840), en ce qui te concerne, qu'une grande voix ne te soit pas utile pour satisfaire votre habile directeur. Je suis bien de l'avis que le goût et l'expression font un bien plus grand plaisir que les tours de gosier ou les éclats de voix. »
La musique, inutile de la chercher à Rome. On ne l'y trouvait pas alors. Un seul endroit « que l'on pût décemment et utilement fréquenter, la chapelle Sixtine du Vatican : ce qui se passait dans les autres églises était faire frémir. En dehors de la chapelle Sixtine et de celle dite des Chanoines dans Saint-Pierre, la musique n'était pas même nulle : elle était exécrable ».
Gounod ne manquera point d'assister souvent aux offices de la Sixtine, en compagnie de son camarade Hébert. Tous deux s'entendaient pour confondre dans une même admiration « le génie colossal qui a décoré les voûtes et le mur de l'autel par ces incomparables conceptions de la Genèse et du Jugement dernier et la musique palestrinienne qui semble être une traduction chantée du vaste poème de Michel-Ange... On dirait que ce qu'on entend est l'écho de ce qu'on regarde ». (*)
(*) L'image est jolie. L'idée qu'elle exprime ne semble pas très exacte. On opposerait volontiers Michel-Ange à Palestrina. Ces deux génies se font contraste.
Et pourtant Gounod eut quelque peine à s'habituer à cette musique si nouvelle pour lui : « Cette musique sévère, ascétique, horizontale et calme comme la ligne de l'Océan, monotone à force de sérénité, anti-sensuelle, et néanmoins d'une intensité de contemplation qui va parfois à l'extase, me produisit d'abord un effet étrange, presque désagréable. Etait-ce le style même de ces compositions, entièrement nouveau pour moi, était-ce la sonorité particulière de voix spéciales que mon oreille entendait pour la première fois, ou bien cette attaque ferme jusqu'à la rudesse, ce martèlement si saillant qui donne un tel relief à l'exécution en soulignant les entrées des voix dans ces combinaisons d'une trame si pleine et si serrée, — je ne saurais le dire. Toujours est-il que cette impression, pour bizarre qu'elle fût, ne me rebuta point. J'y revins encore, puis encore, et je finis par ne plus pouvoir m'en passer. »
Quant au théâtre musical de Rome, inutile d'en parler : « Le répertoire du théâtre était à peu près entièrement composé des opéras de Bellini, de Donizetti, de Mercadante, toutes œuvres qui, malgré les qualités propres et l'inspiration parfois personnelle de leurs auteurs, étaient, par l'ensemble des procédés, par leur coupe de convention, par certaines formes dégénérées en formules, autant de plantes enroulées autour de ce robuste tronc rossinien dont elles n'avaient ni la sève ni la majesté, mais qui semblait disparaître sous l'éclat momentané de leur feuillage éphémère. Il n'y avait, en outre, aucun profit musical à recueillir de ces auditions bien inférieures au point de vue de l'exécution à celles qu'offrait le Théâtre-Italien de Paris, où les mêmes ouvrages étaient interprétés par l'élite des artistes contemporains. La mise en scène elle-même était parfois grotesque. « Je me rappelle, signale Gounod, dans ses Mémoires d'un artiste, avoir assisté au théâtre Apollo, à Rome, à une représentation de Norma, dans laquelle les guerriers romains portaient une veste et un casque de pompier et un pantalon beurre frais de nankin à bandes rouge cerise : on se serait cru chez Guignol. »
Gounod renonçait donc à suivre les théâtres. Il préférait étudier chez lui les partitions de l'Alceste de Lully, des Iphigénie de Gluck, du Don Juan de Mozart, du Guillaume Tell de Rossini.
De concerts, il n'y en avait point.
Donc, rien que la musique palestrinienne.
Tout naturellement Gounod était incliné vers l'art religieux. Son instinct l'y poussait en même temps que l'influence du milieu. Il écrit d'abord une nouvelle messe, exécutée à Saint-Louis des Français en 1841, il songe à un oratorio, une symphonie sacrée, un Te Deum, un Requiem (a cappella). « A ce Requiem il voulait donner le caractère de l'amour plutôt que celui de la terreur. » C'est la disposition toute naturelle de son cœur. Toute sa musique sacrée sera inspirée de cette parole d'un ami : « Chante avec espérance et d'une manière consolante. »
Mais Gounod n'est pas attiré que par la musique religieuse. Déjà sa double nature, son double instinct se révèle. Il ne sera pas l'homme d'un seul chant. « Il est possible, écrit-il, de faire à Rome de la belle musique religieuse, d'un style sévère, en même temps que d'y peindre d'une autre palette la fougue effrénée de la passion humaine, parce que c'est là que notre souvenir et nos yeux encore aujourd'hui nous montrent le centre du drame catholique parmi les hommes et que, d'un autre côté, nous y comprenons et nous y sentons tout autour de nous la puissance des passions. » Gounod composera donc dès son arrivée à Rome de la musique profane. A vrai dire, elle ne sera pas, violemment passionnée. Elle aura plutôt ce caractère rêveur, contemplatif, tout voisin de l'accent religieux qui lui est si naturel et dont il trouve le modèle dans les poésies de Lamartine qui sont alors une de ses lectures favorites. C'est de son arrivée à Rome que datent deux de ses mélodies les plus caractéristiques, et, à vrai dire, deux chefs-d'œuvre, le Soir et le Vallon. On y découvre déjà la courbe particulière de sa phrase musicale et la qualité de sentiment qu'il traduira désormais le plus volontiers. On y constate déjà aussi son goût qui ne cessera de se manifester par la suite pour ce genre, assez négligé jusqu'alors en France ou traité comme très inférieur, de la courte pièce vocale, qui n'est point toujours la simple chanson, qui prétend souvent à un rang artistique plus relevé et qui s'inspire au besoin des plus belles pages de nos meilleurs poètes, — quelque chose comme le lied allemand, mais d'une autre couleur et d'une autre sonorité, tout naturellement adapté à une poésie où domine moins la sentimentalité, où la sensibilité se révèle sous les aspects plus délicats, plus raffinés et plus divers et laisse parfois la place au pittoresque. Depuis ce premier jour où il composa le Soir, Gounod ne cessa point d'écrire des mélodies. Le recueil en est extrêmement abondant. On ne les connaît point toutes, il s'en faut. On en connaît même fort peu. C'est un domaine abandonné dont il conviendrait de reprendre possession.
La mélodie de Gounod apporte du nouveau dans la musique française. Elle se distingue nettement de la romance de salon qui florissait à Paris entre 1830 et 1860, si pauvre et si fade. Elle s'inspire parfois de nos meilleurs poètes : Baïf, Passerat, Ronsard, Hugo, Musset, Lamartine, Th. Gautier, Th. de Banville. Elle se modèle admirablement sur les exigences du parler français. Il arrive même qu'elle ne semble que parler, par exemple dans le début de cette page intitulée Boire à l'ombre :
Je n'ai pas soif, vieillard, merci.
Mais le plus souvent elle chante de la façon la plus soutenue. Et alors on pourrait lui trouver des parentés. Elle rappelle à certains égards la phrase de Mozart ou celle de Mendelssohn, celle aussi de Monsigny ou de Boieldieu, pour ne point remonter jusqu'à nos vieux maîtres du XVIe siècle, les Costeley et les Claude le Jeune. Mais elle a ses caractères irréductibles. Sa physionomie tout à fait distincte permet, en quelques notes, de la reconnaître entre toutes. Volontiers, elle s'arrondit et s'alanguit en des contours qui se dessinent avec lenteur, non sans une grâce heureuse. Elle s'élève facilement et plane sans effort. Elle se repose en des conclusions apaisées et sans heurt, non parfois exemptes de quelque coquetterie ou de quelque préciosité, mais aussi, d'autres fois, dans la simplicité la plus unie. Elle touche les sens d'abord, mais elle va jusqu'à l'âme. Elle s'enveloppe d'un certain mystère mais n'en reste pas moins baignée de lumière, d'une lumière douce et tamisée. Le plus léger accompagnement, les harmonies les plus simples suffisent à l'assurer dans sa route. Elle ne vagabonde point à travers les tonalités, quoiqu'elle ne s'interdise pas quelques ingénieuses modulations. Dans ses meilleurs moments, — nous l'avons déjà noté, — elle prend une certaine gravité dons l'accent a quelque chose de religieux, même quand elle n'a pour objet que les émotions de l'amour profane. Et ainsi, dans ses chants, Gounod a quelque chose de l'élévation, de la pureté, et de la fluidité lamartinienne, comme il peut aussi se perdre dans le vague, le flou, l'inconsistance de l'auteur des Harmonies poétiques.
Toute sa vie il écrira des mélodies, et de tous les styles.
Voici le style « parlé » dans ce charmant Envoi de fleurs qu'on chante d'ordinaire aujourd'hui trop lentement, surtout la ritournelle qui doit être dite plus vite encore que le chant (Gounod l'a indiqué lui-même) :
Si l'on veut savoir qui m'envoie
Ces belles fleurs...
Quel dommage que ce délicieux Envoi de fleurs soit gâté par cette incroyable négligence de l'auteur du poème, Emile Augier :
Elles me viennent d'où ma vie
Pend désormais.
Il faut, autant que possible, esquiver le scandale de cette impardonnable impropriété en escamotant à moitié le mot condamnable.
Autre mélodie d'un style parlant et d'une bien précieuse qualité musicale : Tombez mes ailes. On regrette seulement la sentimentalité un peu niaise du poème de Legouvé :
Petite fourmi sérieuse...
Dans le même genre presque « récitatif », j'ai déjà cité le délicat Boire à l'ombre et je tiens à indiquer le dramatique Départ, si passionné, si émouvant, d'une allure si rapide, dont, malheureusement, la mention Allegretto animato, traduit fort inexactement le caractère entraînant et fougueux.
Je veux oublier, oublier que j'aime...
Les arpèges de l'accompagnement doivent déferler furieusement comme des flots en tempête.
Même lorsque la mélodie de Gounod devient vraiment chantante, elle reste toujours assez peu éloignée du langage parlé et c'est ce qui lui donne son caractère si spécifiquement français. On peut s'en convaincre en relisant les pages remarquables qui s'intitulent Au Printemps, Ce que je suis sans toi, Primavera, le Premier Jour de Mai, le Lever, Sérénade, Au Rossignol, le Vallon, Heureux sera le jour (en dehors des recueils), Mignon, le Soir. Mais qui donc sait aujourd'hui chanter Au Rossignol, par exemple ? Nos chanteurs ont complètement perdu la notion du legato. Ils ne savent plus ce que c'est que « l'archet à la corde » ; et la musique de Gounod, ainsi émiettée, perd presque toute sa beauté. Et pourtant J.-S. Bach savait pratiquer le jeu legato sur un clavecin, l'instrument par excellence du « détaché ». Comment chanter et ne pas lier les sons ? Comment chanter en coupant, en hachant toujours les syllabes ?
Il est une mélodie qui est restée longtemps presque inconnue. Et c'est une des plus belles. Venise ou la Sérénade ne suffisent pas à représenter tout Gounod, quelle que soit la beauté si diverse de ces deux pièces, l'une et l'autre d'un pittoresque si original et d'un sentiment si nostalgique. Je veux parler de l'Absent. Je l'ai signalée il y a quelques années à Mme Croiza et à M. Pierre Bernac, et, grâce aux deux incomparables artistes, elle s'est un peu répandue. On peut la prendre comme le type le plus parfait de la mélodie gounodienne.
Les paroles sont de Gounod lui-même et se rattachent peut-être à quelque aventure de cœur personnelle. Ils ne sont point si méprisables, ces vers de Gounod :
O silence des nuits, dont la voix seule est douce,
Quand je n'ai plus sa voix...
L'Absent n'est pas écrit sous forme de couplets, forme chère à l'auteur, et, à vrai dire, un peu monotone. Il se compose d'une première phrase mélodique qui revient (en partie) à la fin de la pièce et d'une seconde phrase intermédiaire d'une autre tonalité et d'un autre caractère (A B A.) Je crois que c'est la seule mélodie de Gounod ainsi composée. Elle est construite de la façon la plus harmonieuse.
Si nous considérons maintenant la première phrase :
O silence des nuits, dont la voix seule est douce
nous y remarquerons une étonnante continuité d'inspiration. Point de redite. Les deux premières mesures ne sont pas répétées deux fois, comme il arrive chez de très grands auteurs, Debussy par exemple. La deuxième mesure n'imite même pas le dessin de la première, ou si peu. Bien souvent en effet (et c'est ce qui arrive chez certains compositeurs allemands), une mélodie est véritablement « bâtie » avec un premier élément donné dès le début et repris ensuite, plus ou moins déformé, à divers degrés de l'échelle musicale. Ici vous pouvez suivre tout du long la phrase de Gounod, c'est une invention perpétuelle, qui se renouvelle constamment, et non le développement d'un premier motif élémentaire. Et dès la deuxième mesure, la mélodie module. Fait remarquable, surtout du temps de Gounod. Ajoutons que, malgré sa riche variété, la phrase reste d'une parfaite unité, organiquement constituée, merveilleusement spontanée, d'un caractère à la fois somptueux et délicatement ému, — un véritable miracle. (*)
(*) Parmi les compositions de Gounod les moins connues, il faut citer quelques pièces de piano tout à fait charmantes : le Lierre, la Valse des Sylphes, et surtout la Vénéziana, barcarolle d'une harmonisation remarquable et d'un sentiment nostalgique prenant. Jean Doyen les a jouées avec toute la finesse et le goût dont on le sait capable à un concert qu'il donnait avec Mme Croiza. J'ai eu grand plaisir à l'écouter. Je souhaite l'agréable et prochaine occasion de l'entendre de nouveau exécuter ces mêmes pièces.
***
A Rome, Gounod n'écrivait pas que des œuvres religieuses ou des mélodies. Déjà il portait dans sa tête et dans son cœur l'œuvre capitale de sa vie : Faust. « J'avais lu Faust à l'âge de vingt ans, nous dit-il lui-même dans son Autobiographie, et lorsqu'en 1839 je partis pour Rome comme grand prix de composition musicale et pensionnaire de l'Académie de France, j'avais emporté le Faust de Goethe qui ne me quittait pas. » Pendant l'hiver de 1840 sa « distraction favorite était la lecture du Faust de Goethe, en français bien entendu, car je ne savais pas un mot d'allemand. » Durant l'été de la même année, il fit un voyage à Naples et à Capri. Il admirait « la splendeur des nuits sous un pareil climat, dans une telle saison... la voûte du ciel littéralement palpitante d'étoiles... Pendant les deux semaines que dura mon séjour, j'allais souvent écouter le silence vivant de ces nuits phosphorescentes. Je passais des heures entières assis sur le sommet de quelque roche escarpée, les yeux attachés sur l'horizon, faisant parfois rouler le long de la montagne à pic quelque gros quartier de pierre dont je suivais le bruit jusqu'à la mer où il s'engouffrait en soulevant un friselis d'écume... Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la nuit de Walpurgis du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas ; je l'emportais partout avec moi et je consignais dans des notes éparses les différentes idées que je supposais devoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard. » On voit que le Faust de Gounod fut loin d'être improvisé. C'est « en y pensant toujours » qu'il réalisa son chef-d’œuvre.
***
A Rome Gounod fit une bonne rencontre, une rencontre qui devait lui être extrêmement utile. Ce fut celle de la sœur de Mendelssohn, Fanny Hensel, la femme du peintre Wilhelm Hensel. « Musicienne hors ligne, pianiste remarquable, femme d'un esprit supérieur, petite, fluette, mais d'une énergie qui se devinait dans ses yeux profonds et dans son regard plein de feu », elle découvrit tout de suite en Gounod un artiste passionnément épris de la vie et de son art, avec qui il serait intéressant de passer quelques jours de fantaisie et de rêve. Les Hensel devaient consacrer une semaine de leur voyage d'Italie à Rome : ils y restèrent six mois. Hôtes de la Villa Médicis, ils avaient tout naturellement pour compagnons les jeunes pensionnaires. Gounod gagna particulièrement la sympathie de Mme Hensel. « Peu de personnes, disait-elle, savent plus sincèrement et plus follement s'amuser que lui. » Courses en voiture à travers la campagne, séances de musique le soir, promenades nocturnes dans Rome se succédaient sans interruption. On dormait peu. Mais on s'enthousiasmait de tout ce qu'on voyait, de tout ce qu'on entendait, et de mille sensations vagues, du plaisir d'être réunis, de l'odeur de la nuit dans ce pays admirable. Madame Hensel jouait de la musique du frère, de la musique de Bach, de la musique de Beethoven et presque tout était de l'inconnu pour Gounod. « Gounod est passionné pour la musique, écrit Mme Hensel, d'une façon que j'ai rarement vue. Il ne peut pas se lasser d'entendre le Concerto de Bach (sans doute le Concerto italien) : il m'a fallu le lui jouer au moins dix fois déjà. » Le 13 mai madame Hensel note encore dans son journal : « Le soir, les Français, dont Wilhelm a fait le portrait... Je joue tout Fidelio et bien d'autres choses encore ; pour finir la Sonate en ut majeur de Beethoven. Gounod était fou d'enthousiasme et finit par crier : « Beethoven est un polisson. » Sur quoi, ses amis, jugeant qu'il était temps de le mettre au lit, l'emmenèrent. » Trois jours plus tard les Adieux, l'Absence et le Retour et Fidelio. Puis visite au Colisée au clair de lune. « Nous revînmes par le forum. Gounod grimpa dans un acacia et nous jeta à tous des branches fleuries : nous marchions dans la forêt de Duncinan... » Ainsi passaient les jours et les nuits, joyeux, poétiques, enivrants. Et Gounod complétait son éducation musicale. Jusque-là il connaissait peu les Allemands. Bach, Beethoven et aussi Mendelssohn ont une profonde influence sur lui, sur ce Gounod « passionné et romantique à l'excès », selon Mme Hensel. Elle ajoute : « La révélation de la musique allemande produit sur lui l'effet d'une bombe qui tombe dans une maison. Il est possible que cela cause chez lui de grands dégâts. » Elle s'exagère le danger. Au point de vue artistique, Gounod a une nature très solide, très caractérisée, qui pourra être plus ou moins aidée, hâtée dans son développement mais qui ne subira point de modification importante. Elle est et elle restera bien française. Telle que nous l'ont révélée ses premières mélodies, le Vallon ou le Soir, telle nous la retrouverons dans ses derniers ouvrages : Rédemption et Mors et Vita. Ses relations avec madame Hensel, ses voyages en Allemagne, plus tard sa connaissance des œuvres de Richard Wagner n'y changeront rien. Mme Hensel s'attribue un rôle qui n'est pas le sien. Elle fut utile au jeune artiste en lui permettant de prendre plus vite conscience de lui-même. Rien de plus.
Ces beaux jours d'intimité, de conversation, de promenades et de musique eurent leur fin. Un dimanche, les Hensel firent leur visite d'adieu à M. Ingres et deux jours après ils quittaient Rome et prenaient la direction de Naples. Quelques amis, dont son camarade Bousquet, les accompagnèrent jusqu'aux monts Albains. Gounod, trop fatigué, trop ému, restait à la Villa. Ce n'est pas la dernière fois que nous constaterons que Gounod est assez fragile et que les émotions, comme le travail, ont vite fait d'épuiser ses forces. C'est un nerveux.
Les monts Albains sont une des plus jolies excursions aux environs de Rome. Il faut d'abord traverser toute la campagne romaine. Chemin faisant on parlait de Gounod. « Bousquet pestait contre lui, écrit madame Hensel, et regrettait qu'il manquât cette belle journée. »
« Bousquet nous a confié, ajoute madame Hensel, ses craintes au sujet de l'exaltation religieuse de Gounod, depuis qu'il subit l'ascendant du père Lacordaire. Ce dernier, son noviciat terminé à Viterbe, s'est fait ordonner prêtre et séjourne depuis quelque temps à Rome, où il travaille à la fondation d'un nouvel ordre religieux en France. Déjà son éloquence avait groupé l'hiver dernier autour de lui une partie de la jeunesse. Gounod, d'un caractère faible et d'une nature impressionnable, fut gagné dès l'abord par la parole vibrante de Lacordaire. Il vient de s'enrôler dans l'association dite de Jean l'Evangéliste, exclusivement composée de jeunes artistes qui poursuivent la régénération de l'humanité par le moyen de l'art. L'association s'est accrue d'un grand nombre de jeunes gens des premières familles romaines. Plusieurs d'entre eux ont renoncé à leurs carrières pour entrer dans les ordres. Bousquet a l'impression que Gounod, lui aussi, est sur le point d'échanger la musique contre le froc. »
A l'influence de Lacordaire s'ajoutait celle d'un ami, récemment arrivé à Rome, Charles Gay. Ce Charles Gay était un camarade de la classe Reicha qui abandonnait le métier de musicien et se préparait à devenir prêtre. Gounod avait beaucoup d'affection pour lui. C'était un esprit fin, délié, une sensibilité délicate, un cœur enflammé d'une foi ardente : un futur évêque.
Ce n'était pas de sa mère, comme on pourrait le croire, que Gounod tenait ses dispositions à la piété la plus fervente. Mme Gounod, bien que sincère chrétienne, avait à peu près abandonné la pratique de sa religion. La présence à Rome de Charles Gay l'inquiétait même. Elle connaissait son fils. Elle savait avec quel élan il accueillait les idées religieuses. Elle craignait qu'il n'y eût quelque excès dans la façon dont il s'inspirerait de l'exemple de Charles Gay. Elle lui donnait des conseils de modération. Elle lui écrivait : « Je suis bien certaine de la bonté de ton cœur, de la pureté de tes intentions, de l'élévation de ton âme, du désir sincère que tu as de ne dire que des choses utiles et d'agir de manière à être approuvé du maître de toutes choses ; et pourtant, au milieu de tout cela, mon cher enfant, j'ai ressenti à la lecture de ta dernière lettre un serrement de cœur qui a été le résultat de l'espèce d'inquiétude vague qu'elle m'a donnée... Je sais que M. Lacordère (sic) est un homme de grand talent et de grande instruction, mais je dois te manifester mes craintes sur l'influence qu'il cherche à exercer sur les jeunes gens dont il prend la direction... à moins que tu n'aies décidé dans ta tête et dans ton cœur de te faire Dominiquin (sic) (ce que je ne crois guère propre à ta nature passionnée), tiens-toi sur tes gardes et déclare-toi bien franchement artiste qui as des sentiments religieux, mais non Religieux, de pratiques multipliées, qui veut se réserver d'être artiste : il serait pris sur toi dans ce cas un pouvoir absolu, qui arrêterait ta carrière, et, en te préparant des regrets, détruirait peut-être jusque dans ses (sic) fondements des pensées dont je suis heureux de voir ton cœur rempli. » Phrase un peu embrouillée d'une lettre visiblement négligée, mais dont on voit l'intention. Mme Gounod sent que son fils a une vocation beaucoup plus marquée pour le métier de musicien que pour le sacerdoce. Elle craindrait pour lui qu'il choisît le sacerdoce et se préparât ainsi des « regrets » qui finiraient par empoisonner son existence de prêtre et peut-être par lui faire oublier ses devoirs. Mme Gounod obtint que son fils renonçât au dessein d'entrer dans la Confrérie de Saint-Jean. Mais, effet inattendu de la grâce, elle se laissa gagner de proche en proche par les sentiments dont elle combattait l'excès chez son fils : Gounod convertit sa mère. Charles Gay fut pour beaucoup d'ailleurs dans ce retour de Mme Gounod aux pratiques de la religion catholique. En mai 1840, Gay revient à Paris. Elle écrit à son fils : « Ton bon ange m'a consacré deux heures (de huit à dix) et pendant ces heureux instants il m'a donné l'occasion de juger de la douceur et de la paix de son âme si dévouée. Il faut apprécier la sincérité du sentiment pour comprendre combien la pureté du cœur inspire la confiance. Je sens que cet excellent Charles [Gay] aura toute la mienne, et, s'il comptait plus d'années, je lui demanderais d'être le consolateur de ma vie passée, comme le directeur de mes vieux jours. » Elle prenait avec lui des leçons de théologie élémentaire et de catéchisme supérieur. D'autre part elle demandait à l'abbé Dumarsais, ancien aumônier du lycée Saint-Louis, devenu curé des missions étrangères, de la soutenir dans le progrès de son âme vers un idéal de vie chrétienne toujours plus élevé. Entre la mère et le fils c'est désormais un échange de lettres où abondent les paroles de foi et de charité : « Adieu, écrit Mme Gounod à son fils, je te quitte pour aller prier pour toi et pour ton frère, si bon. Après, je demanderai aussi à Dieu qu'il me fortifie et me fasse miséricorde. » Et encore : « Je suis souvent seule, et je ne m'en plains pas. C'est alors que je me sens le plus en la puissance du Maître. Je m'en trouve bien. Je l'écoute et le prie de me rendre digne de sa grâce, de veiller sur toi, sur ton bon frère, de nous faire vivre tous sous sa sainte loi, de nous rendre indulgents les uns pour les autres et remplis de confiance en sa bonté. » Enfin : « Je te donne un saint rendez-vous pour le jour de l'Assomption, 15 août, à 8 heures du matin. Je serai aux Missions... Nous prierons les uns pour les autres et nous serons réunis dans le Seigneur. » Charles Gay pouvait alors écrire à Gounod : « Maintenant tu sais que ta prière est montée jusqu'à Dieu et qu'elle est redescendue sur ta mère en rosée de grâce et de bénédictions ; tu sais.., qu'elle a établi sa demeure dans le cœur même de Dieu, à côté de toi. Oh ! oui, mon bon Charles, le bon Dieu t'a exaucé et au delà peut-être de ce que tu pouvais même demander. Car ta mère est non seulement une chrétienne à l'heure qu'il est ; mais elle est édifiante, et forte, et généreuse comme une sainte. » Et Charles Gay exhortait son ami à devenir lui-même un « artiste chrétien. Le passé et le présent me donnent une immense confiance. Demeure seulement l'enfant de Dieu et laisse-le faire ». On voit dans quelle atmosphère vivait Gounod et de quelle sorte pouvait être sur lui, outre l'influence de Lacordaire et de Charles Gay, celle de Rome, non pas la ville des Césars, mais la ville de Michel-Ange, de Palestrina et la ville des papes. Longtemps encore il ne cultivera guère que la musique religieuse, et, s'il vient un jour à la musique profane, c'est pour terminer son existence dans le culte renouvelé du grand art catholique.
Est-ce à dire que Gounod ait mieux réussi en écrivant pour l'Église qu'en composant pour le théâtre ? Ceci, c'est une autre question, et nous verrons que c'est tout juste le contraire. L'art catholique eut l'inconvénient de favoriser l'épanouissement de ses défauts à l'encontre de ses meilleures qualités. Gounod musicien religieux se laisse aller à plus de mollesse dans la phrase, plus de rhétorique dans le développement qu'il ne fait dans ses opéras. Qui le croirait ? Il est plus pompeux, plus théâtral à l'église qu'au théâtre même. Au théâtre, il cherche volontiers la simplicité. A l'église il s'imagine que les grands et même les gros effets sont absolument nécessaires. Ce qui ne l'empêche pas de trouver parfois des accents naïfs, simples, directs pour traduire ce qu'il y a de plus profond dans ses sentiments religieux. Nous nous en apercevrons.
***
L'été de 1840 venu, Gounod était parti pour Naples. De retour à Rome, il composait un Te Deum et une Messe avec orchestre, pour l'église Saint-Louis des Français. Le Te Deum est mal accueilli par l'Institut. Spontini qui est chargé d'en rendre compte reproche au jeune musicien de s'inspirer inconsidérément de l'exemple de Palestrina et d'employer trop uniformément la « psalmodie », le « plain-chant » et le « choral ». Spontini aurait sans doute préféré quelques cantilènes d'un tour bien italien.
Dans l'hiver de 1840-41, Gounod fait la connaissance qui lui sera précieuse de Pauline Garcia, sœur de la Malibran, qui venait d'épouser Louis Viardot, alors directeur du Théâtre-Italien à Paris. Elle n'avait pas encore 18 ans et ses débuts au Théâtre-Italien avaient été un événement. « Elle faisait, nous dit Gounod, son voyage de noces et j'eus l'honneur et le plaisir de lui accompagner, dans le salon de l'Académie, l'air célèbre et immortel de Robin des Bois (Freischütz)... Chose curieuse ! à douze ans, j'avais entendu la Malibran dans l'Otello de Rossini, et j'avais emporté de cette audition le rêve de me consacrer à l'art musical ; à vingt-deux ans je faisais la connaissance de sa sœur, Mme Viardot, pour qui je devais, à trente-deux ans, écrire le rôle de Sapho qu'elle créa, en 1851, sur la scène de l'Opéra, avec une si éclatante supériorité... »
Au mois d'avril 1841, M. Ingres fut remplacé dans la direction de l'Académie de France par M. Schnetz, peintre assez réputé, et le type du « bon enfant ». Mais qu'était pour Gounod M. Schnetz auprès de M. Ingres ? Dans M. Schnetz il ne trouvait certes pas le même ami sûr, le même grand artiste, le même musicien. La séparation fut pénible pour Gounod. Et peut-être aussi pour M. Ingres.
Après sa dernière année de Rome, Gounod loin de hâter son départ comme tant d'autres, demanda la permission de prolonger son séjour. Il ne quitta l'Italie qu'en mai 1842.
Son départ de Rome fut un déchirement. Il était attaché à cette terre italienne, et surtout à cette ville de Rome, pour la vie.
« Si du moins, écrit-il, j'avais dû venir directement retrouver ma pauvre mère et mon excellent frère, le départ m'aurait moins coûté. Mais j'allais me trouver seul dans un pays [l'Allemagne] où je ne connaissais personne, dont j'ignorais la langue, et cette perspective ne laissait pas de me paraître bien froide et bien sombre. Tant que la route le permit, mes yeux demeurèrent attachés sur la coupole de Saint-Pierre, ce sommet de Rome et ce centre du monde : puis les collines me la dérobèrent tout à fait. Je tombai dans une rêverie profonde et je pleurai comme un enfant. »
Alors il gagna Vienne par Florence, Padoue, Venise, Trieste.
A Florence Michel-Ange et la chapelle des Médicis firent sur son cœur d'artiste et sur son âme religieuse une impression extraordinaire. « Quelle prodigieuse conception, écrit-il, que celle de ce Pensieroso, sentinelle muette qui semble veiller sur la mort et attendre, immobile, le clairon du Jugement ! Quel repos et quelle souplesse dans cette figure de la Nuit, ou plutôt de la Paix du Sommeil qui fait pendant à la robuste figure du Jour étendu et comme enchaîné jusqu'à l'aurore du dernier des jours !... »
Venise l'émut violemment et de sentiments contraires : « Venise, joyeuse et triste, rose et livide, coquette et sinistre, contraste permanent, assemblage étrange des impressions les plus opposées : une perle dans une sentine... »
Venise, à l'opposé de Rome :
« Rome, c'est la sereine et la pacifiante ; Venise, c'est la capiteuse et l'inquiétante : l'ivresse qu'elle procure est mêlée (du moins l'a-t-elle été pour moi) d'une mélancolie indéfinissable comme serait le sentiment d'une captivité. Est-ce le souvenir des drames sombres dont elle a été le théâtre et auxquels sa situation même semble l'avoir prédestinée ? Cela peut être ; toujours est-il qu'un long séjour dans cette sorte de nécropole amphibie ne me paraît pas possible sans qu'on finisse par s'y sentir asphyxié et comme englouti par le spleen. Ces eaux dormantes dont le morne silence baigne le pied de tous les vieux palais, cette ombre lugubre du fond de laquelle on croit entendre sortir les gémissements de quelque victime illustre, font de Venise une espèce de capitale de la Terreur ; elle a gardé l'impression du Sinistre. Et pourtant, par un beau soleil, quelle magie que ce Grand Canal ! Quel miroitement que ces lagunes où le flot se transforme en lumière ! Quelle puissance d'éclat dans ces vieux restes d'une ancienne splendeur qui semblent se disputer les faveurs de leur ciel et leur demander secours contre l'abîme dans lequel ils s'enfoncent chaque jour davantage pour disparaître enfin à jamais !... »
Et encore :
« Venise est une passion ; ce n'est pas un amour. »
« C'est une fête au-dessus d'une oubliette... C'est pour cela sans doute que, sans m'en rendre compte, j'eus plutôt, en la quittant, le sentiment d'une délivrance... »
Gounod arrive à Vienne.
A l'Opéra, il put entendre la Flûte enchantée de Mozart, au concert le Judas Macchabée et le Messie de Haendel, ainsi que les symphonies de Mozart et de Beethoven, à la Carlskirche la Messe du pape Marcel de Palestrina et une Messe de Roland de Lassus.
Le comte Stockhammer, président de la Société Philharmonique, auquel on le présente lui demande de composer un Requiem qui est exécuté dans cette église Saint-Charles où l'on joue aussi sa Messe de Rome. A cette occasion il est émerveillé « de la facilité avec laquelle les garçons des écoles déchiffraient à première vue : ils lisaient tous la musique aussi couramment que si t'eût été leur langue naturelle ».
La critique loue dans son Requiem une harmonie « d'une hardiesse aussi surprenante qu'heureuse » et dans la partie mélodique « des choses qui touchent et impressionnent vivement ». Alors, on lui offre de faire entendre une autre messe, celle-ci « vocale, sans accompagnement » où l'on découvre, dit un critique, à la fois l'imitation du « style palestrinien » et « trop souvent aussi des traces de romantisme français ». Pourquoi ce « trop souvent » ? Sans doute parce que l'auteur de ces lignes tenait par-dessus tout à la pureté, à la sévérité du style palestrinien que tout romantisme venait troubler.
A Vienne, Gounod souffrit violemment d'un abcès à la gorge qui le tint à la chambre pendant une vingtaine de jours. Un ami dévoué, Desgoffe, fit le long voyage de Paris à Vienne, qui durait alors cinq à six jours, pour se rendre auprès de lui et le soigner. Une telle amitié juge les deux amis.
Après Vienne, Berlin. Gounod retrouve ses amis Hensel, qui lui font fête. Mme Hensel écrit : « Gounod passe toutes ses journées avec nous. Il a été accueilli par la famille avec la plus grande cordialité, mais en somme il ne voit de Berlin que notre maison et n'entend, en fait de musique, que ce que je lui joue. Le temps passe très agréablement dans sa société ; son talent s'est bien développé depuis notre séjour à Rome. Supérieurement doué, il joint à une rectitude de jugement et à un sens musical étonnants la plus grande délicatesse et une faculté d'assimilation extraordinaire. Cette faculté, il la possède dans tous les domaines ; je lui ai entendu lire des scènes d'Antigone d'une manière remarquable ; il saisissait d'instinct le génie de la langue... La présence de Gounod m'a été un grand stimulant ; non seulement j'ai joué devant lui, mais nous avons discuté musique à perte de vue. Il passait ses après-midi, en général, seul avec moi. Nous avons aussi parlé de son avenir et je ne crois pas m'être trompée en lui représentant l'Oratorio comme l'avenir musical très proche de la France. »
Décidément, cette brave Mme Hensel était un peu infatuée d'elle-même, de ses vertus d'éducatrice et de sa prescience historique : elle n'avait vraiment pas une vue très exacte des destinées artistiques de notre pays. Elle continue : « Gounod a été facilement convaincu et se propose de travailler en vue de cette éventualité [le règne futur de l'Oratorio en France.] Il est dès à présent préoccupé d'un sujet qui sera Judith. » Projet qui ne sera jamais réalisé.
De Berlin, Gounod se rendit à Leipzig pour y rencontrer Mendelssohn qui dirigeait les concerts du Gewandhaus. Mendelssohn l'accueillit avec la plus grande bienveillance. « Il voulut entendre au piano mes derniers essais et je reçus de lui les paroles les plus précieuses d'approbation et d'encouragement. Je n'en mentionnerai qu'une seule, dont j'ai été trop fier pour jamais l'oublier. Je venais de lui faire entendre le Dies iræ de mon Requiem de Vienne. Il mit la main sur un morceau à cinq voix seules, sans accompagnement, et me dit : « Mon ami, ce morceau-là pourrait être signé Cherubini. »
De ce Dies iræ un thème passera dans le Faust de 1859, l'appel désespéré de Marguerite à la clémence divine, une des plus émouvantes inspirations de la partition.
Mendelssohn profita de la présence de Gounod pour faire entendre au jeune artiste sa Symphonie écossaise, et sur l'orgue, plusieurs compositions de J.-S. Bach pour l'exécution desquelles il avait fait remettre en état le vieil orgue de Saint-Thomas dont J.-S. Bach avait usé jadis. Utile leçon que n'oubliera pas Gounod.
C'est en grande partie par l'intermédiaire de Mendelssohn que devait s'établir chez Gounod le contact entre la musique française et la musique allemande. Non seulement il la lui fit connaître, mais il la lui fit comprendre.
De Leipzig, fort instruit par ses voyages, Gounod partit pour Paris, le 18 mai 1843. Il changea de voiture dix-sept fois. Sur six nuits, il en passa quatre en voyage. Le 25 mai il touchait enfin au but, bien heureux de retrouver la maison maternelle.
RETOUR À PARIS. — SAPHO. — ULYSSE. — LA NONNE SANGLANTE.
Mme Gounod n'habitait plus rue de l'Eperon. Depuis le mois d'avril 1842 elle avait pris logement rue Vaneau dans la même maison que l'abbé Demarsais, curé des Missions, et que Charles Gay. Double voisinage recherché par la mère et dont le fils ne songeait qu'à se féliciter.
Tout de suite l'abbé Demarsais eut l'idée de faire de Gounod le maître de chapelle de sa paroisse. A une condition, répondit Gounod, c'est que je pourrai suivre mes idées, mon sentiment, mes convictions, en un mot que je serai le « curé de la musique ». L'enthousiaste palestrinien, l'admirateur passionné de J.-S. Bach, ne voulait pas entendre parler, à l'église, de cette musique mondaine toute en fades effusions d'un sentimentalisme sucré qui était alors à la mode. Il eut la promesse d'avoir carte blanche. Mais le premier contact avec les paroissiens dont il dérangeait toutes les habitudes, fut un peu rude et les choses faillirent tourner mal. M. Gounod l'avait prédit à son fils et aurait désiré qu'il fît des concessions. Mais Gounod demeurait intraitable. Tout finit cependant par s'arranger. Les paroissiens adoptèrent leur nouveau maître de chapelle et devinrent en fin de compte « ses plus chauds partisans », et, comme signe du succès obtenu, ses appointements furent relevés, et passèrent, la seconde année, de 1.200 à 1.500 francs, puis à 1.800 et 2.000.
Ne nous faisons d'ailleurs pas trop d'illusion. La façon dont Gounod prétendait rester fidèle à la tradition de Palestrina n'était pas bien rigide. Il n'en était pas encore à réformer la musique d'église aussi sévèrement que plus tard Charles Bordes et Vincent d'Indy. C'était tout de même un premier pas dans la bonne voie.
C'était d'ailleurs le moment où les idées religieuses de Gounod le menèrent le plus loin. Il fut sur le point de se faire ordonner prêtre. Pendant tout un hiver, sous l'habit ecclésiastique, il suivit les cours de théologie du séminaire Saint-Sulpice. Il signait ses lettres : l'abbé Gounod. Il s'aperçut enfin qu'il se méprenait sur sa vocation et rentra dans le monde. La méprise, comme celle de Liszt, était significative et de tels artistes sont marqués pour le reste de leur vie dans toutes les manifestations de leur art d'un signe qui ne les abandonne point.
Gounod resta en somme, cinq années retiré dans son quartier des Missions et fort éloigné du monde profane, années de recueillement, de méditation, années fécondes pour le développement de son génie. Cinq années sur lesquelles nous ne possédons que peu de renseignements. Nous savons par MM. Prodhomme et Dandelot que durant ce temps Gounod fut en relations étroites avec le chansonnier Pierre Dupont, très fervent catholique comme lui. Ensemble ils allaient écouter les conférences de Lacordaire à Notre-Dame.
L'éloquent dominicain aimait les artistes. Ils se lièrent avec lui. Amitié très vive. « Je verrai le père demain soir, écrit Gounod à Pierre Dupont ; j'espère qu'il me laissera un baiser pour vous, auquel cas je tâcherai de vous le garder aussi primitif que possible, en me gardant moi-même le mieux que je pourrai... » Et il termine ainsi sa lettre : « Adieu, revenez vite, je vous embrasse et vous aime de cœur. » Toute sa vie Gounod fut un grand « embrasseur ». Et il mêlait ses embrassades à toutes sortes de fantaisies parfois débridées. Car ne nous figurons pas ce grand croyant d'une mine austère et renfrognée. Il était avec toute sa foi d'une extrême gaîté, Mme Hensel nous l'a déjà dit.
Veuillot, écrivant plus tard à sa sœur, fera de Gounod un portrait que Camille Bellaigue a déclaré frappant et qui achèvera de nous apporter de lui une image bien vivante : « Gounod est charmant. Il s'en donne et il se donne. Il sait cent histoires drôles, il est bon acteur, il possède par cœur Mozart, Beethoven et bien d'autres ; il est plein d'idées grandes qu'il produit souvent avec un grand bonheur d'expression... Toutes sortes de contes, toutes sortes de charges et de charmantes cabrioles de bon sens... Il compte te faire visite mardi. Ne t'étonne pas si tu étais embrassée. Il embrasse comme l'évêque de Tulle, et tout y passe. A l'embarcadère, tout à l'heure, il a embrassé le père, la mère, les enfants, l'institutrice, l'amie. Il allait passer au chef de gare, lorsque le train est parti... »
C'est dans un cabaret de la rue Guénégaud, chez le père Fricaud (1 fr. 30 le dîner sans le vin) que Gounod avait fait la connaissance de Pierre Dupont. Il y rencontrait tout un groupe d'artistes : Gustave Courbet, Théophile Gautier, Clesinger, Gérard de Nerval, Baudelaire, Charles Barbara, Henri Murger, Gustave Doré, Théodore Barrière, Champfleury, Banville. On y mêlait assez volontiers aux convictions religieuses des idées sociales assez hardies. Sur le terrain social. Gounod ne devait pas s'avancer bien loin. Il se montra toujours d'une grande modération en ce domaine. La religion l'occupait d'ailleurs plus que la politique. Lacordaire, l'abbé Demarsais, Charles Gay continuaient d'exercer sur lui une influence prépondérante. Jusqu'en 1850 il ne composa que de la musique religieuse : plusieurs Messes, une Messe brève pour trois voix d'homme avec accompagnement d'orgue, les Offices de la semaine sainte (1846), un Salve Regina, un cantique, le Départ des Missionnaires, d'autres cantiques, des motets, etc.
Durant l'été de 1846, l'abbé Demarsais, l'abbé Gay et Charles Gounod furent envoyés aux bains de mer de Trouville pour leur santé. Le bain de mer était alors un remède fort à la mode. Gounod faillit s'y noyer et dans les journaux de Paris on annonça sans façon qu'il « avait été rapporté mort sur une civière ». Il n'en était heureusement rien. Il avait été quitte pour la peur.
C'est à Trouville que, se promenant sur la plage avec ses deux amis, le curé Demarsais et l'abbé Gay il rencontra un troisième abbé, précepteur du jeune Gaston de Beaucourt âgé alors de 12 à 13 ans. Le dit abbé le présenta ainsi que ses deux compagnons à la mère de l'enfant, la comtesse de Beaucourt qui possédait une fort belle propriété à quelques lieues de Trouville, entre Pont-l'Evêque et Lisieux et engagea les trois amis à s'y arrêter avant de retourner à Paris. Ce fut la première origine de la profonde et solide amitié qui durant toute sa vie lia Gounod à la famille de Beaucourt et plus particulièrement à ce Gaston qui n'était alors qu'un gamin, mais qui devenu homme témoigna toujours de la plus tendre affection pour le grand artiste dont il apprécia autant le caractère que le talent.
***
Comment Gounod fut-il amené à laisser de côté la musique d'église et à s'essayer au théâtre ? Il nous le déclare lui-même : il souffrait de rester obscur. Le désir très légitime de se faire connaître du grand public (il avait alors 30 ans) l'amena à chercher des relations dans le monde du théâtre. Il en trouva, ou retrouva, une de première importance : Mme Viardot qu'il avait rencontrée à Rome en 1840. Elle venait de créer avec une autorité magistrale le rôle de Fidès dans le Prophète de Meyerbeer. Mme Viardot présenta Gounod à Emile Augier et à Nestor Roqueplan, alors directeur de l'Opéra. Gounod aurait bien souhaité écrire un opéra en cinq actes. Mais Roqueplan ne voulut abandonner à un débutant qu'une partie du spectacle, non la soirée tout entière. « Il fallait donc trouver un sujet qui réunît trois conditions essentielles : 1° être court, 2° être sérieux, 3° offrir un rôle de femme comme figure principale », un rôle qui pût convenir à Mme Viardot. Emile Augier et Gounod se décidèrent pour Sapho.
Gounod allait se mettre au travail quand un événement bien douloureux vint arrêter son premier élan : la mort de son frère auquel il était lié par une vive affection. Ce frère laissait une veuve, mère d'un enfant de deux ans « et d'un autre petit être qui devait venir au monde sept mois plus tard, au milieu des larmes, et dont la destinée était d'entrer dans la vie le 2 novembre, le jour même où l'Eglise pleure avec nous ceux que nous avons perdus. Cette situation, dit Gounod, amenait des difficultés et des complications d'existence auxquelles il fallut songer immédiatement. Les questions de tutelle des enfants, de succession du cabinet d'architecte de mon frère, dont la mort laissait une foule d'affaires en suspens, toutes les conséquences enfin d'un malheur aussi soudain et aussi imprévu réclamèrent pendant un mois ma participation directe au règlement des intérêts et aux arrangements de la vie de ma pauvre belle-sœur anéantie et inconsolable. »
Au bout d'un mois cependant notre compositeur put s'occuper de son ouvrage. Mme Viardot qui était à ce moment en Allemagne en représentations, et qui avait appris le malheur dont Gounod venait d'être atteint lui écrivit sur-le-champ pour le presser de quitter Paris avec sa mère et d'aller s'installer dans une propriété qu'elle possédait en Brie et où il jouirait de la solitude et de la tranquillité dont il avait besoin. « Je suivis, dit Gounod, son conseil et nous partîmes, ma mère et moi, pour cette résidence où se trouvait la mère de madame Viardot (madame Garcia, la veuve du célèbre chanteur), en compagnie d'une sœur de M. Viardot et d'une jeune fille (l'aînée des enfants), aujourd'hui madame Héritte, remarquable musicienne compositeur. Je rencontrai là aussi un homme charmant, Ivan Tourgueneff, l'éminent écrivain russe, excellent et intime ami de la famille Viardot. » Bien des gens réunis autour de Gounod ! Il sut cependant s'isoler et trouver le calme qui lui était nécessaire.
Cependant, après l'Allemagne, Mme Viardot passait en Angleterre et faisait inscrire le 5 janvier 1851 au programme d'un concert de Saint-Martin's Hall à Londres, quatre compositions de Gounod : un Motet à deux chœurs sans accompagnement, un Libera me, un Sanctus, un Benedictus, et une pièce pour voix de basse avec marche et chœur (que nous retrouverons), Pierre l'Ermite. Le célèbre critique Chorley notait un succès « complet, décisif », et son compte rendu reproduit à Paris dans la Gazette musicale à la veille de la première représentation de Sapho était de nature à mettre en bonne disposition les auditeurs de l'Opéra.
Sapho fut représentée pour la première fois à Paris le 16 avril 1851. Emile Augier avait combiné son livret d'après Ælien et Suidas. Il avait réuni en un seul personnage les deux Sapho célèbres dans l'antiquité, la poétesse d'une part, contemporaine et amie d'Alcée, l'autre connue pour sa passion malheureuse pour Phaon. Ce Phaon, batelier de Mytilène, était vieux et laid. Mais il avait rendu service à Vénus : il avait transporté la déesse dans sa barque sans accepter de paiement. En retour, Vénus lui rendit la jeunesse et lui donna la beauté. Sapho l'aima, et, se voyant dédaignée, se précipita du haut du rocher de Leucade.
Mais Emile Augier complique les choses. Il imagine une jeune Glycère éprise de Phaon, lequel l'abandonne pour Sapho. Glycère se venge en trouvant le moyen de faire croire à Phaon qu'il n'est point aimé de Sapho. Et à cette intrigue d'amour Augier entremêle un drame politique : Phaon, aidé de son ami Alcée trame un complot contre la vie du tyran Pittacus. Trahi par Glycère il n'a de recours que dans la fuite. Et c'est Glycère qui l'accompagne dans l'exil : elle a en effet menacé Sapho de livrer Phaon si celle-ci prétend le suivre. Alors, de désespoir, Sapho se précipite dans les flots. Un style froidement académique ne relève guère l'intérêt de ces inventions d'une élaboration très artificielle.
On ne s'étonne point que Gounod n'ait pas toujours été merveilleusement inspiré par un si pitoyable texte. Mais on admire comment il a pu parfois y trouver le point de départ de quelques-unes des plus belles pages qu'il ait jamais écrites. La partition de Sapho n'est point d'un bout à l'autre à dédaigner, tant s'en faut. Partout le compositeur y fait preuve de la plus remarquable habileté. Mais la romance de Phaon au premier acte : « Puis-je oublier, ô ma Glycère », n'est pas seulement adroite, elle est tout à fait charmante, d'une courbe mélodique particulièrement gracieuse et d'une harmonie très savoureuse. Dans le même acte nous retrouvons la mélodie de Rome, le Soir, dont nous avons déjà dit toute la beauté, chantée par Sapho sur de nouvelles paroles : « Héro sur la tour solitaire... » sous un accompagnement des cordes frémissantes dans l'aigu qui lui donne un caractère encore plus mystérieux. Voilà des accents nouveaux dans la musique française, d'une pureté, d'une noblesse incomparables. Et tout le troisième acte est admirable ; répondant au « Sois trois fois maudite » de Phaon, le « Sois béni » de Sapho d'un sentiment si grave ; et puis, après la gracieuse chanson du pâtre, les fameuses stances finales : « O ma lyre immortelle » d'une grandeur et d'une simplicité de ligne inégalables. Jamais Gounod, ni aucun autre musicien, ne s'élèvera plus haut. La phrase reste immortellement émouvante dans sa douleur tranquille. Elle n'est point chargée de toutes sortes de remous divers, de passions complexes, comme celles des héroïnes de Wagner au suprême moment de mourir, elle n'en exprime qu'une mais au sublime degré de sa profondeur infinie.
Déjà Gounod s'est placé là sur le plan des plus hauts génies.
Il ne fut pas compris ou il ne le fut que très incomplètement et par quelques-uns seulement. C'est ainsi que Théophile Gautier commence son feuilleton en déclarant que « si la partition de Sapho n'est pas un chef-d’œuvre, c'est du moins une des belles pages que l'art moderne ait à enregistrer ». Mais il continue en adressant au compositeur de singulières critiques : « On devine facilement, dit-il, en entendant la musique de Gounod, son habitude d'écrire pour l'église et sa préoccupation constante des vieux maîtres. » Il note la « coupe mal arrêtée qui rend la mélodie un peu diffuse » et le « défaut de clarté » qui résulte « du soin qu'a pris M. Gounod d'éviter les formules et les cadences admises de nos jours dans le domaine lyrique ». D'autres diront qu'il cherche à donner à la « déclamation des formes rétrospectives », au récitatif « des tournures qui remontent à la vieille école française de Lully ». « Cette tendance à l'emprunt de formes archéologiques, ajoutera-t-on, est très sensible dans la plupart des chœurs. » Donc, musicien obscur parce que trop savant et trop imbu des traditions de la musique religieuse, voilà ce que l'on ira répétant à satiété depuis ce début très discuté, jusqu'à ce Faust, dont les premiers auditeurs, nous le verrons, déclarèrent la musique inintelligible. On croit rêver ! Mais c'est ce qui prouve bien que Gounod apportait du nouveau.
Quant aux ennemis de Mme Viardot, voici avec quelle brutalité ils attaquaient son interprétation, dans le journal des Escudier : « Mme Viardot ne chante plus ; chaque note qui sort de sa voix intelligente est un cri déchirant. Cette cantatrice que nous avons tant admirée est morte ou à peu près pour l'art. Son organe brisé n'a plus aucun charme ; ce n'est que l'ombre d'un beau tableau. Ce rôle de Sapho sera, nous le craignons bien, sa dernière création, et cette création n'éternisera pas son nom. »
Sapho quitta
l'affiche après sept représentations.
Berlioz seul avait vu la vérité : « Si les deux premiers actes étaient égaux en
valeur au dernier, écrivait-il, M. Gounod eût débuté par un chef-d'œuvre. »
***
Notons au passage quelques menus événements.
Le 4 janvier 1852, la Société Sainte-Cécile, dirigée par Seghers et Weckerlin, donnait de notre compositeur un Sanctus et un Benedictus, sans doute ceux que Mme Viardot avait fait exécuter à Londres. Voilà qui accréditait de plus en plus l'opinion que Gounod était avant tout un auteur religieux.
Par contre, le 9 janvier, la Comédie-Française représentait le Bourgeois Gentilhomme avec ses divertissements « arrangés » par Gounod.
Le 15 février, la Société Sainte-Cécile faisait entendre deux chœurs d'hommes de l'auteur de Sapho, le Vin des Gaulois et la Danse de l'Epée.
Voici qui est plus important : Le 20 avril 1852, Gounod épousait Mlle Anna Zimmermann, fille du professeur de piano au Conservatoire. Quelque temps auparavant, alors qu'il n'était encore que fiancé, il écrivait à un ami : « Nous sommes tous on ne peut plus contents de cette union, qui nous paraît offrir les plus sérieuses assurances de bonheur durable. La famille est excellente et j'ai l'heureuse chance d'y être aimé de tous ses membres. » Pourquoi Gounod parlait-il autant et plus de la famille dans laquelle il allait entrer que de la jeune fille à laquelle il allait s'unir ? Etait-il surtout attiré par un milieu à la fois de caractère sérieusement artiste, de solide probité, et de chaude cordialité, sans avoir approfondi davantage les raisons de sentiment qui pouvaient l'attacher à sa fiancée ?... Par ce mariage Gounod devenait le beau-frère du jeune peintre Edouard Dubufe.
A la même époque, Gounod était nommé directeur de l'Orphéon de la Ville de Paris (*), institution alors très réputée. L'Orphéon avait été fondé par l'ancien polytechnicien Bocquillon-Wilhem, qui avait eu le mérite et l'habileté d'introduire et de faire rendre obligatoire l'enseignement du chant dans les écoles de la Ville de Paris. L'Orphéon se recrutait dans la classe ouvrière, et il était l'objet de toute l'attention du gouvernement. Gounod prit sa tâche en main avec le plus grand zèle et la plus ferme énergie. Sa direction de l'Orphéon lui donna l'occasion d'écrire plusieurs œuvres chorales et religieuses telles que le Vin des Gaulois, la Cigale et la Fourmi, le Corbeau et le Renard, l'Hymne à la France, le chœur patriotique du second Empire Vive l'Empereur, la Messe des Orphéonistes (a cappella), etc., etc.
(*) Et en même temps directeur de l'Enseignement du Chant dans les écoles communales de la Ville de Paris.
Constatons ici le goût de notre compositeur pour les fables de La Fontaine, qu'il met volontiers en musique, soit qu'il en fasse la matière de chœurs : la Cigale et la Fourmi, le Corbeau et le Renard ; soit qu'il les traite en chant solo, comme le Rat de ville et le Rat des champs dans Philémon et Baucis ; soit qu'il y puise le sujet d'un livret tout entier comme c'est le cas pour cette dernière œuvre. Quel lien secret pouvons-nous donc découvrir entre le poète et le musicien, entre La Fontaine et Gounod ? Peut-être celui-ci : Nous avons déjà noté en étudiant les mélodies de Gounod ce style pour ainsi dire parlé qu'il y emploie souvent, tout voisin du style narratif nécessaire à la fable mise en musique. Gounod sait « raconter » en musique. De plus, il y a chez La Fontaine, comme chez beaucoup d'autres fabulistes et conteurs, une certaine simplicité, une certaine familiarité, qui n'exclut du reste à aucun degré le sentiment poétique, et qui constitue précisément l'un des caractères essentiels de l'art de Gounod. Nous ne nous étonnerons donc pas que la fable, surtout celle de La Fontaine, mais toute fable en général, tout conte lui convienne à merveille ; et nous pouvons ajouter un autre exemple tout à fait significatif : c'est ce petit chef-d’œuvre qu'est la Ballade de la Reine Mab dans Roméo et Juliette. La fable, le conte, La ballade réclament enfin des ressources de pittoresque qui comptent parmi les dons les plus remarquables (et les moins remarqués) de notre auteur ; à cet égard, la Reine Mab fournit une preuve décisive du tempérament de coloriste qu'il importe de souligner chez Gounod et qui éclate en mille pages diverses, depuis Venise, jusqu'à la Sérénade de Méphisto en passant par la Marche funèbre d'une Marionnette.
***
La couleur est justement le caractère principal d'une œuvre bien oubliée de Gounod et qui ne mérite pas cet oubli, Ulysse. On a le tort de la désigner d'ordinaire sous le titre : les chœurs d'Ulysse. Ce ne sont pas des chœurs seulement. C'est toute une partition de musique de scène instrumentale et vocale destinée à accompagner la tragédie de Ponsard, une partition dans le genre de l'Arlésienne de Bizet. Malheureusement l'Ulysse de Ponsard ne vaut pas l'Arlésienne de Daudet, sans quoi la musique de Gounod aurait eu sans doute une fortune analogue à celle de Bizet. La tragédie de Ponsard fut représentée pour la première fois au Théâtre Français le 18 juin 1852, et ce fut un « four » mémorable.
Ce n'était pas ce qu'avait prédit Berlioz à Gounod, Berlioz qui, avant la représentation, avait lu la partition manuscrite de son jeune confrère. « L'œuvre, disait-il, dans son ensemble, me paraît fort remarquable et l'intérêt musical va croissant avec celui du drame. Le double chœur du Festin est admirable et produira un effet entraînant s'il est convenablement exécuté. La Comédie-Française ne doit ni ne peut lésiner sur vos moyens d'exécution. La musique seule, selon moi, attirera la foule pendant un grand nombre de représentations. Il est donc de l'intérêt le plus direct, le plus commercial, du directeur de ce théâtre de faire au compositeur la part large dans les dépenses et la mise en scène d'Ulysse ; et je crois qu'il la lui fera telle. Mais ne faiblissez pas. Il faut ce qu'il faut, ou rien. Prenez garde aux chanteurs que vous chargerez de vos solos : un solo ridicule gâte tout un morceau. » On mit à la disposition de Gounod treize violons, cinq altos, quatre violoncelles, quatre contrebasses, une harpe et les instruments à vent. C'était Jacques Offenbach qui conduisait l'orchestre et Weckerlin les chœurs composés d'élèves du Conservatoire.
Camille Saint-Saëns nous a laissé dans ses Portraits et Souvenirs une relation de la « première ». « On comptait beaucoup, écrit-il, au Théâtre Français, sur la pièce nouvelle. Un orchestre complet, choisi, des chœurs excellents, de magnifiques décors, rien ne fut épargné. Le beau rideau reproduisant le Parnasse de Raphaël, qu'on vit longtemps à la Comédie, avait été peint à cette occasion. Désirant passionnément pour la musique de mon grand ami le succès qu'elle méritait, je voulais que la tragédie fût un chef-d’œuvre et je n'admettais pas qu'elle pût ne pas réussir. Hélas ! la première représentation, à laquelle j'avais convié un étudiant en médecine, fervent amateur de musique, cette première fut lamentable. Un public en majeure partie purement littéraire et peu soucieux d'art musical accueillit froidement les chœurs ; la pièce parut ennuyeuse et certains vers, d'un réalisme brutal, choquèrent l'auditoire ; on chuchotait, on riait. Au dernier acte, un hémistiche, — Servons-nous de la table, — provoqua des hurlements ; j'eus la douleur de voir mon ami l'étudiant, que j'étais parvenu à contenir jusque-là, rire à gorge déployée. Cette tragédie bizarre, curieuse après tout, aurait mérité peut-être des spectateurs plus patients. L'exécution était des plus brillantes. Delaunay, l'artiste impeccable, habitué à l'emploi des amoureux, semblait mal à l'aise dans le rôle insipide de Télémaque ; en revanche, Geoffroy avait trouvé dans celui d'Ulysse ample matière à déployer ses précieuses qualités. Mme Nathalie était fort belle, descendant de son nuage au prologue, et Mlle Judith avait toute la grâce pudique, toute la noblesse désirable dans le rôle de Pénélope. »
Pour compenser cette indifférence du public de la « première » à la musique, il y eut, heureusement, une critique musicale, malgré certaines réserves, assez favorable. Scudo prononçait même le nom de Mozart. Mais dans la Revue musicale on reprochait à Gounod « des formes de chant d'une excentricité peut-être étudiée » et Ernest Reyer notait : Le talent de M. Gounod ne s'est pas encore débarrassé de l'austérité inséparable de la forme religieuse... Sous les frises du théâtre il se croit encore quelquefois sous les voûtes de l'église. » Invraisemblable reproche. Mais, pour longtemps encore, Gounod était classé compositeur religieux. Même un bon musicien, un critique averti comme Ernest Reyer se laissait entraîner par l'opinion courante.
Un seul critique, Maurice Bourges, donnait la note juste en remarquant dans la partition d'Ulysse, malgré des imperfections secondaires... un profond sentiment de couleur locale... « Il s'exhale, ajoutait-il, de cette musique une senteur puissante qui prend au cerveau et réveille, quoi qu'on en ait, le souvenir des temps fabuleux. » Voilà la vérité. Et cette couleur locale « n'est obtenue par aucune imitation » des procédés techniques de la musique grecque ancienne. Elle ne résulte d'aucun archaïsme littéral. Elle provient uniquement de la qualité du sentiment poétique dont s'inspire cette musique essentiellement naïve et pastorale. Les impressions directes qu'a ressenties Gounod à Rome en présence d'une nature calme, tranquille, sereine et des campagnards qui s'y livrent à leurs occupations traditionnelles dans un cadre aux lignes simples, grandes et pures, impression qu'il renouvellera plus tard en Provence, voilà le fonds très riche, très solide et très sûr qui lui fournit cette évocation si suggestive de la Grèce antique. Nous y pressentons le peintre de Philémon et celui de Mireille.
Mais dès la première page de la partition nous comprenons ce qui put effrayer les timides auditeurs de 1852. L'introduction d'orchestre sur cette indication : « Ulysse, seul, endormi sur le sable du rivage », s'ouvre par une pédale de sol qui soutient sans aucune harmonie la descente d'une ligne mélodique sinueuse doublement chromatique, bien faite pour effaroucher des oreilles aux exigences impitoyablement tonales. Pour les rassurer, suit un thème de cors en ut majeur qui oscille tout tranquillement de la tonique à la dominante dans un beau sentiment contemplatif et rêveur. Un contrepoint en trouble ensuite quelque peu la simplicité, jusqu'au retour de la phrase initiale. Puis vient un « mélodrame » où l'on rencontre quelques successions harmoniques qui, sans grande audace, ne manquent pourtant point de saveur. Suivent un premier, puis surtout un deuxième chœur des Naïades, plein de grâce et de charme. La sonorité en est délicieuse. « La sonorité, disait Gounod à Saint-Saëns, est encore inexplorée. » Et Saint-Saëns commente le mot : « Gounod disait vrai : depuis ce temps, quelle floraison magique est sortie de l'orchestre moderne ! Il rêvait, pour ses chœurs de nymphes, des effets aquatiques, et il avait recours à l'harmonica, fait de lamelles de verre, au triangle avec sourdine, celle-ci obtenue en garnissant de peau le battant de l'instrument. »
Mais n'insistons pas davantage sur une œuvre après tout de second plan et, sans feuilleter page par page la partition d'Ulysse, indiquons tout au moins le « réalisme familier » des chœurs de porchers si rudement scandés, et si voisins dans leur expressive nudité, de la poésie d'Homère, indiquons la grâce légère du chœur des suivantes infidèles au début du troisième acte, la touche orchestrale discrète et dramatique dont est soulignée la scène de la reconnaissance d'Ulysse par sa nourrice, le rythme magnifique du chœur des serviteurs des prétendants au quatrième acte et la vigueur tragique de la scène de l'arc. Pourquoi faut-il que, la tragédie de Ponsard étant devenue « impossible », toute cette musique soit mort-née. Comment faut-il que nous ne puissions, de toute manière, songer à ressusciter l'ouvrage de Gounod à côté du chef-d’œuvre récent et qui se suffit à lui-même (puisqu'il n'est pas le simple accompagnement d'un ouvrage littéraire) de Gabriel Fauré ?
***
Nous arrivons à une œuvre dont la destinée est vraiment curieuse. Elle est réputée avoir subi un lamentable échec. Personne aujourd'hui ne la connaît, personne ne l'a lue. On en cite parfois le titre comme symbole des effroyables erreurs dans lesquelles peut tomber un grand compositeur. Camille Bellaigue l'expédie en trois lignes.
Et pourtant c'est à propos de la Nonne sanglante que nous lisons cet étonnant feuilleton d'Adolphe Adam : « M. Gounod est un talent sérieux, élevé, un peu trop rêveur peut-être, mais qui, depuis ses premiers pas dans la carrière musicale, se signale par des progrès immenses à chaque production nouvelle. Dans Sapho, il cherchait encore sa voie : il l'avait déjà trouvée dans les chœurs d'Ulysse, œuvre trop peu connue et dont le mérite suffirait pour asseoir la réputation d'un compositeur. La Nonne sanglante est l’œuvre d'un maître, et son mérite est tel que de nombreuses auditions seraient sans doute nécessaires pour l'apprécier à sa juste valeur... Ah ! mon cher Gounod, si au lieu de demeurer avec Blanche, vous habitiez quelque Léopoldstrasse, à Berlin ou à Munich ; si au lieu d'être directeur à l'Orphéon, vous étiez maître de chapelle de quelque principauté d'Allemagne, si votre nom était impossible à prononcer... vous seriez un bien grand homme ! M. Richaut ou M. Brandus graverait immédiatement votre partition, quelque Castil-Blaze moderne la traduirait, la ferait représenter partout à son bénéfice... J'ai vu des gens ayant fort applaudi votre opéra me dire : « C'est dommage, ce n'est pas amusant. » Je leur ai demandé si Alceste et Iphigénie en Tauride étaient réjouissants et si le Prophète leur paraissait d'une gaieté folle : ils ne m'ont rien répondu. »
Berlioz, d'autre part, déclarait : « Le succès de la Nonne n'a pas été un seul instant douteux ; on a rappelé tous les acteurs et l'auteur de la musique, qui seul s'est abstenu de paraître. »
Enfin, Théophile Gautier, qui consacrait à la Nonne deux feuilletons de la Presse, affirmait : « La partition est une des œuvres les plus belles, les plus grandioses de ce temps-ci. »
J'ai pris la peine de lire la partition de bout en bout. Et voici quelle est mon impression c'est de la musique bien faite, soignée, parfois savante, du moins pour l'époque, qui doit plaire à des musiciens pour ses qualités techniques ; en quelques endroits je l'ai sentie véritablement inspirée. Les critiques du temps lui ont accordé des éloges exagérés. On l'a trop rabaissée depuis. Elle ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Gounod a fait un grand effort, mais il n'a pas été soutenu, porté par son livret.
Ce livret, avant d'arriver jusqu'à lui, était passé de main en main et il avait rebuté tous les compositeurs qui s'y étaient attaqués. Tiré par Scribe et Germain Delavigne d'un roman de Lewis, le Moine, il avait été successivement offert à Berlioz, à Meyerbeer, à Halévy, à Félicien David, à Grisar, à Verdi, à Clapisson. Tous avaient renoncé, sauf Berlioz. Celui-ci y avait travaillé de 1841 à 1847 et Scribe avait fini par lui réclamer son texte, ce qui fâcha Berlioz et obligea Gounod à une démarche qu'il nous conte en ces termes : « Je fis part à Berlioz de ma répugnance à me charger d'une œuvre qui lui avait été retirée contre son gré. Berlioz très sensible à ma démarche, leva tous mes scrupules, quoique puisse laisser supposer un passage de ses Mémoires dicté soit par l'oubli du fait, soit par un mouvement de dépit bien pardonnable et que les déboires de ce grand et malheureux génie excusent du reste. »
Ce livret, c'est une histoire de spectre, dans le genre de la Dame Blanche, mais d'un caractère tragique. Elle est combinée avec le sujet de Pierre l'Ermite. Le tout constituait un mélange assez bizarre dont Gounod lui-même a écrit : « Je ne sais si la Nonne sanglante était susceptible d'un succès durable ; je ne pense pas ; non que ce fût une œuvre sans effet (il y en avait quelques-uns de saisissants) ; mais le sujet était trop uniformément sombre ; il avait, en outre, l'inconvénient d'être plus qu'imaginaire, plus qu'invraisemblable ; il était en dehors du possible, il reposait sur une situation purement fantastique, sans réalité, et par conséquent sans intérêt dramatique, l'intérêt étant impossible en dehors du vrai, ou tout au moins du vraisemblable. » Cependant la pièce fit d'abord recette, sept ou huit mille francs par représentation, tandis qu'on n'encaissait que 6.500 avec les Huguenots. La Nonne sanglante avait paru déjà onze fois sur la scène, lorsque Nestor Roqueplan quitta la direction, et un nouveau directeur, Crosnier, arrêta net les représentations, disant que tant qu'il serait à la tête de l'Opéra « on ne jouerait pas une pareille ordure ! »
Tout est étrange dans la destinée de cette pauvre Nonne : le premier accueil du public et de la critique (le 18 octobre 1854), si opposé à la réputation détestable qu'elle a laissée, la manière brutale dont les premières représentations furent arrêtées, la mauvaise volonté des historiens à entreprendre à nouveau l'examen critique de l'œuvre ; il est entendu que la Nonne ne vaut rien : on n'y regarde pas de plus près. Il serait tout de même intéressant d'en faire entendre au concert quelques fragments. On pourrait tout au moins retenir le beau chant repris en chœur, à la Hændel, de Pierre l'Ermite au premier acte (*).
(*) On peut signaler aussi au deuxième acte le prélude symphonique des Ruines et la Marche des Revenants ; au troisième acte, une cavatine du ténor et son duo avec la Nonne.
La Nonne sanglante reste une énigme.
***
Cependant, une courte page, la Méditation sur le premier prélude de Bach (1853) devait faire plus que de longues partitions pour la réputation du jeune Gounod. Ce fut un succès immédiat et considérable. Elle avait d'abord donné lieu à une mélodie esquissée sur des paroles de Lamartine, puis à un chœur sur paroles latines. Elle se répandit sous la forme d'un solo de violon accompagné par l'harmonium et le piano. Elle se transforma en un Ave Maria encore plus goûté et finit par supporter, plutôt mal d'ailleurs, l'arrangement pour orchestre, « sans oublier la grosse caisse et les cymbales ». C'était désormais pour Gounod, grâce à cette mince production, la véritable popularité.
On a dit beaucoup de mal de l' « Ave Maria de Gounod ». On en a jugé l'inspiration fade. On a parlé de la profanation du chef-d’œuvre de Bach. Ne nous indignons pas outre mesure. Ne prononçons pas de grands mots. Le Premier Prélude pour clavecin de Bach n'est pas, après tout, un ouvrage de haute portée, de profonde signification. L'auteur ne le considérait vraisemblablement que comme un amusement musical sans autre conséquence. Il est évidemment de la forme la plus harmonieuse qu'on puisse imaginer, d'une perfection souveraine, d'une charme délicieux. Mais à cet accompagnement qui n'accompagne rien, pourquoi ne pas imaginer le complément d'une mélodie ? La mélodie qu'a inventée Gounod n'enlève rien à la beauté des harmonies qui la soutiennent. Et, quoi qu'on dise, elle est, en son début, d'une souveraine pureté bien digne du texte divinement simple et souple auquel elle s'ajoute. Si elle se passionne par la suite, ce n'est pas au détriment de la ligne. Renonçons à une intransigeance exagérée. Soyons tout au moins indulgents. Mais il faut ramener la phrase à son intention première et la délivrer de toute cette emphase dont de mauvais chanteurs l'ont déplorablement chargée. N'empêche que l'on peut aimer mille fois mieux le « Je vous salue, Marie » d'André Caplet. Cela va sans dire. Il faut surtout préférer à l'Ave Maria de Gounod la version de la Méditation sur le Premier Prélude de Bach pour violon seul, sans voix.
***
Pour se consoler de la carrière interrompue de la Nonne sanglante, Gounod se met à composer une Première Symphonie en ré (1855), dont la grâce, le charme, et la « science » sont très appréciés des auditeurs des Concerts Pasdeloup, et de la critique, Encouragé par ce succès, il compose une Deuxième Symphonie en mi bémol qui n'est pas moins bien accueillie.
***
Durant l'été de 1855, retiré à « la Luzerne », près d'Avranches, dans la propriété d'un de ses beaux-frères, Gounod entreprend la composition d'une Messe de Sainte-Cécile qu'il n'interrompt de temps à autre que pour l'austère lecture de saint Augustin.
Au sujet de cette messe, il écrit à sa mère : « Entre chacun des trois Agnus qui sont chantés par le chœur, j'ai placé une phrase de chant solo sur les mots : Domine, non sum dignus, que j'ai pensé pouvoir intercaler comme étant les paroles de l'office même, au moment de la communion. La première fois, cette phrase est dite par une voix de ténor, représentant l'homme, dont la conscience plus chargée se traduit par un accent plus pénétré de pénitence ; la seconde fois elle est confiée, avec un tour un peu modifié, à la voix de soprano, emblème de l'enfant, dont la crainte est moindre et la confiance plus grande, en raison de la sérénité que donne l'innocence. » L'intention est intéressante et réalisée de la façon la plus heureuse.
En présence de sa lourde tâche, Gounod confesse d'autre part sa propre indignité : « Il n'y a qu'une difficulté, c'est de répondre par la musique aux exigences de cet incomparable et inépuisable sujet : la messe !... En musique !... par un pauvre homme !... Mon Dieu, ayez pitié de moi !... » La Messe de Sainte-Cécile, une des plus inspirées pourtant parmi les œuvres religieuses de Gounod, était loin de le satisfaire et il avait dans l'esprit le projet « d'une musique sacrée d'une forme tonte nouvelle ».
L'exécution de la Messe de Sainte-Cécile eut lieu le 22 novembre 1855 Saint-Eustache. Elle causa, nous dit Saint-Saëns, une sorte de « stupeur ». Non point que le procédé technique en fût agressif, loin de là. Mais, « parce que cette simplicité, cette grandeur, cette lumière sereine qui se levait sur le monde musical comme une aurore gênaient bien des gens ; on sentait l'approche d'un génie, et, comme chacun sait, cette approche est généralement mal accueillie ». Simplicité, ajouterons-nous, parfois un peu nue et qui gagnerait à s'enrichir d'un peu plus de substance musicale et d'un peu plus de pensée, d'un sentiment sinon plus abondant du moins plus profond. Gounod plane volontiers dans une atmosphère de sérénité d'où la réflexion semble un peu bannie.
***
Cette même année 1855, Gounod trouve autour de lui plusieurs relations utiles. Il fait la connaissance de deux exquis chanteurs, les frères Lionnet, qui seront de précieux interprètes pour ses mélodies, — la connaissance aussi de ses futurs librettistes, Jules Barbier et Michel Carré, — et il rencontre un éditeur qui, pour la première fois, consent à graver à ses frais une de ses mélodies. Il enthousiasme Anatole Lionnet en lui chantant Venise, l'admirable musique inspirée par les vers d'Alfred de Musset, et il lui dédie une bien jolie petite pièce : Mon habit, sur les paroles de Béranger. Aussitôt, Anatole Lionnet se rend chez l'éditeur Heugel et lui fait entendre Mon habit. Pour qui connaît la simplicité de cette petite chanson, la réflexion d'Heugel, après l'avoir écoutée, vaut de l'or : « C'est charmant, me dit-il, raconte Lionnet, mais pas commode à bien chanter ; et puis le morceau est surtout fait pour les délicats... Ce n'est guère de vente... » Il se décida cependant à publier la mélodie, mais seulement sur la promesse de Lionnet qu'il l'inscrirait souvent à ses programmes. Et il offrait à Gounod 100 francs pour prix de l'œuvre... Bientôt après, Gounod écrivait pour les frères Lionnet Deux vieux amis, une « scène » sur des paroles de Pierre Véron, qui remporta, comme Mon habit, un succès considérable. Ces petites choses, de même que l'Ave Maria, faisaient beaucoup pour la renommée du compositeur. Le 6 janvier 1856 le gouvernement impérial lui décernait la croix de la Légion d'honneur.
La mort d'Adolphe Adam (1856) laisse un fauteuil vacant à l'Académie des Beaux-Arts. Gounod pose sa candidature. Il recueille six voix, mais ne s'étonne pas de se voir devancé par Berlioz, qui est élu par dix-neuf voix.
« Le dimanche 8 juin 1856, nous dit Gounod, ma femme me donna un fils. (Trois ans auparavant, le 13 du même mois, nous avions eu la douleur de perdre un premier enfant, une fille, qui n'avait pas vécu.) Le matin du jour où naquit mon fils, ma courageuse femme, au moment où j'allais partir pour la séance [la grande séance annuelle] de l'Orphéon, eut la force de me cacher les douleurs dont elle ressentait les premières atteintes ; et lorsque, dans l'après-midi, je rentrai à la maison, mon fils était au monde. »
Gounod travaillait alors à un Ivan le Terrible, dont le poème était de Leroy et Trianon et que lui avait proposé Crosnier, le directeur de l'Opéra. Sa partition était déjà fort avancée quand soudain il l'abandonna, non sans en réserver certains éléments qu'il devait replacer dans Faust et dans la Reine de Saba.
En octobre 1857, Gounod souffrit d'une violente crise nerveuse dont la presse exagéra singulièrement l'importance. On déclara Gounod « perdu pour l'art ». On répandit le bruit qu'il délirait, qu'il n'avait plus sa raison. Un repos d'une dizaine de jours dans la maison du docteur Blanche suffit à le remettre. N'empêche que l'alerte avait été vive, la secousse grave. Et cependant Gounod rentrait dans sa demeure de Saint-Cloud et « reprenait vite ses occupations habituelles ». Il se remettait à ce Faust auquel il avait toujours pensé mais qui l'occupait plus particulièrement depuis quelque temps. Nous voici en présence de l'œuvre capitale du maître, dont on a dit tant de bien et tant de mal, qu'on a comparée dans des intentions diverses au Faust de Goethe, qui l'inspira, et dont elle semble à quelques-uns avoir été une profanation. Jugeons-en.
FAUST
Le Faust de Goethe fut le compagnon de toute sa vie. Il y travailla dès sa jeunesse, alors qu'il était étudiant à Strasbourg. A ses derniers moments, Faust l'occupait encore.
Il n'est point d'œuvre plus complexe. On ne saurait la définir d'un mot. C'est, si l'on veut, un drame, mais c'est aussi un poème lyrique, une satire politique et littéraire, une sorte de roman philosophique ; c'est tout cela et c'est plus encore : parfois de la féerie, du ballet, de l'opéra. Seul le génie prodigieux d'un Goethe pouvait créer ce monde de pensées et de rêves, cette inépuisable diversité d'images.
Faust a vécu réellement entre 1480 et 1540 environ. Charlatan illuminé, à moitié sincère, ses aventures ont frappé vivement l'imagination populaire pour laquelle il est resté le type même du magicien. L'histoire plus ou moins véridique de sa vie, enrichie évidemment de toutes sortes d'inventions fantastiques, est contenue dans le Livre populaire du docteur Faust (1587).
Nous y trouvons le docteur Faust tenté par le diable sous la figure de Méphistophélès. De son sang, il signe un pacte par lequel il se damne pour l'éternité, tandis que le diable lui promet ses services durant le cours de sa vie terrestre. Et c'est alors un ramassis d'histoires de sorcellerie de toutes sortes. On nous décrit dans le plus petit détail toutes les opérations magiques auxquelles, avec l'aide de Méphisto, se livre le docteur Faust.
Notamment, Faust demande à Méphisto la plus belle femme du monde, et Méphistophélès fait renaître pour lui la célèbre Hélène, femme de Ménélas. De l'union de Faust avec Hélène naît un fils qui grandit auprès de lui.
Sur la fin de ses jours Faust est saisi d'une terrible angoisse à l'idée d'être damné. A l'heure fixée pour sa mort, il réunit autour de lui de gais compagnons, ses amis de débauche, pour le protéger contre l'enfer. Il leur demande de prier avec lui, de supplier Dieu afin d'obtenir que, s'il doit laisser son corps au diable, il sauve au moins son âme.
Dans la nuit suivante, une tempête s'élève, ébranle la maison et, le lendemain, on trouve dans sa chambre le corps de Faust en lambeaux, son crâne brisé, sa cervelle en bouillie.
Hélène et son fils, qui n'avaient cessé d'habiter avec Faust, s'étaient évanouis, avaient disparu comme des ombres.
Cette vieille légende offrit à Goethe l'occasion toujours cherchée par lui, des descriptions du monde surnaturel des esprits. Mais surtout elle lui fournit un cadre pour exprimer sa conception de l'univers et de la vie. Il l'enrichit d'ailleurs d'une foule d'éléments nouveaux, quand ce ne serait que l'épisode essentiel de Marguerite, totalement absent de toutes les versions de l'ancien Faust.
Dans l'œuvre de Goethe, Faust représente le poète lui-même, le penseur, le savant, le philosophe, passionnément attaché à la recherche de la vérité, infatigablement curieux et actif, confiant dans ses forces et dans l'appui de la Nature dont il ne saurait admettre l'irréductible hostilité à l'homme de bonne volonté.
Mais côté de lui, et peut-être en lui-même, il rencontre sans cesse les doutes, les ironies, les moqueries de l'esprit négateur, de l'esprit critique, destructeur de la foi et de l'action. Faust a nécessairement pour compagnon le diable fait homme, Méphistophélès.
Chacun de nous porte en soi un démon qui veut le perdre et dont il triomphera s'il sait seulement vivre avec ardeur et sincérité. Toute la vertu est là. Dieu y retrouvera son bien. Et Faust n'est point damné, comme dans l'ancienne légende. Il est sauvé.
De l'immense drame de Goethe rappelons les principaux moments :
D'abord une admirable dédicace dans laquelle Goethe évoque les charmantes illusions du matin de sa vie, puis un prologue sur le théâtre où le directeur, le poète et le bouffon échangent des propos satiriques sur les tristes conditions de l'art dramatique, les sottes exigences du public, la platitude des réalisations scéniques d'une grande pensée poétique, ensuite un prologue dans le ciel où Méphistophélès, dans un audacieux dialogue avec le Seigneur Dieu obtient du Tout-Puissant la permission de tenter Faust.
MÉPHISTOPHÉLÈS
Maître puisque une fois tu te rapproches de nous, puisque tu veux connaitre comment les choses vont en bas, et que, d'ordinaire, tu te plais à mon entretien, je viens vers toi dans cette foule. Pardonne si je m'exprime avec moins de solennité [que les trois archanges qui venaient de chanter les louanges du Seigneur]. Je crains bien de me faire huer par la compagnie ; mais le pathos dans ma bouche te ferait rire assurément, si depuis longtemps tu n'en avais perdu l'habitude. Je n'ai rien à dire du soleil et des sphères, mais je vois seulement combien les hommes se tourmentent. Le petit dieu du monde est encore de la même trempe et bizarre comme au premier jour. Il vivrait, je pense, plus convenablement si tu ne lui avais frappé le cerveau d'un rayon de la céleste lumière. Il a nommé cela raison et ne l'emploie qu'à se gouverner plus bêtement que les bêtes. Il ressemble (si ta Seigneurie le permet) à ces cigales aux longues jambes qui s'en vont sautant et voletant dans l'herbe, eu chantant leur vieille chanson. Et s'il restait toujours dans l'herbe ! Mais non, il faut qu'il aille encore donner contre tous les tas de fumier.
LE SEIGNEUR
N'as-tu plus rien à nous dire ? Ne viendras-tu jamais que pour te plaindre ? Et n'y a-t-il, selon toi, rien de bon sur la terre ?
MÉPHISTOPHÉLÈS
Rien, Seigneur : tout y va parfaitement mal, comme toujours ; les hommes me font pitié dans leurs jours de misère, au point que je me fais conscience de tourmenter cette pauvre espèce.
LE SEIGNEUR
Connais-tu Faust ?
MÉPHISTOPHÉLÈS
Le docteur ?
LE SEIGNEUR
Mon serviteur.
MÉPHISTOPHÉLÈS
Sans doute. Celui-là vous sert d'une manière étrange. Chez ce fou, rien de terrestre, pas même le boire et le manger. Toujours son esprit chevauche dans les espaces, et lui-même se rend compte à moitié de sa folie. Il demande au ciel ses plus belles étoiles et à la terre ses joies les plus sublimes ; mais rien, de loin ni de près, ne suffit à calmer la tempête de ses désirs.
LE SEIGNEUR
Il me cherche ardemment dans l'obscurité, et je veux bientôt le conduire à la lumière. Dans l'arbuste qui verdit, le jardinier distingue déjà les fleurs et les fruits qui se développeront dans la saison suivante.
MÉPHISTOPHÉLÈS
Voulez-vous gager que celui-là, vous le perdrez encore ? Mais laissez-moi le choix des moyens pour l'entraîner doucement dans mes voies.
LE SEIGNEUR
Aussi longtemps qu'il vivra sur terre, il t'est permis de l'induire en tentation. Tout homme qui marche peut s'égarer.
MÉPHISTOPHÉLÈS
Je vous remercie. J'aime avoir affaire aux vivants. J'aime les joues pleines et fraîches. Je suis comme le chat, qui ne se soucie guère des souris mortes.
LE SEIGNEUR
C'est bien, je le permets. Ecarte cet esprit de sa source, et conduis-le dans ton chemin, si tu peux ; mais sois confondu, s'il te faut reconnaître qu'un homme de bien, dans la tendance confuse de sa raison, sait distinguer et suivre la voie étroite du Seigneur.
En fin de compte, le Seigneur conclut :
Tu pourras toujours te présenter ici librement. Je n'ai jamais haï tes pareils. Entre les esprits qui nient, l'esprit de ruse et de malice me déplaît le moins de tous. L'activité de l'homme se relâche trop souvent ; il est enclin à la paresse, et j'aime à lui voir un compagnon actif, inquiet, et qui même peut créer au besoin comme le diable...
(Le ciel se ferme, les archanges se séparent.)
MÉPHISTOPHÉLÈS
J'aime à visiter de temps en temps le vieux Seigneur, et je me garde de rompre avec lui. C'est fort bien de la part d'un aussi grand personnage de parler lui-même au diable avec tant de bonhomie.
Alors commence le premier Faust. Le début en est consacré aux méditations de Faust sur la vie et sur la mort, sur la science et sur la magie, à sa rencontre avec Méphistophélès, à la conclusion du pacte diabolique, aux premières pérégrinations des deux compagnons à travers le monde. Ici se placent les deux tableaux de la taverne d'Auerbach et de l'antre de la sorcière. Puis se déroule la touchante histoire de Marguerite, interrompue par la course du Sabbat et la Nuit de Walpurgis. Enfin, c'est la tragique scène du cachot et le suprême dialogue de Faust et de Marguerite.
Le second Faust débute par un prologue où Faust, bercé par les chants du chœur des Elfes, se livre à des rêveries poétiques sur les beautés de la Nature et l'impuissance de l'homme à pénétrer jusqu'au fond ses secrets intimes.
Nous voici maintenant transportés à la cour impériale. Faust se met au service de l'Empereur, et, pour lui plaire, évoque devant lui toutes sortes d'apparitions prestigieuses. C'est ainsi que se trouve amené le voyage fantastique de Faust dans le pays des ombres, dans les profondeurs mystérieuses du Passé et, bien au delà encore, jusqu'auprès des redoutables « Mères », à la source intemporelle de l'Etre.
Puis nous assistons à cet étrange Enlèvement d'Hélène où les époques se trouvent confondues, où des guerriers du moyen âge entrent en lutte avec les troupes de Ménélas, et qui n'est que le symbole longuement développé de la prise de possession de l'antiquité par le génie de Goethe. Hélène s'unit alors à Faust et donne le jour à un fils, Euphorion, dont les jeux innocents et fantasques ont toute la liberté, la souplesse et l'harmonie, le caprice parfois inquiétant aussi de la divine Poésie.
L'Empereur n'est pas oublié. Le voici qui gagne une bataille grâce à l'intervention de Faust et de Méphisto. En récompense de ses services, Faust obtient un vaste royaume où il pourra donner un nouveau but à son activité. Il veut organiser, suivant des plans nouveaux et pour le bonheur de tous, le travail des hommes sur la terre. En définitive, par un effort gigantesque, il n'a réussi qu'à préparer la tombe dont il s'approche pas à pas, toujours plein d'espoir dans l'avenir. Il n'a rien à regretter. Sa vie est un chef-d’œuvre d'humanité.
Un épilogue nous montre Méphisto en lutte avec le Seigneur Dieu auquel il prétend disputer celui qu'il croit avoir gagné à l'enfer. Mais, avec le secours de Marguerite repentie, l'âme de Faust s'élève désormais à travers les sphères célestes jusqu'aux plus hautes régions de la sereine béatitude.
Voilà résumé en quelques lignes ce vaste poème qui devait prêter à tant de commentaires musicaux divers mais dont l'étendue même interdisait à tout compositeur d'en illustrer intégralement le texte.
Il fallait d'abord éliminer tout ce qu'il y avait dans cet immense ouvrage de purement politique, philosophique ou littéraire. Il fallait ensuite choisir quelques scènes particulièrement caractéristiques et les grouper suivant un plan défini.
Ou bien, comme Liszt, il fallait renoncer à s'inspirer littéralement du texte et se borner à dessiner comme il le fait dans sa célèbre Faust-Symphonie (et avec quelle profondeur !) les trois figures de Faust, de Marguerite et de Méphisto sans les mettre en scène, sans les faire parler ni agir, en les considérant seulement comme des idées poétiques inspiratrices de thèmes musicaux.
Sauf Liszt, tous les autres musiciens ont pris l'autre parti, et ils ont extrait de l'œuvre de Goethe quelques scènes qui les attiraient davantage et qui, à leur gré, semblaient le mieux appeler la musique.
Schumann a écrit un Faust dont tout élément pittoresque et tout esprit satirique sont absents. Marguerite y joue un rôle assez effacé. Faust occupe le premier plan et l'auteur s'est surtout attaché à rendre les parties mystiques du poème de Goethe.
Berlioz a été séduit par le décor, le magnifique décor romantique. Sur le fond brumeux et sombrement coloré de l'Allemagne moyenâgeuse se détachent dans son œuvre en groupes antithétiques les dénions, les sylphes, les étudiants, les soldats, Méphisto, Faust et la naïve Marguerite, qui, chacun pour son compte, participent de l'atmosphère et du décor flamboyant, s'en imprègnent ou s'y opposent.
De tous les musiciens qui ont touché à Faust, Boito est le plus philosophe, mais le moins musicien. Deus son poème il nous rend avec une certaine ampleur quelque chose de la multiple, ondoyante et harmonieuse pensée de Goethe. Il a tenté une synthèse rapide, mais aussi complète que possible de l'interminable drame. Malheureusement la musique s'efforce vainement à rejoindre la poésie sur les sommets où elle plane. Le souffle manque.
Très modestement, Jules Barbier et Michel Carré, les librettistes de Gounod, se sont bornés à mettre en scène le seul épisode de Marguerite, si poétique et si touchant. C'était leur droit (*).
(*) L'œuvre de Gounod se joue en Allemagne sous le titre de Margarethe qui lui convient d'ailleurs bien mieux que celui de Faust.
On regrette seulement qu'ils aient dessiné d'un trait bien mou et bien indifférent le personnage de Faust. Quand on songe à la place que tient Faust dans l'œuvre de Goethe, on reste confondu de ce qu'il a pu devenir dans le livret de Jules Barbier et Michel Carré ; Faust, c'est-à-dire Goethe lui-même, avec la plénitude d'une pensée qui embrasse l'univers entier à la fois dans la merveilleuse mécanique de ses phénomènes matériels et dans la vie végétale, animale, humaine qui l'anime, Goethe, avec ses curiosités insatiables et son grand esprit de synthèse, Goethe qui unit l'intelligence de l'antiquité et de l'art le plus sobrement classique aux plus aventureuses audaces des romantiques, l'amour du rêve au souci de la réalité et qui passe des régions sublimes de la poésie métaphysique aux spéculations les plus positives sur des questions d'économie sociale et d'organisation industrielle Dans l'œuvre de Goethe, Faust domine de toute la hauteur de son éminente supériorité intellectuelle la pauvre petite jeune fille ignorante et bornée qu'est Marguerite. Elle se fait toute modeste devant lui ; elle sait tout ce qui lui manque pour être son égale et ne lui apporte qu'un cœur simple et aimant. Cette simplicité même et cette profonde tendresse sont des biens inestimables dont Faust sent d'autant mieux tout le prix qu'il peut les comparer à tant d'autres biens qu'il possède déjà sans avoir celui-là.
Le Faust de Jules Barbier et Michel Carré n'est qu'un séducteur vulgaire. Ses mérites bien superficiels n'excusent plus Marguerite. Il n'a pas non plus lui-même l'excuse de la séduction exercée sur une grande âme un peu candide de penseur par la spontanéité de l'innocence.
C'est dès lors le renversement des rôles. Etant donné le piètre personnage de banal coureur d'aventures amoureuses que représente Faust dans la pièce de Jules Barbier et Michel Carré, c'est Marguerite maintenant qui domine Faust de toute la hauteur de sa supériorité morale, et il s'en faut de peu que son indigne amant ne nous devienne tout à fait odieux.
Il est vrai que, pour présenter Faust sous son véritable jour, il aurait fallu développer, infiniment plus que ne l'ont fait les librettistes, les parties de l'ouvrage où il était possible de montrer leur héros sous un aspect un peu relevé. Avant de mettre Faust aux prises avec sa passion pour Marguerite, il fallait nous faire connaître l'universalité de son génie, toutes les puissances variées de son esprit, de son imagination, de sa volonté et nous préparer ainsi à comprendre de quelle sorte très particulière de sentiment son cœur pouvait être touché par la grâce et la naïveté d'une timide jeune fille.
Mais alors on en revient à la conception de Goethe, qui déborde infiniment le cadre d'un opéra, surtout d'un opéra selon la formule de 1859.
Jules Barbier et Michel Carré ont eu au moins le mérite de conserver à Marguerite quelques-uns de ses traits essentiels et de s'en tenir même souvent à la traduction exacte des passages les plus caractéristiques de son rôle dans le texte de Goethe.
Ils ont ainsi permis à Gounod d'écrire les pages maîtresses de sa partition, celles qu'il était né pour composer et qui devaient le plus justement établir sa renommée. Car ce qu'il a certainement excellé à traduire musicalement, c'est le profond besoin de tendresse et l'émouvant envahissement de cette âme délicate par une passion qui la conduit au crime, son remords après la faute et sa foi rédemptrice.
Quant à Méphistophélès, dans le livret de Jules Barbier et de Michel Carré, il n'est que plaisant sans être terrible. En cela les adaptateurs du poème de Goethe ne se sont pas tellement éloignés de sa pensée. Le Méphisto de Goethe ne se présente pas sous un aspect bien effrayant. C'est surtout le « raisonneur » du drame, raisonneur singulièrement sceptique, ingénieusement négateur, d'une ironie cruellement mordante. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à côté du Méphisto de Goethe, celui de Jules Barbier et Michel Carré est en général d'une pensée un peu courte.
***
Comment Gounod fut-il amené à confier à Jules Barbier et Michel Carré le soin de mettre sur pied le libretto de son opéra ?
Nous avons déjà vu que dès son séjour à la Villa Médicis, Gounod formait le projet d'écrire un Faust, que le livre de Goethe ne le quittait pas et qu'il en faisait une de ses lectures favorites.
En décembre 1846 a lieu la première audition, à Paris, de la Damnation de Faust. Gounod ne peut manquer de sentir la beauté du chef-d’œuvre de Berlioz. Va-t-il renoncer à son projet, réalisé par un autre dans de si magnifiques conditions ? Mais la Damnation n'atteint pas le grand public. Et puis ce n'est pas un opéra, c'est une œuvre de concert. Or, c'est à un opéra que songe Gounod. Et puis il y a tellement de manières différentes de traiter le même sujet.
Le 19 août 1850, Michel Carré faisait représenter au Gymnase un « drame fantastique en trois actes et quatre tableaux » de sa façon, Faust et Marguerite, joué par Bressant et Rose Chéri, avec un certain nombre de scènes chantées sur de la musique de Couder. Cette pièce allait bientôt fournir à l'opéra de Gounod les principaux éléments de son livret. Nous y trouvons déjà le texte de la Chanson du roi de Thulé ainsi que les paroles de la malédiction démoniaque : « Souviens-toi du passé... », alors chantée par un chœur d'esprits.
En 1852, les Signale de Leipzig annoncent le prochain mariage de Gounod avec Mlle Zimmermann et ils ajoutent : « Cela n'empêche pas le fiancé de travailler à son opéra de Faust. »
Jusque-là, Gounod avait-il fait plus que de rêver à son sujet ? Nous ne savons sur ce point rien de positif. En tout cas, Gounod ne connaissait pas encore Barbier.
C'est en 1855 seulement que la rencontre eut lieu. « Rappelez-vous, dit Barbier, la phrase de Shakespeare : Roméo vit Juliette et l'aima. Notre amitié fut spontanée comme leur amour. C'était chez Augier. Augier nous présenta... »
Peu de temps après, sur le boulevard, « entre la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin », Barbier entreprend Gounod : « A brûle-pourpoint, conte le librettiste, je lui parlai de Faust, que j'avais toujours considéré comme le modèle des drames lyriques. Gounod, très vivement, me répondit : « Ah ! mon cher monsieur... J'y pense depuis mes plus jeunes années ! » Dès lors, il fut résolu que je lui ferais Faust. D'autres que moi ont pu lui en parler, mais j'affirme que de lui à moi la chose s'est passée comme je viens de la raconter...
« En quittant Gounod, j'allai rendre compte de notre conversation à mon collaborateur habituel et très cher ami Michel Carré. Il ne partagea point mon enthousiasme. Il avait fait représenter au Gymnase un Faust et Marguerite... et il ne se souciait guère de reprendre le même sujet sous une autre forme. Comme il travaillait alors au Pardon de Ploërmel, je le priai en tout cas de me laisser écrire Faust à mon idée, pendant qu'il terminerait notre opéra pour Meyerbeer. Ainsi dit, ainsi fait. Je pris au Faust du Gymnase la Chanson du roi de Thulé, légèrement modifiée par les récitatifs dont je l'entrecoupai, et Carré ne revint à Faust que plus tard avec la Chanson du veau d'or, qui surnagea seule parmi les treize morceaux que Gounod composa successivement pour la scène de la Kermesse. »
Après les librettistes, le directeur, le directeur du théâtre disposé à monter l'œuvre. Ce fut Carvalho.
« C'était en 1853, raconte Carvalho lui-même, peu de temps après mon mariage. Nous habitions alors, Mme Carvalho et moi, rue de Provence, et nous étions tous les deux artistes à l'Opéra-Comique. Gounod vint nous voir pour faire entendre à Mme Carvalho quelques-unes de ses mélodies déjà célèbres. C'est de cette époque que datent nos relations avec le compositeur. Vivant dans le même monde artistique, je le voyais fréquemment, et, en 1856, quand je créai le Théâtre-Lyrique, boulevard du Temple, il devint vite un assidu de la maison. En décembre de la même année, le soir de la représentation de la Reine Topaze... je le rencontrai sur la scène et lui reprochai amicalement de ne pas songer à m'apporter un ouvrage pour le Théâtre-Lyrique. « Je ne demande pas mieux, me répondit-il. Mais quoi encore ? Trouvez-moi un sujet. — Eh bien ! faites-moi un Faust », lui dis-je. A 35 ans de distance, je vois encore l'étonnement et la joie dont brillèrent ses yeux. « Un Faust ; s'écria-t-il, mais je l’ai dans le ventre depuis des années ! » La réponse est textuelle et je ne l'ai jamais oubliée. Dès le lendemain, rendez-vous était pris avec Jules Barbier et Michel Carré, et il était décidé que Gounod allait se mettre à Faust.
« Nous ne nous doutions pas alors de toutes les difficultés que l'œuvre rencontrerait devant elle pour arriver à la vie. D'abord il fallut tailler abondamment dans le livret de Barbier et Carré. Non qu'il ne fût intéressant en toutes ses parties, mais il était trop long, trop copieux, la représentation n'en aurait plus fini. Cela fait, Gounod avança très rapidement dans son œuvre. Elle était presque achevée quand, en 1857, M. Fournier, alors directeur de la Porte-Saint-Martin... s'adressant à un de nos amis communs, lui dit : « Carvalho a, paraît-il, l'intention de jouer un Faust cet hiver. Avertissez-le que, moi aussi, je vais monter une grande pièce de d'Ennery sur le Faust de Goethe. Dites-lui même qu'on y fera de la musique. » Je fis part aussitôt de cet ennui à Gounod... et je lui dis qu'il y avait lieu de retarder d'une année notre Faust. »
La crise nerveuse de 1857 faillit tout
compromettre. Deux actes devaient alors être à peu près composés.
Le 17 juillet 1858, Gounod écrit à Franchomme : « Ma pièce m'a donné bien du
mal, et j'ai grand besoin de la voir s'échafauder sous mes yeux pour savoir ce
qu'elle vaut : je n'y vois plus rien à l'heure qu'il est. J'instrumente le
cinquième acte, puis je me mettrai à l'acte fantastique qui est le quatrième et
que j'ai laissé pour la fin. »
Le 12 septembre 1858, les journaux annonçaient que Faust avait enfin été lu aux artistes du Théâtre-Lyrique.
Et voici que le 26 septembre, avec un long retard, le Faust de d'Ennery passait à la Porte-Saint-Martin. « Mais cette fois, affirme Carvalho, notre détermination était formelle, Faust allait être représenté à la fin de l'année 1858. » On avait arrêté la distribution comme suit : Marguerite, Mme Ugalde ; Faust, Guardi (un débutant) ; Méphisto, Balanqué ; Valentin, Osmond Raynal ; Wagner, Cibot ; Siebel, Mme Marimon ; Marthe, Mme Vadé. Avant même que les répétitions fussent commencées, on décida que Mme Carvalho serait substituée à Mme Ugalde dans le rôle de Marguerite.
A la fin de 1858, Faust n'était pas encore prêt.
Le 4 janvier 1859, Gounod écrivait à Bizet, alors à Rome : « Mon Faust se répète à force. Guardi est ce que tu sais : un bon et digne garçon, rempli des éléments et des hautes qualités qui forment l'artiste. Il est avant tout complètement dénué de vanité ; et, comme il se trouve très peu de chose, il est dans la meilleure condition pour devenir beaucoup. Il a dans son rôle des moments excellents ; il en est de plus faibles, mais tout cela viendra bien, j'espère. Balanqué va à merveille ; c'et un artiste et un comédien ; il chante surtout bien ce qu'il joue. Mme Carvalho a des choses ravissantes : son air des bijoux, plusieurs passages du quatuor, de son grand duo avec Guardi dans le jardin, sa chanson du rouet au troisième acte, etc. Je crois qu'elle sera très sympathique. Elle jouera supérieurement la scène de l'église, qui est un des bons morceaux de l'ouvrage ; elle a des mouvements et des poses excellents ; elle est adorable dans les huit mesures qu'elle chante au premier acte, lorsque Faust l'aborde pour la première fois. »
Gounod pouvait espérer que son Faust passerait en février. Mais la Fée Carabosse de Victor Massé lui barra le chemin ; elle fut représentée le 28 février avec Mme Ugalde dans le rôle principal.
Autre contretemps : le ténor Guardi fut pris d'un enrouement si tenace qu'il fallut le remplacer. On trouva Barbot. « Nous pûmes alors, dit Carvalho, nous mettre sérieusement au travail des répétitions. Elles furent pleines d'incidents. D'abord Gounod fut obligé de faire comme ses librettistes, de tailler lui aussi dans sa musique. Il avait écrit. une partition beaucoup plus volumineuse que celle exécutée aujourd'hui. Ainsi il supprima toute la scène du Hartz, qui était cependant très remarquable par ses sonorités et sa puissance symphonique, mais qui allongeait l'œuvre au point de la rendre impossible dans l'espace d'une soirée. » Indication importante qui nous fait regretter des pages dont nous ne savons malheureusement pas ce qu'elles sont devenues.
« Pour ma part, continue Carvalho, je réclamai de Gounod et obtins, non sans une bouderie de quarante-huit heures, la suppression d'un duo placé au début de la kermesse entre Marguerite et Valentin, et durant lequel Marguerite donnait à son frère la petite croix dont il se sépare plus tard dans son duel avec Faust. Je fis observer à Gounod qu'il valait mieux n'apercevoir pour la première fois la jeune fille qu'au seul moment où elle fait aux avances de Faust cette jolie réponse : « Non, monsieur, je ne suis demoiselle, ni belle, et je n'ai pas besoin qu'on me donne la main. » Gounod finit par me donner raison. » Nous ne pouvons que nous en féliciter.
« Ce fut aussi fort accidentellement, ajoute Carvalho, que le compositeur en vint à placer dans son Faust le chœur des soldats devenu si populaire et à retrancher de la partition une chanson que primitivement Valentin, avent de rentrer dans la ville, chantait à ses soldats et dans laquelle il vantait la beauté de sa sœur : « En savez-vous une plus belle que Marguerite ? » Cette substitution se fit un soir où nous dînions chez Gounod avec Ingres et Dubufe. Celui-ci me dit : « Priez donc Gounod de vous faire entendre un chœur qu'il a composé pour Ivan le Terrible. »
Le maître accède à mon désir, se met au piano et nous chante ce chœur. L'effet fut tellement considérable que, tous à la fois, nous lui avons demandé de supprimer la chanson de Valentin et de mettre à la place le chœur que nous venions d'entendre. Ingres insista plus particulièrement en lui disant : « N'hésitez pas, mettez le chœur. » Gounod n'eut pas à regretter d'avoir écouté ses amis.
La première représentation de Faust eut enfin lieu le 19 mars 1859 devant un public où l'on remarquait Auber, Berlioz, Reyer, Jules Janin, Emile Perrin, Paul de Saint-Victor, Camille Doucet, Dalloz, Alfred Blanche, Peyrat, Emile Ollivier, Eugène Delacroix, Horace Vernet, Eugène Giraud, Saint-Valry, Gustave Bertrand, le baron Taylor, Jouvin, Pasdeloup, Scudo, Heugel etc.
Rien de plus difficile à démêler que l'impression de ces premiers auditeurs. Ils ne sont pas d'accord entre eux et peut-être, comme on n'a parfois recueilli leur témoignage que longtemps après l'événement, ne savent-ils plus bien eux-mêmes ce qu'ils ont éprouvé, ou ont-ils quelque intérêt à modifier leur première opinion.
Carvalho et les premiers interprètes de Faust, notamment le ténor Barbot, parlent d'une totale incompréhension du public.
« A son apparition, dit Carvalho, Faust fut extraordinairement combattu. Beaucoup en trouvaient la musique inintelligible. L'acte du jardin, — et c'est à ne pas le croire, — était plus particulièrement l'objet des attaques du public. Il était chuté tous les soirs... On faisait cependant de fort belles recettes... »
De son côté, Barbot raconte : « Le public n'applaudissait guère que l'air de Marguerite... et le chœur des soldats. Mais l'admirable duo d'amour, la scène de l'église et même l'entraînant trio final n'émouvaient pas l'auditoire. J'ai entendu à cette époque des gens de goût, des artistes, des compositeurs... se demander ce que Gounod avait voulu faire. Ce n'était pas là de la musique, mais de l'aberration musicale, « une œuvre incompréhensible ».
Voilà deux témoignages d'importance. Mais peut-être Carvalho et Barbot exagèrent-ils quelque peu les résistances du public pour grossir la valeur de leurs efforts et de leur victoire. Il faut en effet tenir compte de ce fait que, dès la première année, Faust donna lieu à cinquante-sept représentations avec des recettes plus qu'honorables. Une œuvre presque totalement incomprise n'aurait pas à ce point attiré le public. Maintenant, il faut admettre aussi que le public peut entrevoir la beauté d'une œuvre dont il ne pénètre pas complètement la signification.
En tout cas, Gounod lui-même a écrit : « Le succès de Faust ne fut pas éclatant. »
Mais consultons la critique.
D'abord Berlioz, dans le Journal des Débats, — ami de Gounod, certes, mais auteur de la Damnation ne l'oublions pas, — constate « le grand et légitime succès » obtenu par Faust. C'est une indication qui a son prix. Il admire « le savant harmoniste » qui a écrit l'introduction instrumentale. Le début de la partition à partir du lever du rideau ne lui plaît guère. Il regrette que Gounod ait substitué à la fête de Pâques un monologue de Faust, et le style du duo qui suit ne lui semble pas (comme il a raison !) « assez relevé ». Mais il n'a que des éloges ensuite pour toutes les pages marquantes de l'œuvre : « Rien de plus naturel et de plus gracieux, écrit-il, que la phrase de Marguerite si délicieusement dite par Mme Carvalho à son entrée : « Je ne suis demoiselle, ni belle... » L'air de Faust : « Salut, demeure chaste et pure... » m'a beaucoup touché. C'est d'un beau sentiment, très vrai et très profond... On l'a applaudi, mais pas assez ; il méritait de l'être vingt fois davantage ; je ne connais rien de plus décourageant que cette tiédeur du public français pour les beautés musicales de cette nature. Il les écoute à peine. La mélodie en est insaisissable pour lui ; le mouvement est trop lent, le coloris trop doux, l'accent trop intime... » Retenons ces remarques d'une justesse pénétrante. Berlioz caractérise avec un particulier bonheur ce que Gounod apporte de nouveau aux Français, aux Parisiens de 1859 et ce qui va les obliger à rompre péniblement avec de vieilles habitudes.
« ... Tout est frais, bien vrai, bien senti, continue Berlioz, dans le quatuor entre Méphisto, la vieille Marthe, Marguerite et Faust. Cette belle scène eût pu être mieux disposée pour la musique par les auteurs du libretto : telle qu'elle est, le compositeur l'a supérieurement rendue. Rien de plus doux que l'harmonie vocale si ce n'est l'orchestration voilée qui l'accompagne. Cette charmante demi-teinte, ce clair crépuscule de lune musical caressent l'auditeur, le charment, le fascinent peu à peu et le remplissent d'une émotion qui va grandissant jusqu'à la fin. Et cette admirable page est couronnée par un monologue de Marguerite à sa fenêtre où la passion de la jeune fille éclate à la péroraison en des élans de cœur d'une grande éloquence. C'est là, je crois, le chef-d’œuvre de la partition. » Comme il voit juste ! et il est si réconfortant de constater que dès la première heure Berlioz a compris et proclamé toute la beauté du Faust de Gounod.
Son ami d'Ortigue, dans le Ménestrel, rendait à l'opéra nouveau le même hommage d'admiration.
Mais d'autres critiques se montraient moins enthousiastes. Dans la France musicale, Léon Escudier reprochait à Gounod « de porter au théâtre ce qu'il fallait laisser au concert ». Il ne contestait pas la « science » de Gounod mais il réclamait une musique vraiment « dramatique » qu'il ne découvrait pas dans Faust. « Hormis deux chœurs pleins d'originalité et fort beaux, et une magnifique scène dans les jardins, ajoutait-il, tout ce qui se chante est morne, incolore, sans feu ; tout ce que joue l'orchestre est gracieusement poétique, riche de couleurs. Et c'est là, selon nous, l'erreur de Gounod : ce n'est pas dans les voix qu'il a mis l'effet, c'est dans les instruments. » Nous savons déjà que tout d'abord Gounod passa pour un musicien plus « savant » qu' « inspiré ». A côté de la mélodie rossinienne aux lignes si nettes et de la déclamation meyerbeerienne aux accents si violents, la phrase de Gounod paraissait trop sinueuse, ondoyante, et somme toute confuse.
Cependant, bien des critiques ne s'y trompaient pas et reconnaissaient, comme Rubempré, par exemple, que grâce à son Faust Gounod se classait à une des meilleures places parmi les compositeurs français, « si déjà cette place il ne l'avait conquise en donnant Sapho, la Nonne sanglante et des morceaux d'église de toute beauté ». Notons, en passant, cette mention de la Nonne sanglante comme d'une œuvre faisant honneur à son auteur ; voilà qui confirme ce que nous en disions précédemment. Le critique Fiorentino, d'autre part, parle de « immense succès » de Faust et Reyer n'hésite pas à classer cette œuvre « parmi les plus complètement belles de ce temps-ci, une œuvre dans laquelle de très légères imperfections sont effacées par des inspirations et des beautés de premier ordre. »
En somme, la critique se montrait en grande majorité favorable.
Et cependant Gounod trouva difficilement un éditeur pour la partition de Faust. Sur les instances d'un ami de Gounod (le musicien Prosper Pascal), un petit boutiquier de la rue Saint-Honoré, A. de Choudens, qui jusque-là n'avait guère édité que des romances, se décida à courir la chance d'une entreprise bien grosse pour ses maigres ressources. Il acheta 10.000 francs la partition du Faust de Gounod.
***
Au dire des meilleurs juges, Mme Carvalho fut la Marguerite incomparable et qu'aucune autre artiste n'égala. Le meilleur Faust fut sans contredit Jean de Reszké. Et l'on ne connut point de plus parfait Méphisto que Pol Plançon : il avait tout pour être le plus excellent interprète du rôle, la beauté physique, la haute taille, l'extrême souplesse du corps et de la voix ; celle-ci d'une étoffe somptueuse, profonde et large en même temps que légère. Il triompha à Paris, à Londres et à New York. A Paris il faillit un soir (c'était en 1889) être victime d'une singulière aventure. L'acte du jardin venait de finir. Les acteurs, fort applaudis, saluaient. Pol Plançon, s'étant trop avancé, vit le rideau menacer de tomber sur sa tête et, pour l'éviter, s'avança davantage encore sur le proscenium. Il se trouvait pris entre la scène et la salle, ne sachant pas trop comment sortir de ce faux pas, et, à ce moment, les spectateurs jugeaient l'incident fort comique. Plançon eut enfin l'idée de s'échapper par le côté, et il fit mine de s'engager dans le passage fort étroit du manteau d'Arlequin et d'enjamber l'immense perche de bois qui tient étalé le bas du rideau. Juste au même instant, les machinistes du cintre ayant appris quelle était la situation de l'artiste entre le rideau baissé et la rampe, relevaient le rideau pour lui livrer passage. Et voilà Méphisto à cheval sur l'extrémité de la perche qu'il avait enfourchée sans le vouloir, qui s'élève dans les airs à la grande épouvante des spectateurs qui, cette fois, le voyaient déjà s'écrasant contre je ne sais quel plafond. Tout le monde était debout et l'on criait : « Baissez le rideau ! Mais baissez-le donc » Les machinistes ne pouvaient rien entendre. Le régisseur finit par leur donner le signal nécessaire et tout rentra dans l'ordre. Méphisto redescendit du ciel sur la terre. Il en était quitte pour la peur. On l'acclama d'avoir échappé si heureusement au péril, — qui était bien réel.
Le lendemain, boulevard de la Madeleine, Plançon rencontrait Gounod, au courant de l'aventure, qui lui ouvrait tout grands les deux bras et lui donnait l'accolade aux yeux ahuris de la foule.
***
Cette partition de Faust, malgré quelques inégalités, devait prendre rang parmi les plus beaux ouvrages qu'ait produits dans tous les temps l'école française.
Rappelons-en les pages capitales.
D'abord une des moins connues : l'introduction orchestrale qui ne sert d'ordinaire que de discret accompagnement à l'entrée des spectateurs et à leurs dernières conversations avant le lever du rideau. Page des plus sévères, à la Bach, de l'inspiration la plus concentrée, du style le plus soutenu, faisant allusion aux pénibles recherches de Faust dans le domaine de la science et de la philosophie, à ses déceptions successives, à son désenchantement définitif. Page qui, par un brusque détour, aboutit à une mélodie fort simple, fort claire et fort pénétrante, tout à fait gounodienne.
Malheureusement toute cette introduction, marquée Adagio molto (indication pourtant si nette !) est d'ordinaire expédiée beaucoup trop vite, indignement bousculée, et perd ainsi tout sens et tout caractère.
L'acte I est le plus faible. Pourquoi Gounod n'a-t-il pas continué dans le style de l'introduction ? Mais il a eu peur d'ennuyer son public. Et puis son livret ne lui fournissait pas matière à un ample et profond développement musical. Songeons au magnifique début de la Damnation : « Le vieil hiver a fait place au printemps... » Nous ne saurions guère y comparer la pauvre phrase de Faust : « J'ai langui triste et solitaire... » et encore moins le duo de Faust et de Méphisto : « A moi les plaisirs, les jeunes maîtresses ! » qui semble bien n'exprimer d'autre intention chez les deux compagnons que de « faire la fête » éperdument. Nous tombons presque dans l'opérette et il s'en faut de peu que nous ne songions à la Vie parisienne d'Offenbach. Mais aussi quel pitoyable texte à mettre en musique ! Exceptons de ces critiques le délicieux épisode de l'apparition de Marguerite à son rouet.
Dès le deuxième acte, le compositeur commence à se relever. La kermesse ne manque pas de pittoresque et rend bien l'impression du grouillement confus et de l'agitation désordonnée d'une foule en joie. Mais ici encore l'exécution habituelle nuit à l'effet désiré. Saint-Saëns déplorait avec raison que « partout, à Paris, comme ailleurs, la kermesse fût dénaturée par un mouvement trop rapide. Le chœur des vieillards, chose délicate et charmante, devient une grossière caricature. L'ensemble n'est plus qu'un tohu-bohu informe et déplaisant. »
La ronde du veau d'or a du brillant, un mouvement indiscutablement entraînant et l'on se rappelle l'effet strident et ironiquement incisif des traits de violons.
Le choral des épées est plus théâtral que véritablement imposant. Mais la Valse est charmante et elle s'interrompt quelques instants pour faire place à cette mélodieuse phrase d'une simplicité et d'une pureté de lignes adorables que motive la rencontre de Faust et de Marguerite. Le génie de Gounod se manifeste ici dans toute son originalité. Et quel naturel ! C'est l'opposé de la mélodie italienne, du « bel canto » et de toute mélodie romantique.
Le troisième acte renferme les pages maîtresses de la partition, et, d'un bout à l'autre, ou presque, l'inspiration n'y faiblit pas. Après cette introduction grave, mystérieuse, qui semble évoquer l'image de la vie calme et austère de l'innocente Marguerite, c'est l'allègre chanson de Siebel, peut-être, à vrai dire, un peu pâle. Puis vient la cavatine de Faust, dont nous savons déjà tout le bien que pensait à juste titre Berlioz. Après l'exquise ritournelle, une phrase : « Salut, demeure chaste et pure » qu'il faut imaginer chantée avec tout le recueillement qui lui sied, avec toute la chaleur intime et contenue qui doit l'animer et sans tous les effets de voix qu'y cherchent inopportunément la plupart des ténors.
Sur les quintes monotones des bassons dans le grave s'amorce le récit qui précède la Chanson du Roi de Thulé. Récit fort bien venu et qui contient la courte réflexion de Marguerite : « Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme. » Réflexion qui doit être murmurée à mi-voix, comme dans un rêve intime, et non appuyée de forts accents à la façon de la plupart de nos maladroites chanteuses. Mais comme tout le rôle de Marguerite devrait rester purement « intérieur » ! Je me rappelle une Marguerite qui jouait le rôle et le disait avec une rare justesse de geste et d'accent : Mme Carrère.
La Chanson du Roi de Thulé, fort réussie, amène le fameux air des bijoux dont on a dit beaucoup de mal. Et d'abord on a reproché à Gounod de prêter à Marguerite tant de coquetterie. C'est à ses librettistes qu'il faudrait s'en prendre. Mais d'abord à Goethe, qui n'a pas hésité à introduire la cassette comme moyen de séduction. Goethe, il est vrai, y met un peu plus de discrétion. Et le premier moment d'éblouissement passé, Marguerite se livre à de mélancoliques réflexions : « A quoi nous sert la beauté, dit-elle, à nous pauvres jeunes filles ? Si l'on nous en fait compliment, c'est presque par pitié. L'or, voilà ce dont il s'agit. L'or, voilà ce dont tout dépend ! » Et cet or, elle le méprise, elle le hait, parce que son amour est bien au-dessus de sa coquetterie. Evidemment, Jules Barbier et Michel Carré n'ont songé qu'à motiver un air brillant, un air à vocalises où la première chanteuse pût faire valoir sa virtuosité. Mais il faut avouer que dans le genre qui lui était proposé Gounod a écrit un chef-d’œuvre. Il y a là un art, qui pour ne s'appliquer qu'à de petites choses et pour ne tendre qu'à un effet un peu extérieur, n'en est pas moins remarquable.
Nous arrivons au quatuor et au duo du jardin, qui comptent parmi les pages les plus parfaites que Gounod ait jamais écrites, les plus délicates, les plus fines, les plus spirituelles, les plus passionnées aussi.
C'est dans le quatuor que pour l'harmonie vocale et instrumentale, pour la grâce ou la tendresse des motifs, la légèreté des indications d'un comique qui ne s'abaisse jamais à nulle platitude ou nulle grossièreté, on a pu comparer Gounod à Mozart. L'introduction du duo est une pure merveille : l'ensemble de deux violons, d'un violoncelle et d'un alto soli, rend délicieusement le charme du soir et nous prépare aux premières confidences d'amour. Le sommet du duo, c'est après le dernier mot des serments illusoires, la phrase miraculeuse : « O nuit d'amour, ciel radieux » avec la courbe inverse de la mélodie de Marguerite, d'un acte de foi si soumis.
Pour finir l'acte, après la large et prenante invocation de Méphisto à la nuit, le délicieux nocturne, la grande phrase rêveuse qui se développe à l'orchestre pendant tout le monologue de Marguerite, la voix humaine et les instruments se répondant, s'interrompant, se reprenant avec une liberté, une souplesse et une abondance de lyrisme dont nulle part ailleurs Gounod n'a fait preuve plus que là.
Le quatrième acte comprend d'abord le mélancolique air du rouet puis la magnifique scène de l'église avec ses contrastes saisissants qui n'en rompent point le puissant équilibre mais en soutiennent la force dramatique ; ensuite le vulgaire mais robuste chœur des soldats et la pittoresque sérénade, le trio du duel et la mort de Valentin. Tout cela est d'un mouvement ininterrompu et se termine dans une impression de grandeur extraordinaire.
Le cinquième acte renferme la nuit de Walpurgis, malheureusement très écourtée dans sa partie symphonique et la scène si émouvante de la prison.
Il nous suffit de parcourir ces pages mémorables pour nous rendre compte qu'avec toutes les raisons de plaire au grand public, le Faust de Gounod possède cette qualité d'inspiration et une tenue d'écriture dont le connaisseur se sent vivement touché. La date de 1859 marque la naissance d'un chef-d’œuvre français en même temps qu'un tournant décisif dans l'évolution de notre musique, altérée depuis un demi-siècle par les influences étrangères de Rossini, de Meyerbeer, et qui revient enfin à ses traditions séculaires.
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. — PHILÉMON ET BAUCIS. — LA REINE DE SABA. — MIREILLE.
Durant la longue attente de la « première » de Faust, Gounod avait fait représenter le 15 janvier 1858, sur le texte modifié de Molière, le Médecin malgré lui. La censure s'était demandée tout d'abord si les libertés de langage de Molière ne seraient pas déplacées sur la scène du Théâtre-Lyrique. Cette invraisemblable difficulté fut aplanie. Un éditeur s'offrit : ce fut Colombier. « Il nous acheta nos trois actes, conte Gounod, pour la somme de 4.000 francs. A 39 ans ! Et encore en revenait-il un tiers à mes collaborateurs. Enfin, c'était mon premier argent. Le lendemain, la représentation fut mon premier succès décisif et populaire. » Hélas ! le même soir, sa pauvre mère était à l'agonie et il la perdit le jour suivant (16 janvier 1858).
Charmante petite partition que ce Médecin malgré lui, légère, spirituelle, sans une trivialité, sans une grossièreté, ce qui faisait dire à quelques gens qu'elle manquait de gaîté. « Un opéra délicieux, écrit Pierre Dupont. C'est neuf, saisissant et parfaitement naturel... C'est d'une simplicité adorable... On a arraché Gounod de sa loge et on l'a porté à bras sur le théâtre où il a été l'objet d'une de ces ovations spontanées qui sont l'apogée de la gloire d'ici-bas. » Le Médecin malgré lui fournit une série non interrompue d'une centaine de représentations. La Chanson des glouglous, le Trio de la Bastonnade, le Sextuor de la Consultation, un Fabliau, un duo entre Sganarelle et la Nourrice en étaient les pages les plus applaudies.
Faust quitta l'affiche du Théâtre-Lyrique dès la fin de 1859 et n'y reparut qu'en décembre 1862, après l'inauguration de la salle du théâtre du Châtelet. Cependant, Faust faisait le tour de la province et le tour du monde. Les auteurs, à cette occasion, transformaient leur ouvrage en « grand opéra », remplaçant par des récitatifs le « parlé » qui, jusque-là, tenait une grande place dans la pièce. A cette substitution nous avons perdu quelques petites choses, notamment ce si joli dialogue entre Faust et Marguerite au troisième acte, traduit directement de Goethe.
FAUST
Ainsi, tu m'as reconnu, cher ange, quand je suis entré dans le jardin ?
MARGUERITE
N'avez-vous pas vu que je rougissais ?
FAUST
Et tu me pardonnes mon audace de ce matin ?
MARGUERITE
Je craignais que vous n'eussiez trouvé dans mon air quelque chose de hardi, et je m'en voulais du fond du cœur de ne pouvoir vous en vouloir davantage.
FAUST
Douce créature !
***
Un an après Faust, le 13 février 1860, Philémon et Baucis parut sur la scène du Théâtre-Lyrique. L'accueil de la presse fut des plus favorables ; mais la pièce n'eut à l'origine que treize représentations. Elle était un peu longue : elle comptait alors trois actes, ce qui est beaucoup, pour un si mince sujet. On fit bien de la réduire à deux. Ainsi ramassée, elle constitue une des plus jolies partitions du répertoire de Gounod. Le baryton Taskin et le ténor Clément en rétablirent naguère le succès. Je ne saurais dire à quel point elle me plaît pour sa grâce, son charme, sa tendresse et ce délicieux caractère pastoral que rend si bien Gounod.
Et d'abord cette rêveuse « introduction », si unie, si coulante, si souple où les pipeaux champêtres, hautbois et flûtes, jouent admirablement leur rôle traditionnel, sur le soupir du cor, avec cette exquise réplique des cordes dans l'aigu d'un trait si fin et dont l'habile disposition arrive à rendre étrangement savoureuse l'harmonie de l'accord parfait. Puis le caressant nocturne en duo : « Du repos voici l'heure » où les sixtes et tierces alternées des deux voix (le ténor passant par-dessus le soprano) font un si heureux mélange. Toutes les phrases qui composent ce duo sont de la plus pure inspiration gounodienne. Je vais jusqu'à attacher un grand prix à la souriante bonhomie de cette évocation finale du passé : « O souriante image des plaisirs d'un autre âge... » Le chœur des Bacchantes, qui suit, a beaucoup de couleur et d'accent. L'orage, — en miniature, — n'est point méprisable. Quoi de plus noble et de plus harmonieux que le trio des trois hommes, Philémon, Jupiter et Vulcain ? Et quel art d'écrire pour les voix ! Les couplets de Vulcain, dans leur brutalité voulue, leur bruit d'enclume et de marteaux et le contraste délicat des railleries de Junon sont une des perles de la partition. Est-il rien de plus mystérieux et de plus caressant que la musique d'orchestre sur laquelle Baucis récite, en un tendre murmure, son hymne de reconnaissance à la vie ? Point de départ peut-être de l'inspiration qui dictait plus tard à Bizet l'incomparable Adagietto de l'Arlésienne. Après cela Jupiter consolant Vulcain de ses déboires conjugaux est assez plaisant et il a une bien jolie phrase pour décrire la naissance de Vénus :
Quand sur le flot mouvant
J'ai fait éclore un jour la reine de Cythère
Dans un flocon d'écume emporté par le vent...
La romance de Baucis : « Ah ! si je redevenais belle... » est une de ces mélodies parlées dont Gounod a le secret, pleine de grâce et de tendresse. Avouons que la fable du Rat de ville et du Rat des champs fait un peu hors-d’œuvre et qu'on a bien fait de la supprimer à la représentation. Mais la scène du sommeil avec les strophes de Jupiter et les ensembles des voix est de toute beauté, et rien ne manque à la continuité de perfection de ce premier acte ainsi ramené à ses justes proportions.
Le deuxième acte, bien que très agréable encore, ne vaut pas le premier. La raison en est simple. Le premier ne faisait guère que mettre en action la vieille fable avec ce qu'elle a d'infiniment intime et poétique. Le second est de la seule invention des librettistes. Il développe une intrigue qui met en coquetterie Baucis, redevenue jeune, avec Jupiter. Ingénieuse mais artificielle, elle ne pouvait donner lieu à la même qualité de musique que le premier acte. Quelques pages de ce deuxième acte pourraient cependant être sauvées de l'injuste dédain qu'on affecte parfois à leur égard quand ce ne serait que l'introduction d'orchestre, si vivante, d'un rythme de danse si divers et si heureux.
***
Au mois de novembre 1860 (l'année de Philémon) Gounod fut invité par l'Empereur et l'Impératrice à Compiègne. Camille Bellaigue nous a fait connaître quelques fragments extrêmement curieux des lettres qu'il écrivit à Mme Gounod durant son séjour au château.
La cour est en deuil du roi de Portugal. « Envoie-moi, écrit Gounod à sa femme, un pantalon noir pour le matin, pour remplacer mon pantalon gris et me mettre en tenue de deuil. Le gilet montant va faire merveille comme austérité d'aspect. C'est tout ce qu'il y a de plus sépulcral ; je serai au complet comme catafalque. »
Le deuil ne faisait pas trop oublier la musique.
« J'ai passé plus d'une grande heure à côté de l'Impératrice, en compagnie de quatre ou cinq personnes. Je te donne à deviner en cent, en mille, ce qu'elle m'a proposé. — Sa collaboration pour un ballet qu'elle veut que nous fassions ensemble. Tu juges si j'ai été interdit, si je suis tombé des nues J'ai regardé Sa Majesté sans proférer une parole, ce que voyant, Elle m'a dit, en me fixant dans le fond des yeux : « Mais non, sans plaisanterie. — Oh alors, madame, ai-je dit, dès que ce n'est pas une plaisanterie, cela devient la chose la plus plaisante du monde. Parole de souveraine vaut tous les traités imaginables. Je ne me doute pas au monde de ce que sera le ballet de Votre Majesté, mais voilà mon prochain ouvrage assuré. » Et mettant sa main dans la mienne : « C'est entendu », m'a dit Sa Majesté.
« Ce matin, à déjeuner, entre le prince de Metternich et le comte Waleski, l'Impératrice m'a relancé encore sur notre ballet, et le ministre a consacré cette auguste chimère, qui peut très bien devenir une sérieuse réalité, mais qui, tout au moins, est un renoncement à l'indifférence à mon égard de la part de Sa Majesté.
Enfin, aujourd'hui, à deux heures, l'Impératrice m'a prié de me mettre au piano et s'est tenue tout le temps à côté de moi. Imagine-toi que Sa Majesté a littéralement fondu en larmes. J'ai fait de la musique pendant près de trois quarts d'heure et on disait : « Encore, encore. » J'ai cru ne pas devoir combler l'appétit de mes auditeurs. Il faut en garder pour plus tard.
Après cela l'Impératrice a fait atteler le char à bancs et nous avons fait en compagnie de l'Empereur, qui était à cheval, une admirable promenade dans la forêt. Lorsque nous sommes descendus, pour nous promener un peu à pied, l'Impératrice s'est approchée de moi et s'est excusée de l'enfantillage de ses larmes. Tu juges comment ses excuses ont été prises et ça a été encore là [l'occasion] d'une conversation entre Sa Majesté et moi, qui a bien duré un quart d'heure dans la forêt. »
Autre fragment :
« J'ai été requis hier soir très gracieusement par l'Empereur de faire un peu de musique. Sa Majesté a paru contente et me l'a témoigné avec une bienveillance extrême. J'ai dit : « Assez dormir ma belle » et « Mon vieil habit ». Je me suis fort excusé, tu le comprends, sur mon peu de voix, qui ne me permet guère de jeter de la poudre aux... oreilles, et qui, habituée à ne recevoir qu'en robe de chambre, est toujours un peu effarouchée quand il s'agit de faire de la toilette. Sa Majesté a cependant trouvé moyen de me dire que j'avais une voix charmante, et comme je la trouvais (ma voix) très au-dessous du compliment qui lui était adressé, Sa Majesté a ajouté : « Et puis vous chantez avec une si belle « expression ! »
Nous voyons ensuite Gounod se mettre au piano pour accompagner au Prince Impérial deux petites chansons Au Clair de la Lune et Marlborough s'en va-t-en guerre. Il ne nous dit pas comment chanta le Prince. A son tour, Gounod joue et chante le duo de Faust qui provoque de nouveau « les augustes larmes de la souveraine ».
Nouvelle promenade en char à bancs. L'Impératrice place Gounod à côté d'elle et lui parle du ballet projeté.
Château en Espagne qui sera vite oublié, mais qui amusa quelques jours l'esprit de la souveraine.
N'eût-il pas mieux valu pourtant que Gounod eût à composer ce ballet impérial que cette fastidieuse Reine de Saba qu'il venait d'achever et qui devait lui coûter une de ses plus cruelles défaites ?
Les répétitions de la Reine de Saba commencèrent en octobre, au retour de Compiègne (*).
(*) Nous avons laissé tomber sans autre attention (elle n'en méritait pas) l'insignifiante Colombe, un acte représenté à Baden-Baden le 6 août 1860.
Paris était alors plein de curiosité pour la personnalité de Richard Wagner dont on annonçait que le Tannhäuser serait prochainement représenté à l'Opéra. Disons qu'à ce propos Gounod montre un esprit particulièrement ouvert et compréhensif. Il avait assisté aux trois concerts organisés par Wagner au Théâtre-Italien en janvier et février 1860. Il avait suivi les interminables répétitions du Tannhäuser à l'Opéra et il sera parmi les spectateurs de la « première » (13 mars 1861).
« Je professais alors, et j'avoue que je professe encore aujourd'hui, écrira-t-il 12 ans plus tard, une très grande admiration pour ce vaste cerveau et cette puissante organisation d'artiste. J'avais beau dire que je ne prétendais pas que ce fût « un soleil sans tache », on me répondait qu'il était un fou et que j'en étais un autre ; et lorsque la représentation de la pièce se fut achevée, à grand'peine, au milieu d'une grêle de sifflets, plusieurs de mes amis me dirent, d'un air goguenard et facétieux : « Eh bien, vous devez être satisfait ! J'espère que voilà un beau triomphe ! — Mais, messieurs, répondis-je, pardon ; ne confondons pas. Vous appelez cela une chute : j'appelle cela une émeute ; c'est fort différent ; permettez-moi d'en appeler et de vous donner rendez-vous dans dix ans devant la même œuvre et devant le même homme : vous leur tirerez votre chapeau ; une pareille cause ne se juge pas dans une soirée. Au revoir, dans dix ans ! »
Clairvoyantes paroles qui font honneur à l'impartialité de Gounod.
Le vendredi 28 février 1862 eut lieu en présence de l'Empereur et de l'Impératrice la première représentation de la Reine de Saba. Ce ne fut pas un succès. Et à cette déconvenue il y eut plusieurs causes. D'abord le sujet de la pièce déplaisait à l'Empereur. Un roi délaissé par une reine éprise d'un artiste, et surtout trois ouvriers en révolte contre leur maître, la franc-maçonnerie mise à l'honneur en la personne d'Adoniram, qui passe pour l'avoir fondée à Jérusalem, voilà des images qui doivent être peu agréables à l'esprit de Napoléon III. Le public et la critique, désireux de flatter le souverain, se montrèrent mal disposés pour le nouvel opéra. D'autre part, l'opinion de Gounod sur Wagner lui avait fait des ennemis. On allait jusqu'à le prétendre inféodé au système wagnérien. « C'est dans ce déplorable système qu'a été écrite la partition de la Reine de Saba », écrivait Jouvin dans le Figaro. Et il parle d'une « mélopée flasque, traînante, sans contour, sans cadence, se débattant comme un condamné tiré à quatre chevaux dans les serres d'une harmonie travaillée et tourmentée à l'excès. » Scudo, dans la Revue des Deux Mondes, en dit autant. « Nous savons, insiste-t-il, que l'esprit ingénieux, mais faible, de M. Gounod a le malheur d'admirer certaines parties altérées des derniers quatuors de Beethoven. C'est la source troublée d'où sont sortis les mauvais musiciens de l'Allemagne moderne, les Listz (sic), les Wagner, les Schumann, sans omettre Mendelssohn pour certaines parties équivoques de son style. » Et plus loin : « Après la chute éclatante et méritée du Tannhäuser de M. Richard Wagner, le froid accueil qu'on vient de faire au dernier ouvrage de M. Gounod confirme les principes que nous défendons depuis tant d'années. C'est bien à M. Gounod et à son groupe que nous pensions en signalant ces admirateurs discrets de M. Richard Wagner qui n'attendaient que le triomphe du Tannhäuser pour s'incliner devant la grande mélodie de la forêt, dont leurs œuvres portent plus d'une trace. » Gounod n'a pas fini d'être traité de wagnérien.
Mais la vraie raison, la raison profonde de l'échec de la Reine de Saba elle n'est pas où on l'a dit de son temps. Elle est avant tout dans ce fait qu'en écrivant cet ouvrage, Gounod n'a pas suivi sa nature.
Ce qui appartient en propre à Gounod, et ce qu'il apportait de nouveau, c'était l'opéra de demi-caractère, intermédiaire entre l'opéra et l'opéra-comique, à la fois comique et tragique, noble et familier, qui remplace ces « grandes machines », ces machines pompeuses à la Meyerbeer dont on se croyait obligé jusque-là d'encombrer le théâtre de l'Opéra. Or, par une erreur qui lui fut plusieurs fois fatale, au lieu de s'en tenir à ses Faust, ses Philémon, ses Mireille, ses Roméo, Gounod eut l'ambition de s'élever, croyait-il, plus haut, d'écrire ce qu'on appelait à proprement parler de « grands opéras » et chaque fois, pour sa punition, le public se détourna de lui. En haussant le ton, il perdait le naturel, en voulant faire plus grand, il faisait gros. Nous ne reconnaissons plus Gounod dans l'introduction pompeuse de la Reine de Saba, ni même dans les deux airs pourtant célèbres de Soliman : « Sous les pieds d'une femme » et de Balkis : « Plus grand dans son obscurité. »
***
L'insuccès de la Reine de Saba fut un gros chagrin pour Gounod. Il partit, il quitta Paris. L'été suivant, Jouvin, du Figaro, le rencontre à Baden-Baden où il était venu assister à la représentation de Béatrice et Bénédict, de Berlioz : « Comment, vous ici ? — Oui, répond Gounod, je voyage pour un deuil de famille. — Vous avez perdu l'un des vôtres ? — Oui, une femme que j'ai beaucoup aimée : la Reine de Saba. »
Un mois, jour pour jour, après la première représentation, il s'était mis en route pour Rome.
C'était pour lui une immense joie.
Il nous a laissé quelques-unes de ses impressions dans des notes sensibles et pittoresques :
« Colysée ! la clarté de la lune, les ombres épaisses, le silence, tout donne à ces ruines grandioses un aspect plus imposant. Cri obstiné de la chouette ; arcades des étages supérieurs éclairées de temps en temps par la lueur des torches. — Dernière tournée intérieure entre les arcades du Colysée (il y a à droite en tournant le dos au Palatin, une arcade dont le clair de lune fait un tableau incomparable. C'est une de celles qui donnent sur le Cœlius, et au-dessous de laquelle se trouve un fossé rempli d'eau.) Retour à pied par le Forum jusqu'à l'arc de Septime Sévère...
Dimanche de Pâques 20, à sept heures, nous partons pour Saint-Pierre. Messe papale, imposante solennité. — La musique de Palestrina, mille fois plus belle et plus imposante dans Saint-Pierre qu'à la chapelle Sixtine, — ce réseau musical, cet incessant et merveilleux enchevêtrement des voix, ces vibrations harmoniques dans les registres élevés, cette sonorité presque illuminée du temple chrétien le plus grand qui existe, tout cela emporte l'âme par delà le réel et l'exalte jusqu'à la jubilation. »
La famille de Gounod et ses amis formaient une « petite caravane ». Et chacun à son tour inscrivait quelques notes sur le carnet de voyage tenu en commun. Voici qui est peut-être de M. Arthur Rhoné :
« Jeudi 24 (lever à 4 heures et demie). Albano... Déjeuner. Terrasse idéale ! Gounod trouve une guitare et il nous chante la chanson du pâtre de Sapho... Nous achetons la guitare six scudi ; elle est de Naples (1824) et est excellente. — A l'unanimité, Gounod est nommé conservateur de la guitare ! A deux heures nous repartons, les uns à pied, les autres à âne pour Gensano, délicieuse route au bord du lac Nemi... »
La guitare en question a été donnée par M. Rhoné au musée de l'Opéra.
Un peu plus tard, Gounod :
« Nous avons fait des excursions magnifiques. Je sue l'Italie à grosses gouttes. J'oublie la musique, j'apprends la guitare et je dessine.
... Je sens que je vais avoir un grand chagrin de quitter l'Italie malgré tout ce qui m'attache à Paris et m'y rappelle par tant de liens ; je sens que ce pays de Rome et de Naples est mon vrai, mon seul pays ; c'est là que j'aurais voulu vivre jusqu'à ma mort ; mes instincts ne sont pas où est ma demeure. »
De Florence il écrivait à Bizet : « J’ai aujourd'hui 44 ans qui ne valent pas grand'chose, à peine deux sous pour un pauvre. Je t'avais promis de t'écrire de Rome : mais à Rome écrit-on comme on veut ? — J'ai vu Rome en désespéré, en amant qui va partir ; j'aurais dû ne jamais la quitter ; j'aurais valu mieux et plus, c'est-à-dire un peu. »
***
En revenant à Paris, Gounod songeait à un opéra nouveau. Cette fois il laissait les « grandes machines » de côté. Deux sujets le tentaient : Mignon ou Mireille. Quel dommage qu'il n'ait pas traité Mignon ! Du moins nous reste-t-il une magnifique mélodie de ce titre qui mérite une place de premier rang dans son anthologie. La phrase, d'un si beau dessin, est rein-plie d'une émotion intime, contenue, douce et pénétrante.
Cependant, Gounod ne prenait pas parti. Il ne choisissait pas un sujet.
Le 30 octobre 1862 le Théâtre-Lyrique rouvrait place du Châtelet. A cette occasion Gounod avait composé un Hymne à la Musique qui fut chanté par mesdames Carvalho, Viardot, Cabel et Faure-Lefebvre.
Le 18 décembre, reprise de Faust et c'est alors qu'un critique de la Revue et Gazette musicale résuma son impression connue il suit : « Quoiqu'il y ait au troisième acte de fort belles cantilènes, Faust dans son ensemble n'est point l'œuvre d'un mélodiste, mais on y peut reconnaître une harmonie très riche, une instrumentation puissante et vivement colorée, des combinaisons fort ingénieuses et quelquefois une grande force d'expression. »
Gounod avait enfin choisi Mireille pour sujet de son prochain ouvrage.
Il fuit Paris, qui « l'étouffe, qui le suffoque », où il ne parvient pas à se recueillir. Il se réfugie auprès de Mistral.
« Je le tiens enfin, ce beau et bon Mistral tant rêvé, tant cherché et tant désiré. Maillane ! Un jour, Maillane voudra dire Mistral, comme les Charmettes ou Vevey veulent dire Jean-Jacques. J'arrive donc à Maillane. Je salue cette humble petite maison, le berceau de « Miréio ». Nous causons cependant qu'on prépare le déjeuner ; nous déjeunons. Mireille, comme tu le devines, fait les frais de la conversation. Je trouve dans Mistral tout ce que j'y attendais, le poète dans le berger antique, dans l'homme de la nature, dans l'homme de la campagne et du ciel. Mistral me propose un plan que j'accepte, à savoir : une excursion après déjeuner à Saint-Rémy, avec projet d'y coucher, pour aller demain matin dans la montagne visiter le village des Baux, l'un des points principaux de Mireille et d'où l'on domine toute la Crau jusqu'à la mer... »
Deux jours plus tard :
« Le pays que nous venons de parcourir et où nous venons de coucher est une merveille de sauvagerie : les rochers n'y font qu'un avec les ruines du moyen âge et de la féodalité... J'ai traversé hier le Val d'Enfer et j'ai vu une issue du Trou des Fées, où Mistral parle du séjour de Taven... Du haut des rochers des Baux, on découvre l'immense plaine de la Crau et de la Camargue ; c'est un panorama encore plus vaste que celui de la campagne de Rome, et d'une austérité terrible. »
Gounod avait d'abord pensé prendre pension chez Mistral. Mais Mistral craint que la présence d'un étranger ne soit une fatigue pour sa mère. Alors Gounod loue une chambre à Saint-Rémy, au deuxième étage de l'hôtel de la Ville Verte. Il vit tout le temps dehors, il court la campagne, un carnet à la main. Il ne se fait pas connaître. Il se fait appeler M. Pépin — « Pépin le Bref », parce qu'il parle peu. On le prenait pour un peintre. On finit tout de même par découvrir que M. Pépin était M. Gounod.
Cette grande paix de la campagne lui plaisait par-dessus tout. « Les agités, disait-il, ne vivent pas ; rien n'est calme comme de vivre. » Camille Bellaigue a retrouvé dans ses papiers cette expression : « Oh ! le bonheur de la paix et la paix du bonheur ! » Il aimait « cette absence des humains ». « ... Décidément, c'est le parlage qui ne me va pas. Je peux tout (tout ce que je peux s'entend) dès qu'il n'y a autour de moi ni bruit ni mouvement, c'est-à-dire ni agitation de corps ni d'esprit. Mais le tourbillonnage, le va-et-vient continuel me tuent les idées, et à Paris on parle tant et si souvent ! Il me semble qu'on ne fait que cela, et qu'on regarde le silence comme un tombeau... Un tombeau ! Mais c'est un paradis, le silence. »
Et Gounod se promenait toujours à travers champs et villages. Il « broutait » le pays, disait-il. Il en goûtait la saveur, la lumière et le parfum. Il avait fait venir un piano. Mais il ne s'en servait guère. Toujours dehors. Il prenait des notes dans son calepin.
Du 25 mars, il écrit à sa femme :
« Je t'écris au milieu d'un tas de violettes que je viens de rapporter... Je suis, fenêtre toute grande ouverte, en présence du plus beau coucher de soleil : il vient à peine de disparaître. La lumière orange, la lisière du ciel et les montagnes, respirent l'indigo à pleins poumons. Il y a ici, tout près, à vingt minutes de Saint-Rémy, dans la montagne, la plus belle vallée qu'on puisse voir : c'est de la pure Italie ; c'est même grec. »
Du 31 mars :
« Il y a une demi-heure, à trois heures et demie, je quittais l'admirable vallon de Saint-Clerc... Je viens d'y passer près de trois heures dans un enchantement de solitude... Pas une créature n'a traversé le vallon pendant ces trois heures. J'y suis resté sous un petit bois de pins jeunes, à l'ombre, avec mon poème, au milieu des senteurs de toute espèce, retenant parfois ma respiration (le seul bruit humain que j'entendisse), pour mieux entendre, au sein de ce silence de la nature, le concert mystérieux de ces milliers de petits êtres qui peuplent l'air et le sol, et dont le bourdonnement ininterrompu tremble à l'oreille comme l'atmosphère tremble aux yeux par un jour de chaleur. »
Le soir il aime retrouver sa petite chambre si simple, si nue : Jocelyn l'aurait trouvée adorable. »
Et toutes ses idées religieuses lui remontent à la tête, lui refluent au cœur : « Tu n'as pas idée de la pureté et de la jeunesse du ciel... L'aubépine est maintenant dans une telle exubérance de floraison que la campagne a l'air de faire sa première communion. On dirait que tout ce qu'il y a d'anges au ciel et de jeunes âmes sur la terre s'est changé en buissons fleuris pour souhaiter Dieu aux passants. »
Nous savons que c'est le 26 mars, au bord d'un frais ruisseau, que Gounod trouva sa délicieuse chanson : « Heureux petit berger ».
« J'étais dans un calme profond. L'écorce lisse et luisante des petits arbres qui bordent cette rivière mignonne semblait rire... Les oiseaux célébraient sans doute une de leurs fêtes dans les arbres voisins, car c'était un concert de virtuoses... De longues herbes souples et touffues tapissaient le fond du ruisseau et semblaient du velours sous du diamant. »
Aux Saintes-Maries de la Mer Gounod nous dit qu'il a « visité et en quelque sorte palpé par les pieds cette terrasse de la chapelle supérieure, terrasse du haut de laquelle Mireille expirante plonge ses derniers regards sur cette admirable mer dont l'horizon lui semble le chemin du ciel indiqué par la vision des trois saintes. Il y a dans le mélange de cette situation dramatique et de cet aspect une grandeur légendaire qui émeut profondément. C'est un beau dernier tableau de dernier acte et quand on voit ces deux choses à la fois, je t'assure qu'on n'a plus envie de faire revivre Mireille que parmi les anges du Ciel... Il faut que cette âme lumineuse meure devant la mer inondée de soleil. C'est une messe en blanc et non en noir qu'il lui faut. »
A propos de maître Ramon, ceci :
« Je te dirai une chose qui m'explique pourquoi j'espère avoir trouvé juste : c'est que pour traiter cette figure du père de Mireille, il me fallait pouvoir le faire d'après nature. Tout ce que. j'ai observé par moi-même, joint à tout ce que j'ai recueilli des récits et confidences de Mistral sur son vieux père, m'a fait entrer au fond de cette nature de patriarche, du chef de la famille. Ici, le chef de famille est une autorité immense ; c'est le pontife de la maison. Il est vénéré. Femme, enfants, grands ou petits, sont devant lui à genoux. Et tu juges si cela était plus tranché encore à la génération précédente... Ainsi la mère de Mistral, qui adorait son mari, l'appelait toujours « Maître ». Quand il dînait elle ne s'asseyait jamais à table avec lui ; elle le servait et mangeait ensuite avec les enfants. Tu n'as aucune idée de ces mœurs-là ; c'était de la Bible, Ancien Testament bien entendu. »
Gounod se préoccupe de bien traduire le caractère de chaque rôle dans sa vérité ou sa vraisemblance. Il n'est pas jusqu'à la sorcière Taven pour laquelle il ne se flatte d'avoir découvert des harmonies et des timbres « couleur chauve-souris ».
Mistral voyait son ami presque tous les jours, suivait de près son travail et s'écriait : « Allons, j'irai pleurer dans un coin en entendant cela... Vous, vous êtes venu au monde pour découvrir la Provence. Vous le tenez, votre opéra. »
Mistral disait bien : Gounod a découvert musicalement la Provence, ouvrant délicieusement et magnifiquement la voie à Bizet.
La partition de Mireille se bâtissait pièce à pièce, ou plutôt les éléments en étaient rassemblés, attendant la mise en ordre définitive et la véritable construction. « Dans quinze jours, écrivait Gounod, si cela continue à marcher ainsi, je pourrai, sans aucun préjudice pour mon œuvre, recevoir ici ma femme et mon fils : une fois que mes idées sont trouvées, je ne crains pas d'être distrait par la présence des êtres que j'aime ; au contraire, cela me fait du bien de les avoir auprès de moi. » Mme Gounod et son fils viennent bientôt le rejoindre.
Le 26 mai, un banquet est offert au compositeur et à sa famille par les Saint-Remigeois. Mistral lit un poème en provençal en l'honneur de Gounod. Puis au siège de l'Echo des Alpilles, sur son vieil harmonium poussif, Gounod donne à ceux qui l'entourent une idée de son œuvre.
Trois jours après, Gounod filait sur Paris où l'attendaient impatiemment son directeur Carvalho et son éditeur Choudens.
Celui-ci l'entraîne à Londres pour une représentation de Faust et là, il le « promène, il le montre, il l'expose », lui faisant jouer « le rôle d'une affiche ou d'une grosse caisse avec laquelle il allait tambourinant sa marchandise à l'étranger ».
L'été, Gounod termine Mireille.
Mais il est surmené. Il lui faut du repos. A Fontainebleau d'abord, ensuite chez son ami le docteur Blanche, à Passy.
***
Une moustache et une barbiche à la Napoléon III, les épaules larges, la chemise largement ouverte sur un cou puissant, le regard ardent et doux à la fois, le nez droit, le front haut, plein de rêve, tel nous apparaît Mistral en une fort belle gravure, signée Hébert, jointe au texte de Mireille dans l'édition Lemerre.
Dans sa visite à Maillane, l'ami du poète, Charles Maurras, le voit ainsi : « Sous l'ample chevelure dont la teinte rappelle le feuillage de l'olivier, les traits ont conservé leur admirable pureté. On n'y lit aucune fatigue ni aucun découragement. Sur le grand front uni et net, sur les joues coupées d'un grand pli, dans l'arc superbe des orbites vivent des sentiments de foi et de paix. Les yeux, d'une grande finesse, manifestent, quand ils le veulent, bien des pensées : mais on n'y trouve d'ordinaire qu'un reflet glorieux et paisible de la lumière avec un grand amour de la simplicité. »
Un homme de foi robuste. Un homme courageux et persévérant. Vers 1860, Mistral s'aperçut que la Provence ne possédait pas de traduction de la Genèse. Il l'entreprit aussitôt à raison d'un chapitre par an, et comme il y en a exactement cinquante, le poète vit la fin de son travail en 1910.
Mais quel plus beau courage et quelle plus belle persévérance que de se consacrer entièrement au relèvement « d'une idée, d'une langue, d'un peuple que l'on tenait pour des vaincus ». Et cette tâche il l'a magnifiquement réalisée.
***
C'est en 1859, l'année de Faust, que Mistral avait achevé son poème de Mireille. Il en fit hommage à Lamartine avec cette dédicace :
Te consacre Miréio : es moun cor e moun amo.
Es la flour de mis an,
Es un rasin de Crau qu emè touto sa ramo
Te porge un païsan.
Je te consacre Mireille : c'est mon cœur et mon âme.
C'est la fleur de mes ans
C'est un raisin de Crau qu'avec tous ses rameaux
T'offre un paysan. (*)
(*) « Il faut lire, dit Charles Maurras, le cri d'admiration adressé par Adolphe Dumas à la Gazette de France, l'article de Lamartine, le triomphe dans l'univers. » « Le parfum de ton livre ne s'évaporera pas dans mille ans », a prédit Lamartine.
Puis il débute : (*)
(*) La traduction française de Mireille est de Mistral lui-même.
A ce propos, nous devons citer les réflexions suivantes de Charles Maurras : Quand il le voulait, quand cela lui chantait, Mistral écrivait un français admirable, d'une souplesse, d'une harmonie, d'une familiarité et d'une pureté excellentes. Les parties connues de sa Correspondance suffisent à le montrer. Quand il se traduisait, ce n'était plus la même chose. Là, il ne voulait pas. Là, entre sa langue naturelle qu'il avait trouvée en haillons, qu'il avait vêtue en princesse et ce français qu'il avait toujours jugé trop académique pour nous livrer son cœur, il éprouvait on ne sait quelle contrainte qui le faisait hésiter : finalement il demeurait bien en deçà, je ne dis pas des ressources générales de la langue française, mais des virtualités propres à son français, au français vivant de Mistral. »
Et cependant, — et c'est l’avis de Maurras lui-même, — après Mistral, qui oserait « retraduire » Miréio ?
Je chante une jeune fille de Provence. — Dans les amours de sa jeunesse, — à travers la Crau, vers la mer, dans les blés, humble écolier du grand Homère, — je veux la suivre. Comme c'était — seulement une fille de la glèbe, — en dehors de la Crau il ne s'en est guère parlé.
Bien que son front ne resplendît — que de jeunesse bien quelle n'eût — ni diadème d'or ni manteau de Damas, — je veux qu'en gloire elle soit élevée — comme une reine et caressée — par notre langue méprisée, — car nous ne chantons que pour vous, ô pâtres et habitants des mas.
Toi, Seigneur Dieu de ma patrie, — qui naquis parmi les pâtres, — enflamme mes paroles et donne-moi du souffle ! — ... Dieu beau, Dieu ami, sur les ailes — de notre langue provençale, — fais que je puisse atteindre la branche des oiseaux !
Vincent est le fils d'un vannier.
... Vincent n'avait pas encore seize ans [Mireille en avait quinze] — mais tant de corps que de visage — c'était certes un beau gars et des mieux découplés, — aux joues assez brunes, — en vérité... Mais terre noirâtre — toujours apporte bon froment — et sort des raisins noirs un vin qui fait danser.
Vincent et son père passent devant la ferme de maître Ramon, s'y arrêtent et reçoivent l'hospitalité. Vincent parle à Mireille. « M'est avis, dit Mireille à sa mère, que pour l'enfant d'un vannier, il parle rudement bien ! »
...C'est maintenant la cueillette des feuilles de mûrier pour les vers à soie.
Chantez, chantez, magnanarelles ! Car la cueillette aime les chants.
Par hasard, Vincent, le raccommodeur de corbeilles, passe au sentier voisin. La jeune fille l'appelle. Le gars accourt, et pour aider Mireille, monte à côté d'elle sur l'arbre. Ils aperçoivent un nid de mésanges bleues, veulent l'atteindre. La branche rompt et les voilà tous deux à terre.
En défeuillant vos rameaux, chantez, chantez magnanarelles ! — Ainsi les beaux enfants, de l'arbre feuillu — cachés sous la ramée, — dans l'innocence de leur âge, — s'essayaient à l'amour...
Quand les récoltes sont honnêtes, — qu'à pleins barils les vergers d'oliviers — dans les jarres d'argile épanchent l'huile rousse ; — quand par les champs et les chemins, — du ramasseur de gerbe qui erre çà et là — le grand chariot cahote — et heurte de toute part avec son front altier,
... Et, diaphanes, sur les genêts — quand les vers à soie montent en fête — pour filer leurs prisons blondes : et que rapidement, — ces chenilles, artistes consommées, — s'ensevelissent par milliers — dans leurs berceaux si subtils — qu'ils semblent tissus d'un rayon de soleil ;
Alors, en terre de Provence — il y a plus que jamais ébaudissement ! — Les bons muscats de Baume et de Ferigoulet — alors se boivent à la régalade — Alors on chante et l'on banquette ; — alors se voient garçons et filles — au son du tambourin former leurs rondes.
Mireille a déclaré son amour à Vincent ivre de joie. Ils se voient en cachette.
Courts moments da félicité — que passent alors Mireille et Vincent — ... Mais parlons bas, mes lèvres — Car les buissons ont des oreilles ! — Cachés dans l'ombre pie, — leurs mains, peu à peu, se mêlaient ensemble.
Ensuite ils se taisaient de longs intervalles, — et leurs pieds heurtaient les cailloux ; — et tantôt, ne sachant se dire autre chose, — l'amoureux novice — contait en riant les mésaventures qui lui arrivaient d'ordinaire : — et les nuits qu'il dormait sous le firmament,
Et les dentées des chiens de ferme — dont sa cuisse portait encore les cicatrices. — Tantôt Mireille, de la veille et du jour — lui racontait les petits travaux, — et les propos de sa mère — avec son père, et la chèvre — qui avait ravagé toute une treille en fleur.
Une fois Vincent ne fut plus maître : — Sur l'herbe rude de la lande — couché tel qu'un chat sauvage, il vint en rampant — jusqu'aux pieds de la jouvencelle... — Mais parlons bas, mes lèvres — car les buissons ont des oreilles !... parlons bas, mes lèvres — car les buissons ont des oreilles !... — « Mireille ! accorde-moi de te donner un baiser ! »
« Mireille ! dit-il, je ne mange ni ne bois, — tellement tu me donnes d'amour ! — Mireille ! je voudrais enfermer dans mon sang — ton haleine que le vent me dérobe ! — A tout le moins, de l'aurore à l'aurore, — seulement sur l'ourlet de ta robe — laisse que je me roule en la couvrant de baisers ! »
— « Vincent ! C'est là un péché noir ! — et les fauvettes et les pendulines — vont ensuite ébruiter le secret des amants. » — « N'aie pas peur qu'on en parle, — car moi, demain, vois-tu, je dépeuple de fauvettes — la Crau entière jusqu'à Arles ! — Mireille ! je vois en toi le paradis pur ! »
... Elle était pâle ; lui, avec délices, — l'admirait... Dans son trouble, — tel qu'un chat sauvage il se dresse alors, et promptement — de sa hanche arrondie — la fillette effarouchée — veut écarter la main hardie — qui déjà lui ceint la taille ; il la saisit de nouveau…
Mais parlons bas, ô mes lèvres, — car les buissons ont des oreilles !... — « Laisse-moi ! » gémit-elle, et elle lutte en se tordant. — Mais d'une chaude caresse — déjà le jeune homme l'étreint. — joue contre joue ; la fillette — le pince, se courbe et s'échappe en riant.
Et puis après, vive — et moqueuse elle lui chantait de loin : Lingueto ! Lingueto ! (*) — Ainsi eux deux — semaient au crépuscule — leur blé, leur joli blé de lune (**), — manne fleurie, heur fortuné — qu'aux manants comme aux rois Dieu envoie en abondance.
(*) Lingueto ! mot intraduisible qu'on répète en riant à quelqu'un en lui montrant quelque chose de loin et de haut pour exciter sa convoitise.
(**) Blé de lune (blad de luno). Au propre, faire de blad de luno signifie dérober du blé à ses parents à la clarté de la lune. Blad de luno, au figuré, désigne les larcins amoureux.
Mais trois prétendants briguent la main de la jeune fille : Alari le berger, Véran le gardien de chevaux, Ourrias, le toucheur de taureaux. Mireille les éconduit tous. Alors, Ourrias, furieux, provoque Vincent. Un combat à mort a lieu entre les deux rivaux dans la Crau déserte. C'est Vincent qui emporte la victoire et généreusement il épargne la vie du vaincu et le laisse se retirer. Traîtreusement, en s'échappant, Ourrias perce Vincent d'un coup de trident et fuit au galop de sa cavale. Il arrive au Rhône, rencontre trois bateliers fantastiques qui lui offrent le passage. Mais la barque s'effondre sous le poids de l'assassin. Ourrias est englouti par les flots tandis qu'a lieu la procession des noyés sur les rives du Rhône.
Au petit jour, trois porchers trouvent Vincent étendu dans le désert de la Crau, baigné dans son sang. Ils le portent au mas des Micocoules, où Mireille, en le voyant presque mort est près de s'effondrer. Elle le fait transporter et elle l'accompagne dans la montagne auprès de Taven, la sorcière, qui le guérit.
Mireille avoue son amour à ses parents qui entrent dans une violente colère et refusent de lui laisser faire un si pauvre mariage. Car la famille de Mireille est riche et Vincent n'a rien. Désespoir de Mireille qui, au milieu de la nuit, fuit la maison paternelle. Elle veut se rendre au tombeau des Saintes-Maries de la Mer supplier les patronnes de la Provence de fléchir ses parents.
Course de Mireille à travers la Camargue. La chaleur. Le mirage. Les dunes. Frappée d'une insolation, Mireille se traîne jusqu'aux Saintes-Maries qui lui enseignent la nécessité et le mérite de la souffrance et lui font le récit de leurs propres épreuves. « Adieu, Mireille ! disent-elles, nous voyons la vie trembler dans ton corps, comme une lampe qui va s'éteindre. Vers les cimes, vers les suprêmes hauteurs du Ciel, il est nécessaire que nous arrivions avant elle. Vierge et martyre d'amour, elle va mourir ! »
Vincent et les parents de Mireille accourent. Ils la voient morte. Mais ils ne veulent, ils ne peuvent croire. « Elle est morte ! s'écrie Vincent. Ne voyez-vous pas qu'elle est morte ? » Et comme on tord les harts d'osier, en désespéré il se tord les poings...
Et dans la gloire du Ciel avec les Saintes-Maries, lentement l'âme de Mireille monte.
Ainsi se résume en quelques lignes les douze chants de Mireille de Frédéric Mistral. Histoire banale d'amour mais singulièrement relevée par le cadre, la couleur d'âme des personnages, l'évocation de la Provence, de la Crau, de la Camargue, des coutumes et des traditions des Saintes-Maries de la Mer. Les librettistes de Gounod n'ont qu'en partie et bien imparfaitement rendu toute cette poésie dont Mistral a su vivifier son sujet, et, sauf dans les premières scènes peut-être, ils n'ont livré au musicien qu'un schéma bien insuffisant d'un admirable conte où toutes les puissances de la Nature — et les êtres surnaturels aussi — jouent leur rôle. Ils ont amoindri l'œuvre de Mistral et lui ont enlevé beaucoup de son parfum capiteux.
***
La Mireille de Gounod parut sur la scène du Théâtre-Lyrique « cinq ans, jour pour jour, après Faust, le 19 mars 1864 ». La soirée, commencée triomphalement avec le chœur des magnanarelles bissé d'enthousiasme, s'acheva en déroute. Le duo « O Magali, ma bien-aimée » ne fut qu'à moitié goûté. Mais surtout le tableau du Rhône, avec ses noyés, parut d'un réalisme ridicule. La chanson du pâtre, les couplets de Mireille, la scène des Saintes-Maries ne furent pas compris.
« Il n'y a pas de soleil dans cette musique, écrivit Scudo, il n'y a pas de verdure ; on dirait que le compositeur n'a jamais été dans le pays dont il a voulu retracer les mœurs et la nature. » Qu'il n'y ait pas de verdure, cela va presque de soi. La Provence est plutôt sèche. Mais pas de soleil ! Que faut-il donc à Scudo ?
Mireille ne dépassa pas tout d'abord la vingt-cinquième représentation.
Le 15 octobre, au Théâtre-Lyrique, on reprenait l'ouvrage réduit en trois actes. L'auteur avait dû consentir à toutes sortes de changements. La nouvelle Mireille ressemblait peu à celle qu'il avait conçue tout d'abord. Au dénouement on ne voyait pas Mireille « revivre parmi les anges du Ciel ». Elle épousait Vincent pour que tout le monde pût s'en aller content. La partie fantastique était supprimée ou singulièrement réduite : les rôles de Taven et de Vincenette étaient modifiés et en partie soudés.
Tout récemment, par les soins de MM. Büsser et Reynaldo Hahn, notre Opéra-Comique a rétabli le texte musical de Mireille dans son intégrité originelle. L'œuvre ainsi présentée offre certainement des faiblesses. Mais elle contient quelques-unes des pages les plus exquises qu'ait jamais composées Gounod. Il y a en somme deux parts à faire dans Mireille : tout ce qui a rapport à la Provence, à la description de la Nature, à la figure de Mireille elle-même, relève de la plus vive et de la plus fraîche inspiration. Le drame lui-même est rendu souvent par des moyens un peu déclamatoires qui peuvent rebuter. Mais l'ouvrage n'en contient pas moins des parties de chef-d’œuvre. Il n'est personne qui n'ait admiré la délicate perfection de la première scène, de ce chœur des magnanarelles parfumé de toutes les senteurs de la France méridionale et animé de toute la joie naïve de ses jeunes paysannes. Les reparties de Taven, de Clémence et de Mireille qui le coupent sont de la plus heureuse variété. La phrase de Taven particulièrement est d'une couleur bien savoureuse. Et celle de Mireille est miraculeusement dessinée ; encore un de ces chants presque parlés et pourtant mélodieux où excelle Gounod : simplicité, intimité, émotion, tout se trouve réuni pour nous charmer et nous toucher au vif. Si nous songeons en même temps à la première rencontre de Faust et Marguerite au milieu de la valse du deuxième acte de Faust, nous reconnaissons vite l'étroite parenté de ces deux phrases-sœurs, dans la diction desquelles madame Carvalho apportait, au témoignage de tous ceux qui l'ont entendue, un art unique.
Quelle jolie chose encore que le duo de Mireille et de Vincent : « Vincenette a votre âge... » Tout ce premier acte est incomparable.
Le deuxième acte commence d'une façon délicieuse par la farandole et la chanson de Magali. La chanson de Magali est une des plus étonnantes réussites de Gounod. Il s'y est inspiré d'une chanson populaire qu'on lui a reproché parfois de n'avoir pas conservée dans son texte original. Il l'a en effet profondément modifiée. Mais pourquoi nous en plaindre ? La chanson populaire n'est après tout qu'une gentille mélodie, un peu courte. En la développant, en lui donnant ce rythme à cinq temps, pour l'époque si hardi, en en variant le thème suivant les moments divers du texte poétique, Gounod a créé une pièce musicale d'une grâce adorable dont nous ne saurions qu'admirer le caractère profondément original.
La chanson de Taven est encore une trouvaille bien séduisante de couleur, de rythme et d'expression, et d'une spirituelle ironie.
Avec l'air de Mireille : « Mon cœur ne peut changer... » nous entrons dans un domaine plus conventionnel, mais qui peut plaire encore.
C'est seulement avec l'air d'Ourrias que commencent vraiment nos déceptions et surtout avec la phrase de maître Ramon : « Le chef de famille autrefois était le maître... » qui nous entraîne dans la région des banales grandiloquences. Désormais, jusqu'à la fin de l'ouvrage, nous ne trouvons plus guère pour nous satisfaire pleinement que l'introduction orchestrale du désert de la Crau d'une si riche couleur et d'un si beau sentiment et la savoureuse chanson du berger qui la suit, — sans oublier non plus la jolie cavatine : « Heureux petit berger ».
En somme, une œuvre inégale, mais dans laquelle Gounod atteint en certains points des sommets qu'il ne dépassera pas.
ROMÉO ET JULIETTE
C'est encore en Provence, au bord de la mer cette fois, à Saint-Raphaël, qu'en 1865 Gounod s'installa pour composer Roméo et Juliette. Il y loua l'Oustalet dou Capelan « une charmante petite maison toute mignonne… et entourée d'une terrasse d'où la vue est une merveille. » Il écrit le 5 avril :
« Je travaille soit chez moi, soit dehors, sur le bord de la mer ou à l'ombre de quelque pin parasol ; il y en a ici de charmants groupes... Nous avons un ciel admirable, d'une transparence merveilleuse : la planète Vénus y est grosse comme une orange et semble une vraie petite lune, d'un brillant extraordinaire. » Et le 9 avril : « Aujourd'hui, l'eau est du lapis liquide, c'est comme à Pæstum. Je me suis levé ce matin avec le soleil ; j'ai été passer deux ou trois heures sur le bord de la mer, mon album sous le bras. Je me suis installé sous une petite cabane, à vingt pas des vagues qui venaient écumer devant moi et là j'ai travaillé avec amour... »
Il ajoute : « Tu ne te figures pas combien le calme de cette existence laisse penser et aide à penser. Voilà ce que j'appelle du travail, et cela, c'est impossible pour moi, en plein Paris. Quoi qu'on fasse, le détail vous râpe et vous pulvérise ; on n'a pas le silence de l'esprit. Ici rien ne m'arrête, je vais, je vais toujours, sans que rien vienne casser l'œuf que la réflexion féconde sans cesse et dont l'éclosion serait incessamment compromise au milieu des innombrables rencontres de la vie citadine. A propos d'œufs, veux-tu que je te dise combien j'en ai déjà ? Comptons :
1° Toute l'introduction du premier acte ;
2° Le Scherzo de la Reine Mab ;
3° Le premier duetto galant entre Roméo et Juliette à leur rencontre dans le bal ;
4° Le chœur des moines qui ouvre le troisième acte dans la coulisse (*) ;
5° La cantilène du frère Laurent qui suit, avec une reprise d'un nouveau chant des moines et du frère Laurent (**).
Je te réponds qu'il y a du travail. L'introduction est très développée ; elle renferme trois motifs de chœurs, un air du père Capulet et la phrase d'entrée de Juliette, avec un thème d'orchestre comme motif de danse qui enveloppe le tout. Quant au scherzo de la reine Mab, je n'ai pas besoin de te dire le côté symphonique auquel il a fallu m'attacher, tu le devines. L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Eh bien, sauf deux motifs que j'avais à Paris (celui de la danse et celui du petit duo entre Roméo et Juliette), tout le reste représente le travail de quatre jours ; cinq en comptant aujourd'hui. Mais ces quatre ou cinq jours-là en valent quarante ou cinquante de ceux de là-bas. »
(*) Supprimé.
(**) Supprimé.
Quelle rapidité d'exécution ! C'est de la véritable improvisation et sans méditation ultérieure pour mettre au point l'inspiration. Car Gounod ne reviendra pas, ne modifiera pas, ne corrigera pas ce premier jet. C'est là son fort et son faible : une sûreté étonnante en général dans la première invention, mais rien ensuite pour pallier les faiblesses ou les manques, point de révision critique et c'est ce qui nous vaut par exemple l'air du père Capulet, hélas !
Un autre jour, il cherche son inspiration dans la campagne de Fréjus :
« Je ne sais pas un pays qui ait plus de charme que celui-ci écrit-il le 23 avril : je l'aime encore mieux que la Provence de Maillane. »
Le 2 mai, à midi et demi, il annonce : « Enfin, je le tiens, cet endiablé duo du quatrième acte. Ah ! que je voudrais savoir si c'est bien lui ! Il me semble que c'est lui. Je les vois bien tous les deux, je les entends. Mais les ai-je bien vus, bien entendus, ces deux amants ? S'ils pouvaient me le dire eux-mêmes et me faire signe que OUI ! Je le lis ce duo, je le relis, je l'écoute avec toute mon attention ; je tâche de le trouver mauvais ; j'ai une frayeur de le trouver bon et de me tromper ! Et pourtant il m'a brûlé ! Il me brûle ! Il est d'une naissance sincère. Enfin, J'Y CROIS. Voix, orchestre, tout y joue son rôle ; les violons s'y passionnent ; les enlacements de Juliette, l'anxiété de Roméo, ses étreintes enivrées, des accents soudains de quatre à huit mesures au milieu de toute cette lutte entre l'amour et l'imprudence, il me semble que tout cela s'y trouve. Nous verrons. »
Peu à peu le brouillon de la partition de Roméo finit par remplir tout un album, écrit au crayon d'une main légère, qu'il a été donné à Camille Bellaigue de feuilleter et qu'il nous décrit ainsi : « Sous la reliure de cuir fané, mais toujours odorant, entre les gardes de moire passée, sur le papier jauni, les petites notes fines ont pâli. Presque tout est là, depuis le madrigal jusqu'à la scène du tombeau. Voici la page où, pour la première fois, la voix de Roméo s'est unie à celle de Juliette, voici la page où l'alouette a chanté. On voit très bien ici comment travaillait Gounod, ou plutôt comme il créait. Le duo du balcon, c'est-à-dire le second acte tout entier, est écrit d'un seul jet ; la ligne de chant, sans interruption ni rature, accompagne le texte et souvent même le dépasse. Celui-ci manque parfois sous les dernières notes, comme si la musique alors n'avait pas jailli de la parole, mais du sentiment. Çà et là, une indication et, pour ainsi dire, une amorce d'harmonie ou d'instrumentation, témoigne de l'accord préétabli dans l'imagination de l'artiste entre les divers éléments de l'œuvre totale. »
***
L'idée qu'avait eue Gounod de mettre en musique le Roméo de Shakespeare datait de loin. Il nous dit lui-même : « Berlioz a été l'une des plus profondes émotions de ma jeunesse. Il avait quinze ans de plus que moi, il était donc âgé de 34 ans à l'époque où moi, gamin de dix-neuf ans, j'étudiais la composition au Conservatoire, sous les conseils d'Halévy. Je me souviens de l'impression que produisirent sur moi la personne de Berlioz et ses œuvres, dont il faisait souvent les répétitions dans la salle des concerts du Conservatoire. A peine mon maître Halévy avait-il corrigé ma leçon, vite je quittais la classe, pour aller me blottir dans un coin de la salle de concert et là je m'enivrais de cette musique étrange, passionnée, convulsive qui me dévoilait des horizons si nouveaux et si colorés. Un jour, entre autres, j'avais assisté à une répétition de la symphonie Roméo et Juliette, alors inédite et que Berlioz allait faire exécuter peu de jours après pour la première fois. Je fus tellement frappé par l'ampleur du grand final de la « Réconciliation des Montaigus et des Capulets » que je sortis en emportant tout entière dans ma mémoire la superbe phrase du frère Laurent : « Jurez tous par l'auguste symbole ». A quelques jours de là, j'allai voir Berlioz et, me mettant au piano, je lui fis entendre ladite phrase entière. Il ouvrit de grands yeux et me regardant fixement : « Où diable avez-vous pris cela ? dit-il. — A l'une de vos répétitions », lui répondis-je. Il n'en pouvait croire ses oreilles. » C'est sans doute alors que Gounod conçut déjà le projet de faire de Roméo un opéra. Toujours est-il qu'un de ses envois de Rome à l'Institut en 1842 consistait dans des fragments du second acte de Romeo e Giulietta, probablement d'après le livret de Romani, auparavant utilisé par Bellini.
***
En attendant que Roméo fût mis à la scène, l'année 1866 apporta dans la vie de son auteur un événement d'importance : son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Ce fut une grande joie pour Gounod, d'autant plus que cette élection se produisit dans des conditions particulièrement flatteuses pour le compositeur de Faust. La mort de Clapisson rendait un siège disponible dans la section de musique. Cinq candidats se présentèrent : Gounod, Félicien David, Victor Massé, Aimé Maillart et Antoine Elwart. Gounod eut la satisfaction d'être « cordialement, chaudement, fraternellement » soutenu par Berlioz. Lors de la discussion de la valeur des candidats Berlioz eut cette parole décisive : « M. Félicien David a un remarquable tempérament de musicien, mais il lui serait impossible de composer seulement l'introduction instrumentale de Faust. » Gounod fut présenté en première ligne par la section de musique. Au premier tour de scrutin de l'Académie en assemblée plénière, il recueillit 19 voix sur 36 votants, 16 voix allant à Félicien David. La victoire était dès lors assurée. Elle fut complète.
***
La mise au point de Roméo ne se fit pas sans encombre. Il y eut toutes sortes de difficultés, notamment pour le choix du ténor. Nous ne savons pas au juste ce qui s'était passé. Il semble bien que Carvalho avait engagé Capoul pour créer le personnage de Roméo et que Gounod ne voulut pas renoncer au concours de Barbot, le créateur de Faust, par un sentiment de reconnaissance dont on appréciera la délicatesse, d'autant plus que Capoul avait alors au suprême degré l'oreille du public. Il en résulta toutes sortes de négociations qui traînèrent en longueur. Il fallait ménager l'amour-propre de Capoul et, pour cela, user d'une diplomatie en laquelle Gounod se montra très expert.
La distribution fut en définitive arrêtée comme il suit : Barbot eut le rôle de Roméo : il exultait d'avoir supplanté le « petit frisé », comme il appelait Capoul ; Mme Carvalho chantait Juliette et Gounod lui concéda la « Valse » sans laquelle il paraissait impossible à la brillante actrice de paraître en public. Troy fut Capulet, Cazeaux le frère Laurent, Barré Mercutio, Puget Tybalt, Laurent Benvolio, Laveissière Pâris, Troy jeune Gregorio, Martel le Duc, Neveu Frère Jean, Mlle Darasse Stefano et Mlle Duclos Gertrude.
Primitivement, Roméo, comme Faust, comportait des scènes parlées : « Pour beaucoup de raisons, écrivait Gounod, de Villerville, le 28 septembre 1866, pour beaucoup de raisons je ne veux pas d'une version unique : d'abord il y a une foule de théâtres qui préféreront monter l'ouvrage avec du dialogue et, à mon avis, le récit partout n'est pas un bénéfice dans Roméo : 1° en ce que cela allonge la durée de l'exécution ; 2° en ce que cela n'y ajoute pas de mouvement. Ensuite, je veux pouvoir juger par moi-même et d'après la représentation de ma pièce avec du parlé quels sont les passages qui gagneraient à être transformés en récits ; cela m'évite une besogne à laquelle il y aurait certainement à revenir si je la faisais dès maintenant et sans le conseil de la comparaison et de l'expérience. Je m'attache uniquement aux raisons de convenances musicales de faire telle chose plutôt que telle autre. En un mot, il faut que j'aie devant moi l'ensemble de mon tableau avant de m'occuper des modifications dont cet ensemble seul peut me faire connaître l'opportunité... »
L'opinion de Gounod en cette matière peut nous paraître étonnante à certains égards. Nous n'aimons guère aujourd'hui le mélange du parlé et du chant. Nous préférons la musique continue. Ce fut toujours le sentiment des Italiens. Les Français suivirent très longtemps la méthode opposée, au moins pour l'opéra-comique, et n'oublions pas que Faust et Roméo sont, à l'origine, des opéras-comiques, ou, du moins, des opéras enfermés dans les cadres de l'opéra-comique. Les Allemands ont usé longtemps aussi du procédé français. Songeons à l'Enlèvement au Sérail, à Fidelio, au Freischütz. Fidelio, sujet tragique par excellence, s'accommode au mieux de l'usage du parlé, et nous nous sommes habitués ces dernières années à écouter cette œuvre admirable dans la forme où elle fut conçue sans en être choqués. Le contraste de la parole et de la musique ne nuit pas aux effets les plus pathétiques, à la condition qu'on ait affaire à des acteurs qui sachent opérer harmonieusement la liaison toujours délicate du parlé et du chant. La musique a ainsi l'avantage de se trouver réservée pour ce qui est essentiellement musical ou musicable.
Après bien des modifications de détail, Roméo et Juliette passa en première représentation le samedi 27 avril 1867.
« La répétition générale, conte Carvalho, la répétition générale faite à huis clos, avait été maussade. Il semblait que rien n'était fini. Les artistes étaient nerveux. Quelques costumes n'allaient pas bien. On voulait à tout prix que la première représentation n'eût pas lieu le lendemain. D'autant que ce jour-là, M. Roulier, ministre de l'Empire, donnait un grand bal officiel auquel le monde tout entier des lettres, des arts, de la politique, du journalisme devait assister. Gounod, dans la crainte qu'il n'y eût personne à la première de Roméo, insistait pour qu'elle fût remise. Je pensais au contraire qu'il y avait lieu de passer le lendemain. Et à minuit, après la répétition générale, alors que tout le monde était parti sous l'impression que la première serait retardée, resté seul dans le théâtre avec quelques fidèles collaborateurs, je fis venir les machinistes, les couturiers, et je leur dis : « Me garantissez-vous toutes choses en l'état pour demain soir, en passant la nuit ? — Oui, monsieur le directeur. » Devant cette réponse affirmative, je me mis tout seul à confectionner les services de presse, les bulletins de représentation aux artistes. J'envoyai dans la nuit à l'imprimerie pour faire composer les affiches, et, le lendemain, Gounod et les interprètes de Roméo apprirent, en se réveillant, que l'œuvre passait le soir même, malgré les hésitations de la veille et la soirée de M. Rouher. Il est vrai qu'en prévision de celle-ci, j'avais dit aux machinistes : « Trente louis pour vous si l'ouvrage est terminé avant minuit. » Ils gagnèrent la somme, car à onze heures trois quarts le spectacle était achevé et tout le monde se dirigeait vers les salons de M. Roulier pour aller proclamer le grand succès de Roméo. »
Grand succès en effet. C'était le début de l'Exposition universelle. Paris regorgeait de monde, de provinciaux et d'étrangers. Pendant quatre-vingt-dix représentations Roméo connut des salles combles.
***
Comme pour Faust, comme pour Mignon, comme pour Carmen, le succès populaire de Roméo coïncide avec le choix d'un grand chef-d’œuvre de la littérature pour sujet de l'opéra. Ce qui confirme ce principe, parfois discuté, que la première condition de la réussite d'une partition est la valeur du livret sur lequel elle est construite. La musique, à elle seule, ne saurait assurer le sort d'un ouvrage dramatique devant le grand public. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il suffit d'user d'un bon livret pour écrire un bon opéra, même si l'on est un musicien de valeur. Vincenzo Bellini n'était pas un mauvais musicien, et pourtant sur le sujet de Roméo et Juliette (I Capuletti e i Montecchi, 1830) il n'a pas réussi à composer une œuvre durable. Et d'autre part, il est vrai, les connaisseurs écouteront toujours avec ravissement la partition d'Obéron de Weber, malgré le médiocre livret.
La presse fit le meilleur accueil au nouvel opéra de Gounod. Reyer, dans le Journal des Débats, après avoir rendu hommage à l'œuvre de Berlioz, conçue 30 ans auparavant, ajoutait, en parlant de l'opéra de Gounod : « Voilà une œuvre poétique et charmante dans laquelle le savoir et l'inspiration se révèlent au suprême degré. Elle passionnera le public et sera pour les musiciens un sujet d'études et de méditation ; elle apprendra à ceux qui cherchent le succès dans la banalité qu'on le trouve aussi quelquefois dans les plus pures régions de l'art. »
Gustave Bertrand dans le Ménestrel, saluait avec joie l'apparition du Roméo de Gounod « qui va faire enfin disparaître la partition de Bellini et de Vaccaj » et il appelait de ses vœux le jour où « l'avenir appartiendra peut-être à l'école française ». Ce ne sera pas alors un « mince honneur pour M. Gounod, ajoutait-il, d'avoir commencé à indiquer la possibilité de ce grand fait de par le monde ». Parole prophétique. C'est en effet de Gounod qu'il faut faire dater, après le prodigieux abaissement du génie musical français dans la première moitié du XIXe siècle (sauf la glorieuse exception de Berlioz, d'ailleurs méconnu) ce renouveau merveilleux dont l'épanouissement après 1870 devait mettre à l'honneur les Bizet, les Bruneau, les Charpentier, les Duparc, les Chausson, les d'Indy, les Debussy, les Fauré, les Ravel, les Dukas, les Florent Schmitt, les Albert Roussel, pour nous en tenir à ces quelques grands noms.
Nous ne citerons pas toutes les critiques favorables à Gounod à l'occasion de la « première » de Roméo. Il est plus curieux de souligner quelques notes maladroitement discordantes. C'est ainsi qu'Henri Blaze de Bury, ami et collaborateur de Meyerbeer et successeur de Scudo à la Revue des Deux Mondes, exprimait bien des réserves : « Grammaticalement, disait-il, c'est peut-être exquis. Impossible de faire parler aux instruments une langue plus élégante et plus discrète. Cette musique, jamais tendre, jamais passionnée, rarement en situation, a des détails qui vous enchantent, des enlacements décoratifs qui vous rappellent les arabesques de Raphaël dans les loges du Vatican. Beaucoup d'afféterie et de maniérisme, une musique d'idées abstraites, quelque chose de posthume jusque dans l'instrumentation, rien pour le cœur, rien pour les sens, mais par moments les plus délicates gourmandises pour l'esprit : tout cela presque sans rapport avec le sujet et se contentant d'effleurer l'anecdote... Absence complète de vie dramatique » et point de « mélodie ». Eternel reproche aux génies créateurs.
Gustave Chadeuil, dans le Siècle, résumait ainsi son impression : « Salle magnifique, décorations splendides, mise en scène éblouissante et grande musique froide... M. Gounod reste constamment à plusieurs degrés au-dessous de zéro. »
Ce ne fut pas l'opinion des publics français et étrangers et Roméo eut bien vite fait de s'installer au répertoire des théâtres du monde entier.
Roméo fut même, à l'origine, un plus grand succès que Faust. On compara d'ailleurs les deux ouvrages et, sur l'opportunité qu'il y avait à accorder l'avantage à l'un des deux sur l'autre, les avis furent partagés. La question est peut-être oiseuse. Il s'agit en effet de mérites assez différents. Il y a plus de variété dans Faust, des scènes plus diverses, avec plus de couleur, plus de pittoresque, et il s'agit principalement d'un amour autrement mouvementé, amour coupable, accompagné de toutes sortes de remords de part et d'autre, amour combattu surtout chez Marguerite par le sentiment religieux et le sentiment du devoir. La musique de Roméo est d'un dessin plus coulant, plus uni, parce qu'il s'agit d'un amour auquel rien ne saurait faire obstacle et qui se développe en toute liberté, malgré l'hostilité des deux familles rivales, en sa douceur passionnée. Rien en dehors de cet amour n'intéresse les deux personnages principaux, ni l'auteur, ni le public. Pas d'épisode, pas de hors-d’œuvre pour nous arrêter. Et l'opéra tout entier est presque contenu dans ses quatre duos d'amour.
Mais parcourons la partition de Roméo avec quelque détail :
L'ouverture-prologue avec chœur est de main de maître. D'abord une page violente qui rappelle le cadre de l'action : l'incessante guerre civile dans la vieille cité véronaise. Ces déchirements intérieurs sont traduits encore par l'entrée de fugue qui suit, fugue sur un thème rude et qui se développe avec une énergie sauvage dans sa concision brutale. Les violences du début se répètent. Puis tout d'un coup le silence se fait. La toile se lève et un magnifique chœur est chanté, non point par des choristes, mais par l'ensemble des artistes qui interprètent les divers rôles de l'opéra, tous rangés immobiles sur le devant de la scène : « Vérone vit jadis deux familles rivales... » C'est la transcription du chœur qui sert de prologue à la vieille pièce de Shakespeare (1591, 1596 ou 1597) : « Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, la vieille rivalité de deux familles, toutes deux également honorables, éclate en rixes continuelles et le sang des citoyens souille les mains des citoyens... » Ce chœur de Gounod est un des plus beaux qu'il ait jamais écrits. Conçu dans le style récitatif, mélangé d'incidentes mélodiques, il s'établit sous des harmonies de la saveur la plus imprévue et qui annoncent parfois Fauré (*). Conclusion sévère et recueillie. Le rideau se referme sur quelques mesures d'un appel lointain et, pour terminer, les violoncelles divisés, en une phrase délicieusement émue, aux enlacements langoureux, chantent par avance les amours passionnées de Roméo et de Juliette.
(*) Le passage de l'accord parfait de ré mineur à l'accord de sixte et quarte de si bémol majeur est une première trouvaille. — « Comme un rayon vermeil brille en un ciel d'orage, Juliette parut et Roméo l'aima », dit le texte. « Et Roméo l'aima » se pose sur l'harmonie tout à fait inattendue et particulièrement douce et tendre de la dominante de fa dièse majeur. Une modulation des plus ingénieuses dans son tour presque un peu forcé souligne les mots : « Et tous deux oubliant le nom qui les outrage » et nous amène à une cadence en si bémol majeur. Ici une courte réplique de l'orchestre. Puis nouvelles modulations, assez détournées, pour amener la conclusion sur les paroles : « Sort funeste ! Aveugles colères ! Ces malheureux amants payèrent de leurs jours la fin des haines séculaires qui virent naître leurs amours. »
Maintenant le rideau se lève de nouveau. Voici le premier acte. A vrai dire, la première scène ne nous enchante pas : cette fête chez Capulet sur le rythme d'une robuste mazurka, n'offre rien de ce que nous espérions. Rien de princier, rien des splendeurs de la Renaissance italienne. On se croirait dans un salon second Empire bien platement bourgeois. L'entrée de Capulet : « Soyez les bienvenus, amis » manque tout à fait de noblesse. Celle de Juliette est saluée par un petit chœur : « Ah ! qu'elle est belle ! » d'une outrageante banalité. Mais aussi quelles tristes paroles On aimerait mieux encore, autre chose que ce rythme de valse pour les premières paroles de Juliette elle-même. Capulet reprend son discours et l'on ne sait rien de plus lamentablement pauvre que ce passage : « Qui reste à sa place et ne danse pas — de quelque disgrâce fait l'aveu tout bas ». Paroles et musique se valent.
Mais voici la Ballade de la Reine Mab. Ici, nous n'avons qu'à admirer. « Mab est la sage femme des fées, disait Shakespeare, elle se présente sous une forme qui n'est pas plus grosse que l'agate placée à l'index d'un conseiller municipal et, traînée sur un char de légers atomes, elle passe sur le nez des gens endormis. Les rayons des roues de son carrosse sont faits de longues pattes de faucheux, la capote d'ailes de sauterelles, les rênes de la plus fine toile d'araignée, les harnais des humides rayons du clair de lune, le manche de son fouet est un os de grillon ; la mèche est un fil tout menu ; son cocher un petit moucheron en habit gris qui n'est pas de moitié aussi gros qu'un petit point rond enlevé au doigt indolent d'une jeune fille ; la coque de son char est une noisette vide, creusée par le menuisier écureuil ou par le vieux ver, de temps immémorial carrossier des fées. C'est dans cette équipage que toutes les nuits la reine Mab galope à travers les cervelles des amants qui alors rêvent d'amour ; sur les genoux des courtisans qui soudain rêvent de révérences ; sur les doigts des hommes de loi qui soudain rêvent d'honoraires ; sur les lèvres qui soudain rêvent de baisers... D'autres fois elle se promène sur le cou d'un soldat, et alors il rêve de gorges coupées, de brèches, d'embuscades... »
Jules Barbier et Michel Carré ont assez fidèlement et habilement transposé ce texte pour l'usage de Gounod, et Gounod utilisant leurs paroles a écrit une page qui est un chef-d’œuvre de pittoresque et d'esprit.
Le dessin si fin des traits, la couleur si diverse de l'harmonie, l'animation, la légèreté du mouvement, tout concourt à l'effet de mystère, d'enveloppement vaporeux et de vivacité de cette pièce exquise, qui serait aussi bien digne de Berlioz que de Gounod ; mais Gounod se montre peut-être plus fluide et plus irréel, Berlioz plus incisif et plus sec. Sans cesse, chez Gounod, les motifs changent. Ils se renouvellent avec une inépuisable fécondité, jamais pareils, et cependant liés par une secrète unité.
Pour sa seconde entrée, Juliette chante une valse, que madame Carvalho avait obtenue de la condescendance du compositeur, et qui ne vaut certes pas l'air des bijoux de Faust, mais qui témoigne d'une extraordinaire adresse et qui, en somme, finit par plaire.
La première rencontre de Roméo et de Juliette amène le madrigal à deux voix auquel on ne saurait reprocher trop de préciosité. C'était le moins qu'on en pouvait mettre en cette occasion. Il faut songer à l'intolérable gongorisme dont use Shakespeare à cet endroit :
ROMÉO
Si ma main, indigne de cet honneur, profane cette sainte châsse, j'ai un moyen d'expiation charmante : mes lèvres, pèlerines rougissantes, sont prêtes à effacer par un tendre baiser son rude attouchement.
JULIETTE
Bon pèlerin, vous faites trop grande injustice à votre main qui n'a montré en cela qu'une dévotion conforme aux usages ; car les saints ont des mains que touchent les mains des pèlerins et le serrement de mains est le baiser des pieux porteurs de palmes.
ROMÉO
Les saints n'ont-ils pas des lèvres et les pieux porteurs de palmes aussi ?
JULIETTE
Oui, pèlerin, des lèvres qu'ils doivent employer pour la prière.
ROMÉO
Oh, en ce cas, chère sainte, laissez les lèvres faire ce que font les mains ; elles prient, exaucez leur prière, de peur que la foi ne se tourne en désespoir.
JULIETTE
Les saints ne bougent pas, quoiqu'ils exaucent les prières qui leur sont faites.
ROMÉO
Alors ne bougez pas, tandis que je vais goûter le fruit de ma prière. C'est ainsi que tes lèvres purifient les miennes de leur péché. (Il lui donne un baiser.)
JULIETTE
En ce cas, mes lèvres ont maintenant le péché qu'elles ont enlevé.
ROMÉO
Le péché de mes lèvres ? O faute délicieusement reprochée ! Eh bien, rendez-moi mon péché...
Ici, les librettistes de Gounod ont fort bien réussi leur transcription à l'usage du musicien français, et Gounod lui-même a écrit une petite pièce d'un style délicat, d'un charme certain. Une préciosité modérée (comme on l'a déjà constaté dans Faust) lui est toujours facile et pourrait-on dire naturelle, et reste toujours, avec lui, dans les limites du meilleur goût.
Juliette apprend de Tybalt que le jeune seigneur qu'elle vient de quitter n'est autre que Roméo. Dans une courte mais très belle page et sur la répétition obstinée de déchirantes harmonies, elle dit sa volonté de n'être qu'à lui ou à la mort.
Le deuxième acte s'ouvre par une charmante symphonie qui évoque les mystères de la nuit. Voici Roméo sous le balcon de Juliette. Il fallait entendre ici Talazac ou Jean de Reszké chanter la célèbre cavatine : « Ah ! lève-toi, soleil ». De l'exquise demi-teinte du début on était amené par un progrès si bien ménagé à l'éclat triomphant du si naturel aigu qui couronne magnifiquement la phrase. Jean de Reszké avait la beauté du corps, et celle du geste en même temps que celle de la voix et du style. Mais la voix et la diction de Talazac n'étaient-elles pas plus belles encore ?
Un détail à noter : le bienheureux bécarre dont Gounod souligne si à propos le palissement des étoiles.
Suit le duo : « O nuit divine, je t'implore... » d'une telle simplicité d'un bout à l'autre et en même temps d'une émotion si pénétrante. Simplicité d'un langage presque « parlé », tellement la mélodie en est d'une ligne unie, sans aucune recherche dans l'accompagnement, souvent réduit à l'alternance presque « guitaresque » d'une basse et d'un accord en contretemps, avec seulement la saveur délicate d'enchaînements harmoniques qui donnent toujours un tour distingué à cette musique d'ailleurs constamment suave. Songe-t-on à la qualité si rare d'une beauté si nue ? Mais qui dira l'étrange séduction harmonique des huit mesures où pour la première fois paraissent ces mots : « De cet adieu si douce est la tristesse ? »
Et la symphonie orchestrale du début de l'acte
soutenant cette fois un chant de Roméo amène le baisser du rideau dans une sorte
d'extase et de ravissement.
Le premier tableau du troisième acte, qui se passe dans la cellule de frère
Laurent, nous donne l'impression exacte de ce qu'est en général la musique
religieuse de Gounod. D'abord une entrée de fugue d'une écriture fort coulante,
d'un style recueilli, puis cette phrase en ut majeur : « Dieu qui fit l'homme à
ton image », le ton d'ut majeur choisi ici à dessein par Gounod pour plus de
solennité. Solennité un peu creuse peut-être. Enfin le quatuor : « Sois béni par
deux cœurs heureux ! », avec ses grands élans un peu artificiels, ses points
d'orgue et ses « escaliers ». Tout cela d'un sentiment sincère mais un peu
extérieur. Il semble qu'on aperçoit Gounod prêchant la bonne parole comme il
aimait à le faire, avec des périodes onctueuses, des phrases épiscopales et de
larges gestes. Mon ami le violoniste Henri Marteau me racontait naguère
qu'invité à déjeuner chez l'archevêque de Reims avec Gounod dont il venait de
jouer pour la première fois à la cathédrale l'Hymne à Sainte-Cécile, il
fut abasourdi d'entendre Gounod prendre la parole au début du repas et
« prêcher » jusqu'à la fin du déjeuner, ne laissant pas placer un mot au
cardinal Langénieux, son ancien condisciple à Saint-Sulpice, assez marri de se
voir souffler son rôle et son succès.
Le deuxième tableau du troisième acte débute par la si gracieuse chanson de Stephano, ironique et coquette et qui sert d'introduction à la grande scène des duels, pleine de mouvement et dramatique à souhait.
Ayant quatre duos d'amour à écrire dans cette même partition de Roméo, Gounod a eu l'art de les varier si bien et d'en établir si heureusement la gradation que pas une seule fois on ne s'avise de regretter une redite malencontreuse ou un affaiblissement de l'expression. Celui du quatrième acte s'ouvre par le retour de la phrase exposée par les quatre violoncelles dans l'ouverture, mais cette fois autrement instrumentée. Jamais rappel de thème ne fut plus opportun.
« Va, je t'ai pardonné, dit Juliette. Tybalt voulait ta mort. S'il n'avait succombé, tu succombais toi-même... Il te haïssait, et je t'aime... Je t'aime, ô mon époux. » Alors commence la grande méditation amoureuse : « Nuit d'hyménée... » Période plutôt que phrase. Car bientôt les éléments mélodiques s'enchaînent dans un perpétuel chevauchement, un peu dans la manière de la rêverie de Marguerite à la fin du troisième acte de Faust. Juliette, Roméo, l'orchestre se repassent les motifs les plus passionnés dans un ardent et incessant échange.
Puis le cri de l'alouette, l'alarme de Roméo, la réplique brûlante de Juliette : « C'est le doux rossignol, confident de l'amour ! » Page digne de Shakespeare, d'une force d'expression incomparable et toujours par les moyens les plus simples : force purement mélodique, tout en lumière. Camille Bellaigue se demande avec raison, surtout quand on songe au déchaînement de la phrase délirante d'orchestre qui clôt cette partie du duo, si le musicien de Faust « avait déployé jusqu'alors tant de force expansive, une pareille puissance de projection et d'explosion ». Les termes employés ici sont tout à fait exacts. L'amour de Roméo et de Juliette, à vrai dire, n'est pas celui de Marguerite et de Faust. Rien ne le contient : rien ne fait obstacle à ses effusions nuptiales, précisément parce qu'elles sont nuptiales. Il ne connaît ni timidité, ni remords. Et puis considérons l'âge des deux époux : ce sont deux enfants, et non plus un homme de longue expérience en présence d'une toute jeune fille ; ce sont deux enfants italiens, et ce qui est parfaitement rendu ici, c'est « la nature italienne avec ses volcans à fleur d'âme, comme dit Montégut, le traducteur de Shakespeare, et sa vie morale si prompte à se jeter en dehors du moi intime. » A côté de cela des passages de calme et pénétrante tendresse comme celui-ci : « Un jour, il sera doux à notre amour fidèle de se ressouvenir de ses tourments passés. » Délicieuse courbe mélodique !
A côté de ce merveilleux duo, l'air de Capulet : « Que l'hymne nuptial succède aux cris d'alarme », pâlit un peu. Et l'on aimerait que l'acte se terminât autrement que sur cette cavatine assez conventionnelle de Juliette buvant le narcotique que lui a versé frère Laurent. Heureusement le spectateur, à ce moment tout entier captivé par l'intérêt dramatique, n'écoute plus guère la musique.
Incontestablement l'acte final de Roméo est très supérieur à celui de Faust. La progression purement tonale de l'appel de Marguerite : « Anges purs, anges radieux » est d'un effet en somme assez faible. Le quatrième duo de Roméo est d'une composition autrement savante, autrement expressive, autrement dramatique. Ici un seul motif nouveau : « Console-toi, pauvre âme... » Mais quels admirables rappels de thèmes, liés entre eux par de si émouvants récitatifs ! C'est d'abord la phrase passionnée des violoncelles dans l'ouverture qui reparaît ici dans une nouvelle tonalité et donne naissance à un imprévu contre-chant du ténor. Puis c'est le thème du « délire d'amour » dans le précédent duo qui soutient les premières paroles de Juliette à son réveil. C'est un fragment du quatuor dans la cellule de frère Laurent, le fameux « escalier » dont chaque degré répète deux mesures identiques du chant ascendant, avec arrêt sur la note la plus aiguë dans un vibrant élan de reconnaissance au « Dieu de bonté » (souvenir du procédé employé dans le final de Faust, mais ici sous une forme plus restreinte). C'est enfin l'émouvant thème de l'alouette dont le sinistre retour annonce la fin toute proche du drame. Une dernière fois nous entendons le motif du « délire d'amour » qui amène, sans vain développement, mais dans la plénitude de l'émotion, la conclusion tragique de l'opéra par la mort des deux amants.
VOYAGE À ROME. — FAUST À L'OPÉRA
De toute la carrière dramatique de Gounod, Roméo fut le plus grand succès et l'année 1867 la plus glorieuse de sa vie.
A ce moment il y eut projet de collaboration entre Victor Hugo et Gounod. Mais ce ne fut qu'une vague intention sans suite aucune.
La Neue Zeitschrift für Musik du 26 juillet 1867 annonçait que Gounod songeait à une Françoise de Rimini, dont le premier acte se passerait dans l'Enfer et le cinquième au Ciel, et que l'auteur de Faust allait partir pour Rome afin d'y travailler à ce nouvel ouvrage. Il s'agissait sans doute de la Françoise de Rimini, dont le livret était signé des librettistes ordinaires de Gounod, Jules Barbier et Michel Carré, et qui fut mis en musique par Ambroise Thomas.
Mais autre chose se préparait.
La faillite de Carvalho avait amené la fermeture du Théâtre-Lyrique. Aussitôt, Jules Barbier et Michel Carré pressentirent Perrin, le directeur de l'Opéra, qu'ils trouvèrent tout disposé à porter Faust sur la scène de la rue Le Peletier. Mais Gounod, très reconnaissant à Carvalho de l'avoir accueilli avec empressement quand, encore assez peu connu, il cherchait à placer son Faust, avait des scrupules ; il ne voulait pas retirer son œuvre à l'homme qui avait eu foi en lui. Pour décider Gounod, Jules Barbier lui écrivit le 1er juillet 1868 la lettre suivante :
« En droit, il est bien évident que la double faillite de notre ami Carvalho (directeur de la Renaissance et du Théâtre-Lyrique) nous dégage absolument envers lui. En fait, j'aurais regret de lui porter un préjudice quelconque, mais ce n'est pas, je crois, lui porter un préjudice que de reprendre un ouvrage dont les dernières représentations se sont misérablement traînées à la salle Ventadour et qui ne peut retrouver un regain de succès et de jeunesse que dans le cadre de l'Opéra, qui lui rendra tout l'attrait de la nouveauté. Carvalho doit trop à Faust pour ne pas lui témoigner sa reconnaissance en lui rendant sa liberté, alors que Faust cesse de lui être réellement utile... Pour lui, Faust ne représente plus qu'un passé sans lendemain, pour nous, c'est tout un avenir. » Michel Carré était plus catégorique encore et s'opposait de toutes ses forces à un nouveau « massacre » de Faust à la Renaissance. Devant l'insistance de ses librettistes, Gounod finit par céder. Trois traités furent signés, le premier entre le compositeur, les deux auteurs et le directeur, consignait les accords intervenus entre les quatre signataires et spécifiait que les rôles de Marguerite et de Méphistophélès seraient joués par mademoiselle Nilsson et M. Faure, le second, entre Carvalho et Perrin, assurait à celui-ci le droit de représenter Faust moyennant remise à Carvalho d'une somme de 20.000 francs. Un troisième traité entre l'éditeur Choudens et le directeur Perrin donnait acte de la vente à Perrin, pour la somme de 3.000 francs, de tout le matériel d'orchestre (partitions et parties) nécessaire à la représentation de Faust, ainsi que d'une mise en scène manuscrite.
***
A l'occasion de son entrée au répertoire de l'Opéra, Gounod s'était engagé à écrire pour son Faust un ballet et de nouveaux couplets destinés à Méphisto, au quatrième acte.
Le ballet de Faust est un des meilleurs divertissements chorégraphiques qui aient été écrits pour la scène de l'Opéra. Il n'est point de musique plus brillante, d'un rythme plus entraînant et plus divers, mieux adaptée à sa fin qui est simplement de faire danser.
Le ballet de Faust trouve place dans le tableau de la nuit de Walpurgis. En voici l'argument.
Sur un signe de Méphistophélès, le Brocken change d'aspect, les rochers s'effondrent et découvrent les ruines d'un palais gigantesque éclairées d'une lumière fantastique. Au milieu de ces ruines se dresse une table immense qu'entourent, étendues sur de riches coussins, Cléopâtre avec ses esclaves nubiennes, Hélène avec les filles de Troie, Aspasie et Laïs dans un groupe de courtisanes.
Aspasie et Laïs, à la tête des courtisanes, se lèvent et viennent inviter Faust et Méphistophélès à prendre part au festin.
Après elles, Cléopâtre et les Nubiennes, Hélène et ses servantes entourent Faust de leurs séductions.
Les esclaves nubiennes boivent dans des coupes d'or les poisons de Cléopâtre, qui trempe elle-même ses lèvres dans la coupe où elle a fait dissoudre la plus précieuse de ses perles.
A Cléopâtre succèdent les Troyennes et Hélène, rivale de Vénus. Toilette d'Astarté.
Cette lutte de séduction est interrompue par l'apparition de Phryné entièrement voilée. Mouvement de curiosité. D'un signe elle ordonne à ses rivales de reprendre les danses un instant suspendues. Elle s'y mêle elle-même, laissant peu à peu tomber ses voiles et apparaissant enfin dans tout l'éclat d'une radieuse beauté. Son triomphe éveille autour d'elle des jalousies et des colères qui font dégénérer la fête en une bacchanale effrénée.
Les courtisanes vont retomber sur leurs coussins, épuisées et haletantes. Faust, subjugué, tend sa coupe à Phryné.
Une teinte livide se répand sur le théâtre.
Tout à coup le fantôme de Marguerite apparaît au sommet d'un rocher, dans un rayon lumineux. L'action reprend.
***
Le scénario offrait un cadre souple où le compositeur pouvait évoluer à son aise. Tout d'abord une valse fort aimable, toute gracieuse. Décidément, la valse convient au tempérament musical de Gounod : il y trouve toujours l'occasion des plus charmantes inspirations.
Puis vient un adagio langoureux, avec un premier motif largement chanté par les violons sur la quatrième corde, à plein son, auquel succède un thème rapide à l'aigu, tout de légèreté.
Le troisième morceau accompagne un ensemble chorégraphique de vive allure.
Les premiers violons prennent alors la parole pour soutenir brillamment, de leurs « coulés » parlants, suivis de leurs sextolets significatifs, puis de la course haletante de leurs croches, un solo de danse de haute virtuosité.
On ne reprochera pas à cette musique de ne point suggérer immédiatement l'idée précise d'un certain « pas » très caractérisé.
Voici maintenant la page peut-être la plus remarquable de cette suite. C'est un moderato con moto où Gounod fait preuve d'infiniment de grâce, de souplesse, de distinction dans un mouvement qui, sans être fortement rythmé, enlève cependant, entraîne, dispose de toute façon à la danse.
Puis, cette fois, sur des temps très marqués, une série de tournoiements rapides qui donnent à la ballerine l'occasion de prouver toute sa légèreté, toute sa prestesse.
Enfin, la bacchanale, d'une inspiration un peu facile dans son premier thème essoufflé, mais avec une seconde idée chantante, très agréable.
Gounod avait réussi à écrire là de quoi satisfaire les abonnés de l'Opéra, en même temps que d'excellente musique.
C'est à Morainville, chez ses amis de Beaucourt, où il s'était réfugié un peu souffrant, que Gounod composa le ballet de Faust. Après quoi, il rejoint son vieux camarade Hébert à la Tronche, près de Grenoble. Et comme celui-ci vient d'être nommé directeur de la Villa Médicis, il part avec lui pour Rome. Il emportait dans son bagage un poème d'oratorio, Sainte-Cécile, dont son ami le marquis Anatole de Ségur était l'auteur. Mais une fois en route, il se demande ce que vaut son sujet, et, arrivé à Rome, il se décida à l'abandonner. A ce propos, il écrit à Anatole de Ségur une longue lettre qui lui apporte les excuses que voici :
« Mon bien cher et excellent ami, l'homme propose et Dieu dispose, on l'a dit et on n'aura jamais fini de le dire. Depuis saint Paul, renversé persécuteur et relevé apôtre, jusqu'aux 'plus humbles projets de la détermination humaine, nous sommes tous sous le coup de ces revirements dont parlait Notre-Seigneur quand il disait à saint Pierre : Alius te cinget et ducet quô non vis. Il semble que notre chère Sainte-Cécile que j'ai emportée de Paris et que je suis venu méditer et invoquer ici, avec un si grand désir et un si doux espoir de lui consacrer une des pages de ma vie musicale, n'était pas, à présent du moins, dans les vues de la Providence sur mes travaux. La première impression que j'ai reçue à Rome et qui a persisté plus d'un mois sur deux et demi que j'y aurai passés, a été le bouleversement et l'anéantissement de tout ce que j'avais rêvé. A cet état douloureux et obscur a succédé soudain la vue claire, nette, précise et instantanée d'un tout autre travail, dont le plan, la forme et l'expression m'ont apparu avec une autorité si impérieuse, que je me suis mis immédiatement à l'œuvre et que j'ai même la témérité d'en écrire jusqu'aux paroles. Voilà certes une audacieuse tentative pour un pauvre musicien peu assoupli aux exercices littéraires, et j'aurai grand besoin de jeter sur le squelette de ma prose rimée une draperie musicale qui en dissimule la misère pour n'en laisser voir que le sens et l'intention. Je vous montrerai cela à mon retour. Nous en causerons souvent et longuement. J'espère et je ne doute pas que vous me donniez l'absolution pour avoir momentanément déserté notre chère sainte en faveur de son divin maître. J'ai le regret d'avoir péché par ignorance et d'avoir dérobé, sans profit actuel, bien des heures précieuses à votre vie si pleine et si utilement occupée. Envoyez-moi mon pardon avec de bonnes nouvelles de vous et de tendres paroles de votre si chère amitié. » Le pardon réclamé vint sans doute, mais il est à supposer qu'Anatole de Ségur ne put tout d'abord réprimer un mouvement de mauvaise humeur. On admirera la diplomatie de Gounod et l'on s'amusera de la façon délibérée dont il rapporte aux vues impérieuses de la Providence son changement de projet. La Providence, en ce cas, dirons-nous, s'il est permis de s'exprimer ainsi, a bon dos.
A ce moment, Gounod ne songe plus du tout au théâtre. Dans le calme et le recueillement de cette Rome, où il retrouve les profondes impressions religieuses de sa jeunesse, il ne pense plus qu'à cette Rédemption qu'il annonce à son ami, sans lui en donner ni le plan, ni le titre.
Rome l'a repris tout entier.
13 décembre : « Il fait aujourd'hui un temps charmant, doux comme en septembre. Ce matin, chapelle Sixtine, c'est plus beau pour moi que jamais : musique admirable, et musique de cette peinture-là. »
15 décembre : « Rome est chaque fois, chaque jour plus belle que jamais. Ce n'est plus de la surprise, de l'étonnement ; c'est quelque chose d'habituel, je dirai presque de naturel, qui vous enveloppe et vous couve, pour vous mener, par un travail insensible comme celui de toute la nature, à l'éclosion et à l'épanouissement de tout ce qu'on porte en soi. »
Gounod se laisse envelopper par le charme romain. Il ne travaille pas. Il écoute la grande voix qui lui parle tout bas. Il attend, dans le silence, qu'elle éveille l'inspiration pressentie.
Il se promène avec son ami Hébert. Il passe des après-midi chez Liszt qui lui fait entendre sa Sainte-Elisabeth et son Christus. Il admire l'intensité de l'expression mais reste un peu étonné d'audaces qui lui paraissent « au delà peut-être des limites de la sagesse du grand art ». Rencontre de deux hommes bien semblables à certains égards, quoique divers par la race et par les tendances musicales, mais semblables par la religiosité un peu vague, par le mélange des pratiques pieuses et des faiblesses de la chair, par l'ambition de composer de vastes fresques de musique sacrée qu'ils croient supérieures à tout ce qu'ils ont écrit d'autre, et par l'impuissance de leurs génies à créer des ouvrages plus sincères, plus profonds, plus originaux et plus grandioses que leurs œuvres profanes. Qui ne donnerait Sainte-Elisabeth pour la Faust Symphonie ou pour la Sonate en si ? Qui préférerait Rédemption et Mors et Vita à Faust ou à Roméo ?
Dans les derniers jours de décembre 1868, Gounod écrit : « Voilà dix-huit mois bientôt que je n'ai pas mis la plume à une œuvre ! une vraie œuvre. Voyons ce que 1869 m'apportera. »
Et le 1er janvier 1869 : « Ce matin, à 6 heures et demie, j'étais levé et commençais ma journée et mon année comme j'espère et désire achever ma vie. »
Le 2 janvier : « Ce matin, à 8 heures, j'étais à Sainte-Cécile avec un ami [Charles Gay] qui a dit la messe et à qui je l'ai servie sur l'autel derrière lequel repose le corps de la sainte... »
Et bientôt il se met à cette Rédemption qui le tient et dont il faut d'abord établir le texte littéraire : « Il était temps que je me sentisse pris par quelque chose de grand et qui me donnât la pâture dont j'ai besoin. »
Rédemption comportera trois parties divisées en 16 morceaux « dont plusieurs seront musicalement considérables... Mon poème part de la douleur et des larmes pour arriver d'époque en époque à la pleine lumière et à la joie... »
Il n'en dit pas plus long pour le moment. Il garde le secret de son œuvre.
Gounod avait passé deux mois à Rome. Il y fut profondément heureux. Son ami Hébert le défendait des importuns, ne permettait à personne de l'approcher. Pour lui seul, pour son ami Hébert, Gounod lisait les fragments du libretto de Rédemption, auquel il travaillait tous les soirs dans le silence des admirables nuits romaines. Puis il se mettait au piano et jouait, comme au temps de sa jeunesse avec des regards où brillait la flamme de l'enthousiasme, les œuvres des grands maîtres.
Quand il fallut revenir à Paris, rappelé par Perrin pour la première représentation de Faust au grand Opéra, Gounod offrit à son ami Hébert de jouer et de chanter tout ce qu'on voudrait au prochain dimanche dans le salon de l'Académie, où il n'avait pas paru une seule fois pendant tout son séjour. On pense si l'offre fut acceptée. La nouvelle s'en répandit rapidement dans Rome et au jour fixé le salon et la salle à manger du directeur étaient pleins à craquer. Gounod, toujours aimable et souriant se mit au piano, ce bon vieux piano Erard qu'il avait si souvent pratiqué, et de dix heures du soir à une heure du matin, il joua et chanta devant la foule enthousiasmée et dans une atmosphère surchauffée, irrespirable, si bien qu'on fut obligé d'ouvrir plusieurs fois les fenêtres. Il fut acclamé. On salua en lui le chef de l'école française et ce triomphe, dans une relative intimité et dans la solennité du lieu, fut doux à son cœur.
Le 16 février, Gounod quittait Rome avec le poème achevé de Rédemption.
Les 23 et 25 février il assistait aux dernières répétitions de Faust à l'Opéra. La « première » eut lieu le 3 mars 1869.
***
On a compté que, depuis sa fondation, ou, pour mieux dire, depuis les premiers essais de « l'Opéra d'Issy » (1659), notre premier théâtre lyrique avait occupé jusqu'à nos jours successivement treize salles. La salle de la rue Le Peletier fut une des plus célèbres en ce sens qu'on y créa les opéras fameux de Rossini et de Meyerbeer et qu'on y « reprit » le Faust de Gounod
... Autre souvenir : C'est là que Ludovic Halévy découvrit Madame et Monsieur Cardinal.
Mais remontons plus haut, quelque peu en arrière. En 1820 l'Opéra occupait la salle Favart. L'histoire de cette salle Favart comporte un point assez curieux : Sous le règne de Louis XVI, la Comédie-Italienne occupait encore le vénérable hôtel de Bourgogne, dans le quartier des Halles. Mais à ce moment, tout le mouvement de la vie parisienne se portait du côté des boulevards. En conséquence, dès 1780, on décida d'y transporter la Comédie-Italienne. Après bien des intrigues et des discussions, il fut décidé que le nouveau théâtre serait bâti dans une partie du jardin de M. de Choiseul et qu'il aurait sa façade sur le boulevard. Mais quand les comédiens italiens furent informés de cette décision, ce fut toute une histoire. Ils ne voulaient à aucun prix avoir leur façade sur le boulevard. Ils se seraient crus déshonorés. Ils prétendirent qu'on voulaient les assimiler aux bateleurs du boulevard du Temple. La querelle menaçait de s'envenimer. L'architecte Heurtier proposa la solution la plus simple : puisque les Italiens ne voulaient pas avoir regard sur les boulevards, ils lui tourneraient le dos et la façade donnerait, d'un petit air boudeur, sur une place ménagée tout exprès de l'autre côté. C'est cette salle Favart que l'Opéra occupa provisoirement de 1820 à 1821, en attendant que la salle de la rue Le Peletier fût prête.
C'est encore la famille de Choiseul qui fournit le terrain de ce nouveau théâtre. Elle possédait en effet un second hôtel de l'autre côté du boulevard, avec de très vastes dépendances parmi lesquelles on perça, vers 1786, la rue Le Peletier.
Louis Le Peletier, marquis de Montmellian et seigneur de Mortefontaine, était alors prévôt des marchands, c'est-à-dire ce qu'est à peu près aujourd'hui notre préfet de la Seine.
En 1820, le gouvernement décida que le nouvel Opéra serait construit dans le jardin de l'hôtel de Choiseul avec façade sur la rue Le Peletier. L'architecte Debret ne mit qu'un an à terminer les travaux. Le premier coup de pioche avait été donné en août 1820, la nouvelle salle ouvrit le lundi 16 août 1821. Elle était large de 16 mètres, profonde de 22 mètres, haute de 18 mètres, d'une ouverture de scène de 12 mètres, et contenait 1.954 places. Elle n'avait coûté que 2.287.000 francs. Mais elle n'était qu'en partie neuve. Elle était faite des morceaux du théâtre de la rue de Richelieu, qui avait été construit par le célèbre architecte Victor Louis, auteur du magnifique théâtre de Bordeaux, l'un des créateurs du style Louis XVI. La salle de la rue de Richelieu était bâtie sur l'emplacement de l'actuel square Louvois. C'était un chef-d’œuvre d'élégance et de goût. On y comptait cinq rangs de loges. Le nombre des places y était d'environ 1.650, et le parterre, grande innovation, était garni de banquettes. A ce propos, la Décade philosophique présentait les réflexions suivantes : « Ce changement était commandé par le bon sens et le respect qu'on doit au peuple. On ne conçoit pas comment, depuis la Révolution, il existait encore des théâtres où l'on eût l'insolence d'entasser des citoyens français debout, à la gêne, dans un bas-fond, le tout pour les amuser ! Au moins le public pourra-t-il écouter de la belle musique sans être au supplice, et voir de magnifiques ballets sans tendre le col. »
Donc, la salle de la rue Le Peletier était faite de pièces et de morceaux empruntés au théâtre de la rue de Richelieu. Les devantures des loges, les colonnes, l'encadrement de la scène, tout ce qui constituait la partie artistique du chef-d’œuvre de Victor Louis avait été démonté avec soin et transporté rue Le Peletier. L'ensemble était fort beau. On ne ménagea cependant pas les critiques. « Tiens, disait un passant, il n'y a que huit muses sur cette façade ; quelle est donc celle qui manque ? — Vous ne voyez pas que c'est celle de l'architecture ! » répliquait un autre.
Le Journal des Dames et des Modes décrit avec assez de détail et avec admiration le nouveau théâtre : L'aspect de l'intérieur de la salle est or et blanc aux étages inférieurs ; ensuite bleu et or jusqu'au plafond. Les corridors sont vastes ; les escaliers très beaux, les dégagements nombreux et bien entendus. Le foyer public règne sur toute la longueur de la façade ; les peintures en sont blanc mat et or, les draperies des croisées amarante et orange. Le foyer du chant et celui de la danse sont deux pièces d'une grande beauté. Dans l'un les murs paraissent sonores ; dans l'autre le plancher en pente doucement inclinée vers une superbe glace qui va jusqu'en bas est d'une élasticité parfaite. »
Le soir de l'ouverture du théâtre il faisait un temps superbe. Les promeneurs du boulevard avaient pris des sièges et s'étaient assis tranquillement auprès des dames en double rang depuis la rue du Helder jusqu'à la rue Le Peletier, en attendant l'heure de la sortie de l'Opéra. Les fenêtres, les balcons des rues Le Peletier et Grange-Batelière étaient garnis de monde comme en un jour de fête. « On remarquait des chapeaux parés en crêpe rose et en satin blanc, avec, sur le devant, un paquet de plumes d'autruche panachées et frisées. »
Habeneck fut le premier directeur du nouvel Opéra. Il ne craignit pas de dépenser 188.000 francs pour monter Aladin ou la Lampe merveilleuse de Niccolo. La représentation de cet opéra le 6 février 1822 fut bien la soirée de la Lampe merveilleuse : car la lumière du gaz y fit son apparition au théâtre. C'est l'éclipse totale et définitive des chandelles de Lully, des bougies de Rameau, des quinquets de Gluck et de la lampe d'Argant plus moderne.
Le Journal des Dames et des Modes décrivait d'avance cette étonnante innovation : l'auteur de l'article a vu le lustre chez le serrurier et il se fait « une grande idée de la surprise qu'on en éprouvera. Cent huit becs donneront issue à la flamme, laquelle au lieu de monter en ligne droite formera une tulipe. »
Ce fameux gaz, cette substance mystérieuse et magique intriguait fort les journalistes ! Ils en perdaient la tête.
Les uns se figuraient que le gaz hydrogène, qui se fabriquait alors à l'abattoir de Montmartre, serait allumé sur place et cheminerait tout enflammé dans les tuyaux souterrains pour aboutir finalement au lustre.
D'autres étaient effrayés de la façon dont se comporteraient les réverbères de la rue les jours de pluie. Ils s'étaient laissé dire que le gaz d'éclairage n'était que le feu grégeois, dont on avait retrouvé le secret, et « qu'ainsi les plus grands malheurs pourraient advenir si l'autorité permettait qu'il pût être mis en contact avec l'eau ».
Par bonheur, le Journal des Dames avait pris ses renseignements, et, fort de sa science toute fraîche, remettait les choses au point.
Chose étrange, l'éclairage au gaz n'était pas installé partout. Du côté des foyers et des loges d'artistes, il y avait, nous dit Ludovic Halévy, « de vieux couloirs délicieux, avec un tas de petits coins et recoins mal éclairés par des quinquets fumeux ». Les abonnés aimaient assez aller rôder par là.
L'Opéra de la rue Le Peletier fut en son temps le théâtre le plus glorieux de toute l'Europe. C'est lui qui donna les premières représentations du Siège de Corinthe (1826) et de Guillaume Tell (1829) de Rossini, de la Muette (1828) d'Auber, de Robert le Diable (1831), des Huguenots (1836), du Prophète (1849) de l'Africaine (1865) de Meyerbeer, de la Juive (1835) d'Halévy. On ne concevait pas alors qu'il pût y avoir de plus grand art au monde ni dans toute l'histoire de la musique. Sur la scène illustre de la rue Le Peletier le Faust de Gounod allait faire entendre un tout autre son.
L'administration de l'Opéra avait fait un gros effort pour préparer l'entrée du Faust de Gounod au répertoire de notre première scène lyrique. Les répétitions avaient duré trois ou quatre mois. Neuf décors nouveaux avaient été commandés aux plus renommés décorateurs : Despléchin, Cambon, Rubé et Chaperon. La maison Choudens avait fait graver les parties de chœurs. Aux 8.250 francs de frais habituels par représentation, la direction ajoutait 756 francs de frais supplémentaires, soit en tout 9.006 francs qui devaient laisser encore une marge suffisante pour un bénéfice appréciable.
La répétition générale eut lieu le 25 février 1869 et elle ne dura pas moins de cinq heures un quart, de 7 h. 41 à minuit 55. Ou dut prévoir des coupures et une manipulation plus rapide des décors pour les représentations suivantes. L'annonce d'une brillante mise en scène avait provoqué un tel mouvement de curiosité que M. Perrin s'était vu assaillir par des milliers de demandes venues de toutes les classes de la société parisienne et même de la province, conçues parfois dans les termes les plus extraordinaires. Philippe Gille, connu pour sa tenue débraillée, promettait, contre la remise d'un fauteuil, de faire une « toilette étonnante » ; Edouard Stoullig sollicitait une place « aussi mauvaise que possible ». Ernest Legouvé écrivait : « J'aime mieux m'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, et vous avez toujours été un si bon bon Dieu pour moi, que je remets tous nos intérêts entre vos mains. » — Et ainsi de suite.
Le rôle de Marguerite avait été « distribué » à Mlle Nilsson. Mais la cantatrice suédoise avait cru devoir s'effacer devant Mme Carvalho et, par une lettre rendue publique, elle offrit à Perrin « de restituer le rôle de Marguerite, créé par elle avec tant d'éclat, à Mme Carvalho, heureuse de pouvoir en cette circonstance, témoigner toute sa déférence pour l'admirable talent de Mme Carvalho. »
Mais l'affaire se compliqua. Mme Carvalho, engagée en mars à Monaco puis à Bruxelles, cédait d'abord la place à Mlle Nilsson, qui jouait Marguerite vingt fois de suite, laissant ensuite le rôle à sa créatrice. Les autres rôles étaient tenus par Colin, Faure, Devoyod, Mlles Mauduit et Desbordes.
« La « première » eut lieu le 3 mars, à 7 heures et demie du soir. Dans la salle on remarquait : Emile de Girardin, Castelbajac, écuyer de Napoléon III, le comte de Juigné, Niedermeyer, Duprato, Constant Coquelin, Gevaert, Jules Garnier, Ritter, le prince Bibesco, E. Bertin, Camille Doucet, Cormon, Sardou, Cham, Joncières, Barbey d'Aurevilly, Meilhac, la Taglioni, le baron Gustave de Rothschild, Delibes, Villaret, Heugel, etc.
Faust, à l'Opéra, fut un succès immense. « Mademoiselle Nilsson, écrivit Paul de Saint-Victor, a été trouvée sublime. » Les trente premières représentations firent 391.452 francs, soit le maximum, sans interruption. On joua dans les petits théâtres des parodies : Saf'aust et Marguerite ; Faust du Faust, pas trop n'en Faust ; et surtout le Petit Faust d'Hervé, un chef-d'œuvre en son genre.
Il y eut quelques auditeurs pour regretter la version du Faust avec parlé. Il y a quelques années M. Jacques Rouché a essayé de la remettre à la scène. La tentative était intéressante. Mais elle a démontré à l'évidence que la version en « grand opéra » valait infiniment mieux. Il y eut quatre représentations seulement du Faust (première version) du 22 janvier au 17 février 1932.
***
C'est au moment des premières représentations de Faust à l'Opéra de la rue Le Peletier que Gounod commença de penser sérieusement au Polyeucte, dont il avait sans doute pris la première idée lors de son dernier séjour à Rome. Jules Barbier et Michel Carré furent encore une fois ses librettistes. Gounod leur restait, depuis Faust, très fidèlement attaché. Il n'avait point tout à fait tort. Car c'étaient au moins de très habiles techniciens qui savaient bâtir un opéra en y ménageant comme il convenait toutes les sortes d'intérêts, musical, dramatique et même littéraire : ils n'abîmaient pas outre mesure les grands sujets qu'ils empruntaient à un Goethe ou à un Shakespeare : ils savaient même en conserver quelque chose de la poésie essentielle. La tâche, cette fois, était difficile, périlleuse. Il n'est point aisé de transformer une tragédie de Corneille en opéra et l'on est toujours écrasé par le souvenir tout proche d'un texte célèbre écrit dans la même langue. Et puis le sujet de Polyeucte n'est-il point bien austère pour la scène de l'Opéra, où l'on souffre malaisément de voir évoquer les mystères de la religion catholique, d'une religion qui nous est trop proche et nous est présentée sous un caractère trop positif. N'invoquons pas l'exemple de Parsifal. D'abord parce qu'il y a là en jeu le génie de Wagner, capable de tous les miracles. Et puis parce que la religion chrétienne y est présentée sous l'enveloppement de vieilles légendes moyenâgeuses qui en atténuent la trop réelle présence.
Le 19 juillet 1869 Gounod avait déjà reçu de Carré la première scène du livret de Polyeucte, qu'il trouvait charmante, avec son chœur de femmes à Phœbé et le récit du rêve de Pauline. Jusqu'en janvier 1870, Gounod travaille à son nouvel ouvrage. Le deuxième acte était déjà terminé. L'Opéra s'assurait la propriété de l'œuvre. Mais le compositeur se plaignait de ne pas avoir le travail facile. Dans les premiers mois de 1870, en effet, il subit encore une crise de fatigue nerveuse, en même temps que de mysticisme.
« J'attends, écrivait-il le 10 juin, en m'occupant de menus détails, que la porte de Polyeucte veuille bien se rouvrir. » Ce sont de bien pénibles moments que ceux où l'inspiration semble se tarir... pour un temps ? ou pour toujours ? « Mon travail me coûte les plus pénibles efforts et me casse la tête. Je me débats contre le vide, je crois faire quelque chose de passable, et puis, quand je relis, je trouve cela détestable ; ma tête se perd et se désole, je ne sais où j'en suis... Je ne vois plus clair ; je ne sais plus où je vais... Vingt fois la tristesse me prend, je pleure, je me désespère et j'ai envie de m'en aller... J'ouvre et ferme et rouvre mon cahier. Rien ! la tête vide ! Oh ! mon Dieu ! Que faire de mieux que d'accepter cette désolation du néant !... Je me croyais quelque chose ! Je ne voulais pas être petit et je suis très misérable. Je sens combien la part excessive et maladive l'emporte en moi sur le calme et l'équilibre. » Misère affreuse du génie, dans les intermittences presque inévitables de ses manifestations.
Mais l'inspiration revient et le travail va infiniment plus vite que le compositeur n'osait l'espérer. Toujours installé à Morainville, en juillet, il peut écrire à la comtesse de Ségur : « Polyeucte est terminé de tête : il faut maintenant le réaliser de plume ! » La joie emplissait de nouveau le cœur de l'artiste.
Hélas ! Les mauvais jours approchent. Le 19 juillet la guerre est déclarée. Le 8 août Devoyod, en uniforme de zouave, à l'Opéra, chantait A la frontière ! cantate de Jules Frey, musique de Gounod.
Gounod est rentré à Saint-Cloud. Il a envoyé sa famille à Varangeville, près de Dieppe. Deux fois par jour, il écrit à sa femme pour lui donner des nouvelles de la guerre.
« Le cœur en désarroi », il devient bientôt impossible à Gounod de rester seul à Saint-Cloud. Il rejoint sa femme à Varangeville chez son beau-frère Pigny. Il essaye de travailler à son Polyeucte. Mais son esprit est ailleurs. Il ne se croit d'ailleurs pas en sûreté à Varangeville. Il redoute l'invasion. Il se décide à prendre le bateau pour l'Angleterre avec les siens.
Sa belle-mère, Mme Zimmermann, avait reçu d'une amie anglaise Mrs Luisa Brown, l'offre de lui donner l'hospitalité, ainsi qu'à tous les siens, chez elle à Blackheath, près de Greenwich, au moins jusqu'à ce que Mme Zimmermann trouvât à s'installer ailleurs. Le 13 septembre, la famille Gounod débarquait à Liverpool et arrivait aussitôt à Blackbeath. Au début d'octobre elle quittait Mrs Luisa Brown et prenait domicile « 8 Morden Road, Blackheath Park, near London ». Mais bientôt Gounod juge indispensable à son travail et à ses affaires d'habiter Londres. Il s'y établit le 12 novembre.
TROIS ANNÉES À LONDRES
A Londres, Gounod se sentait accablé par les événements de France. Il écrivait à son beau-frère Pigny, demeuré à Varangeville : « Il va falloir se remettre à l'œuvre et à la vie utile, car je ne peux me laisser plus longtemps éteindre et anéantir dans une tristesse sans fin et sans fruit... Si je peux produire et vendre, je vendrai. Si je suis obligé de donner des leçons, j'en donnerai... Il faut que je me tire de cette agonie à distance qui dure depuis notre arrivée ici, et qui me submergerait comme un déluge si je n'employais pas les forces qui me restent à réagir, moi aussi, contre cette invasion de mon territoire moral. »
Il se met courageusement au travail. Il compose « un tas de mélodies, plus un grand psaume en quatre morceaux très importants avec solo, chœurs et orchestre pour des concerts sacrés... En outre, ajoute-t-il, une grande société m'a demandé des chœurs. » Les Anglais, en effet, sont très friands de musique chorale et de musique sacrée. Rappelons-nous ce que Hændel, Mendelssohn et aussi Saint-Saëns ont écrit pour eux d'oratorios, de cantates ou de simples chœurs. Ce grand psaume dont parle Gounod est un De profundis « qui lui a été suggéré par toutes les peines que notre pauvre pays a traversées ». Il fut exécuté par la Philharmonie Society dans l'un des deux concerts que Gounod fut appelé à conduire et au programme desquels figuraient en outre sa Symphonie en ré, un Saltarello qu'il venait de composer, un O Salutaris à quatre voix, tout nouvellement écrit et plusieurs airs chantés par Stanley et miss Wynne.
Gounod, dont la réputation était fortement établie à Londres, trouva facilement un éditeur : ce fut Littleton, successeur de Novello, Ewer and C°.
Pour l'Exposition internationale qui devait s'ouvrir à Londres le 1er mai 1871, on demande à Gounod s'il voudrait « représenter l'art musical français dans une œuvre qui serait exécutée publiquement dans la gigantesque et splendide salle Albert-Hall devant un auditoire de 10.000 personnes ». Gounod commença par refuser. « Je ne me sentais pas le courage de chanter sur la terre étrangère pendant que mon malheureux pays pleurait et saignait sous les coups de l'invasion allemande et les discordes de la guerre civile. » Mais on revint à la charge. Et alors Gounod se demanda s'il n'était pas au contraire « de son devoir de chercher à relever d'autant plus le nom français dans la sphère des arts qu'il était plus humilié par les revers des batailles ». Il se souvint de Jérusalem en ruines, des gémissement du prophète Jérémie et, sur les premiers versets des Lamentations, il écrivit une élégie biblique qu'il intitula, pour bien marquer l'allusion patriotique : Gallia.
La musique de Gallia, exécutée le 1er mai 1871, produisit un effet considérable.
C'est une œuvre bien oubliée aujourd'hui. Elle n'est point sans valeur, il s'en faut. Je me rappelle l'avoir entendue, dans ma jeunesse, aux Concerts Colonne avec l'admirable Gabrielle Krauss comme soliste. Elle faisait grand effet. Je viens de relire la partition. Elle m'émeut toujours. Elle débute par une page désolée d'une inspiration très haute et très large, dont le style et la couleur annoncent le Saint-Saëns des meilleurs jours, sur le texte latin : « Quomodo sedet sola civitas plena populo... » que Gounod a ainsi traduit : « La voilà, seule, vide, la cité reine des cités !... Ses enfants pleurent nuit et jour dans ses murs désolés ! Reine, flambeau du monde ! Aujourd'hui délaissée. »
Puis vient une cantilène pour soprano solo et chœur : « Ses tribus plaintives à ses temples saints ne viennent plus chanter leurs cantiques... » d'un mouvement plus dramatique.
Ensuite un chœur avec solo de soprano : « O mes frères, qui passez sur la route, voyez mes pleurs, ma misère » d'un bel accent plaintif.
Enfin une dernière page : « Jérusalem, reviens vers le Seigneur Dieu ! » d'un vif élan enflammé qui soulevait infailliblement l'enthousiasme du public.
En somme une œuvre digne à la fois de son auteur et du sujet traité. Une œuvre qui fut appréciée par la presse anglaise dans les termes les plus exaltés. On comparait Gounod à Hændel, peut-être dans l'espoir que, comme l'auteur du Messie, il se fixerait en Angleterre, et, comme lui, se ferait naturaliser anglais. On affectait de le traiter en compatriote. Il y eut même là de la part des journaux anglais une exagération maladroite qui, en France, fit quelque tort à Gounod. A Paris, le Gaulois releva certaines expressions des panégyriques dont le compositeur avait été l'objet à Londres et y trouva l'occasion de réflexions assez cruelles pour l'auteur de Gallia. Un autre journal de Paris, l'Evénement, inséra un article moins dur, mais encore assez blessant dans lequel il était constaté que le musicien de Faust n'était plus un Français pratiquant. Gounod riposta par une lettre au Gaulois, qu'il mit ce journal en demeure d'insérer.
En réalité, Gounod se trouvait dans une situation fausse, d'autant plus fausse qu'il s'était laissé entraîner dans une aventure sentimentale qui menaçait d'absorber toute sa vie, qui fit grand bruit dans toute l'Europe et dont il faut bien que nous contions les principaux épisodes.
***
Le dimanche 26 février 1871, il y avait réception à Londres chez le critique réputé Jules Bénédict. Gounod était au nombre des invités. La réunion touchait à sa fin lorsque parurent Mr et Mrs Weldon. Louis Pagnerre, qui a écrit une des premières biographies de Gounod (1890), décrit ainsi le couple : « L'homme, grand et vigoureux, réalisait le type accompli du gentleman anglais. On l'appelait le Capitaine. La femme était d'une beauté étrange : figurez-vous, sur un corps de femme imposant, une tête de jeune fille, encadrée par une luxuriante chevelure blonde. De grands yeux doux et intelligents. La bouche est petite, mais bien arquée. Une main blanche et aristocratique, une main d'enfant !... Bref, cette femme-là n'est pas seulement une jolie femme, c'est quelqu'un ! A l'aspect agréable et féminin se joint je ne sais quoi de passionné et de vindicatif. »
On avait demandé à Gounod de se faire entendre. Il se met au piano, et de sa voix délicieusement expressive, il chante quelques-unes de ses mélodies. Peut-être son regard, charmé par la beauté de Mrs Weldon, lui adressa-t-il l'intention d'un discret hommage. Toujours est-il que la jeune femme fond en larmes, et son trouble va presque jusqu'à la crise de nerfs. Jamais Gounod n'avait souvenir d'avoir fait telle impression sur un cœur féminin.
Deux jours après, nouvelle rencontre en apparence fortuite, en réalité savamment préparée par Mrs Weldon. Gounod était allé entendre une répétition de la Société Chorale dirigée par Mr. H. Leslie. Mrs Weldon était précisément en train de chanter la partie de soprano solo dans la belle composition de Mendelssohn : « Hear my prayer. » « Je fus frappé, affirme Gounod, de la pureté de sa voix, de la sûreté de sa méthode, de la noble simplicité de son style, et je pus me convaincre que Bénédict ne m'en avait pas trop dit sur son remarquable talent de cantatrice. » Quelque illusion favorable sans doute, dans cette appréciation. Mrs Weldon ne possédait qu'un assez médiocre talent.
Le lendemain, Mrs Weldon venait « de la part d'un M. Rimmel, parfumeur français établi à Londres, demander à Gounod de se faire entendre dans un concert donné au bénéfice des blessés français » où elle devait chanter.
« Peu de jours après, poursuit Gounod, Mrs Weldon et son mari quittèrent Londres pour aller passer un mois dans le nord du Pays de Galles. A leur retour à Londres, ils vinrent nous voir, et c'est alors que s'établirent entre eux et moi des relations qui devaient me faire rencontrer en eux de si fidèles et si courageux amis. » Ces lignes étaient écrites alors que la passion de Gounod pour Mrs Weldon battait son plein. Car c'était une terrible passion qui prenait alors naissance dans le cœur du musicien et allait bientôt le ravager.
Mrs Georgina Weldon, Écossaise par sa mère, Galloise par son père, était née Trehern, au Pays de Galles, le 24 mai 1837. Quand son aventure avec Gounod prit fin, elle publia, pour se justifier de toutes les accusations qui pesaient sur elle un interminable plaidoyer intitulé Mon orphelinat et Gounod en Angleterre et qui se compose de trois volumes : 1. L'Amitié. II. Les affaires. III. Lettres de M. Gounod et autres lettres et Documents originaux.
On y lit tout d'abord ces lignes : « J'avais été très bien élevée, je n'avais jamais lu le moindre roman, je parlais et j'écrivais l'anglais, le français, l'allemand et l'italien, je jouais du piano, je dessinais, mais, avec tout cela, j'étais une vraie enfant, une vraie gamine. » C'était une musicienne passionnée, une âme exaltée et même encline au mysticisme : elle le prétendait du moins. Mais son culte de l'idéal n'excluait nullement le sens pratique de la vie, nous nous en apercevrons bientôt.
Le 21 avril 1860, Miss Georgina Trehern épousait William Henry Weldon, jeune officier de hussards. Elle menait dès lors une vie mondaine coupée de quelques séjours solitaires au Pays de Galles ou à l'île d'Anglesey et de voyages au Canada, où elle avait donné en 1861 des concerts, — en Suisse et en France. D'abord cantatrice amateur, Mrs Weldon avait été amenée peu à peu à se produire en public et à donner des leçons de chant. L'année même où Gounod débarquait en Angleterre, elle avait résolu de fonder un orphelinat où elle voulait recueillir des enfants pauvres pour leur enseigner la musique.
Il est certain que Mrs Weldon fit tout, dès qu'elle connut l'arrivée de Gounod à Londres, pour engager une entreprise sentimentale dans laquelle elle vit surtout une excellente affaire. Elle cherchait un président pour son orphelinat. Il était maintenant tout trouvé : ce serait l'illustre compositeur Gounod. Mais il fallait l'amener à accepter d'entrer dans cette ingénieuse combinaison.
Pour établir son orphelinat, Mrs Weldon avait loué une grande maison de Tavistock square, Tavistock House, autrefois habitée par Dickens, entourée de jardins et de beaux arbres. Mrs Weldon avait signé le bail de location le 3 décembre 1870.
Le 12 mai, elle entrait en possession de Tavistock House, et le même jour Mme Zimmermann et Gounod lui rendaient visite. Mme Gounod avait promis d'amener sa fille Jeanne. Mais elle ne vint pas. Sans doute avait-elle déjà un mauvais pressentiment.
Le 21 mai, Mme Gounod quittait Londres avec sa fille ; son mari, son fils et Mme Zimmermann devaient la rejoindre un mois plus tard.
Mais déjà Gounod était décidé à rester à Londres.
Bientôt il laissait repartir en France son fils et Mme Zimmermann et il acceptait l'hospitalité de Mrs Weldon à Tavistock House, où il devait passer trois années.
Sous le patronage du maître, l'orphelinat ne pouvait manquer de devenir florissant. Le pauvre Gounod, à proprement parler sous le « charme » de l'adroite ensorceleuse, ne s'aperçoit pas du piètre rôle, du rôle ridicule qu'on lui fait jouer.
Tristes événements, qu'on a peine à raconter.
Au mois de juin 1871, la mort d'Auber rend vacante la place de directeur du Conservatoire de Paris. Thiers fait proposer cette succession à Gounod. On pense bien qu'il ne fut pas laissé libre d'accepter. Mrs Weldon n'était pas disposée à lâcher si facilement sa proie.
Dès lors, Tavistock House devient le lieu des plus brillantes manifestations musicales de Londres. Chaque soir, grande réception. Le matin et l'après-midi, travail. Car le grand homme n'était pas maître de son temps. Il fallait qu'il produisît assez abondamment pour suffire à la soif de son insatiable Egérie. Il était vraiment séquestré. Mrs Weldon faisait argent de son génie, de ses œuvres, de sa gloire, de tout ce qui en lui représentait une valeur marchande. Elle l'entraînait à de mesquines discussions d'intérêt avec ses éditeurs qui le mettaient bientôt à l'index de toute la corporation.
Le 3 juillet, Gounod part pour Paris. Il a des affaires à traiter. Mrs Weldon s'est mis en tête de chanter devant un public français. Elle ne songe à rien moins qu'à créer le rôle de Pauline à l'Opéra dans le Polyeucte de Gounod. A cet égard, les pourparlers avec Halanzier n'aboutissent pas. On le comprend sans peine. Alors Gounod s'adresse à la Société des Concerts du Conservatoire et obtient que Gallia sera donnée à l'automne avec Mrs Weldon comme soliste. L'exécution eut lieu le 29 octobre 1871. L'accueil que le public parisien fit à la cantatrice fut courtois, sans plus. Mais ç'avait été une grande émotion pour tous les Parisiens de retrouver leur cher Gounod qu'ils étaient désolés de ne pouvoir garder. Ils déploraient cette maudite chaîne qui l'attachait ailleurs.
Un mois plus tard l'Opéra-Comique consentait à mettre Gallia en scène dans un décor de palmiers, devant des choristes en costumes bibliques. Georgina Weldon apparut sous de longs voiles qui lui seyaient assez bien. Mais la démarche était gauche, malgré tous les conseils, toutes les leçons de maintien (en même temps que de chant) que lui avait prodigués le maître. Gallia était précédée d'un ouvrage du répertoire, Fra Diavolo, ou le Domino Noir, et terminait la soirée, jusque-là joyeuse, par des impressions qui parurent bien austères à un public frivole. Gallia disparut de l'affiche après trois ou quatre représentations.
C'était beaucoup de fatigue et d'émotion pour Gounod. De retour à Londres, il tomba sérieusement malade. Mrs Weldon et son mari lui prodiguèrent des soins, sans doute quelque peu intéressés. On souhaitait que le musicien pût reprendre au plus vite son travail abandonné. En attendant on tenait, jour par jour, le public londonien au courant des moindres détails de l'état de l'illustre malade : la publicité allait son train.
Gounod, heureux de justifier son retour à Londres, accusait Paris, « ce Paris que je ne peux plus empêcher de me tuer, et contre lequel je ne suis plus en état de me défendre... Songez donc à ce qu'est Paris pour moi ? Plus mes forces diminuent, plus ses exigences augmentent... Paris ne peut pas entendre raison, il est fait de manière à dévorer ses enfants : par nature il est un gouffre, une fournaise, un tombeau. »
La rentrée de Gounod à Tavistock House avait été lamentable : « Il s'est abattu comme un oiseau blessé, écrit Mrs Weldon : il s'est blotti dans son lit comme une bête malade pendant plusieurs jours sans vouloir le quitter. Il était venu [à Londres] pour trois semaines et il prenait du repos à foison. Il devait retourner [à Paris] pour la Noël ; de plus, il était très désireux de retourner voter à l'Institut pour Ernest Reyer... »
Le médecin déclara Gounod plus sérieusement malade que ne le pensait Mrs Weldon. Il lui ordonna les bains turcs au Hammam, « où tout, écrit Gounod, s'accomplit comme un mystère, avec un sérieux tout à fait théologique ». Il suivit le traitement pendant un mois. Il allait mieux, mais restait très fatigué. Le docteur Blanche vint le voir et put constater que son état n'était pas tout à fait satisfaisant.
Désireux, comme un enfant, d'être entouré de tous les soins auxquels il était habitué, il avait l'inconscience de réclamer sa femme auprès de lui. Comme Barbier s'étonnait de cet interminable séjour en Angleterre, il lui répondait : « Mon cher ami, il y a des mots qui n'ont pas deux sens. L'Angleterre ne m'enlève ni à mes amis, ni à mes œuvres, ni à mon pays. Mon éloignement actuel de France, tu le sais, et tu es obligé de le croire parce que je te l'ai dit, est dû à mon état de santé uniquement et non du tout à des sentiments dont le mobile puisse échapper à tes appréciations. Il ne peut être question ici d'apprécier, mais de constater, et je ne peux pas accepter de toi ni de personne que ce soit là un sujet délicat sur lequel on ne puisse pas s'expliquer. »
MM. Prodhomme et Dandelot, qui citent cette lettre à Barbier, ajoutent que dans une longue lettre, de deux jours postérieure (15 mars 1872), « Gounod s'expliquait sur ses affaires : sans ses amis, il perdait 2.500 francs chez Novello ; sur ses travaux, dix-huit morceaux, psaumes, mélodies qu'il venait de composer, parmi lesquels un Te Deum, vingt-cinq chœurs harmonisés ; sur ses collaborations, ses amitiés, sa vie : « Je serais mort et enterré sans les soins incomparables que Dieu m'a prodigués par eux [Mr. et « Mrs Weldon]. »
Gounod se leurrait lui-même en écrivant des lignes comme celles-ci : « Je remplis mes devoirs avec conscience et avec tout ce qui me reste de force. Je travaille pour ma famille, je fais tout au monde pour me mettre en état de retourner un jour chez moi, et ce serait une joie véritable pour mes amis, Mr. et Mrs Weldon, de m'y savoir rentré et heureux. Je travaille pour mon art, auquel je tâche de laisser des œuvres qui fassent honneur au nom français que je porte et, par conséquent, à mon pays. »
Le 23 avril 1872, il écrivait encore, cette fois à madame de Ségur : « Je serais ad patres, à l'heure qu'il est, sans la maison que j'habite et sans les chefs-d’œuvre de tendresse, de dévouement et de charité qui m'ont ouvert leurs bras et prodigué leur cœur et leurs soins. Vous savez si je tiens à ce que mes amis sachent ce que valent mes amis : c'est bien le moins pour me consoler des mécomptes douloureux et cruels que j'aie eus à souffrir à ce sujet et qui ont usé mes forces et flétri ma vie dans ma propre maison... Je travaille immensément, et je n'en éprouve ni peine, ni fatigue, parce que je vis dans mon élément, qui me porte. »
En réalité, Gounod ne retrouvait toujours pas ses forces, dont il abusait. Au mois d'avril 1872 son fils vint pour quelques jours auprès de lui. Et Gounod réclamait toujours sa femme : « Tu viendras me rechercher ici et, après moi, tu rendras à ces admirables amis, dont tu pouvais connaître, apprécier et t'approprier le trésor, le témoignage tardif mais nécessaire que tu regretteras de ne pas avoir rendu plus tôt ».
Cependant, Gounod composait la musique de scène pour les Deux Reines, drame en quatre actes d'Ernest Legouvé, et il chargeait le jeune compositeur Paladilhe, gendre de Legouvé, de surveiller les répétitions à la salle Ventadour. La première représentation eut lieu le 27 novembre. La musique de Gounod reçut un accueil chaleureux. Mais elle ne devait pas survivre au succès éphémère de la pièce de Legouvé.
Gounod travaillait toujours avec des alternatives de bonne et mauvaise santé. Il recevait la visite de son collaborateur et ami Jules Barbier, qui écrivait à madame Gounod d'attendre avec patience que le temps fît son œuvre et ramenât son mari à des pensées plus saines. Il disait la foi absolue, enthousiaste, presque mystique de Gounod dans ses nouveaux amis et concluait : « Vous êtes sur la terre, on est dans le ciel et l'on ne peut comprendre que vous n'y veniez pas. »
Pour comprendre l'état d'esprit de Gounod, il faut se rendre compte que le grand musicien n'était pas précisément un sensuel, mais surtout un sentimental imaginatif, disposé à toutes les exaltations les plus effrénées. Il souffrait certainement d'être séparé de sa femme, mais ne pouvait supporter un seul instant la pensée de se détacher de Mrs Weldon.
Gounod vivait au milieu de préoccupations de toutes sortes. Le voici avec un procès sur les bras. L'éditeur Littleton s'était en effet jugé offensé par une lettre dans laquelle Gounod parlait « d'éditeurs qui font siffler les artistes chantant ses œuvres ». Naturellement, il s'agissait de Mrs Weldon, laquelle « déclara devant la cour du Banc de la Reine qu'elle était l'auteur de la lettre incriminée ». Néanmoins Gounod fut « condamné à 40 shillings d'amende et aux dépens, soit 118 livres sterling ». Il refusa de se soumettre et préféra la prison. « C'est le 28 que j'entre dans mon couvent, écrivait Gounod aux Ségur... Je vais orchestrer en prison la prison de Polyeucte et ma messe des anges gardiens. » Mais Littleton comprit le ridicule de ses poursuites et déclara avoir été désintéressé intégralement : ce qui est peut-être vrai ; Mrs Weldon prétend en effet que Mme Zimmermann avait versé à Littleton les 3.000 francs requis. Littleton laissait donc Gounod en paix. Mais le pauvre musicien avait souffert profondément de toute cette histoire, comme de bien d'autres ennuis que nous ne contons pas, notamment de ses perpétuels démêlés avec les éditeurs anglais.
Cependant, Gounod avait terminé une nouvelle musique de scène, celle qu'il destinait à la Jeanne d'Arc de Jules Barbier.
Le 4 novembre, Mrs Weldon note : « La S. Charles, je suis partie pour Paris, laissant mon mari avec le Vieux [entendez : Gounod]. Gounod ne voulait pas venir à Paris pour les représentations de Jeanne d'Arc, mais il désirait de tout son cœur que nous y allions afin de pouvoir lui faire le rapport fidèle de la façon dont l'affaire se passerait. »
« L'affaire » ne se passa pas trop bien. La critique se montra peu bienveillante. Elle reprochait à Gounod de se répéter, de s'imiter soi-même, de ne se renouveler en aucune façon. On ne donnait guère d'éloges qu'à deux des quinze morceaux de la partition : la Marche funèbre d'une marionnette, utilisée dans le ballet et le Chœur des soldats dans la prison avec le contraste fort heureux du Duo des Saintes apparaissant à Jeanne d'Arc.
Gounod, malgré ses malaises continuels, travaillait toujours. Attiré de nouveau par Molière, il commençait un George Dandin sur le texte en prose original. Il écrivait à ce propos à Mrs Weldon, alors à Margate : « C'est quelquefois difficile de donner à la prose une construction musicale qui ait de la symétrie et de la régularité rythmique. J'ai fait depuis ton départ un autre duo (celui entre Lubin et G. Dandin au 2e acte) et un trio entre George Dandin, M. et madame de Sottenville ; les ensemble, en prose, sont souvent difficiles ; mais je les tiens pour ces deux morceaux-là... C'est aujourd'hui le 26 février ; ce soir, à 11 heures, il y aura trois ans que je t'ai vue pour la première fois. — Trois ans ! — Déjà ! et d'un autre côté, il me semble qu'il y a toute une vie que je te connais. »
L'opéra en prose ! Gounod précurseur d'Alfred Bruneau ! Quel malheur que ce George Dandin n'ait jamais été achevé. Nous en possédons du moins la Préface. Gounod s'y explique sur son dessein. Il se félicite de tenter cette innovation, — innovation du moins au théâtre. « Car, remarque-t-il, il y a de nombreux oratorios qui ont été écrits sur de la prose soit latine, soit allemande, soit anglaise. » Et il cite les noms de Bach, de Hændel, de Mendelssohn. Il ne se dissimule point les difficultés de la tâche. « Toute la question est de découvrir dans l'ensemble d'une période (soit monologue, soit dialogue) les subdivisions qui comportent la symétrie de la période musicale ; cette ordonnance une fois trouvée, le seul élément qui ait disparu est la rime. » Mais cet élément n'est pas, au point de vue musical, de si grande importance. Et il faut voir aussi les avantages : « La variété indéfinie des périodes, en prose, ouvre devant le musicien un horizon tout neuf qui le délivre de la monotonie et de l'uniformité. » Sans compter que l'usage de la prose entraîne « des formes d'accompagnement plus concertantes, plus symphoniques ».
***
Mais de nouveau Gounod ne se sentait pas bien. Surmené, souffrant d'insomnies continuelles, il accepta avec joie l'invitation de Mrs Luisa Brown qui lui offrait de passer quelques jours dans sa maison de Blackheath. Une fois arrivé, il fut pris de toutes sortes de malaises, dont plusieurs évanouissements qui effrayèrent Mrs Brown à ce point qu'elle n'hésita pas à télégraphier à Morainville l'état de son hôte et sa vive inquiétude. Aussitôt arrivaient M. de Beaucourt et le docteur Blanche qui, opérant un véritable « enlèvement », ramenaient leur ami en France. Ainsi se terminait brusquement une lamentable aventure qui menaçait si gravement les intérêts artistiques, la santé et peut-être la vie même du malheureux compositeur.
Gounod n'était pas encore détaché de Mrs Weldon. Il croyait seulement leur liaison « interrompue ». Mais peu à peu la lumière se fit dans son esprit. Il aperçut dans quel abîme il était tombé et qu'il fallait se remettre sur pied. Il se tourna vers sa femme. Il implora son pardon. Il écrivait : « Il s'agit de préparer l'avenir et de relever autant que possible tant de choses en ruines. Espérons que la restauration dépassera l'édifice primitif. Si Dieu me prête vie, je n'aurai pas souffert en vain. »
Voyant dans son ultime délivrance le signe d'une faveur particulière de la Providence, il écrivait encore à une amie : « Dieu est prodigieux. Rien ne saurait décrire ce qui se passe en moi. Etre ce que Dieu me fait, voir ce qu'il me montre, entendre ce qu'il me dit, pénétrer les choses incertaines et cachées de sa Sagesse, être introduit dans ses desseins inscrutables comme je le suis à cette heure ; après cinquante-six ans d'une existence qui présente un des exemples les plus éclatants, les plus irrécusables, je dirai les plus populaires de la faiblesse et l'irrésolution, faire tout à coup au plus intime de soi-même, l'expérience de la force tranquille et de la paix invincible, c'est manifestement être le sujet d'un miracle. Je vous envoie la bonne et chère nouvelle afin que vous glorifiiez Dieu, vous qui m'avez tant obtenu de cette grâce insigne par vos ferventes prières. Vous direz avec moi le Magnificat pour remercier celui qui « a fait en moi de grandes choses ». Je n'ai pas besoin de vous en dire plus long. Il me suffit de vous mener haut, pour vous prouver les joies que vous méritez et que je veux vous donner parce que ce sont celles des saints. Le démon que vous savez est aux abois. Mais elle est encore de ce monde ; donc un miracle peut encore la sauver. Ah ! que je surabonde de joie en Jésus au milieu de mes tribulations ! »
Toutes les lettres de cette époque sont du même ton, débordantes de reconnaissance envers Dieu, véritables « actes de foi, d'espérance et d'amour ».
« Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai appris et compris depuis trois mois... de ce que m'ont (sic) appris et donné de vérité l'expiation de ces trois à jamais inqualifiables années... »
Mais les « tribulations » ne sont pas terminées. Le « démon » a retenu en « otage » en Angleterre la partition de Polyeucte. Gounod s'impose la tâche de la récrire par cœur tout entière.
Mrs Weldon manifestait ainsi sa fureur d'avoir été jouée. Elle trouva mille façons de se venger : par des poursuites judiciaires et des pamphlets, des procès et des condamnations pécuniaires « qui finirent par rendre impossible à Gounod, sous peine de saisie », l'accès du Royaume-Uni.
Rien n'y fait. Gounod est tout à la joie, profonde et grave, d'avoir retrouvé la vie familiale, l'affection des siens, la voie du Bien et de la Vérité.
Vers la Toussaint de 1874, il réintégrait à Paris sa demeure de la rue de La Rochefoucauld. La réconciliation avec sa femme était chose faite.
Dans tous les théâtres, dans tous les concerts, on fêtait son retour. Faust triomphait dans la salle Ventadour, adoptée pour les représentations de l'Opéra après l'incendie de la salle de la rue Le Peletier, en attendant l'achèvement du monument Garnier. La Patti succédait dans le rôle de Marguerite à Mme Carvalho et à la Nilsson. On reprenait Mireille à l'Opéra-Comique. Charles Lamoureux, qui venait de fonder l'Harmonie sacrée, faisait entendre Gallia au Cirque d'été.
CINQ-MARS. — MAÎTRE PIERRE. — POLYEUCTE. — LE TRIBUT DE ZAMORA
Un grand événement se préparait à Paris. Les esprits en étaient tout agités. On annonçait l'ouverture prochaine de la nouvelle salle de l'Opéra du boulevard des Capucines.
La construction en avait été déclarée d'utilité publique le 29 septembre 1860. Cent soixante-dix projets avaient été présentés au concours ouvert à cette occasion. Le jury ne décerna point de prix et dans la distribution des « primes d'encouragement » Charles Garnier n'obtint que le dernier rang. Un second concours fut ouvert et le nouveau projet de Charles Garnier fut couronné à l'unanimité.
Pour faire place au nouvel Opéra, « on avait créé à coups de pioches un grand espace entre les rues Basses-du-Rempart, de la Chaussée-d'Antin, Neuve-des-Mathurins, et le passage Sandrié ». Par un curieux hasard il se trouvait que la salle et une partie de la scène du futur Opéra devaient occuper exactement l'emplacement du théâtre que la Guimard avait fait construire, cent ans auparavant, dans son hôtel de la Chaussée-d'Antin.
Les terrassements commencèrent en juillet 1861.
Mais bientôt le travail se compliqua. On découvrit en effet une nappe d'eau souterraine qu'il fallut épuiser avec des pompes à vapeur. L'incident était à prévoir : car le quartier de la Chaussée-d'Antin est bâti sur un marais entretenu par le voisinage du ruisseau de Ménilmontant, qui coule sous la rue de Provence, après avoir passé à la Grange-Batelière.
La première pierre du monument fut posée le 13 janvier 1862.
L'Opéra de Paris est un des plus grands et des plus luxueux théâtres du monde. Il a 172 mètres de long, 101 mètres de large, 79 mètres de hauteur depuis le fond du troisième dessous jusqu'à la lyre de l'Apollon d'Aimé Millet, qui couronne le pignon de la scène. Le volume total de l'édifice représente environ treize fois celui de l'Opéra de Berlin. Il forme une sorte de « salon » d'art permanent où sont exposées les œuvres de 105 artistes (13 peintres, 73 sculpteurs et 19 ornemanistes).
Le nombre des places est de 2.156. La longueur des tuyaux pour la conduite des eaux d'environ 7 kilomètres. Celle des cordages de la machinerie était à l'origine de 235.800 mètres. Soit à peu près la distance de Paris à Caen.
L'ouverture de la nouvelle salle se fit le mardi 5 janvier 1875. Le programme se composait des deux premiers actes de la Juive avec Gabrielle Krauss (dont c'était le début), Villaret et Belval ; de la Bénédiction des Poignards des Huguenots et du premier tableau du deuxième acte de la Source (le ballet de Léo Delibes), avec, en plus, l'ouverture de la Muette et celle de Guillaume Tell, de sorte que les noms alors illustres d'Halévy, de Meyerbeer, d'Auber et de Rossini, sans compter celui moins réputé de Léo Delibes se trouvaient réunis sur l'affiche. Il y manquait celui de Gounod. On devait, il est vrai, chanter la scène de l'église de Faust (dans un décor de Guillaume Tell !) avec Nilsson et Gailhard. Mais, soit caprice, soit indisposition réelle, la cantatrice se refusa à paraître et l'on supprima de l'affiche le fragment de Faust.
Les fauteuils d'orchestre, pour ce soir-là, se vendirent couramment, dans le commerce des marchands de billets, 1.000 francs.
Il n'est pas sans intérêt de rapporter certaines impressions d'un spectateur de cette mémorable soirée. Il insiste sur la question des « qualités acoustiques » du nouvel Opéra. « Il n'y a pas à le nier, dit-il, les conditions de l'ancienne salle ne se retrouvent pas dans la nouvelle, où l'orchestre, et particulièrement le quintette à cordes, donne des sons plus mats. Par contre, les voix s'y font entendre avec une netteté extraordinaire. Etant donné le chapelet de notes formant le discours mélodique, chacune de ces notes arrive à l'oreille sans garder le plus faible écho de celle qui l'a précédée. Quand le son a cessé d'être émis, il a cessé d'être entendu. D'où il résulte que le spectateur ne perd pas une syllabe du texte : particularité remarquable et qui forcera peut-être les librettistes à surveiller leur français, leurs rimes, et toutes autres choses de leur métier avec lesquelles ils en prenaient à leur aise quand ils étaient sûrs de l'impunité. Il est certain qu'aujourd'hui M. de Jouy ne se risquerait plus à faire dire à Gessler, répondant au peuple qui lui demande la grâce de Guillaume Tell :
Et leur horrible faim lui répond d'un tombeau !
Voyez comment Gessler pardonne :
Aux reptiles je l'abandonne,
Dans la salle, ce soir du 5 janvier, mêlés aux officiels, dont l'ex-roi de Hanovre et l'ex-reine Isabelle et Alphonse XII son fils, toutes les personnalités les plus en vue, et, parmi les hommes de lettres et les critiques musicaux : Théodore de Banville, Gustave Bertrand, Blaze de Bury, Jules Claretie, Oscar Comettant, Escudier, Armand Gouzien, Adolphe Julien, Lavoix, Marcelin, A. Pougin, Reyer, de la Rounat, Paul de Saint-Victor, J. Weber, etc.
« Il y a foule dans les coulisses, surtout au moment où défile la procession de la Juive ; et c'est un spectacle à troubler l'entendement que celui des abonnés et des invités en habit noir se mêlant aux beaux seigneurs de l'an 1414, à tous ces moines encapuchonnés, à ces hommes d'armes, à ces valets, à ces pages, à ces cardinaux que commande l'empereur Sigismond du haut de son cheval de parade. »
La représentation fut des plus remarquables, malgré la froideur d'invités un peu guindés dans leur rôle officiel. Elle s'acheva vers minuit et demi. De notre témoin déjà cité cette notation : « On a pu compter comme un cinquième acte le défilé de la foule dans le pompeux escalier de l'Opéra. Et pourtant les costumes y paraissaient étriqués et médiocres. Le lord-maire et sa suite brillante formaient un groupe qui était seul en harmonie avec cet éblouissant décor de marbre et d'onyx qu'inondait par surcroît une lumière d'apothéose. »
Il conclut : « C'est à ce moment que 200 ou 300 personnes qui stationnaient sur la place et que la curiosité affolait, se sont ruées sur les portes de l'Opéra. La force armée a eu beaucoup de peine à leur barrer le passage. Alors, refoulées, elles se sont dédommagées par le spectacle du cortège de M. le Président de la République, composé de voitures de gala auxquelles faisaient escorte 200 cuirassiers armés de torches. »
***
Le nom de Gounod ne parut sur l'affiche du nouvel Opéra que le 30 mai 1875. C'était une soirée de gala au profit de l'œuvre des pupilles de la guerre. Le troisième acte de Faust fut joué (toujours dans un décor de Guillaume Tell) par Vergnet, Manoury et les chœurs, puis la scène de la prison et le trio final par madame Carvalho, Vergnet et Gailhard. Après quoi en entendit encore de Gounod un Memorare du Soldat pour voix de basse et chœur d'hommes et l'Hymne à Sainte-Cécile avec Remenyi comme violoniste. Enfin madame Carvalho chanta l'Ave Maria, accompagnée par tous les premiers violons de l'orchestre.
Dès les premiers beaux jours, Gounod partait pour Dieppe, où il s'installait pour passer l'été. Le 5 juin, il revenait à Paris pour assister aux obsèques de son jeune ami Georges Bizet, mort l'avant-veille. Après le service à la Trinité, au cimetière Montmartre il prit la parole après Jules Barbier et du Locle. Il ne put dire que quelques mots, l'émotion lui brisait la voix.
Le 10 juin, faisant allusion à son retour d'Angleterre, il écrivait à Mme de Ségur : « J'ai bien fêté le 8 juin, qui est à la fois le jour de la naissance de Jean et l'anniversaire de mon passage de la mer Rouge. »
En septembre, il revenait à Paris pour la reprise de Faust au nouvel Opéra. C'était la 480e représentation de cet ouvrage à Paris. Elle eut lieu le 6 septembre. Les interprètes étaient Vergnet, Gailhard et Manoury. Vergnet, bon chanteur, mais médiocre comédien ; Gailhard, voix magnifique, jolie tête, taille un peu petite pour le rôle, et surtout interprétation sans relief ; Manoury convenable Valentin. Mme Carvalho remportait son habituel triomphe dans le rôle de Marguerite « qui est bien sa propriété car elle l'avait créé et y reste inimitable, écrit son biographe E. A. Spoll. Elle le chanta avec un art merveilleux et une habileté consommée ». Mlle Daram reprenait le rôle de Siebel, qu'elle avait tenu au Théâtre-Lyrique et où elle se montrait tout à fait charmante. Le chœur des soldats eut son succès accoutumé avec l'accompagnement d'une musique militaire « heureusement rétablie ». Les décors signés Cambon, Daran, Lavastre, Despléchin, Rubé et Chaperon, furent estimés assez agréablement réussis, sauf le décor du jardin « d'un vert un peu trop criard ».
Et voici une heureuse surprise. Quelques jours après la reprise de Faust, Oscar Comettant remettait à Gounod le manuscrit de Polyeucte, un cahier de notes relatives à Rédemption, un fragment de la Messe instrumentale, la partition inachevée de George Dandin et le livret de Polyeucte, retenus depuis un an en Angleterre par Mrs Weldon. Les négociations avaient été laborieuses. L'ambassade de France à Londres s'en était mêlée. En dix mois Gounod avait récrit de mémoire toute sa partition de Polyeucte : effort considérable dont il ressentait une terrible fatigue. Il commençait à prendre le repos absolu auquel il s'était condamné près de son ami Charles Gay, l'un des artisans de sa délivrance, quand Oscar Comettant lui fit savoir quel « colis précieux » il avait reçu. En octobre, dès son retour à Paris, Gounod vint tout joyeux en prendre possession, mais au moment de quitter Comettant il fit un faux pas et « alla tomber lourdement l'épaule gauche sur l'escalier à droite du perron. Le choc fut d'une violence extrême. L'épaule se désarticula, quelques muscles furent déchirés et l'humérus subit un écrasement ». Le docteur Péan, immédiatement appelé, donna ses soins. Gounod se remit assez vite et au début de novembre, il rentrait rue de La Rochefoucauld.
Le 29 novembre Gounod applaudissait Gabrielle Krauss dans donna Anna de Don Juan, où elle était admirable (j'ai pu encore en juger quelques années plus tard) et il la désignait pour créer Pauline dans son prochain Polyeucte.
Le 16 mai, reprise de Philémon et Baucis, en deux actes à l'Opéra-Comique, reprise qui donna lieu aux réflexions suivantes que nous lisons dans les Annales du Théâtre et de la Musique de Stoullig : « Cette première soirée est un triomphe pour Gounod... Mais, ainsi que le fait fort bien remarquer M. Adolphe Jullien, cet ouvrage vaut surtout par la grâce des idées mélodiques, par le charme des détails, par les harmonies ingénieuses et la distinction parfois un peu cherchée. » Il ne faudrait cependant pas ne goûter en art que l'improvisation. La recherche peut avoir les plus heureux effets et stimuler l'inspiration et aboutir aux trouvailles les plus savoureuses. C'est bien le cas pour Gounod quand il écrit Philémon. Mais je continue la citation : « Or, dit notre auteur, ces qualités de forme et de style, cette instrumentation ciselée [mon Dieu ! comme en ce temps-là on avait peur de tout ce qui révélait l'application dans le travail de l'artiste, le souci bien légitime cependant du beau métier !] ne suffisent pas à faire vivre au théâtre une composition où, à proprement parler, il n'y a pas de pièce [quelle exagération !] partant nul intérêt ; où la musique toute jolie qu'elle fût, devait nécessairement manquer de chaleur, d'élan passionné, surtout de variété dans les couleurs ou l'accent, et paraître monotone à la longue... Ainsi s'explique l'échec de cet ouvrage à l'origine, et sa mise à l'écart pendant seize ans. Ainsi s'explique la courte durée de la reprise actuelle, intéressante cependant pour les esprits délicats, enclins à la douce rêverie, mais peu attrayante pour le grand public. » Que voilà bien des lignes qui révèlent au mieux l'état d'esprit d'une époque ! Ainsi on ne peut admettre au théâtre que la musique écrite sur des pièces essentiellement dramatiques. On se refuse à faire une place sur une scène lyrique, à un simple conte, à une simple fable, même disposé convenablement pour l'effet scénique. Sans musique, Musset se fait pourtant accepter avec des fantaisies tellement éloignées de la formule courante du théâtre classique. La musique, c'est-à-dire le langage, par essence, du rêve ne saurait-elle donc faire d'autant mieux admettre des ouvrages de nature analogue ? Nous avons connu plus tard des publics qui se plaisaient à la représentation de Philémon et qui en assuraient le succès prolongé. Et nous souhaitons la prochaine reprise de cette œuvre si proprement délicieuse.
***
En 1837, Meyerbeer avait accepté d'écrire la musique d'un Cinq-Mars d'après le roman d'Alfred de Vigny sur un livret de Saint-Georges. Mais il renonça bientôt à ce projet, qui ne reçut qu'un commencement de réalisation.
M. de Saint-Georges offrit à Gounod la succession de Meyerbeer. Gounod n'accepta point. On se demande pourquoi il consentit plus tard à mettre en musique le poème de Paul Poirson sur le même sujet, poème bien médiocre et qui donna lieu à une partition que Gounod eut le tort d'écrire un peu vite, — en six mois. Carvalho dépensa, dit-on, cent mille francs pour monter l'œuvre nouvelle à l'Opéra-Comique. La première représentation eut lieu le 5 avril 1877. Il est curieux de constater que le public se montra d'une extraordinaire indulgence pour le nouvel ouvrage de Gounod, un des moins intéressants, un des moins vivants, un des moins inspirés qu'il ait produits. On jugeait évidemment le compositeur sur sa réputation acquise, sur son passé et on apportait à l'applaudir toute la ferveur d'une longue admiration et d'une inlassable sympathie.
« Cette première-là, écrivait le « Monsieur de l'Orchestre » du Figaro, peut compter parmi les plus belles de l'année. Les illustrations de toute sorte garnissaient la salle de bas en haut. J'ai vu un académicien, M. Legouvé, aux secondes loges et un gommeux des plus connus à la troisième galerie. M. Halanzier est dans une loge. M. Pereire, que je n'ai jamais rencontré à aucune première, est dans une avant-scène avec sa famille. Je crois que tous les compositeurs de Paris ont trouvé le moyen de se caser dans la salle, les grands, les moyens et les petits ; les uns, bien en vue, au balcon ; les autres, effacés, sur de malheureux strapontins. Les amateurs de musique aussi sont au grand complet. On se raconte que la partition de Cinq-Mars a été achetée cent mille francs par M. Grus, un millionnaire qui est éditeur par vocation et amour de l'art. La somme est rondelette. Il est vrai que la popularité de M. Gounod à l'étranger est si grande que, dès maintenant, M. Grus a vendu son édition trente-trois mille francs en Allemagne. »
Le soir de la « première » le succès fut considérable. Le lendemain une partie de la presse se montra bienveillante. Reyer, Oscar Comettant, Heugel écrivaient des articles véritablement enthousiastes. Blaze de Bury était moins bien disposé : « Il semble que ce talent ingénieux à l'excès, habile à toutes les adaptations, cet esprit travaillé de curiosité et velléités sans nombre, ait enfin marqué sa limite. Cette fois au moins son sujet ne dépassait pas sa puissance... La musique de M. Gounod est à son aise dans cette action toute romanesque et dont les figures héroïques, si l'on veut, ne s'élevaient point jusqu'au type. » Il aggravait ses premières appréciations par les remarques suivantes : « Au premier acte, nous avons eu le duo des adieux, comme dans la Lucia ; au second la conjuration et le bal, comme dans les Huguenots ; au troisième, voici la Partie de chasse de Henri IV, en attendant la prison du Trovatore au quatrième. Impossible d'imaginer, en fait de poncif, quelque chose de mieux réussi, de plus complet. » Adolphe Jullien est dur : « Voilà en somme dix ans que l'auteur de Roméo n'a produit un opéra, et il faut avoir entendu Cinq-Mars pour discerner quel travail de désagrégation s'est produit dans le style de M. Gounod, chez qui la mélodie et l'orchestration allaient autrefois si bien d'accord et auquel on pouvait reprocher plutôt trop de recherche et de fini dans les détails. Non seulement sa pensée se meut aujourd'hui dans un cercle très restreint de formules qui le rejettent constamment sur des œuvres antérieures, mais sa phrase musicale, aussi bien au chant qu'à l'orchestre, est essentiellement formée des mêmes unissons auxquels il a eu déjà cent fois recours. » Adolphe Jullien avait raison. La nouvelle partition ne valait pas grand'chose. Même dans la fameuse cantilène qui eut alors tant de vogue, Gounod n'apportait rien de nouveau. On sentait qu'il avait encore une fois voulu faire « du Gounod ».
N'insistons pas et passons sur cet ouvrage manqué qui ne mérite pas qu'on s'arrête plus longtemps à le considérer.
Au cours des représentations de Cinq-Mars il y eut entre le chef d'orchestre Charles Lamoureux et le directeur Carvalho, des discussions assez vives. Lamoureux était un admirable chef d'orchestre, mais il avait très mauvais caractère. Déjà, pendant les répétitions de Philémon, trois mois auparavant, les deux hommes avaient été sur le point de se brouiller définitivement. La réconciliation n'avait jamais été complète. Un nouvel incident se produisit dans l'après-midi du 3 mai, à la dernière répétition de Bathyle, opéra-comique en un acte de W. Chaumet, qui devait être représenté le lendemain. Lamoureux voulait faire reprendre un passage dont ses instrumentistes ne lui paraissaient pas assez sûrs. Carvalho s'y oppose formellement. Lamoureux résiste. Carvalho maintient son refus. Alors Lamoureux déclare qu'il donne sa démission. (A la bonne heure !) Elle est immédiatement acceptée. Il est seulement convenu que Lamoureux restera à son poste tant qu'il ne lui aura pas été trouvé un successeur. Mais, le soir même, après le premier acte de Cinq-Mars, Lamoureux quitte brusquement le pupitre, comptant sur Vaillard, son deuxième chef, pour le remplacer. Carvalho profite de l'occasion pour demander à Gounod de prendre immédiatement la direction de son ouvrage. Gounod accepte avec empressement. Il aimait conduire lui-même ses œuvres. Il le faisait d'autant plus volontiers que sa présence au pupitre faisait toujours monter la recette et par conséquent ses droits. Son apparition est longuement applaudie. Du 3 mai au 21 mai Gounod continue à diriger l'orchestre. Il est ensuite remplacé par Vaillard. Cinq-Mars se donne devant de fort belles salles. Plus de 3.000 exemplaires de la partition ont été enlevés chez l'éditeur. Cinq-Mars disparaîtra de l'affiche avec la fermeture du théâtre, mais reparaîtra au mois de novembre avec de nouveaux morceaux ajoutés par Gounod : une ouverture plus développée, un air pour de Thou et un final dramatique ajouté à la chasse du troisième acte. Cinq-Mars ne méritait vraiment pas cette vogue.
Gounod avait promis à l'Opéra-Comique un nouvel ouvrage dont le poème, tiré d'une ancienne pièce de Scribe, serait comme pour Cinq-Mars, de Paul Poirson et Louis Gallet. Gounod voulut tenir sa promesse et il songea à une Charlotte Corday, d'après Ponsard, sinon d'après Scribe.
Mais « l'Ange de l'assassinat » est bientôt délaissé. « Feu de paille, conte M. Croze, que cet amour de Gounod pour la vierge cornélienne... Il accourt un matin chez Gallet : « Avez-vous lu les lettres d'Héloïse ? quelle merveille ! Sa passion pour Abailard : voilà notre opéra. — Et Fulbert ? dit le librettiste. — On peut s'en passer. — Il est bien temps ! » Et les deux amis de rire, puis de causer. Le drame prend corps ; on en exclut les démêlés du héros avec la... censure et Gounod en examine tout le côté philosophique et religieux. Son âme d'ancien séminariste ressuscite. Il vante les idées d'Abailard, voulant, comme ce dernier, mettre d'accord la raison et la foi. Il envoie même à son collaborateur le commencement d'un air :
O Raison, puissance sublime,
Sœur immortelle de la foi !
Telle fut l'origine de Maître Pierre, opéra en cinq actes, qui ne fut jamais terminé, mais qui occupera Gounod l'année suivante. »
***
Singulier sujet que Maître Pierre. Il faut rappeler ici la curieuse existence d'Abailard et l'extraordinaire passion qui le lia toute sa vie, malgré les circonstances les plus diverses, à cette femme d'un caractère étrange qu'est Héloïse, pour expliquer comment Gounod put songer à prendre ce couple extraordinaire pour héros et héroïne d'un opéra.
Abailard, né en 1079 au Pallet (ou Palais) près de Nantes, appartenait à une famille noble et il semblait qu'il fût destiné par sa naissance au métier des armes. Mais l'amour des lettres, qu'avait développé en lui son père, lui fit prendre une direction différente. Il parcourut plusieurs provinces, allant d'école en école pour se perfectionner dans la philosophie jusqu'à ce qu'il arrivât à Paris où il devint bientôt le rival et le vainqueur des maîtres les plus fameux. Il « régna » dans la dialectique. Quand il se mit à enseigner la théologie en même temps que la philosophie, il attira de toutes les parties de l'Europe une telle foule de disciples que, selon son mot, « les hôtelleries ne suffisaient plus à les contenir, ni la terre à les nourrir ». Avec cela, il était beau, il était poète, il était musicien ; il faisait en langue vulgaire des chansons qui amusaient les écoliers. Il fut presque martyr de ses opinions philosophiques. Il fut martyr en tout cas dans sa chair par la vengeance d'une brute.
Ses opinions ? Quelles étaient donc ces opinions dangereuses qui assurent la pérennité de sa renommée ? Il s'agit ici surtout de la grande querelle des universaux qui agita tout le moyen âge. Pour comprendre la signification de cette dispute fameuse il faut remonter jusqu'à Platon et son disciple et adversaire Aristote. Voilà qui enchantait Gounod. N'oublions pas que Platon était avant tout géomètre. Or il avait remarqué que toutes les réalités de ce monde ont une figure et que toute figure, si complexe qu'elle soit, se ramène, si on la décompose, aux figures simples de la géométrie. Bien plus, ces figures, ces formes simples, ces « idées » suivant le langage de Platon, gouvernent le monde et sont l'essence des choses. Elles les précèdent. Avant qu'il n'y eût au monde aucun objet triangulaire, la nature du triangle existait déjà, puisqu'il était déjà vrai que la somme des angles de tout triangle quel qu'il fût, serait toujours égal à deux angles droits. Les « idées » (les « idées universelles ou universaux » diront les scolastiques) sont donc la substance même de la réalité. Ce sont les premières réalités. Et il n'y a pas que les « idées géométriques ». L'idée de l'homme par exemple existe avant aucun homme particulier et c'est sur le modèle de cette idée et à son imitation que les hommes divers sont faits. Saint Anselme reprend ainsi la théorie de Platon, en la modifiant quelque peu, et sa doctrine prend le nom de réalisme, puisque, contrairement à l'opinion vulgaire, les idées ou les « universaux » sont des réalités et les premières réalités (universum ante res) (*).
Cette opinion paraît insoutenable à bien des esprits et notamment Roscelin, chanoine de Compiègne vers 1090, affirme que les individus sont seuls des réalités. Les idées universelles, les universaux ne sont rien, lien que des noms, des mots, des « souffles de la voix » (flatus vocis). D'où le titre de nominalisme donné à cette nouvelle doctrine selon laquelle les idées ne sont qu'après les choses (universum post res) comme des étiquettes uniquement propres à un classement méthodique. Et cette opinion amenait Roscelin à penser qu'en Dieu les trois personnes, comme trois individus, sont seules réelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Dieu trinitaire en qui, selon l'Église, elles s'unissent, n'est qu'un mot. Grande hardiesse condamnée comme une hérésie par le concile de Soissons.
(*) Le réalisme du moyen âge s'appellerait aujourd'hui idéalisme.
Guillaume de Champeaux, reprend alors la doctrine de saint Anselme, le réalisme, et la pousse à ses dernières conséquences.
C'est maintenant qu'intervient Abailard, comme une sorte de conciliateur. Pour lui, les idées ne sont ni avant ni après les choses ; elles sont dans les choses (universum in rebus) dont elles constituent les caractères ou les qualités ; et elles sont en même temps dans l'esprit, dont elles forment les conceptions, d'où le titre de conceptualisme donné à cette troisième doctrine. En conséquence, Abailard soutient que dans la Divinité les trois personnes ne sont que trois attributs, trois caractères d'une réalité unique. Nouvelle hérésie, hérésie de l'unicité de la personne divine opposée à celle des trois dieux de Roscelin. Et aussi, et surtout peut-être, Abailard, humanisant la métaphysique, prétend soumettre les dogmes de la Religion aux règles de la Raison. De loin et sans le vouloir, il est l'ancêtre de la pensée libre et c'est pourquoi Michelet en fait un précurseur de la Révolution.
Mais ce ne sont pas surtout ces pensées, si belles, si magnifiques soient-elles, qui ont rendu Abailard célèbre et son nom presque populaire. C'est l'extraordinaire aventure dont il fut le héros et aussi la victime.
A l'époque où Abailard occupait la chaire de l'Ecole épiscopale de Paris, il y avait une petite jeune fille de dix-huit ans qui venait d'arriver du couvent chez le chanoine Fulbert, du chapitre de Sainte-Marie. Elle habitait chez lui dans une petite maison entourée d'un jardin contre l'enclos de l'église cathédrale. Sa naissance était enveloppée d'obscurité. On la disait fille d'un prêtre, peut-être de ce chanoine Fulbert, qui se disait son oncle. Elle était belle, fière et « sage » ; ce qui veut dire dans le langage du temps, surtout savante. Elle était attirée par toutes les choses de l'intelligence. Elle écrivait en latin et même en vers latins. Elle sut du grec et même de l'hébreu. Elle s'appelait Héloïse.
Abailard avait alors 38 ans, et il enthousiasmait toute la jeunesse des écoles par sa hardiesse et sou éloquence. Il était aux yeux de cette jeunesse « l'Avenir », l'avenir de l'Esprit dans son mystérieux développement.
Héloïse eut bien vite fait d'apprendre de quelle haute réputation jouissait Abailard. Elle voulut suivre ses cours.
Et alors commence la lamentable histoire.
Héloïse, assiste, extasiée, aux leçons publiques d'Abailard. La pensée, la parole, la beauté du maître la captivent. Sous prétexte de lui demander des éclaircissements sur un de ses propos, elle lui écrit. Cet appel, sans le vouloir paraître, déjà passionné, éveille chez Abailard un sentiment que jusqu'alors il avait ignoré. Il se laisse aller à la douceur d'aimer, ou plutôt, ce Celte fougueux entre avec fureur dans l'entreprise dangereuse de séduire la jeune fille. Pour réaliser un dessein tout de suite fermement conçu, il emploiera la ruse. Il demande à Fulbert de le prendre chez lui en pension. Ainsi il se trouvera continuellement auprès d'Héloïse. Fulbert a toute confiance en son hôte, ne voit en lui que l'éminent dialecticien dont les conseils, les instructions pourront être si profitables à sa nièce. Et peu à peu, allant de la leçon de philosophie à la leçon d'amour, Abailard arrive à ses fins. Mais à la longue Fulbert finit par s'alarmer. S'il avait été imprudent !... Or, un jour, il surprend les deux amants dans l'ivresse de leurs transports. Aussitôt, cet homme violent entre dans une rage épouvantable. Il chasse Abailard et ne songe plus qu'à trouver le moyen de se venger d'avoir été ainsi joué, trahi, de la façon la plus ridicule et la plus déshonorante. Quant aux deux coupables, ils sont plaints par la jeunesse des écoles d'avoir été découverts. On s'entremet pour faire parvenir les lettres qu'ils s'adressent mutuellement, pour favoriser leurs rendez-vous secrets.
Mais la situation ne peut se prolonger. Une nuit, Abailard aide Héloïse à fuir la maison de son oncle puis il l'envoie au Palais, chez sa sœur Denise, à qui il la confie. Le voyage de plus de cent lieues, elle le fait à dos de mule, installée sur un petit siège à dossier. Or, elle était enceinte.
Le départ d'Héloïse redouble la colère de Fulbert. Mais Abailard vient calmer le bonhomme. Il veut, dit-il, réparer le mal qu'il a fait. Il demande à Fulbert la main de sa nièce. (Mariage secret, dans sa pensée, bien entendu, car il est ambitieux, il songe à la mitre, peut-être à la tiare.) Il va chercher au Palais Héloïse. Cependant, l'enfant est né. Il s'appellera Astrolabe (tombé des astres). Il restera au Palais, aux bons soins de Denise. Héloïse et Abailard reprennent
le chemin de Paris, où, dans la vieille église de Saint-Denis-du-Pas, la bénédiction nuptiale leur est donnée de grand matin. Cependant, ils ne vivront pas ensemble. Héloïse demeure de nouveau chez son oncle et elle ne voit Abailard que clandestinement. Fulbert n'est Point apaisé par un mariage qu'il ne voulait pas secret. Un jour, dans un accès de colère, il roue de coups sa nièce. Celle-ci s'échappe et retourne au couvent où elle fut élevée, au monastère des Bénédictines d'Argenteuil. Une fois ou deux par semaine, maître Pierre vient l'y visiter. La prieure, d'un esprit assez libre, leur ménage des tête-à-tête, et, au moment où la cloche sonne la prière, les deux époux n'hésitent pas à « violer la sainteté de l'asile inviolable ».
Un jour, Fulbert, qui avait fini par découvrir la retraite où s'était réfugiée sa nièce, voulut l'en ramener. Il se présenta au monastère. Mais la prieure, toujours dévouée aux intérêts de la jeune femme, le chassa du parloir. Dernière humiliation que Fulbert ressentit cruellement. Mais cette fois, il avait trouvé sa vengeance : la castration d'Abailard, et il la prit férocement, avec l'aide de trois infâmes sacripants.
Abailard subit la terrible épreuve avec une constance héroïque. Il en rendit grâce à Dieu qui le délivrait ainsi du péché et y vit un signe de la bienveillance divine. Son amour pour Héloïse n'en fut pas diminué. Mais il prit un autre caractère et devint tout spirituel et ne s'adressa plus qu'à l'âme délicieuse de celle qu'il devait racheter de la faute si grave où il l'avait entraînée.
Héloïse supporta le malheur de son époux et sa propre infortune d'un cœur moins patient. Elle commença par un mouvement de révolte et en voulut à Dieu. Elle s'en accusa plus tard quand elle revint, sous l'influence d'Abailard, à d'autres sentiments, à l'acceptation du sacrifice en pleine mansuétude. Elle s'éleva peu à peu dès lors à la presque parfaite sérénité et finit sur la volonté d'Abailard, et sans vocation, par entrer dans les ordres. Ce n'était pas une âme religieuse. C'était presque une pure intellectuelle ; sa seule religion, c'était son amour incorruptible pour Abailard.
Nous savons tout cela par les lettres qu'échangèrent les deux époux et aussi par l'Historia Calamitatum qu'écrivit Abailard.
« Je ne dois rien attendre de Dieu, dit Héloïse, n'ayant rien fait pour l'amour de lui. »
« Ne trouverez-vous donc point de charme, réplique Abailard, dans l'idée de nous acheminer ensemble, sans être plus jamais désunis, vers les divines félicités qui nous sont promises. »
Ils vivent séparés, chacun à la tête d'un monastère, et au milieu de toutes sortes de dramatiques événements que je renonce à rapporter.
Héloïse devint veuve d'Abailard à 43 ans et lui survécut vingt longues années avec le souvenir toujours présent de son époux disparu. Elle était alors abbesse du Paraclet. Lorsqu'elle mourut à son tour, le dimanche 16 mai 1164, « elle fut enterrée, selon son vœu, dans la même crypte qu'Abailard, et dans le même cercueil, sa place y étant demeurée vacante, selon la Chronique de Tours, qui relate ce fait miraculeux : « Lorsque la morte fut apportée à cette tombe qu'on venait d'ouvrir, son mari, qui, bien des jours avant elle, avait cessé de vivre, éleva les bras pour la recevoir et les ferma en la tenant embrassée. (*) »
(*) John Charpentier. Héloïse, amante d'Abailard.
Emouvante histoire qui pouvait tenter un artiste comme Gounod, et à plusieurs titres. D'abord tout le côté philosophique et religieux du sujet l'attire. « Il vantait les idées d'Abailard, nous dit Croze, et approuvait son dessein de mettre d'accord la raison avec la foi. » Il avait déjà composé sur ce thème un chant large et puissant d'une sereine confiance. Et puis cet invisible lien qui attache Héloïse à son époux, dans les circonstances où il devenait d'autant plus méritoire de lui rester fidèle, était une bien belle chose dont le cœur sensible de Gounod fut touché. Mais comment présenter au public la navrante disgrâce dont fut atteint Abailard et sans laquelle le drame n'existe plus ? Ce fut certainement là l'obstacle qui l'arrêta, qui le fit renoncer à un projet tentant et généreux, — ou plutôt qui arrêta le directeur Halanzier, car, pour sa part, Gounod aurait passé outre. Nous le voyons par les deux lettres que C. M. Croze cite dans le Supplément du Figaro du 27 mars 1909 :
28 août 1878. Lettre de Gounod à Louis Gallet.
« On m'a offert la lecture d'un ouvrage en quatre actes dont les auteurs m'ont affirmé qu'Halanzier voulait faire son ouvrage en quatre actes de l'hiver 1879-1880. Cette résolution d'Halanzier prouve qu'il n'était pas en disposition de jouer Abailard et c'est ce dont j'ai pu me convaincre par la frayeur que lui-même m'a avouée d'assumer devant le public de l'Opéra la responsabilité d'un pareil sujet... J'espère que vous resterez comme moi fidèle à notre œuvre et à notre amicale collaboration. »
Gallet comprit mal et se figura que Gounod lui proposait une nouvelle collaboration. Alors Gounod précisa :
« Saint-Cloud, 30 août 1878,
Cher ami,
Assurément, la joie de m'appuyer sur votre pur et poétique langage eût bien adouci pour moi la véritable peine de dire adieu pour un an à notre cher projet de Maître Pierre. Mais, hélas ! vous étiez mal renseigné. La pièce de d'Ennery et Brésil (le Tribut de Zamora) m'a été lue toute faite, depuis le premier vers jusqu'au dernier. Et, dans ces conditions, un troisième collaborateur ne me paraît guère possible. C'est Brésil qui a fait les vers de la pièce... Ah ! dame ! ce n'est pas vous, ni Augier, ni Barbier, mais enfin c'est fait ! et j'y modifierai bien des choses. J'en ai même déjà arrangé plusieurs et fait des coupures. Le sujet est beau et coloré. MAIS NOUS ACHÈVERONS MAÎTRE PIERRE. Et quelqu'un le jouera, je ne sais qui, mais il n'importe : il sera joué quelque part. »
Cependant, trois ans plus tard, le 31 août 1881, Gounod écrivait de Morainville à Louis Gallet : « Oui, sans doute j'ai Maître Pierre toujours à cœur, mais vous savez sans destination au théâtre. J'en voudrais faire une « suite » de scènes dramatiques purement et simplement... Nous travaillerons à cela cet hiver. »
Jusqu'à la fin de ses jours, Gounod pensa à Maître Pierre. Il y travaillait par moments. En 1904, onze ans après sa mort, Mme Gounod en communiqua le manuscrit à Saint-Saëns en lui demandant s'il voulait se charger de compléter l'ouvrage inachevé. Saint-Saëns estima qu'il valait mieux laisser l'œuvre telle qu'elle était et se borna à écrire deux ou trois récits pour relier entre eux les morceaux sans liaison. La partition fut alors confiée à M. Reynaldo Hahn, qui en fit la réduction pour piano.
Le dimanche 26 mars 1939, M. Reynaldo Hahn dirigeait lui-même aux Concerts Colonne l'admirable dernier tableau qui fit une profonde impression. C'est du grand Gounod. Héloïse est retirée au couvent du Paraclet après la mort d'Abailard. Elle médite douloureusement. Soudain, en une vision surnaturelle, lui apparaît l'image de celui qu'elle a tant aimé. Un dialogue mystique s'engage, d'un sentiment très élevé. Pages austères mais en même temps frémissantes de tendresse que Mme Germaine Lubin et M. Endrèze ont rendues avec une grande émotion.
***
Arrive 1878, l'année de l'Exposition. Gounod se rappelle le succès continu de Roméo et Juliette durant l'Exposition de 1867. Il espère le même sort pour Polyeucte en 1878. Il y avait longtemps qu'on parlait de ce nouvel opéra et qu'on en annonçait la prochaine représentation. Mais, cette fois, le directeur Halanzier n'avait point hâte d'engager les grandes dépenses qu'exigeait la mise à la scène de la nouvelle pièce. Durant toute l'Exposition le théâtre de l'Opéra réalisait le maximum en affichant n'importe quel ouvrage du répertoire. On venait voir la salle, le grand escalier, le foyer. On ne s'occupait guère de ce qui se jouait et se chantait en scène. « Ce sera toujours très bien », disait-on.
Cependant, les rôles de Polyeucte étaient distribués à Salomon, Lassalle, Menu, Couturier et Gabrielle Krauss ; les répétitions commençaient. Après deux mois de « travaux forcés », dit Gounod, « de répétitions, de coupures, de ressemelages et becquets de toutes sortes » la première représentation était annoncée pour le 7 octobre. Elle eut lieu devant une très brillante assemblée : tous les hauts personnages du milieu parisien étaient présents. On s'attendait à un grand succès. Les morceaux sur lesquels on comptait le plus, comme la marche triomphale du premier acte, et le final du baptême, au second, ne produisirent aucun effet. Seule Gabrielle Krauss recueillit d'unanimes applaudissements. Elle jouait Pauline « en tragédienne admirable de geste, d'attitude, d'expression, donnant de la valeur à la moindre phrase musicale, et disant avec le baryton Lassalle, de manière à le faire bisser, le joli duo du second acte : Soyez généreux, qui rappelle le premier duo de Mireille... Quant à l'orchestration, elle était aussi simple que possible : rien que des blanches et des rondes, des tenues continuelles où tous les instruments jouaient à l'unisson : « J'ai voulu « faire une fresque » avait dit Gounod. »
Ainsi s'exprime un témoin de cette « première », Stoullig, dans ses précieuses Annales du Théâtre et de la Musique. Il continue : « On remarquait aussi le début d'une jeune danseuse espagnole, Mlle Rosita Mauri, une Vénus blonde (?) qui a dansé avec une rare légèreté la mazurka du troisième acte. Une mazurka en l'an 300 !... »
Le quatrième et le cinquième acte parurent déplacés au théâtre. « Trop de messes ! » disait-on.
Le ténor Salomon ne pouvant supporter le poids de son rôle écrasant, fut doublé, à partir de la quatrième représentation, par un jeune chanteur, Sellier, qui alterna avec lui. Mais ni Sellier, ni Gabrielle Krauss, quels que fussent leurs mérites, d'ailleurs très divers, ne purent sauver la pièce, qui disparut de l'affiche à la vingt-cinquième représentation. Sellier avait une énorme voix qu'il maniait assez gauchement : ce n'était pas du tout un musicien, ni un artiste. Mais enfin le volume exceptionnel de sa voix impressionnait le public. Il faisait cependant bien piètre figure en face de l'incomparable interprète qu'était Gabrielle Krauss.
La critique s'était montrée aussi favorable que possible à Gounod. Elle rejetait la cause de l'échec sur le livret. Selon Blaze de Bury Polyeucte n'était « ni un opéra ni un oratorio ». Cet ouvrage hybride ne pouvait se supporter au théâtre. C'était la thèse que soutenaient presque taus les journalistes au lendemain de la « première ». Ils n'admettaient point sur la scène cette « œuvre d'art apostolique » suivant le mot de Gounod lui-même.
Camille Bellaigue a exactement dit ce qu'il faut penser en définitive de Polyeucte lorsqu'il a écrit : « Sans être, il s'en faut, un chef-d'œuvre, ni le chef-d’œuvre de Gounod, ni même l'élevure qu'un tel sujet, antique et chrétien, amoureux et sacré, lui pouvait inspirer, Polyeucte a de belles parties. » Seulement je ne suis pas toujours d'accord avec Camille Bellaigue sur celles des parties qu'il faut admirer le plus. C'est ainsi que notre maître critique considère le rôle de Sévère comme le plus faible de toute la partition. Or, c'est justement celui que je préfère. J'aime beaucoup la cavatine du premier acte, d'une belle écriture harmonique, avec même des hardiesses savoureuses. Le duo de Pauline et de Sévère renferme des passages excellents : je vous abandonne la fin, d'un style « militaire » un peu déplacé en cette occasion. Mais que de répliques touchantes au cours des récitatifs. Et la seconde cantilène de Sévère est d'une ligne mélodique bien jolie. Tout cela ne vaut pas, évidemment, l'invocation de Pauline à Vesta, qui est la perle de la partition, du Gluck plus féminin, plus tendre, du Gluck à la fois et du Mozart et ce n'est point faire tort à ces deux grands noms que de les citer ici. La faute de Gounod c'est de n'avoir pas touché le fond du drame qui se joue dans les cœurs de Pauline et de Polyeucte. Le personnage de Polyeucte est particulièrement pâle dans cet opéra qui n'exprime qu'une religiosité vague et ne nous transmet rien de la foi ardente dont Corneille s'est montré le si éloquent interprète. C'est encore, comme toujours, dans les parties profanes de son œuvre que le croyant, le fervent chrétien qu'était Gounod, trouve les accents les plus persuasifs. Il y a là une sorte d'antinomie sur laquelle nous avons déjà insisté et dont nous avons essayé de rendre raison. Nous n'y reviendrons pas de nouveau. Le chœur nocturne des femmes au début, le petit chœur du festin, la voluptueuse barcarolle de Sextus sont autant de pages exquises. Saint-Saëns raconte que le premier fragment de l'opéra que lui fit entendre Gounod fut justement cette barcarolle. « Mais, lui dis-je, si vous entourez le paganisme de telles séductions, quelle figure fera près de lui le christianisme ? — Je ne puis pourtant pas lui ôter ses armes », répondit-il avec un regard dans lequel il y avait des visions de nymphes et de déesses. »
Camille Bellaigue défend certaines pages « chrétiennes » de la partition : la longue scène du baptême, certains « élans » de Polyeucte, la « lecture de l'Evangile » que fait Polyeucte à Pauline dans sa prison. Je ne suis guère touché que du récit de l'enfance de Jésus-Christ aux sons d'un gracieux Noël. La voix du récitant psalmodie sur une seule note et un frêle hautbois l'accompagne. « Alors, dit justement Camille Bellaigue, ce que n'avaient su faire encore trois actes d'opéra : poser l'antithèse historique et morale qui résume et partage un tel sujet, voici que, pour l'accomplir, il suffit d'une humble ritournelle, et le paganisme, et Rome, et tout le vieux monde s'écroule, au souffle d'un pipeau de berger. » Le tort de Gounod est de chercher presque toujours les effets de masse et de puissance alors qu'il réussit bien mieux par des moyens tout simples, naïfs et sincères.
***
L'échec de Polyeucte attrista Gounod mais ne le découragea point : « Je suis désarçonné, dit-il, il s'agit maintenant de remonter à cheval. » Il travaillait alors au Tribut de Zamora sur le livret de d'Ennery et Brésil. Ce nouvel ouvrage eut pour interprètes Gabrielle Krauss, Sellier, Lassalle, Melchissédec, Giraudet. La première représentation se donna le 1er avril 1881. Le « Monsieur de l'Orchestre », du Figaro, la conte ainsi : « Huit heures dix minutes, Gounod fait son entrée et vient se placer debout au pupitre de chef d'orchestre. Les scènes que j'ai déjà racontées, il y a un an, se renouvellent. On fait au maître français les mêmes ovations qu'au maître italien [Verdi]. Gounod paraît fort ému. Il avait tenu à conduire l'orchestre. Il a toujours soutenu, par la parole et par la plume, que les musiciens avaient le droit et le devoir de diriger eux-mêmes l'exécution de leurs œuvres... Salle splendide. Est-il besoin de le dire ? Dans la grande avant-scène du gouvernement, M. Grévy et sa famille, et, sur le théâtre, dans la loge de la direction, M. Gambetta... Une personne fort remarquée à l'amphithéâtre : Mme Georgina Weldon. Robe noire, aumônière garnie d'argent, grand col en point de Venise, les cheveux coupés ras et, sur la poitrine, une énorme médaille de mérite. »
On fit fête au compositeur chef d'orchestre et à sa principale interprète Gabrielle Krauss, que l'on comparait à Rachel et à la Malibran. Sellier et Lassalle furent aussi très applaudis. Mais personne ne se faisait illusion sur la faiblesse du dernier grand ouvrage dramatique de Gounod. M. de Fourcaud dans le Gaulois écrivait : « Si l'on se reporte aux acclamations enthousiastes qui ont salué la chute du rideau, le succès a été éclatant. Mais il reste douteux si l'on tient compte de la froideur avec laquelle on a écouté les premiers actes. » Il y eut cependant des comptes rendus très favorables. Ainsi Joncières écrivait : « La partition de Gounod est claire, limpide, mélodieuse, d'une grande unité de style ; elle contient des pages charmantes de grâce et de sentiment, comme l'exquise aubade du premier acte, la touchante phrase d'Iglésia, l'enfant trouvée au seuil de l'église, comprise dans le tribut des cent vierges ; ]es couplets si expressifs de Ben-Saïd au dernier acte ; à côté de morceaux d'une rare puissance, tels que le finale du premier acte, d'une allure scénique si mouvementée et si intéressante ; celui du second acte, d'un caractère grandiose et d'une sonorité superbe ; et, par-dessus tout, le dramatique duo des deux femmes au troisième acte, qui a soulevé des transports d'enthousiasme... Clarté, simplicité, charme, telles sont les trois vertus musicales que l'auteur du Tribut de Zamora pratique avec une ferveur qui ne s'est jamais démentie. » Mais c'était la parole d'un ami. Par contre, Pigot, dans l'Artiste, reprochait à Gounod de se répéter, de ne pas se renouveler, de manquer de vigueur, de force d'expression. « Néanmoins, concluait-il, la griffe du maître a marqué çà et là sa puissante empreinte. » Adolphe Jullien constate que Gounod ne suit pas, comme Rossini et Verdi, une marche ascendante, et qu'il écrit dans un système rétrograde ses derniers opéras « tandis que tous les jeunes musiciens français, prenant ses ouvrages antérieurs pour point de départ, s'efforçaient de renchérir sur ses délicatesses d'orchestration et de fondre chaque acte en une symphonie à la fois vocale et orchestrale. » Ainsi, le tort de Gounod est, aux yeux de beaucoup de ses contemporains, de ne pas marcher avec son temps. Et il est indéniable qu'après Roméo et Juliette, Gounod n'est plus guère que l'écho de lui-même.
Tout compte fait, le Tribut de Zamora ne mérite plus de sortir des rayons d'une bibliothèque où cette partition ne figure que pour ne point laisser de lacune dans la collection des œuvres complètes de Gounod.
RÉDEMPTION. — MORS ET VITA
Après le Tribut de Zamora, Gounod abandonne le théâtre et se consacre désormais tout entier à la musique religieuse.
On ne dira jamais assez quelle place la religion, la religion catholique, occupa dans la vie de Gounod. Son ami, Monseigneur Gay, lui écrivait un jour : « Je sais ton âme par cœur. Ce n'est qu'en Dieu qu'elle peut se reposer, se dilater et fleurir. » A tous les instants de son existence il pense à Dieu, lui rapporte ses joies, lui demande la consolation de ses tristesses. Il veut répandre autour de lui, dans sa famille et dans la société, le bienfait de la foi dont il a si profondément ressenti la grâce en lui. Il ne conçoit pas de vie saine ni pour l'individu, ni pour la nation, sans ce soutien indispensable. En 1890, trois ans avant de mourir, il composait pour un de ses petits-fils un Résumé de la doctrine catholique avec ces deux épigraphes : la première, tirée de saint Luc : « Une seule chose est nécessaire », l'autre empruntée à saint Paul : « Je n'ai pas jugé que je dusse savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Et la dédicace finit par ce touchant adieu : « C'est donc au nom de ta jeunesse et sur le seuil des dangers et des épreuves qui t'attendent, que je mets entre tes mains ce testament de ma tendre sollicitude pour une vie dont je ne serai plus le témoin, mais dont je voudrais être le soutien toujours présent, quoique invisible. Je prie Dieu de m'en accorder la grâce, comme le meilleur prolongement de mon amour pour toi.
Ton vieux grand-père,
CH. GOUNOD. »
On peut dire que Gounod ne voit la vie qu'à travers Dieu. Et n'oublions pas la place que la religion occupe dans la plupart de ses œuvres de théâtre. Elle a inspiré quelques-unes des meilleures pages de Faust.
Parmi les manuscrits qu'il a laissés, on trouve de nombreux essais de philosophie et de théologie : Etudes de logique, signées « l'abbé Gounod » ; Méditation sur la prière ; notes sur l'Histoire comparée des religions, sur la Foi et la Raison, sur l'Hostilité envers l'enseignement de l'Église ; Essai philosophique sur les dogmes ; traduction de Dix Sermons du pape saint Léon sur la fête de Noël (1887) ; Réflexions sur la vie de Jésus, de Renan.
« C'est à contrecœur qu'il travaille en 1881 au Tribut de Zamora », nous dit Camille Bellaigue. En fait, la musique profane n'a plus son cœur, il ne songe plus qu'à la musique religieuse, et l'échec de son dernier opéra ne le touche point profondément. Dès lors, il a renoncé à chanter les passions humaines. Il ne veut plus chanter que Dieu.
Fut-il plus grand lorsqu'il chanta Dieu que lorsqu'il chanta la vie humaine ? Nous nous le sommes déjà demandé. Saint-Saëns en est persuadé. Il n'a pas hésité à écrire, parlant de Mors et Vita : « L'œuvre peut attendre ; quand de par la marche fatale du temps, dans un lointain avenir, les opéras de Gounod seront entrés pour toujours dans le sanctuaire poudreux des bibliothèques, connus des seuls érudits, la Messe de Sainte-Cécile, Rédemption, Mors et Vita resteront sur la brèche pour apprendre aux générations futures quel grand musicien illustrait la France au XIXe siècle. » Nous ne le croyons pas et déjà le temps, faisant son œuvre, laisse au premier plan de la production de Gounod Faust et Roméo, tandis qu'il recule dans un lointain de plus en plus effacé Rédemption et Mors et Vita. Une fois au moins Gounod a trouvé l'accent de la véritable piété, douce et tendre, mais néanmoins profonde, à la manière si simple et si coulante de Racine, c'est quand il écrivit sur les strophes d'Athalie l'exquis duetto : D'un cœur qui t'aime (*). Il lui aurait sans doute fallu un tel poème pour l'inspirer toujours. Mais hélas ! sur des paroles le plus souvent bien vaines, il ne sait pas donner de corps à sa musique qui se traîne molle et inefficace, vraiment fade, traduisant une foi trop purement sentimentale où la volonté ne joue pas son rôle.
(*) La première audition de cette page délicieuse fut donnée le 11 février 1882 chez Mme Trélat par la maîtresse de maison et Gabrielle Krauss. Le même soir on reprenait à l'Opéra-Comique Philémon avec Mlle Marguillié, dont c'était le début, Nicot, Taskin et Belhomme.
En tout cas, ce « musicien d'amour » ne sut exprimer avec quelque bonheur, de la foi religieuse, que ce qu'elle comporte d'amour. Tous les autres aspects de la religion, aspects puissants, aspects terribles, aspects de grande désolation, de grande pitié, lui échappèrent.
***
Aux premiers beaux jours de l'été 1882, Gounod partait pour Birmingham. Le 30 août et le 1er septembre y avait lieu un solennel festival au cours duquel Gounod dirigeait en personne deux exécutions consécutives de Rédemption, trilogie sacrée dédiée à la reine Victoria avec le concours de Mmes Albani, Marie Rose, Anne William, Patey et Trebelli, de MM. Llyod, Stanley, King, Foli et Cummings, d'un orchestre de 140 musiciens et de 400 choristes. Ce fut un immense succès. L'oratorio ne fut connu en France qu'en 1885 par une exécution au Trocadéro, le 5 avril, dans un concert organisé par l'Union internationale des compositeurs sous la présidence de M. Alfred Bruneau et avec le concours de mesdames Albani, Bloch et Ketten, de MM. Faure, Léopold Ketten, Fournets. Auteur et interprètes furent acclamés.
Selon Saint-Saëns « le plan de Rédemption est à lui seul un chef-d'œuvre ; il ne pouvait être conçu et exécuté que par un artiste nourri, comme l'auteur, d'études théologiques non moins que de fortes études musicales ».
Et l'auteur lui-même déclare : Cet ouvrage est l'exposition lyrique des trois grands faits sur lesquels repose l'existence de la société chrétienne et qui sont : 1° la Passion et la Mort du Sauveur ; 2° sa vie glorieuse sur la terre depuis sa Résurrection jusqu'à son Ascension ; 3° la diffusion du Christianisme dans le monde par la Mission Apostolique. Ces trois parties de la présente théologie sont précédées d'un prologue sur la Création, la Chute de nos premiers parents et la promesse d'un Libérateur. »
Et voici, présentée par Gounod lui-même, ce qu'on pourrait appeler la « Table des matières » du PROLOGUE :
« A. La Création. Un prélude instrumental. Exprimant le Chaos (confusion primitive) des éléments. « Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit ensuite, Que la lumière soit, et la lumière fut. »
B. Création de l'Homme, pontife et roi de la nature. Le Démon. Prévarication de l'Homme ; sa Déchéance. Inutilité des sacrifices. Nécessité d'un Médiateur Divin. Première apparition de la Mélodie typique de l'Homme. — Dieu Rédempteur.
C. Promesse du Rédempteur. (Seconde apparition de la Mélodie typique). Le décret de la Rédemption dans les conseils éternels. Chœur mystique. Annonciation du Mystère de l'Incarnation à la Sainte Vierge (Troisième apparition de la Mélodie typique). »
Ce qui nous empêchera de souscrire au jugement de Saint-Saëns cité plus haut, c'est la considération de l'immense contenu de ce prologue. Comment ramasser en quelques pages le commentaire musical de tant d'images, de tant d'idées ? Il y a là déjà la matière d'un oratorio entier, sinon de trois. Et c'est ce qui amène fatalement Gounod à traiter ces sujets infinis de façon ridiculement sommaire.
Mais ouvrons la partition.
Voici ce Prologue où la Création occupe exactement deux pages d'harmonies en leur début savamment étudiées et d'une complication savoureuse tournant autour de la tonique ut, mais se simplifiant à la longue et traînant à la fin sans accent leurs séquences monotones. Nous n'avons pas fait un pas. La pensée musicale est demeurée sur place. S'est-elle bornée à commenter les quelques mots du texte cité en épigraphe : « Et l'Esprit de Dieu planait sur les Eaux » ? Mais alors, c'est tout ce qui nous sera dit de la Création ? On avouera que c'est peu et que nous pouvons être déçus, si nous avons lu le titre.
Voici maintenant la Chute. Elle est plus développée. Ici ce n'est plus seulement l'orchestre qui parle, mais un récitant, dans un langage à vrai dire assez ferme. Gounod, remarquons-le, nous annonce dans ces pages la première apparition de la « mélodie typique de l'Homme-Dieu Rédempteur » qui doit être redite huit autres fois au cours de la partition. Nous attendons ici quelque chose de particulièrement significatif, un thème exprimant à la fois l'infinie bonté du Christ, son surnaturel dévouement et l'immense souffrance dont il consent à être accablé sur la terre pour le rachat des péchés des hommes. Nous entendons au violon solo un pauvre petit motif de deux mesures sans expression définie qui attaque par la septième une descente diatonique de quatre degrés et se répète identique à soi-même six fois de suite, avec, pour toute variété la transformation de la septième initiale en octave. Nous nous demandons comment Gounod a pu se contenter à si peu de frais dans ce moment capital de son œuvre.
Quant à la Promesse de la Rédemption, elle nous est donnée par quelques mesures d'un petit chœur bien tonal avec une chute attendrie dans la manière la plus banale. Et c'est tout. En dix pages le prologue est terminé et les importants sujets auxquels il fait allusion sont considérés comme épuisés. Reconnaissons que tout ce début est conçu littérairement et musicalement de façon bien superficielle. Nous sommes désolés d'avoir à le constater. Mais il faut dire les choses comme elles sont et il nous est impossible de souscrire au jugement de Camille Bellaigue, qui apprécie la « mélodie typique » de l'Homme-Dieu Rédempteur, selon lui, d'une exquise douceur, comme il suit : « Tout est Gounod ici : le dessin de la mélodie, les courbes toujours plus vastes qu'elle décrit en s'élevant, la chute élégante, harmonieuse, dont, avec tant de noblesse, elle tombe. » Il ne s'agissait pas d'élégance ici, ni de courbe gracieuse dans le contour mélodique. Il fallait de l'intensité d'expression, il fallait une émotion pénétrante que nous ne trouvons pas. Dans les lignes de Bellaigue que nous venons de citer, il y a certains termes qui nous étonnent. Bellaigue parle de « courbes toujours plus vastes dessinées » par la mélodie qui s'élève. Or, comme nous l'avons indiqué, le motif initial ne décrit pas en s'élevant des courbes plus étendues, il se contente de se répéter identique à lui-même sur des différents degrés de l'échelle musicale, suivant un procédé cher à Gounod, et à vrai dire un peu lassant.
Quant à la Promesse de la Rédemption, il faut vraiment y chercher finesse pour y voir, comme le fait Camille Bellaigue, « un chant à quatre voix écrit avec la pureté de Bach ». « Le Christ lui-même, ajoute notre auteur, y est censé parler et s'offrir à son Père :
La terre est votre ouvrage.
A l'œuvre de vos mains je rendrai votre image,
O mon Père, et je viens.
Oui, la musique ici pouvait être de Bach, mais jusqu'aux dernières mesures seulement... Sur les mots : « O mon Père ! » certaines harmonies, et plus encore une arabesque montante, d'une grâce affectueuse, puis le silence des voix, que semble remplir un long regard d'amour, enfin les derniers accords d'une si tendre et si fondante saveur, avant le musicien de Rédemption, tout cela nous était inconnu. »
Je crois que l'amitié, l'affection profonde que Bellaigue porte à Gounod lui fait enrichir d'un sens, d'une portée qu'elle n'a point, une musique en réalité bien pauvre. Reportez-vous à la partition. Vous en jugerez. Je veux tout au moins attirer votre attention sur ces accords a d'une si tendre et si fondante saveur », au gré de Bellaigue, qui terminent la pièce et qui comptent, en vérité, parmi les conclusions déjà les plus rebattues au temps même de Gounod, — ou, si c'est Gounod qui les a inventées, ce n'est certes pas ce que nous lui devons de plus précieux.
Nous ne continuerons pas, avec ce détail, l'analyse de la partition de Rédemption. Il nous suffit d'en avoir rappelé par ces premières citations, le ton général, la couleur, l'accent souvent plus profane que religieux, l'écriture un peu lâche et abandonnée, sauf quelques heureuses exceptions. Le plus souvent Gounod est absent de lui-même. Il y a, dans bien des parties de cette œuvre, quelque chose de creux qui nous déçoit. La meilleure page de Rédemption serait peut-être la marche au calvaire, dont Saint-Saëns s'est plu à faire l'éloge. Citons aussi la prière du bon larron (quelques mesures), dont Bellaigue dit, avec justesse, — avec un peu d'exagération tout de même, — (mais enfin gardons-en quelque chose) : « Dans aucun art inspiré par l'Evangile, est-il rien de plus humble et de plus pur, de plus pénitent et de plus pénétré d'un plus parfait amour que la prière du bon larron, ou, comme dit Bossuet, de « cet heureux voleur ».
Camille Bellaigue prend aussi la défense de la scène des Saintes Femmes au Sépulcre, auxquelles on a reproché de trop ressembler aux magnanarelles. Il n'y a rien en effet ici de Mireille qu'une lointaine analogie de sentiment. Scène pastorale et printanière, d'un art tout simple, tout intime et familier, bien dans la note du meilleur Gounod. Et, il fallait le dire, le « grand art » ne se trouve point menacé par ce « réalisme ».
Au cours des répétitions du Tribut de Zamora, Gounod écrivait à madame de Ségur : « Rédemption avance. Ah ! c'est autre chose. Tout le « Calvaire » est terminé. Je nage dans les Saintes Femmes. C'est délicieux. » Il avait raison. C'est proprement délicieux.
Quand, après avoir vu le Seigneur et l'avoir entendu, les Saintes Femmes s'en vont vers les disciples, raffermies, consolées et joyeuses elles racontent aux apôtres comment le Seigneur leur est apparu, elles usent, dans leur allégresse, d'une sorte de bavardage ou de « babillage » pieux qui se trouve merveilleusement traduit dans la partition de Gounod par une sorte de scherzo à la façon de Mendelssohn, qui rappelle, sans contredit, celui de la Symphonie écossaise. Encore une des bonnes pages de réalisme familier dans cette, après tout, curieuse partition de Rédemption.
Enfin, et ce sera notre dernière citation, Camille Bellaigue s'extasie sur la beauté du cantique : « Ah ! qu'ils sont beaux sur la montagne », « admirable, celui-ci, non plus de ferveur et d'élan, mais de quiétude et de félicité... Tout serait à citer ici : le contour mélodique et le rythme, les syncopes, et les cadences encore davantage. On verrait alors ce que, dans une page de Gounod, du meilleur Gounod, chaque élément et jusqu'au moindre détail sonore peut exprimer d'innocence, de béatitude et d'amour. » Camille Bellaigue parle si bien de Gounod, avec une grâce si charmante, et avec une foi si assurée qu'on est toujours tenté de le suivre, de le croire. Mais regardons-y de plus près. Relisons, sans prévention d'aucune sorte, la page en question : elle est d'un bien mince intérêt. Mais voyez comme un aveugle parti pris vous fait tout admirer, jusqu'à ces « syncopes » qui ne sont que le triste vêtement de la pauvreté d'un accompagnement sans variété, jusqu'à ces cadences sur l'élégante usée desquelles Gounod compte pour amener l’ « effet ».
Il y aurait beaucoup à dire sur les cadences de Gounod.
Une phrase musicale se termine le plus souvent sur l'accord de tonique (quand cette chute naturelle n'est pas à dessein évitée) par le moyen d'une suite d'accords, d'une formule harmonique, qu'on appelle une cadence. Il fut un temps, celui de Hændel par exemple, où ces cadences ne variaient guère ; elles étaient toujours les mêmes ; on n'y cherchait point finesse et ce n'était pas là que l'auteur comptait rencontrer l'effet de beauté ou d'originalité. A la même époque cependant, Jean-Sébastien Bach usait de cadences parfois remarquables et tout à fait personnelles. En cela Gounod l'imita. Non point qu'il ait reproduit certaines des cadences de Bach. Mais lui aussi il mit une certaine coquetterie à ne pas terminer ses phrases comme tout le monde et à leur trouver une conclusion qui fût bien sienne et qui fermât le développement du thème en y apposant la marque de l'ouvrier.
Il cherche les cadences qui chatouillent agréablement l'oreille, qui produisent une impression de surprise heureuse ou de tendre abandon, et qui amènent un murmure de satisfaction dans l'auditoire avec l'applaudissement. Il fut peut-être un des premiers au XIXe siècle à donner à la cadence cette importance singulière. Il trouve mille moyens d'amener différemment l'accord décisif de septième de dominante, d'en varier la disposition, de régler de façon imprévue la marche des parties, d'insister sur des retards dans l'une ou dans l'autre, quand il ne va pas tout droit son chemin et ne nous surprend pas justement par sa simplicité sans détour. Massenet, après lui abusera de la caresse des cadences attendries, et des ingénieuses combinaisons harmoniques qui les produisent. L'abus se rencontre déjà chez Gounod quand il ne consisterait que dans la répétition d'un même procédé, d'une même formule, une première fois découverte et qu'il reproduit sans la varier.
Ici, dans le cas de la cadence qui termine la phrase : « Ah ! qu'ils sont beaux sur la montagne », cadence tant admirée par Bellaigue, la chute de la phrase n'est même pas élégante, elle n'est pas ingénieusement ouvragée, elle veut être simple, mais hélas ! elle n'est que plate.
Nous avons essayé de découvrir dam la partition de Rédemption tout ce qui peut paraître digne d'admiration ou au moins d'attention. Nous constatons qu'au total notre récolte est peu abondante. En toute sincérité nous n'avons pu faire mieux.
***
New York invitait Gounod à venir diriger lui-même au delà de l'Océan sa partition de Rédemption. On comptait organiser une de ces grandioses manifestations avec un orchestre et des chœurs monstres, dont les Américains sont si friands, mais Gounod refusa de traverser l'Atlantique.
Pour l'Académie des Beaux-Arts, il composait un discours sur Don Juan où il disait sa profonde admiration pour le génie de Mozart, le plus proche de lui parmi les grands maîtres du passé.
Il pensait à rétablir, en quatre actes, cette Sapho dont il destinait cette fois le premier rôle à Gabrielle Krauss.
Il se faisait critique musical et rendait compte dans la Nouvelle Revue, de l'Henry VIII, de son ami Saint-Saëns, ouvrage si discuté et dont il prenait ardemment la défense. Il avait promis d'assister à la première représentation, et pour tenir cette promesse avait renoncé à un voyage en Italie. C'était un grand sacrifice.
Le 23 juin 1883 il participait au jugement qui attribuait le prix de Rome, au jeune Paul Vidal.
Après quoi, il partait pour Nieuport et Morainville. Il aimait cette retraite, le vieux château normand, où le recevaient de si bons amis et où il trouvait tant de calme. Là, il remaniait Sapho, refaisait le rôle de Glycère, cherchant à mieux exprimer « ces formes d'arrogance, de dureté, d'ironie hautaine et insolente qui composent le caractère de cette exécrable femme... Puissé-je, ajoutait-il dans une lettre dont on ignore le destinataire (15 septembre 1883), puissé-je avoir tiré au moins ce profit-là de ma douloureuse expérience et des odieux souvenirs de mon odyssée. Figure-toi que je suis tellement appliqué à ce portrait que, cette nuit même, j'ai rêvé du modèle... qui était horrible de laideur satanique. »
A Morainville, Gounod travaillait déjà à son second oratorio : Mors et Vita.
Mais on préparait la reprise de Sapho à l'Opéra. Elle eut lieu le 2 avril 1884. Gounod conduisait l'orchestre.
« A l'heure fixée pour le lever du rideau, en présence d'une salle composée de tous ceux que ces solennités artistiques ont coutume de réunir, sous le plafond endommagé par le gaz de M. Lenepveu, le maestro faisait son apparition au pupitre, acclamé à plusieurs reprises par toute cette foule houleuse d'habits noirs et de toilettes tapageuses, dont les inquiétudes s'étaient, jusqu'à ce moment, repues de tous les bruits qui avaient transpiré de la répétition générale, laquelle avait, assurait-on, laissé le public assez froid. Il ne devait pas en être de même du public de cette soirée qui comptera parmi les plus brillantes dans l'histoire de l'Académie de musique. Tout l'intérêt, après s'être un moment partagé dans la salle, était maintenant tout entier concentré sur la scène, en passant par-dessus l'orchestre, d'où s'échappaient les dernières mesures du prélude large, lent, discret, à quatre temps, d'un accent tout religieux, qui sert d'ouverture à l'ouvrage. Puis le rideau se levait sur l'Agora de l'Olympie (sic), un magnifique décor de Rubé et Chaperon. » Ainsi parlent Noël et Stoullig dans leurs Annales du Théâtre et de la Musique.
La distribution était extrêmement brillante. On y comptait des artistes tels que Gabrielle Krauss et Renée Richard, Dereims, Gailhard, Melchissédec, Plançon et Piroia.
Victorin Joncières, en rendant compte de cette reprise, n'hésita pas « à placer Sapho au premier rang des œuvres de Gounod. Peut-être même, ajoutait-il, serions-nous disposé à la préférer à Faust, dont elle n'a ni l'intérêt dramatique, ni la couleur pittoresque, mais qu'elle surpasse par la fermeté du style et la profondeur de l'expression. » Sans cesser de reconnaître la grande valeur de l'œuvre, il nous sera permis de dire qu'il y a quelque exagération dans ce jugement.
Sous sa forme définitive, Sapho donna lieu à trente et une représentations.
L'été de 1884, Gounod le passait encore à Morainville, puis, en septembre, il s'installait à Arcachon. Il n'avait point abandonné Maître Pierre. Il y travaillait toujours, ainsi qu'à Mors et Vita. On dit qu'il aurait pensé un moment tirer un opéra du Jocelyn de Lamartine.
Le 8 novembre, il assistait à cette mémorable représentation du Barbier de Séville où la célèbre cantatrice Van Zandt parut en scène un peu plus gaie qu'il n'eût convenu et dans le même état d'ébriété que, quelque cent ans plus tôt, la créatrice de l'Iphigénie en Tauride de Piccinni. Il fallut la remplacer immédiatement. Mlle Cécile Mézeray se trouvait dans la salle. Ce fut Gounod qui la désigna pour chanter au pied levé le rôle de Rosine où elle fut acclamée.
L'Opéra-Comique préparait une reprise de Roméo et Juliette. Le 5 décembre, après trois ans d'interruption, l'œuvre de Gounod reprenait sa place sur l'affiche avec deux protagonistes hors de pair : Talazac, Heilbronn.
Le 9 juin 1884 Mme Carvalho donnait à l'Opéra-Comique sa représentation de retraite. Ce fut un triomphe pour l'admirable cantatrice et en même temps pour Gounod, dont elle passa en revue une grande partie du répertoire. Faust, Roméo, Mireille, Philémon, figuraient au programme. L'acte du jardin de Faust était chanté par Mme Carvalho, Mlle Vidal, Talazac et Faure. Le duo de Magali (transposé d'un ton) avec Mme Carvalho et Faure fut le couronnement de la soirée.
***
Cependant Gounod avait terminé sa partition de Mors et Vita et il était invité à Birmingham pour en diriger lui-même la première audition. Mais il n'imaginait pas quelle difficulté allait s'opposer à son départ pour l'Angleterre. Mrs Weldon, implacablement acharnée à sa vengeance, venait d'obtenir un jugement condamnant Gounod à lui payer 250.000 francs, sans préjudice des frais et dépens. « Toutefois, ajoutent MM. Prodhomme et Dandelot, le tribunal du Banc de la Reine repoussait une demande de Mrs Weldon (alors détenue à la prison d'Holloway), tendant à se faire déclarer propriétaire des droits d'auteur à percevoir sur Mors et Vita. Le jugement rendu en faveur de Mrs Weldon n'était pas exécutoire en France, mais la contrainte par corps existant de l'autre côté de la Manche, il rendait désormais impossible à Gounod le voyage de Birmingham. » Cette Mrs Weldon, c'était véritablement le diable ! L'audition de Mors et Vita eut lieu le 26 août 1885, sous la direction de Hans Richter, avec le concours de Mmes Albani et Patey, de MM. Llyod et Stanley. Ce fut un succès considérable, immédiatement télégraphié à Gounod et à la presse parisienne.
Le 30 janvier 1886, Gounod conduisait la même œuvre au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et recevait les compliments de la reine.
A Londres, sur l'ordre exprès de la reine Victoria, Mors et Vita devait être exécuté à l'Albert-Hall. A cette occasion, le sollicitor R. Harding insista auprès de Mrs Weldon pour qu'elle ne mît aucun empêchement au séjour de Gounod en Angleterre, « juste le temps nécessaire à ce but [l'exécution de l'œuvre]. » Il lui demandait donc de ne faire aucune démarche pour l'exécution du jugement qu'elle avait obtenu contre lui. A l'intervention de R. Harding Mrs Weldon fit cette réponse : « Je suis plus qu'étonnée de votre impudence. Je suis depuis ce matin de retour de Paris, où, avec succès, j'ai tout mis en mouvement pour obtenir l'exécution de mon verdict contre M. Gounod. S'il essaye de mettre les pieds en Angleterre, je le fais arrêter immédiatement. » Et en même temps elle essayait (mais en vain) d'obtenir des tribunaux français un jugement confirmant l'arrêt du Banc de la Reine.
Le festival eut lieu à Londres, sans l'auteur, le 26 février 1885 et, à l'issue du concert, la reine Victoria tint à faire parvenir à Gounod, dont elle aimait beaucoup la musique, ses félicitations personnelles (*).
(*) Ce qui prouve que la reine Victoria avait une affection particulière pour la musique de Gounod, c'est que, lorsqu'il s'agit d'organiser des fêtes à l'occasion du mariage du duc d'York, son petit-fils, avec la princesse May of Teck, la Reine choisit pour la représentation de gala qui devait avoir lieu à Covent Garden, son cher Roméo avec Jean de Reszké et Melba pour principaux interprètes. J'en possède le programme imprimé sur magnifique satin blanc. Je l'ai en ce moment sous les yeux. En voici le texte :
SOUVENIR
STATE PERFORMANCE
ROYAL OPERA COVENT GARDEN
Under the Management of sir Augustus Harris
On July 4 th, 1893,
By Command of Her Most Gracious Majesty THE QUEEN
In honour of the Marriage of their Royal Highnesses
THE DUKE OF YORK AND THE PRINCESS MAY OF TECK
Gounod's
ROMÉO ET JULIETTE
JULIETTE Mme Melba
STEPHANO Miss Lucile Hill
GERTRUDE Melle Bauermeister
FRÈRE LAURENT M. Edouard de Reszké
CAPULET M. Plançon
TYBALT M. Bonnard
MERCUTIO M. Ghasne
LE DUC DE VÉRONE M. Castelmary
GRÉGORIO M. Villani
BENVOGLIO M. Coutellier
and
ROMÉO M. Jean de Reszké
CONDUCTOR Signor Mancinelli
Le haut du programme est occupé par sept portraits photographiques ; ceux de la reine Victoria, du prince et de la princesse de Galles, du duc d'York et de la princesse May of Teck et de ses père et mère.
« Ce fut une grande hardiesse, écrit Camille Saint-Saëns, d'écrire une œuvre latine et catholique pour la protestante Angleterre. L'accueil, réservé d'abord, chaleureux ensuite, fait à cette œuvre sévère (si différente des oratorios de Hændel et de Mendelssohn, ne demandant rien à une concession quelconque, soit à des habitudes prises, soit à des convenances religieuses assurément respectables) est également un honneur pour l'œuvre qui s'est imposée par sa puissance et pour le public qui s'est laissé convaincre. J'ai vu, par un de ces temps horribles, noirs et pluvieux, dont Londres a la spécialité, l'énorme salle d'Albert-Hall remplie jusqu'aux galeries supérieures d'une foule de 8.000 personnes, silencieuse et attentive, écoutant dévotement, en suivant des yeux le texte, une exécution colossale de Mors et Vita à laquelle prenaient part un millier d'exécutants, l'orgue gigantesque de la salle, les meilleurs solistes de l'Angleterre. A Paris, on se demande encore ce qu'il faut en penser : on en est à chercher pourquoi le Judex se déroule sur un chant d'amour. L'œuvre peut attendre. »
Et c'est là que se place la fameuse affirmation de Saint-Saëns déjà citée selon laquelle, lorsque tous les opéras de Gounod seront tombés dans l'oubli, la Messe de Sainte-Cécile, Rédemption et Mors et Vita demeureront comme des monuments impérissables de sa gloire. Nous avons dit ce que nous pensions de cette opinion.
Le samedi 2 mai, au Trocadéro, avait lieu la première audition en France de Mors et Vita, au bénéfice des ateliers d'aveugles. Les solistes étaient Gabrielle Krauss et madame Conneau, Faure et Lloyd. L'œuvre fut jugée « de beaucoup supérieure à ce que l'auteur avait écrit en ce genre, et notamment à Rédemption... La superbe phrase du Judex fut acclamée et bissée. » Des trois parties de l'ouvrage, la dernière parut la plus intéressante. « Il s'y rencontre, écrivent Noël et Stoullig, tout un courant de mélodies de genre agréable, à travers lesquelles éclate encore, par intervalles, le thème austère de la justice, mais que domine particulièrement le thème tendre de la mansuétude et de l'amour divin. M. Gounod a visiblement cherché à exprimer la sérénité. C'est malgré lui qu'il a peint cette sérénité quelque peu voluptueuse ; mais on l'a dit, un artiste aussi personnel obéit toujours à sa nature. » Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut retenir de cette appréciation.
***
Un jour du printemps de 1865, de Saint-Raphaël, où il travaillait à son Roméo, Gounod écrivait :
« C'est aujourd'hui 4 mai, l'anniversaire de la mort de mon pauvre père... Cette infatigable et invisible révolte de l'humanité contre ce sort inévitable et dont elle est témoin ou victime à chaque instant de la durée, n'est pas autre chose que le droit que nous avons de ne pas mourir. ET NOUS NE MOURRONS PAS. » Voilà, exprimée vingt ans par avance, l'idée même de Mors et Vita.
Gounod dit encore, et ce sont les premiers mots de la préface de son oratorio : « Cet ouvrage est la suite de ma trilogie sacrée, Rédemption. On se demandera peut-être pourquoi j'ai placé, dans le titre, la mort avant la vie. C'est que, si, dans l'ordre du temps, la vie précède la mort, dans l'ordre éternel c'est la mort qui précède la vie. La mort n'est que la fin de l'existence, c'est-à-dire de ce qui meurt chaque jour ; elle n'est que la fin d'un « mourir » continuel ; mais elle est le premier instant et comme la naissance de ce qui ne meurt plus. »
Mors et Vita est très supérieure à Rédemption. Est-ce l'influence du texte purement liturgique et de la gravité de la langue latine, ou du sujet lui-même, il est certain que Gounod se montre ici beaucoup plus profond. Au point de vue purement musical, sa composition est d'un tissu beaucoup plus serré. Elle est beaucoup plus construite et d'éléments plus nouveaux en même temps que plus expressifs.
« Je me bornerai, dit Gounod dans sa préface, à signaler les traits essentiels des idées que j'ai voulu exprimer ; à savoir : les larmes que la mort nous fait répandre ici-bas ; les espérances d'une vie meilleure ; la crainte solennelle de la Justice sans tache ; la confiance filiale et tendre dans un amour sans bornes. Parmi les formes musicales dont la persistance à travers l'œuvre est le plus saisissable, j'appellerai principalement l'attention sur celles qui suivent :

exprimant la terreur qu'inspire le sentiment de la Justice seule, et par suite l'angoisse du Châtiment. Cette forme, dont l'emploi soit ascendant, soit descendant, présente une suite de trois secondes majeures, donne un total de quarte augmentée, dont l'expression farouche se retrouve dans les arrêts de la Justice divine, dans les souffrances des damnés, et se combine, dans tout l'ouvrage, avec les formes qui expriment des sentiments tout différents, comme dans le Sanctus, et le Pie Jesu du Requiem, qui compose la première partie.

Cette seconde forme, celle des tristesses et des larmes, devient par l'emploi du mode majeur et l'altération d'une simple note, la forme des consolations et des joies :

et exprime la fidélité des bienheureux.
Enfin la forme suivante :

par sa triple superposition qui donne un cadre de quinte augmentée, annonce le réveil des morts par cette effrayante fanfare de la trompette angélique dont parle saint Paul dans l'une de ses Epîtres aux Corinthiens...
Il ne me reste plus qu'à déposer l'hommage respectueux de ma vénération et de ma gratitude profondes aux pieds de 1'Eminent Pontife, Sa Sainteté le pape Léon XIII, qui m'a fait le suprême honneur d'accepter la dédicace d'une œuvre dont le seul orgueil sera d'être placée sous une telle protection.
Jamais Gounod n'avait témoigné d'une telle préoccupation de liaison dans le développement, dans la superposition, dans la transformation des thèmes, ni d'une telle hardiesse dans l'emploi des intervalles mélodiques rares en vue d'effets particulièrement définis. Ce n'est là, évidemment, qu'une considération d'ordre extérieur, en un sens, et qui intéresse surtout le musicien de métier. Mais quand par ces moyens savants le but expressif est atteint, nous avons le devoir d'en noter l'emploi, et c'est souvent le cas ici. Nous avons aussi l'obligation de reconnaître que cette fois Gounod se renouvelle vraiment et qu'il y a telle page de Mors et Vita qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait écrit auparavant.
Quand ce ne serait que la première, celle du prologue, à la fois grandiose et terrifiante. Sur le texte : « Horrendum est incidere in manus Dei viventis » (« Il est horrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ») le chœur à l'unisson soutenu par l'orchestre à toute force clame un même ut répété pendant quatre mesures et suivi des quatre notes du thème I, formant une série de quatre secondes majeures et aboutissant à un sol bémol bien inattendu et vraiment effroyable. L'effet est saisissant. Il se répète trois fois sur des degrés imprévus de l'échelle musicale en vertu de modulations brutales que n'adoucit aucune préparation. On ne pouvait mieux traduire l'épouvante des humains devant la mort, ni par des moyens plus brefs, plus sobres et cependant plus émouvants.
Le contraste est grand avec la tonalité claire d'ut majeur qui anime la réponse du Christ : « Ego sum Resurrectio » (« Je suis la Résurrection »). On voudrait seulement que le motif fût plus suave. Gounod s'est contenté de la répétition obstinée de cet ut sur les grands mots latins : « Resurrectio... Ressuscitabo eum... In novissimo die. » Et, à ce propos, Camille Bellaigue raconte : « Je me souviens qu'après la première audition à Paris de Mors et Vita, me parlant de Faure, qui venait de faire acclamer ce récitatif et les autres, Gounod s'écriait avec enthousiasme : « Mon enfant, il a chanté en lettres « majuscules ». »
Ce ton d'ut, mineur puis majeur, par où débute le prologue est cher à Gounod. « Gounod, dit Bellaigue, aurait voulu se faire une cellule dans ce ton d'ut. Il s'y est construit ici un temple magnifique. »
Ici, dans ce prologue, Gounod s'est montré vraiment grand.
Le Requiem débute assez heureusement. La deuxième harmonie du chœur Requiem æternam rappelle le commencement du beau chœur initial de Roméo. Et puis il y a des heurts de tonalités assez curieux. La suite est moins bonne. On y remarque des batteries de triolets d'un effet un peu creux. Avant cela, notons un chromatisme assez rare chez Gounod.
Mais, sans parcourir, page par page, une volumineuse partition, signalons les plus significatives.
D'abord, une bien jolie phrase, une phrase de trente mesures, — ce qui est quelque chose (Guillaume Lekeu citait avec admiration pour son long développement la première phrase de la Sonate de Franck qui n'en a que vingt-sept), — trente mesures qui se tiennent étroitement unies, sans se répéter, sans que le lien entre elles paraisse jamais artificiel, trente mesures qui sont le modèle d'un abondant développement naturel et sûr et remarquez la cadence : « La phrase, dit ici, fort judicieusement, Camille Bellaigue, tombe de haut, d'un sommet où s'est allumée une flamme, dans cette paix où la mélodie de Gounod s'achève toujours. »
Le tendre Pie Jesu est une pièce curieuse. Il est écrit pour le quatuor des solistes et il est très mélodique. Il faut en remarquer d'abord le chromatisme insistant dans la partie haute, chromatisme qui traduit ici fort heureusement une plainte d'une infinie douceur. Par contre, à la fin de la phrase, on n'aime guère la réplique de l'orchestre, sorte de ritournelle d'une grâce trop mondaine et d'une tendresse trop sucrée. Le milieu de la pièce manque de personnalité. Mais toute la fin est excellente depuis l'entrée du thème de la terreur (les trois secondes majeures) ramenée piano à la partie de soprano, puis apparaissant à la basse quatre mesures plus loin, jusqu'au retour du motif de la ritournelle ingénieusement combiné avec le développement de la phrase principale.
La grande phrase instrumentale de Judex a toujours eu un succès considérable ; elle a été presque toujours bissée. Camille Bellaigue, dont l'âme religieuse se trouve particulièrement accordée à toute cette musique, y trouve les meilleurs motifs d'admiration. C'est, selon lui, « une phrase type, la phrase par excellence de Gounod. On dirait le motif mélodique de l'introduction de Faust, élargi démesurément, embrassant d'une courbe hardie un plus vaste horizon. Vous reconnaissez jusqu'aux triolets réguliers, un peu trop, [de l'accompagnement], mais dont la monotonie disparaît dans la splendeur de la cantilène. Quand la phrase reprend encore à l'orchestre avec le soutien du chœur, Camille Bellaigue a l'impression d'une foule qui se rassemble et se répand en formules d'adoration. Cette musique le fait songer au texte de l'Apocalypse : « Je vis ensuite une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils disaient à haute voix : Gloire à notre Dieu, qui est assis sur le trône et gloire à l'Agneau... Bénédiction, gloire, sagesse, actions et grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu dans tous les siècles des siècles. » Et Bellaigue conclut que cette fois Gounod « nous a donné jusqu'au ravissement la sensation et l'émotion de l'infini ».
Il m'est impossible de me hausser à un tel degré d'enthousiasme. Il s'agit là d'une phrase qui a de l'étoffe et du mouvement, de l'allant, qui entraîne, mais dont la qualité me semble médiocre. Elle rend à mon oreille un son un peu banal et ces batteries de triolets qui la poursuivent inexorablement sont vraiment bien décevantes. Comment se peut-il que lorsque ces triolets deviennent des groupes de doubles croches avec l'entrée du chœur, Camille Bellaigue prétende qu'on a l'impression d'une surabondance musicale évoquant l'idée d'une multitude ? Je vois cette idée de grouillement des foules suscitée quelquefois par la complexe polyphonie d'un Bach, mais la répétition monotone d'une même harmonie ne saurait éveiller que l'idée du vide et c'est bien l'impression que, pour notre part, nous éprouvons ici. Somme toute, la réputation du index de Gounod nous semble très au-dessus de son mérite.
Citons plutôt pour finir la grâce charmante du chœur de voix de femmes qui accueille les élus : Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni. Voilà qui est parfait, et qui est bien du Gounod, du Gounod tendre pur et féminin. « Un jour que Gounod me jouait, en le commentant, l'hymne délicieux, dit Bellaigue, je me souviens qu'il traduisit : « Elles lavent et non point ils lavent. » C'étaient des bienheureuses qu'il voyait, plutôt que des bienheureux. » Il obéissait à un secret instinct qui lui dictait une de ses plus heureuses inspirations.
Nous avons relu les deux partitions de Rédemption et de Mors et Vita avec le souci de nous faire une opinion aussi dégagée que possible de tout préjugé, et si nous y avons trouvé des pages très intéressantes, originales, charmantes ou grandioses, nous avons cependant confirmé nos précédentes impressions et reconnu que ce qui manquait à ces œuvres c'était la continuité, que trop souvent Gounod s'y montre inférieur à lui-même, et que même quand il parle un langage qui vient directement du cœur, il ne l'élève jamais si haut dans le domaine religieux que dans le domaine profane, que dans Faust ou dans Roméo.
A côté de Rédemption et de Mors et Vita, la Messe de Jeanne d'Arc est bien peu de chose.
Elle fut composée à l'instigation du cardinal Langénieux, archevêque de Reims. Le 24 juillet 1887, la cathédrale de Reims fêtait l'entrée de Jeanne d'Arc dans la ville et le sacre de Charles VII. Gounod dirigeait lui-même son ouvrage, qui débute par un prélude pour grand orgue, huit trompettes et trois trombones, qui est la partie la plus réussie. La messe elle-même s'essaye de façon assez lointaine au style de Palestrina. A l'offertoire, le jeune virtuose Henri Marteau, âgé de 13 ans, exécutait la Vision de Jeanne d'Arc, avec une sonorité délicieuse et dans un très beau style.
***
Mais une grande révolution se préparait dans la musique d'église et Gounod put en connaître et il en suivit avec le plus vif intérêt les premiers effets. Depuis bien des années déjà les admirables moines de l'abbaye de Solesmes, acharnés à l'étude des vieux manuscrits, s'efforçaient de reconstituer la véritable interprétation des textes et la pratique de l'antique chant grégorien. Ils le débarrassaient de la monotonie et de la lourdeur des exécutions courantes. Ils ne voulaient plus du grossier plain-chant et de ses harmonisations pataudes. Ils soutenaient que le vrai chant grégorien était souple, léger, aérien et qu'il fallait le libérer des pesantes harmonies qui le liaient étroitement à la terre. Dans leur monastère résonnaient ces vieux chants rénovés par leur exécution ailée qui séduisait tous ceux qui venaient les écouter. La réputation de l'abbaye de Solesmes se répandit peu à peu : elle alla jusqu'au pape.
D'autre part, un jeune musicien français, — tout ce qu'il y a de plus français, — né au cœur même de la France en 1863, à Bellangerie, en Indre-et-Loire, — Charles Bordes, était nommé en 1890 au poste de maitre de chapelle de l'église Saint-Gervais, à Paris. C'était un charmant compositeur, et en même temps un homme d'action, un passionné de l'art religieux ancien, du grégorien, de Palestrina, de J.-S. Bach. Un apôtre qui enflammait du même enthousiasme tous ceux qui l'approchaient. Un improvisateur qu'aucune difficulté ne rebutait et qui savait faire quelque chose de rien, organiser au besoin une exécution chorale avec des choristes de hasard, des amis, des amateurs de rencontre, souvent sans argent pour payer les frais d'une audition, se disant toujours que la Providence l'aiderait à réussir. Et il réussissait toujours.
Ses choristes l'appelaient Pater. Ils lui étaient dévoués corps et âme. Dans les tournées qu'il organisa avec eux en province pour répandre le goût des belles musiques de la Renaissance, de Palestrina, de Roland de Lassus et autres, il obtenait d'eux des choses incroyables. « Je me souviens, conte M. Pierre de Bréville, avoir rencontré la troupe dans une ville du Midi. Je ne sais pour quelle cause de retard l'heure du dîner était passée lorsqu'il fallut monter sur l'estrade, et je vois encore Bordes à l'entrée du couloir qui y conduisait distribuant à chacun pour le réconforter un verre de vin de kola ! Deux verres étaient préparés à cet effet : un pour les femmes, l'autre pour les hommes. » Et l'on chantait tout de même, l'estomac vide, mais de tout son cœur.
Avant qu'il eût organisé ses Chanteurs de Saint-Gervais, lorsqu'il n'était encore que maître de chapelle à Nogent-sur-Marne, Bordes montait déjà des auditions musicales d'importance, par exemple celle de la Messe de Franck. Pour cela, il réquisitionnait ses amis, Duparc, d'Indy, Chausson, Chabrier... « et nul de nous, dit M. Pierre de Bréville, n'a oublié la vision de ce dernier, son mouchoir sur la tête pour se préserver d'un courant d'air, et qui après avoir consciencieusement exécuté sa partie, se présenta lui-même comme s'il était le père Franck (qui n'avait pu venir) au curé, afin de ne pas priver celui-ci du plaisir de connaître le maître. »
C'est le jeudi saint 26 mars 1891, date mémorable, que Charles Bordes donna à l'église Saint-Gervais sa première audition solennelle avec le Stabat à deux chœurs de Palestrina et le Miserere d'Allegri (*).
(*) Dès son avènement au trône pontifical, Pie X témoigna par un motu proprio de l'intérêt qu'il attachait à l'initiative de Charles Bordes. C'était la charte de la réforme de la musique d'Eglise.
Gounod qui, nous l'avons déjà dit, était à l'affût de toutes les nouveautés musicales, de toutes les généreuses tentatives des jeunes générations, qui pressentit le génie de Debussy et tâcha de se rendre utile à l'intrépide novateur, Gounod assistait à cette audition du 26 mars 1891 avec son ami Camille Bellaigue. Il suivit tous les offices de « la première semaine sainte de Saint-Gervais ». Et quelques mois plus tard, le 16 novembre, il écrivait à Charles Bordes : « Il est temps que le drapeau de l'art liturgique remplace dans nos églises celui de la cantilène profane, et que la Fresque musicale proscrive toutes les guimauves de la romance et toutes les sucreries de piété qui ont trop longtemps gâté nos estomacs. Palestrina et Bach ont fait l'Art musical, en sont pour nous les Pères de l'Église, il importe que nous restions leurs fils et je vous remercie de nous y aider. » Et rencontrant Charles Bordes, le vieux Gounod lui promettait avec enthousiasme pour les chanteurs de sa tribune un « Salve Regina », « comme je n'en ai point écrit encore ». Il ne l'écrivit jamais. Quel dommage ! Cet essai dans une voie si nouvelle eût été bien curieux. Parler ainsi c'était, en tout cas, s'accuser soi-même et se repentir d'avoir chanté Dieu d'une voix parfois un peu profane.
LES DERNIÈRES ANNÉES
Le 6 décembre 1890 Gounod écrivait à son vieil ami, à son ami de toujours, monseigneur Gay : « Tu sais que la composition théâtrale est depuis longtemps finie pour moi. Mais un rêve vient de me traverser l'esprit : c'est d'écrire une sorte de diptyque musical à la façon des tableaux des primitifs, sur saint François d'Assise. Je voudrais que le premier des deux tableaux fût la traduction musicale du beau tableau de Murillo représentant le Crucifié qui se penche vers saint François et lui passe les bras autour du cou. Le second morceau serait la traduction de l'admirable tableau de Giotto, la mort de saint François entouré de ses religieux. Je ne sais qu'une âme en état d'écrire les vers de ces deux scènes sublimes : c'est celle de mon saint ami. »
Des projets, encore des projets, mais peu de réalisations.
Le 13 août 1889, Gounod notait : « Je ne travaille plus ! Hélas ! Je crois bien que je suis au bout du rouleau, comme production au moins... Je tâche de prendre ma retraite peu à peu. Enfin ! à la grâce de Dieu. »
Il se recueillait dévotement.
« Je pense, je lis, je médite, j'écris. Enfin je me ramasse de mon mieux devant la dernière heure, toujours proche pour chacun de nous, mais surtout pour moi qui ai fait un long voyage, et je sens chaque jour davantage combien la vie est encombrée de petitesse et vide de grandeur. »
Gounod sut vieillir. Il vieillit magnifiquement. Dans son cabinet de la rue de Montchanin, vaste et haut comme une chapelle, assis devant son orgue, il faisait figure de patriarche, de grand prêtre de son art. Pas d'affectation. Une entière sincérité. Une éloquence facile, de l'esprit, de la malice, « un jaillissement continu de « mots » et d'images, de lumière et de flamme, de verve et de joie ».
Quelques menus faits jalonnent ces dernières années.
C'est d'abord le 15 mai 1886 une reprise du Médecin malgré lui avec Fugère, qui, pour jouer le rôle de Sganarelle, avait pris les conseils de Got et qui en fut l'interprète incomparable. Mlle Chevalier était Martine et Mme Molé-Truffier Lucinde. Danbé conduisait l'orchestre avec une finesse rare. Malgré tous ces éléments de succès, le Médecin ne fournit que dix représentations. Ce n'était pas le genre de plaisir — trop relevé sans doute — que venait chercher au théâtre le public habituel de l'Opéra-Comique.
Le 4 novembre 1887 on donna en grande pompe la 500e représentation anticipée de Faust. On avait choisi cette date parce qu'elle coïncidait avec la fête de Gounod, la Saint-Charles. Le compositeur était au pupitre de chef d'orchestre. Mme Lureau-Escalaïs, Jean et Edouard de Reszké, Melchissédec tenaient les principaux rôles. C'est à la suite de cette brillante soirée qu'il fut décidé que Roméo et Juliette passerait au répertoire de l'Opéra. Paravey, directeur de l'Opéra-Comique, cédant aux sollicitations du maître, consentit à ce « grand sacrifice... Que Juliette aille donc retrouver sa sœur Marguerite », écrivait-il dans une lettre rendue publique.
Le 6 février 1888, Gounod était à Angers, où l'Association artistique avait organisé un festival de ses œuvres. Le jeune virtuose Henri Marteau jouait l'Hymne à Sainte-Cécile, la Vision de Jeanne d'Arc et accompagnait à madame Colombel l'Ave Maria. Mme Lucie Palicot jouait un concerto pour piano pédalier et orchestre, déjà exécuté aux Concerts Colonne. J'y étais, j'étais chez Colonne et je me rappelle que l'impression fut étrange de cette toute gracieuse et mignonne personne juchée sur une immense caisse contenant les cordes graves du pédalier sous un piano à queue de concert lui-même reposant sur ladite caisse ; et surtout, ce qui nous surprit, assez agréablement d'ailleurs, ce fut de voir madame Palicot vêtue d'une jupe courte, au genou, bien nécessaire, mais étonnante en ce temps-là et s'escrimant fort adroitement de ses jolies jambes pour atteindre successivement les différentes touches du clavier qu'elle avait sous les pieds, tout semblable à un pédalier d'orgue.
A Angers, Gounod faisait la connaissance de dom Pothier, le célèbre bénédictin de l'abbaye de Solesmes. Ils causèrent un peu, sur les découvertes et les théories de l'érudit religieux.
Le véritable chant grégorien restait encore tout à fait étranger à l'esprit de Gounod. Il lui fallut attendre la révélation de la première semaine sainte des Chanteurs de Saint-Gervais.
Il était toujours question de faire entrer Roméo au répertoire de l'Opéra. Pour donner à l'événement une importance sensationnelle, le directeur, qui était alors Gailhard, eut une idée qu'il jugea excellente. Il fit appel à la Patti.
Le 20 octobre 1888, Gailhard part pour l'Angleterre, afin de rendre visite à l'illustre cantatrice dans son château de Craig-y-nos. Il lui expose son projet et lui demande son concours. La Patti ne veut pas s'engager tout de suite, elle demande à réfléchir. Mais, le 23, elle télégraphie à Gailhard : « Mon cher camarade, j'ai été on ne peut plus touchée de la démarche que vous avez faite auprès de moi à Craig-y-nos Castle. Vous me conviez à l'exécution d'un chef-d'œuvre artistique conduit par le maître lui-même. Créer Juliette à l'Opéra. Je vous réponds : Oui. Patti. »
On pense bien que ce télégramme fut rendu public. Quelle publicité déjà ! Et la Patti n'omettait pas d'indiquer qu'elle répondait de son « château ».
Le succès de la reprise de Roméo était assuré.
Le 24 novembre, la Patti arrivait à Paris, où elle devait donner trois représentations seulement. Sur les instances des abonnés du samedi, elle consentit à en donner une quatrième.
Le mercredi 28 novembre avait lieu la première soirée. La Patti était entourée de Jean de Rezské, Delmas, Muratet, Melchissédec, Tequi, Ballard et de mesdames Agussol et Canti. Pour la circonstance, Gounod avait ajouté un ballet dans lequel on applaudit Rosita Mauri et Vasquez. Le Président de la République occupait sa loge. Gounod conduisait l’orchestre. Tout le monde officiel, littéraire, artistique était présent. Aux dernières galeries on ne voyait qu'habits noirs et toilettes décolletées. Jean de Rezké fut un superbe Roméo. La Patti avait sa jolie voix et sa prodigieuse virtuosité, mais elle fut une Juliette assez indifférente. Le ballet nouveau parut médiocre. « On fera bien de le supprimer au plus vite » disait le Ménestrel. Mme Carvalho, créatrice de Juliette, assistait à la représentation ; elle occupait modestement une baignoire. On l'ignora.
En 1889, Roméo fut « l'opéra de l'Exposition ». Mme Eames, grande et remarquablement belle, y fit son début le 13 mars et fut fort applaudie.
Le 29 novembre 1889, l'Opéra-Comique reprenait Mireille, en trois actes. Mais Gounod déclarait le lendemain que cette Mireille-là n'était ni de son goût, ni de son cru, mais qu'il avait été bien obligé de la conserver, de s'y résigner et, partant, de la rendre possible. Il ajoutait : « Quant aux deux coupures qu'on est dans l'usage de pratiquer, cette suppression rend simplement inepte une pièce qui n'est déjà pas bien vigoureuse de libretto, et je trouve que, pour expliquer la blessure de Vincent et le danger qu'il a couru et dont on parle au quatrième acte, il serait élémentairement logique de laisser au moins le Val d'Enfer qui montre le combat de Vincent et d'Ourrias. » Mlle Deschamps (plus tard Mme Deschamps-Jehin) chantait le rôle de Mireille ; le délicieux Clément était Vincent, Taskin Ourrias, Fournets maître Ramon, Mlle Auguez le pâtre et Danbé conduisait l'orchestre magistralement.
Cette reprise, après un long intervalle, prit l'importance d'une « première » et Auguste Vitu résumait ainsi les impressions du public :
« Par un heureux phénomène, qui a été plusieurs fois observé pour d'autres œuvres musicales, il s'est trouvé que cette Mireille que l'on croyait méconnue parce que le répertoire l'avait abandonnée depuis quinze ans, vivait dans toutes les mémoires et voltigeait sur toutes les lèvres. Avec quel plaisir saluait-on au passage ces délicieuses cantilènes, le chœur des magnanarelles, le duo « Oh ! c'Vincent » ; l'ariette ou plutôt la valse ailée : « O légère hirondelle ! » ; la chanson de Magali ; l'inspiration géniale de l'air : « Mon cœur ne peut changer » tout imprégné de touchante et profonde tendresse. Appuyé par des masses chorales et orchestrales, c'est une page de grand opéra, ou plutôt de drame lyrique, où la déclamation musicale tient une large place ; peut-être le public de 1874 le visait-il lorsqu'il parlait de wagnérisme en écoutant l'un des musiciens les plus français qu'ait formés notre école nationale. Cette exquise partition de Mireille se recommande, il est vrai, par son grand souci de la vérité théâtrale et par la sincérité du sentiment ; mais cette préoccupation visible laisse à l'imagination du compositeur, j'allais dire du poète, toute sa liberté, toute la spontanéité de son inspiration personnelle. La partie descriptive n'est pas traitée avec moins de bonheur ; après deux « déserts » qui avaient précédé Mireille, après celui de Félicien David et celui de Reyer dans la Statue, Charles Gounod en a renouvelé la physionomie avec une simplicité de moyens tout artistique ; son désert de la Crau est un désert qui susurre avec les vibrations de la chaleur solaire et de la lumière éthérée et qui chante avec les cigales, sans qu'on devine dans l'orchestre la plus légère trace de musique imitative. »
Mireille fut représentée treize fois jusqu'à la fin de 1889 et 63 fois l'année suivante. C'était un beau succès.
Une autre reprise, celle de Jeanne d'Arc à la Porte-Saint-Martin, avec Sarah Bernhardt, donna 136 représentations.
Cependant, Gounod écrivait un quatuor en la mineur qui fut exécuté par le quatuor Nadaud, presque en même temps que la Petite Symphonie pour instruments à vent dédiée à Taffanel.
Le 4 avril 1890, au théâtre du Châtelet, Gounod remplaçait Colonne, alors à Moscou, au pupitre de chef d'orchestre. On exécuta sa Deuxième Symphonie en mi bémol. Gabrielle Krauss et madame de Montalant chantèrent le duo D'un cœur qui t'aime qui fut bissé. L'Hymne à Sainte-Cécile, des fragments de Mors et Vita, le Concerto pour piano-pédalier, avec madame Lucie Palicot, et la lamentation Gallia, avec Gabrielle Krauss, complétaient le programme. On acclama Gounod et ce fut sa dernière apparition en public.
Cependant, d'Amérique, on offrait un million à Gounod pour une tournée de concerts, non compris ses frais de voyage et de séjour, ceux d'une personne qui l'accompagnerait et d'un domestique. Gounod faillit accepter. Mais sa famille le dissuada d'entreprendre ce long et fatigant voyage et « il se contenta de passer l'été en Normandie ». C'était plus sage.
Le 1er mai 1891 s'ouvrait le Salon et la foule s'arrêtait devant le portrait de Gounod par Carolus-Duran. Au cours des séances qu'il dut accorder au peintre, il prononça beaucoup de « mots » et notamment celui-ci : « Je me sens aussi jeune qu'à 20 ans. Ce qui vieillit en nous, c'est le logement. Le locataire ne vieillit pas. »
Pourtant, il avait de mauvais moments et se trouvait parfois immobilisé dans sa propriété de Saint-Cloud.
En novembre, les médecins envoyèrent Gounod à Arcachon.
Ne parlons pas d'une musique de scène, assez faible en vérité, que le compositeur écrivit pour accompagner les représentations des Drames sacrés d'Armand Silvestre.
A Saint-Cloud, les reporters assiégeaient Gounod pour des interviews. Il fallait défendre sa porte. Il en recevait quelques-uns. A l'un d'eux il confia :
« L'insuccès de Polyeucte, voyez-vous, c'est le chagrin de ma vie. C'est ce que j'ai fait de meilleur au théâtre, croyez-le bien. — Mais Faust ? — Faust ! répète Gounod — Faust ! (Et confidentiellement :) L'acte du Jardin... Oui... J'ai fait commettre bien des fautes... Parfois, j'en ai le remords... J'en ai le remords... Parfois seulement, parce que... il v a aussi beaucoup de gens qui lui doivent leur bonheur... Le roi Georges de Hanovre me disait : « J'entends Faust le dimanche soir. Il me semble que c'est la suite de l'office divin... Je vous félicite : votre Marguerite sort pure de la scène. »
Gounod écrivait encore un peu. Sa dernière œuvre est un tendre petit Requiem, à la mémoire d'un de ses petits-fils décédé en bas-âge (1893).
***
En 1891, Gounod fit la connaissance d'un jeune musicien, qui ne se doutait guère à cette époque qu'il occuperait à l'Institut le fauteuil de l'illustre maître : Henri Büsser.
Henri Büsser était alors au Conservatoire élève de Guiraud pour la composition. Il n'était pas riche et vivait surtout des mensualités d'un opulent amateur qui faisait éditer sous son propre nom par la maison Durand des mélodies dont en réalité Henri Büsser était l'auteur.
Un jour, Guiraud se trouvant chez l'éditeur tombe en arrêt devant un manuscrit musical dont il reconnaît tout de suite l'écriture : « Mais c'est de Henri Büsser, cette musique-là. — Non, c'est de M. X... » lui répond-on et on lui explique la combinaison.
Le lendemain, à la classe, Guiraud prend à part son élève et lui dit : « Mon petit Büsser, je sais ce que tu fais pour M. X... Durand m'a appris cela... Mais, vois-tu, il faut cesser ce petit commerce. C'est très mauvais pour toi. Tu te gâtes la main. Laisse cela de côté. — Mais, maître, répondit Büsser, c'est que je n'ai que cela pour vivre. 150 ou 200 francs par mois, c'est à considérer. — Je comprends, mon petit. Mais je vais te trouver autre chose. » Aussitôt Guiraud se met en campagne. Notamment il écrit à Gounod pour lui recommander son élève. Il se trouvait justement que la place d'organiste à l'église de Saint-Cloud était vacante. Gounod la fait donner à Büsser, enchanté de trouver ce moyen de gagner son pain en même temps que d'approcher le compositeur de Faust. En fait, il est tout le temps fourré dans la villa de Montretout, rendant mille petits services et obtenant en échange de précieux conseils. Bientôt Gounod ne peut plus se passer de lui et l'on peut dire que pendant les deux dernières années de sa vie, Henri Büsser a vu le maître tons les jours. Il me dit toute sa bienveillance, toute sa bonté et comme il se montrait reconnaissant de la moindre attention. Quand Gounod venait à Paris, c'est à Büsser qu'on le confiait. Toutes les semaines Büsser le conduisait à l'Institut. Pour aller de la gare Saint-Lazare au Palais Mazarin, il prenait quelquefois une voiture, un fiacre. Il n'avait jamais de porte-monnaie. Mais avant de quitter Saint-Cloud, madame Gounod lui mettait quelques louis dans sa poche. Le plus souvent il faisait le chemin à pied. Il marchait très lentement et ne cessait de parler. Il s'arrêtait tous les trois pas et pérorait d'une voix assez haute qui faisait retourner les passants. On mettait ainsi facilement une heure pour arriver au quai Conti...
A l'Institut, quand avaient lieu les concours de Rome, Gounod défendait volontiers les audaces les plus hardies. « C'est lui, me dit Henri Büsser, qui m'a fait connaître et aimer Debussy, Charpentier, Bruneau. Il admirait beaucoup le Rêve de ce dernier. C'est lui qui fit décider l'exécution de la Vie du Poète de Charpentier. »
Quand Henri Büsser prit part au concours de Rome qui lui valut le premier grand prix, c'est Gounod, délégué par l'Institut, qui vint mettre les candidats en loge. Dans ce temps-là, on ne remettait pas à chacun d'eux un exemplaire du poème de la cantate. On le leur dictait. Cette façon de procéder avait ses inconvénients. Beaucoup de ces jeunes musiciens n'avaient pas eu le temps de faire leurs études dans un lycée, ni même à l'école primaire. Quelques-uns ignoraient l'orthographe, et, en tout cas les noms de la mythologie qui paraissaient souvent dans ces poèmes ne leur étaient certes pas familiers. Gounod s'acquitta de sa tâche avec tout le soin, toute la conscience désirables. Il commença par dicter le texte phrase par phrase, répétant très lentement et par deux fois chacune d'elles. Puis il relut tout le poème d'un bout à l'autre en le déclamant largement. « A cette troisième lecture, me conte Henri Büsser, j'eus l'idée de noter soigneusement, en suivant la voix du maître, les longues et les brèves, les stringendo, les ritardando, les allargando et tous les changements de mouvement. Vous n'imaginez pas à quel point ces indications m'aidèrent dans mon travail. Elles me suggéraient immédiatement des thèmes mélodiques appropriés à chaque situation et à chaque parole du texte. J'étais tout heureux de ma découverte et j'en fis part à Gounod qui me répondit : « Mais, mon petit Büsser, il n'y a pas d'autre manière de composer. Moi-même, quand je commence un opéra nouveau, mon premier soin est de copier sur mon papier à musique le poème en entier. C'est sur ce support, sur cette base solide et sûre que je compose. C'est là que je trouve le point de départ infaillible de mon inspiration. C'est ce qui la soutient, c'est ce qui la dirige, c'est ce qui fait, quand elle est heureuse, sa force et sa vérité. »
Le maître Henri Büsser, ce jour-là, ne m'en conta pas plus long. Mais j'étais bien heureux d'avoir appris ce que je viens de dire. Et je ne m'étonne plus que les mélodies de Gounod m'aient paru parlantes. De son propre aveu, elles sont construites à la mesure même des paroles dont elles reflètent la structure intime. Pas toujours, cependant. Et j'appris de Büsser un petit fait qu'on ignore d'ordinaire. Chacun a dans la tête la phrase chantée par Faust dans le grand duo du troisième acte : « O nuit d'amour, ciel radieux ! » Un jour, à l'église de Saint-Cloud, au moment de la communion, Büsser jouait à l'orgue ce thème fameux. Après la messe, on lui en fit le reproche et dans des termes véhéments : « Comment, à l'instant solennel du mystère sacré le plus vénérable de la religion catholique, faire entendre cette phrase d'amour, d'amour profane, d'amour coupable ! Ce n'est pas seulement une faute de goût, c'est une faute contre la religion même, c'est un véritable péché, et comme il est commis en public, c'est un scandale ! — Pardon, monsieur, répliqua Büsser d'un ton fort calme, ne vous mettez point tant en colère. Ce que vous ignorez sans doute c'est que la mélodie incriminée fut composée par Gounod pendant son premier séjour à Rome, et que c'était alors un O Salutaris. N'ai-je donc pas le droit de jouer un O Salutaris pendant la communion ? »» Voilà qui nous explique que dans l'opéra de Faust, la même mélodie soit, par exception, si mal prosodiée. Rappelez-vous toute la fin : « O douces flammes ! Le bonheur silencieux verse les cieux dans nos deux âmes. » On dirait que le compositeur s'est appliqué à faire tomber chaque note de la mélodie en porte-à-faux sur les paroles. (Détestables paroles d'ailleurs ! « Verse les cieux... » quel horrible langage !) Gounod en use autrement d'ordinaire. Cette fois il a retrouvé dans sa mémoire un ancien thème qui s'appliquait merveilleusement à la situation et qui, par une sorte d'harmonie préétablie, convenait infiniment mieux à chanter l'amour profane que les saints mystères de la religion. Il a fort bien fait de l'utiliser.
Je voudrais vous répéter tout ce que m'a dit Büsser de Gounod. Il y en a trop et tout n'importe pas. Mais il y a des détails significatifs qu'il faut retenir. Ainsi celui-ci : « Gounod, me dit Büsser, écrivait sa musique comme vous écrivez une lettre, au courant de la plume. » C'est bien l'impression qu'on a quand on l'écoute : musique merveilleusement facile toujours, avec ce que la facilité peut comporter de bonheur et de grâce dans le cas de la réussite, de négligent abandon et d'insuffisante tenue dans le cas contraire.
Dans ses derniers temps, Gounod devenait de plus en plus appliqué à ce qu'il considérait comme ses devoirs religieux. C'est ainsi qu'il prit l'habitude de servir régulièrement la messe de l'abbé Aglon, deuxième vicaire de l'église de Saint-Cloud. Et il fallait entendre l'abbé Aglon expédier son texte au plus vite : Dominus vobiscum était à peine bredouillé, tandis que Gounod, plein de conviction, étalait sur le mode oratoire son : Et cum spiritu tuo.
L'église était toujours pleine. On venait « voir Gounod servir sa messe ».
Le dimanche 15 octobre 1893, au matin, Gounod se sentait un peu fatigué. Il allait tout de même à l'église. Puis il rentrait chez lui, y ramenant son fidèle compagnon Henri Büsser. Après le déjeuner, il s'occupa avec lui de la « réduction » pour piano ou orgue de l'orchestre du Requiem qu'il venait de composer. Il joua une dernière fois l'exquis Benedictus.
Büsser le quitta à trois heures moins dix pour aller prendre son train. Arrivé à la gare il aperçoit un abbé passer sur la route accompagné d'un enfant de chœur agitant une sonnette. C'était le saint viatique que l'on portait à quelque mourant. Lequel ? Büsser pense tout d'un coup à Gounod. Il court à la maison de Montretout et apprend ce qui était arrivé. Après son départ, Gounod avait quitté le piano et s'était mis à une table devant sa partition du Requiem pendant que sa femme et sa fille, madame de Lassus, faisaient une partie de dominos. Il avait allumé sa pipe. Madame Gounod, qui lui tournait le dos, inquiète sans doute de n'entendre aucun bruit, l'appelle : « Gounod ! » Il répond : « Oui, oui ! » Quelques instants après elle l'appelle de nouveau : « Gounod ! ». Puis une troisième fois. Il ne répond plus. Elle se retourne et l'aperçoit la tête tombée en avant et retenue par la pipe dont le fourneau s'appuyait sur la table. Elle s'effraie. Que se passe-t-il ? Vite on va chercher le docteur Sune qui ne peut que constater que le grand musicien venait d'être frappé d'une congestion. On s'empresse de lui donner tous les soins nécessaires. Il ne reprit pas connaissance. Il vécut encore soixante heures, tenant un crucifix fermement serré dans la main. Le mardi 17 octobre 1893, il expirait à 6 heures 25 du matin.
La nouvelle fut vite connue à Paris, d'où l'on accourut de tous les côtés pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu.
Mme Gounod, MM. Jean Gounod, G. Dubufe, M. et Mme Pierre de Lassus entouraient le lit mortuaire. Camille Bellaigue, Reyer, Massenet, Saint-Saëns, Bruneau, Charpentier avaient été parmi les premiers visiteurs, dès avant le décès. Puis Paul Viardot, Lenepveu, Carvalho, Alexandre Dumas et une foule d'autres personnalités vinrent présenter leurs condoléances à la famille du maître. Poincaré, ministre de l'Instruction publique, la reine d'Angleterre, les directeurs de l'Opéra et de toutes les grandes institutions françaises et étrangères envoyèrent des télégrammes de douloureuse sympathie.
Tout cela se passait dans une douceur d'atmosphère extraordinaire et le temps ne s'était pas mis en deuil pour cette âme qui montait au ciel. Camille Bellaigue écrit : « Je me souviens de tout, de la tiédeur de l'automne et de la couleur du temps. En sortant de la chambre mortuaire, on s'attendait presque à trouver en deuil et dépouillé le jardin de la petite maison, le jardin de Marguerite et de Juliette. Mais non, les dernières roses n'étaient pas flétries, l'heure du soir était exquise, baignée comme l'avait été l'illustre vieillesse, de lumière et de douceur. A la pointe du clocher voisin, de son clocher, étincelait le petit coq d'or. »
On fit à Gounod des obsèques nationales. Mais selon son vœu, les funérailles furent strictement liturgiques. On ne chanta que du grégorien. La cérémonie religieuse eut lieu à la Madeleine. Pendant la traversée de Paris les cordons du poêle étaient tenus par Poincaré, Ambroise Thomas, Reyer, Bertrand, Gérôme, Sardou, Barbier et Carvalho. Des discours furent prononcés sous le péristyle de l'église par Poincaré, Gérôme, Barbier, Ambroise Thomas, Saint-Saëns, Gailhard et Laurent de Rillé. Puis le cortège prit le chemin du cimetière d'Auteuil, où la famille et les intimes firent au grand artiste et à l'excellent homme leurs derniers adieux.
GOUNOD DANS L'HISTOIRE
L'influence de Gounod sur son temps et sur les temps qui ont suivi jusqu'à nos jours est indéniable. Elle atteste la grandeur de son génie. Même les musiciens les plus originaux n'y échappèrent pas complètement et c'est ce que nous voudrions montrer rapidement, sans cependant forcer les choses ni chercher les analogies de style là où elles n'existent pas vraiment.
Ecoutez l'air de Micaëla dans Carmen ou plutôt le duo de Micaëla et de don José, écoutez la phrase : « J'apporte de sa part, fidèle messagère » ou encore celle-ci : « Et tu lui diras que sa mère » ainsi que la ritournelle par laquelle elle se termine, n'y trouvez-vous pas l'écho lointain de la voix de Gounod, n'y voyez-vous pas comme passer l'ombre du compositeur de Faust effaçant pour un moment la personnalité de l'auteur de Carmen ? Il va sans dire que Bizet est en général un tout autre musicien que Gounod : ses idées musicales sont bien plus nerveuses, bien plus ramassées ou plus capricieuses. Mais si nous parcourions ensemble les partitions des Pêcheurs de Perles ou de la Jolie Fille de Perth, œuvres dans lesquelles Bizet n'est pas encore lui-même, nous trouverions bien plus souvent l'occasion de constater l'influence de Gounod. Je ne parlerai pas de ce qu'on appelle à tort la Romance de Carmen : « La fleur que tu m'avais jetée ». Ce n'est point une romance. Le ton en est d'une ardeur bien trop concentrée. On y sent le goût amer d'une affreuse tristesse, et un désespoir tout à fait étranger à l'âme de Gounod. Gounod ne peint pas des hommes de ce caractère, trop violent à son gré. Il lui faut des héros plus simples et plus souples dans lesquels les sens parlent moins haut que le sentiment. Il n'y a pas de nerfs chez Gounod. Et nous voyons qu'à comparer Gounod aux musiciens de son temps, nous le comprenons mieux, nous le définissons avec plus de précision.
Massenet connaît à fond Gounod mais ne lui ressemble guère. Il a seulement hérité de lui le goût des cadences à retards longuement et voluptueusement appuyées. Mais il a le souffle bien plus court. Sa phrase n'est pas tout d'une venue ; elle est construite pièce à pièce en partant d'un petit motif de quelques notes. Elle manque d'ampleur et de liberté. Songez aux thèmes de des Grieux par exemple et par opposition à la grande phrase des stances de Sapho. Comme il y a plus de génie dans celle-ci, parce que plus de continuité.
L'un des plus intimes amis de Gounod, Saint-Saëns, est peut-être le musicien qui a le plus échappé, de son temps, à l'influence de l'auteur de Roméo, ou si, par hasard, on en perçoit — et bien rarement — la trace, c'est que Saint-Saëns se trouve exceptionnellement à court d'idées. Il les chercherait d'ailleurs plus volontiers chez Hændel, Bach, Rameau, Gluck ou Haydn.
César Franck est plus près de Gounod. Jugez-en par la Messe à trois voix. Et songez à l'air de Rédemption : « La terre a tressailli d'une extase profonde », n'a-t-il pas l'élan, l'envolée, l'accent de foi sincère d'un grand thème de Gounod ? Deux croyants, et croyants de même sorte, d'instinct et de sentiment plus que de réflexion. Ils n'ont pas la foi raisonneuse et la volonté de croire ne s'exprime pas chez eux autant que la douceur d'une tendre piété. Donc, parfois, une analogie d'inspiration mélodique entre les deux compositeurs malgré toutes les différences qu'on peut remarquer le plus souvent dans leurs styles.
Dans les mélodies de Duparc, une fin de phrase de Phidylé m'a toujours fait penser à Gounod : celle qui se pose si joliment sur ces paroles : « Et les oiseaux rasant de l'aile la colline cherchent l'ombre des églantiers ». Ce n'est qu'un court instant, mais il est significatif. Par ailleurs, je sais tout ce qu'il y a dans l'âme de Duparc d'amer et de douloureusement voluptueux, de curieux du rare et de désenchanté, tous sentiments qu'ignore absolument Gounod.
Chez Vincent d'Indy point de Gounod : nature trop âpre, trop rude, trop escarpée pour descendre à ces épanchements où l'âme se laisse aller sans retenue.
Ernest Chausson a l'abondance mélodique de Gounod, mais l'abondance seulement, car le contour et la couleur des thèmes rappellent plutôt Wagner ou Franck.
Gabriel Fauré est peut-être quelque peu de la famille de Gounod, mais ce n'est qu'un parent éloigné. Sa mélodie, bien plus capricieuse, pleine d'imprévu, suit les chemins détournés que lui tracent de subtiles harmonies. Et puis Fauré n'ouvre pas largement son cœur en de débordantes expansions. Il est confidentiel. Parcourez cependant le Poème d'un jour et vous y rencontrerez un « adieu » sur une modulation charmante qui pourrait être de Gounod. Avec cela une diction syllabique, une musique parlante, toute simple, tout unie, familière et pourtant relevée d'une discrète poésie, comme chez Gounod. Et puis chez leu deux musiciens ce don incomparable du « charme ». On dit : « le charme de Fauré ». On pourrait dire tout aussi bien « le charme de Gounod ». A quoi tient donc cette précieuse qualité ? A une certaine caresse voluptueuse qui dépend à la fois du contour de la mélodie et de la saveur des harmonies, mais dont la volupté n'est cependant pas à ce point insistante qu'elle arrive à troubler notre plaisir purement musical, quelque chose de contenu et d'un peu lointain. Voilà le secret de la parenté de ces deux génies, à d'autres égards assez divers.
Enfin, à considérer les choses d'un point de vue plus général, c'est un grand mérite pour Gounod d'avoir donné au genre de la « mélodie vocale » ce relief qu'elle n'avait pas eu jusque-là en France, d'avoir dédaigné la romance à la mode de 1830 ou de 1860, de s'être adressé aux plus grands poètes pour les faire parler en musique. La « mélodie » se rattachait dès lors au « grand art » et n'était point abandonnée à l'amusement frivole du salon, — ou du moins le salon était obligé de quitter pour un temps son frivole amusement.
Il serait peut-être vain de rechercher l'influence de Gounod sur Debussy, sinon à travers Massenet, et dans les toutes premières œuvres. Du moins, Debussy, comme Gounod, calque sa mélodie sur le chant implicite du langage français, ou du moins de la façon dont il l'entendait chanter intérieurement en lui, murmure souvent plutôt que chant, murmure grave, et caresse encore, tendre et prolongée.
Mais où va reparaître à plein l'influence de Gounod, c'est après la « grande guerre ». Un formidable bouleversement se produisit alors dans la musique et dans les mœurs des artistes. Plus d'art raffiné : c'est la fin à la fois du Debussysme et du Franckisme. Une musique simple, forte, directe, au besoin brutale. Et c'est l'apparition des « Six » avec leur directeur de conscience Erik Satie. Ce n'est plus le temps des ouvrages longuement médités, dix fois remis sur le métier. On produit en toute hâte, avec une rapidité et une assurance singulières. On compose à la diable. On improvise comme au temps de Mozart. On se souvient des 83 quatuors de Haydn et l'on sourit de l'unique sonate de Franck. On va de l'avant un peu au hasard au risque de s'égarer dans les broussailles de la polytonalité.
Mais cette impétuosité ne dure pas. On s'assagit. On se recueille. On se cherche des patrons, des ancêtres. On en trouve un d'abord dans J.-S. Bach, le grand échafaudeur de polyphonies parfois si complexes qu'elles frisent le polytonalisme. Puis on renonce peu à peu à ce mélange barbare des tonalités, à ce sauvage contrepoint où l'on étouffait. On cherche l'air libre, la lumière crue, la mélodie toute nue, la douceur et la naïveté. C'est là qu'Erik Satie joue principalement le rôle d'initiateur. Socrate fut l'évangile des nouvelles générations. Et en même temps, « l'ermite d'Arcueil » recommandait à ses disciples l'exemple de Gounod.
Gounod est devenu l'auteur le plus aimé, le plus imité, — imité parfois jusqu'au pastiche, — des jeunes musiciens d'aujourd'hui. Un Francis Poulenc, un Sauguet, et, — avant d'entrer en religion, un Maxime Jacob, — ne jurent plus que par lui et ne savent comment assez exprimer leur admiration pour Faust et pour Philémon.
Ainsi, par l'étendue de son influence à tant de musiciens qui furent ses contemporains ou qui lui succédèrent plus on moins directement, Gounod témoigne de l'importance de son rôle dans l'histoire de la musique française. Cette musique, il l'a vraiment sauvée des dangers mortels de l'italianisme et de l'éclectisme, il l'a remise sur le bon chemin, sur la route royale, où, roi lui-même en son art, avec tant d'autres beaux génies, il en assurait la glorieuse immortalité.
Autographes (Catalogue d') de Charavay, à Paris ; Sotheby à Londres ; Liepmanssohn à Berlin, etc.
BAMBILL (J.-B.) : Gounod's opera « Faust » : a plear for tho lyric drama. London, 1894.
BELLAIGUE (Camille) : Gounod. Alcan, Paris, 1910. — Charles Gounod. (Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1895).
BERLIOZ (Hector) : Lettres intimes. Avec une préface par Ch. Gounod (Nouvelle Revue, 15 juin-15 août 1880). — Les Musiciens et la Musique, Paris, 1908.
BIZET (Georges) : Lettres : Impressions de Rome (1857-1860) ; La Commune (1871), Paris, 1908.
BLAZE DE BURY (Henri) : Musiciens du passé, du présent et de l'avenir. Paris, 1880.
B. DE LA CHEVIGNERIE et AUVRAY : Dictionnaire général des Artistes de l'École française.
BOVET (Marie-Anne de) : Ch. Gounod. His Life and his Work. London, 1891.
BURGESS : Gounod's Faust (Nights at the Opera). London, 1905.
BRENET (Michel) : Gounod, musicien religieux. (Le Correspondant, 10 décembre 1893).
CAREL : Histoire anecdotique des Contemporains. Paris, 1885.
CASTÉRA (René de) : Dix ans d'action musicale religieuse (1890-1900).
Catalogue d'une vente d'objets d'art, de livres, gravures, et meubles provenant de la bibliothèque de M. Urbain Gounod, architecte du Gouvernement (7 novembre 1850 ; ajournée au 18 janvier 1851). Paris. Imprimerie Maulde et Renou, 1850.
CHARPENTIER (John) : Héloïse, amante d'Abailard, Editions Jules Tallandier, Paris, 1941.
CLOUZET (Gabriel) : Pierre Dupont. (Portraits d'hier, n° 13) Paris, H. Fabre, 1910. — Pierre Dupont et Ch. Gounod. (Les Pages modernes, oct. 1909).
CROZE (C.-M.) : Supplément du Figaro du 29 mars 1909.
DANCLA (Charles) : Les Compositeurs chefs d'orchestre. Réponse à M. Gounod. Paris, 1873. Cf. Autobiographie de Ch. Gounod.
DANDELOT (A.) : La Société des Concerts du Conservatoire de 1828 à 1897. Paris, Havard, 1898.
DELADORDE (Henri) : Notice sur la vie et les œuvres de Ch. Gounod, lue à l'Institut. (Paris, 3 novembre 1894).
DELAGARDETTE : Les ruines de Pæstum ou Posidonia. Paris, An VII.
DUBOIS (Théodore) : Notice sur Charles Gounod, lue à l'Institut. (Paris, 29 novembre 1894).
DURANDE (Amédée) : Joseph, Carle et Horace Vernet. Paris, 1863.
DURCETTE (Cte C.) : Esthétique musicale. Technie ou lois générales du système harmonique. Paris, 1855. — Résumé élémentaire de Technie harmonique et complément de cette Technie, suivis de l'exposé de la loi de l'enchaînement dans la mélodie, dans l'harmonie et dans leur concours. Paris, 1876. Dédié à Gounod.
EHLERT (Louis) : Aus der Tonwelt, Essays : Gounod contre Wagner, Berlin, 1877.
EHRLICH (Heinrich) : Aus allen Tonarten, Studien über Musik. Berlin, 1888.
FRÈRE (S.) : Charles Gounod. Rouen, 4 mars 1896.
GAY (abbé Charles) : Correspondance. 3 vol. Paris, 1886-88.
GIRODET-TRIOSON : Œuvres posthumes, publiées par Coupin de la Couperie, tome II. Paris, 1829.
GŒTHE : Faust et le second Faust, traduits par Gérard de Nerval, Calmann-Lévy, Paris.
GŒTHE : Faust, traduction précédée d'une notice et accompagnée de commentaires explicatifs par Henri Lichtenberger. La Renaissance du Livre. Paris, 1919.
GOUNOD (Charles) : Autobiographie de Ch. Gounod et Articles sur la routine en matière d'art, édités et complétés avec une préface par Madame Georgina Weldon. (London, published by Mrs Weldon, Tawistock House, Tawistock square, W. C., 11 août 1875). Ce volume contient : Préface, par Madame Weldon ; Introduction, sur la Routine, etc. ; le Public ; la Critique ; la Propriété artistique ; Urgence d'un Congrès Artistique International ; les Auteurs ; la Critique musicale anglaise ; Préface au George Dandin de Molière ; les Interprètes ; l'Enseignement ; les Compositeurs chefs d'orchestre (étude datée du 9 juin 1873, parue en quatre numéros du Ménestrel du 22 juin au 13 juillet 1873 et qui provoqua une réponse de l'éditeur de ce journal M. Heugel, le 20 juin, ainsi que de la part du violoniste Ch. Dancla [voir plus haut]) ; les Pères de l'Église de la Musique. Ces études avaient été publiées d'abord en anglais. La plupart, inachevées, sont suivies de l'indication : à continuer. — Préface aux Lettres intimes de Berlioz (Nouvelle Revue, 15 juin 1880). — L'Allaitement musical (dans la revue Le Nouveau-né d'Oscar Comettant, janvier 1882). — Le Don Juan de Mozart. Lu dans la séance publique des cinq académies du 25 octobre 1882. Paris, 1882. — C. Saint-Saëns ; à propos d'Henry VIII. (Paris, Nouvelle Revue, 15 mars 1884). — Les Soirées parisiennes de 1883, par un Monsieur de l'orchestre (Arnold Mortier), 10e année, préface. Paris, 1884. — Les Annales du Théâtre et de la Musique, par Noël et Stoullig. Préface de la 11e année : Considérations sur le théâtre contemporain. Paris, 1886. — Proserpine, de Camille Saint-Saëns. Le Figaro, 17 mars 1887. — Le Don Juan de Mozart. Paris, 1890. — Traduction allemande, Leipzig, 1891. — Ascanio de Camille Saint-Saëns. (La France, 23 mars 1890). — Mémoires d'un artiste. Calmann-Lévy, Paris, 1896. Publiés d'abord dans la Revue de Paris (juin-juillet-août 1895). Ces Mémoires, commencés en septembre 1877, s'arrêtent après Faust, en 1859, et sont suivis : 1° de 17 lettres à Lefuel et à sa famille, et d'un toast à la princesse Mathilde du 6 janvier 1891 ; 2° d'articles, de critiques ou de lectures faites à l'Institut : De l'artiste dans la société moderne (188., Revue de Paris, 1er nov. 1895) ; l'Académie de France à Rome (janvier 1882) ; la Nature et l'Art, lu dans la séance publique annuelle des cinq académies du 25 octobre 1886 ; Préface à la Correspondance de Berlioz ; M. Camille Saint-Saëns : Henry VIII (avril 1883). Traduction allemande sous le titre : Aufzeichnungen eines Künstlers (Autorisierte Uebersetzung von E. Bauer), avec portrait (Breslau, 1896). Traduction anglaise par A.-E. Crochet-Chicago, 1896). — Lettres de 1870-71 (Revue de Paris, 1er février 1896). — Lettres à Georges Bizet (Revue de Paris, 15 décembre 1899). — Lettres à Richomme, publiées par André Beaunier (Revue hebdomadaire, 26 déc. 1908 et 2 janvier 1909). — Lettres de Rome et de Vienne, publiées par J.-G. Prodhomme (Revue bleue, 31 déc. 1910 et 5 janvier 1911).
GUIFFREY (J.-J.) : Les logements d'artistes au Louvre (Nouvelles archives de l'Art français, tome H, Paris, 1873). — Procès verbaux de l'académie royale de Peinture et Sculpture, tomes VIII et suivants.
HANSLICK (Eduard) : Die moderne Oper (9 volumes).
HENSEL (S.) : Die Familie Mendelssohn-Bartholdy (1729-1847). Nach Briefen und Tagebüchen. Berlin, 1879.
HERVEY (Arthur) : Masters of French Music. London, 1894.
HILLEMACHER (P.-L.) : Gounod. Laurens. Paris, 1906.
HÉBERT (Ernest) : L'Ecole de Rome en 1840 (Gazette des Beaux-Arts, 1901, tome I.).
IMBERT (Hugues) : Nouveaux profils de musiciens. Paris, 1892. — Charles Gounod : Mémoires d'un artiste et autobiographie (Guide musical, Bruxelles. 1896-97).
JULLIEN (Adolphe) : Musiciens d'aujourd'hui (2 séries, Paris, 1892 et 1894). — Musique. Paris, 1896. — A propos de la mort de Charles Gounod (Rivista musicale italiana, Torino, janvier 1894).
LAPI (R.) : L'avenire della musica in Italia. Torino, 1881.
LAJARTE (Théodore de) : Bibliothèque musicale de l'Opéra, catalogue. tome II. Paris, 1878.
LAPAUZE : Ingres. Paris, 1911.
LASALLE (Albert de) : Mémorial du Théâtre-Lyrique. Paris. 1877. — Les treize salles de l'Opéra. Sertorius. Paris, 1875.
LASALLE (Albert de) et THOINAN : La Musique à Paris. Paris, 1880.
LEGOUVÉ (Ernest) : Soixante ans de souvenirs, tome II. Paris, 1880.
LIONNET (Frères) Souvenirs et Anecdotes, Paris, 1888,
MAURRAS (Charles) : Mistral. Aubier, Editions Montaigne, Paris, 1941.
MISTRAL : Mireille. Lemerre, Paris.
MONTAIGLON (A. de) : Correspondance des Directeurs de l'Académie de France à Rome, tomes XV et suivants. Paris, 1905-1910.
MORTIER (Arnold) : Les Soirées parisiennes, par un Monsieur de l'orchestre, 11 vol. Paris 1875-1885.
NOEL (Edouard) et STOULLIG (Edmond) : Les
Annales du Théâtre et de la Musique. 1875-1910. Paris 1876-1911.
PAGNERRE (Louis) : Charles Gounod. Sa vie et ses œuvres. Paris, 1890.
PIGOT (Charles) : Georges Bizet et son œuvre. Paris, 1886.
POINCARÉ (R.) : Gounod, discours prononcé aux obsèques du maître. Figaro du 23 octobre 1909.
POUGIN (Arthur) : Adolphe Adam, sa vie, sa carrière, ses mémoires artistiques [nombreux extraits de feuilletons]. Paris, 1877. — Les ascendants de M. Charles Gounod (Revue libérale, juillet 1884 et Gazette de France, 12 juillet 1884). — Charles Gounod (Revue encyclopédique, novembre 1893). — Musiciens du XIXe siècle. Paris, 1911.
PRODHOMME et DANDELOT : Gounod, 2. vol. Delagrave. Paris. Cet ouvrage est le plus complet, le plus richement documenté de tous ceux qui sont consacrés à l'étude de la vie de Gounod et à l'histoire de ses œuvres.
PRODHOMME (J.-G.) : Les Symphonies de Beethoven. Paris, 1914. — Une famille d'artistes : les Gounod (Revue musicale, septembre 1910).
DE RECY (René) : Charles Gounod (Revue bleue, 3 décembre 1877).
REGNAULT-DELALANDE (F.-L.) : Catalogue de Tableaux, Dessins, Estampes... qui composaient le cabinet de feu M. Gounod, peintre, ancien pensionnaire de l'Ecole de France à Rome, Dessinateur du Cabinet de feu S. A. R. Monseigneur le duc de Berry, et Maître à dessiner de MM. les Pages du Roi... (23 février 1824).
SAINT-SAËNS (Camille) : Charles Gounod et le Don Juan de Mozart. Paris, 1894. — Portraits et Souvenirs. Paris, 1900 et 1909. — Le livret de Faust (Monde musical, janvier 1919).
SCUDO (Paul) : La Musique ancienne et moderne, Paris, 1854. — Critique et Littérature musicales. Paris, 1860. — L'année musicale, première année. Paris, 1860. — L'année musicale, deuxième année. Paris, 1861. — La Musique en l'année 1862. Paris, 1863.
SERGY (E.) : Fanny Mendelssohn, d'après les mémoires de son fils. Fischbacher. Paris, 1888.
SERVIÈRES (Georges) : La légende de la Reine de Saba et l'opéra de Ch. Gounod (Guide musical, 2 décembre 1909). — La version originale de Mireille (Quinzaine musicale, 1er avril 1901).
SHAKESPEARE : Œuvres. Traduction Montégut. Hachette, Paris.
SOUBIES (Albert) : Soixante-sept ans à l'Opéra en une page. Paris, 1893. — Soixante-neuf ans à l'Opéra-Comique en deux pages. Paris, 1894. — Histoire du Théâtre-Lyrique, 1851-1870. Paris, 1899. — L'Almanach des Spectacles 1873-1910. Paris, 1874-1911. — Les membres de l'Académie des Beaux-Arts (3e série). Paris, 1911.
SOUBIES et MALHERBE : Histoire de l'Opéra-Comique. La seconde salle Favart. 1840-1887. Paris, 1892-93.
SPOLL (E.-A.) : Madame Carvalho. Notes et Souvenirs. Paris, 1885.
STOULLIG : Annales du théâtre et de la musique. Paris.
TOLHURST (H.) : Gounod (Bell's Miniature Series of Musicians), London, 1904.
VOSS (Paul) : Ch. Gounod. Ein Lebensbild. Leipzig, 1895.
WAGNER (Richard) : Gesammelte Schriften, 10 vol., notamment tome IX, Uber die Bestimmung der Oper (1871). Cf. traduction Prodhomme. — Mein Leben (Munich, 1911).
WELDON (Georgina) : Mon orphelinat et Gounod en Angleterre. L'Amitié. Première partie. London, 1882. — Les Affaires, seconde partie, 11 août 1875. — Troisième partie : Lettres de M. Gounod et autres lettres et documents originaux. Imprimés et publiés à la demande de ses amis par Madame Georgina Weldon pour sa justification personnelle (11 août 1875). — La Destruction du Polyeucte de Gounod. Paris, Imprimerie Paul Dupont 1875. — Le troisième Faust. Volume annoncé mais non paru. — Musical Reform. Gounod's Concerts, and other articles of the musical Trade. London, 1875. — The Quarrel of the Albert Hall Company with M. Charles Gounod, 1875. — Après vingt ans et autres poésies (Verses purporting to be communicated by the spirit of Gounod), illustré, Paris et London, 1902.
JOURNAUX DE MUSIQUE
Revue et Gazette musicale de Paris, 1837-1880.
La France musicale, 1837-1873.
Le Ménestrel, 1835-19...
Le Guide musical, 1850-1911.
Le Monde artiste, 1861-19...
La Renaissance musicale, 1881-1883.
L'Indépendance musicale, 1887-1888.
L'Artiste, 1831-1901.
La Gazette des Beaux-Arts, 1859-19…
L'Art, 1875-1907.
Le Monde musical, 1888-19...
Die allgemeine musikalische Zeitung, 1789-1848 et la suite. (Neue Folge), 1863 et suiv.
Die Signale, Leipzig 1843-19...
Die neue Zeitschrift für Musik, 1834-19...
Das Musikalische Wochenblatt, 1871-19...
The musical Times.
The Athenœum.
The Academy.
1840. Portrait (plâtre) par Farochon, Rome 1840-41. Dessiné par Chartran, lithographié par Michelet, 1884.
1840. Portrait par E. Hébert (Rome, à la Villa Médicis).
1841. Portrait (au crayon) par Ingres : « Ingres à son jeune ami, M. Gounod. Rome, 1841. »
1842. Gounod peignant, étude peinte par Pils, Rome, 1842. Dessinée par Clairin.
1857. Caricature par Carjat (lithographiée dans le Diogène du 1er mars 1857).
1860 (?). Photographie par Pierre Petit. Nargeot, sculp.
1861. Photographie de Gounod et d'Antoine de Choudens « Souvenir de la première représentation de Faust donnée le 17 février 1861 à la Légation de France à Darmstadt. (Monde artiste, 10 décembre 1893).
1862. Caricature par Carjat (lithographiée dans le Boulevard du 9 mars 1862).
?. Buste, lithographié par Jacotin.
1865. Photographie par Carjat.
1867. Gravure à l'eau-forte anonyme. Publiée par Gambart.
1868 et 1871. Photographies par Pierre Petit.
1869. Portrait par E. Hébert, Rome. 15 février 1869.
1871. Buste, par Franceschi. Londres.
1872. Buste en bronze, par Carpeaux (Londres) ; reproduit en terre cuite par Carpeaux. Voir E. Chesneau : Carpeaux pp. 138 et 275. Gravé par Masson.
?. Trois dessins originaux par le même. (Collection G. Doucet).
1872. Caricature par Marquet (Chronique illustrée, du 6 janvier 1872).
1873. Caricature par Hadol dans le Trombinoscope.
1873. Lithographie par Challand.
1874. Lithographie par Bocourt (Monde illustré).
1875. Portrait au crayon par Sébastien (Musée de Béziers).
1875. Portrait-charge de Gounod. Aquarelle de E. Durandeau (Vente Péricaud, 29 avril 1910).
?. Photographie par Pirou, grav. de Navellier (supplément du Journal Illustré).
1875. Lithographie par Carjat (Le Masque, du 25 avril).
1877. Photographie, par Pierre Petit.
1878. Portrait par Carolus-Duran.
1878 (?). Portrait. Chaix et Cie, éditeurs.
1879. Portrait par Elie Delaunay.
1879. Portrait par A. Gilbert (L'Illustration).
(?). Buste, gravé par Weger.
(?). Buste, gravé par L. M.
1881, Portrait de Gounod, dessin de Edelfelt, grav. de Baude (Monde Illustré).
1882. Photographie par Pirou (2 juillet).
(?). Dessin par Renoir (la Revue illustrée).
1885. Portrait par Nadar.
1886. Médaillon par Ringel d'Illizach, et dessin par le même.
188 (?). Caricature dans le Trombinoscope, par Moloch.
1886. Lithographie, par E. Pirodon.
1888. Gravure de Lemaire d'après Nadar (l'Univers illustré).
1888. Caricature par Coll-Toc (Les Hommes d'aujourd'hui), Vanier, éditeur.
1889. Photographie par Paul Boyer (cinq poses).
1890. Nos contemporains chez eux, photographie par Dornac.
(?). Caricature par Luque.
(?). Photographie par L. Petit.
(?). Médaille par Chaplain (Musée du Luxembourg).
1891. Portrait par Carolus-Duran.
1893. Gounod sur son lit de mort, photographie.
1893. Obsèques de Gounod à la Madeleine, photographie Benque.
Le beau portrait photographique qui illustre la couverture de notre ouvrage a été donné par Gounod lui-même, peu de temps avant sa mort, au maître Henri Büsser qui, fort obligeamment, a bien voulu consentir pour la première fois à en autoriser en notre faveur la reproduction. Nous l'en remercions bien vivement. P. L.
TABLE
Les deux premières pièces
Chapitre I. — La famille de Gounod. — Son enfance. — Sa jeunesse. — Rome.
Chapitre II. — Retour à Paris. — Sapho. — Ulysse. — La Nonne sanglante.
Chapitre III. — Faust.
Chapitre IV. — Le Médecin malgré lui. — Philémon et Baucis. — La Reine de Saba. — Mireille.
Chapitre V. — Roméo et Juliette.
Chapitre VI. — Voyage à Rome. — Faust à l'Opéra.
Chapitre VII. — Trois années à Londres.
Chapitre VIII. — Cinq-Mars. — Maître Pierre. — Polyeucte. — Le Tribut de Zamora.
Chapitre IX. — Rédemption. — Mors et Vita.
Chapitre X. — Les dernières années.
Chapitre XI. — Gounod dans l'histoire.
Achevé d’imprimer le 27 février 1942 par Emmanuel Grevin et Fils à Lagny-sur-Marne.