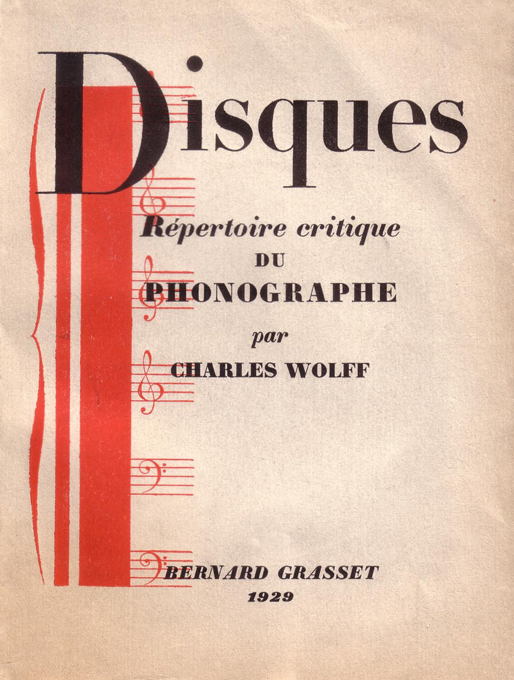
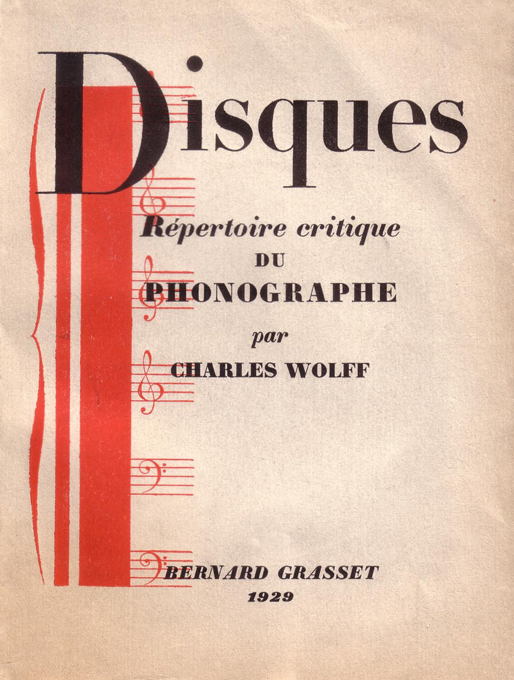
Charles WOLFF
DISQUES
Répertoire critique du Phonographe
(Bernard Grasset, 1929)
Quelques précurseurs méconnus de l'idée phonographique
Charles Cros, véritable inventeur du phonographe
Comment choisir votre appareil - Quels soins lui donner
La première collection officielle de disques
Les « Archives Sonores » de la Staatsbibliothek de Berlin
Choix de quelques-uns des meilleurs textes critiques consacrés au phonographe
ROBERT DESNOS - Vieux Disques – Ted Lewis
Amateurs de disques et de livres, attention ! Ne placez pas ce volume au hasard sur l'un des rayons de votre bibliothèque, choisissez pour lui une tablette neuve car il inaugure une série qui promet d'être riche. Nous assistons en effet, aujourd'hui, au premier contact de la discophilie et de la bibliophilie. Cette conjonction inévitable de deux passions modernes également dévorantes, engendrera des incidences incalculables.
Voici posée aujourd'hui la première pierre de l'édifice bibliographique devenu indispensable aux discomanes. Jusqu'ici, les exégètes de la musique mécanique n'avaient confié leur enthousiasme qu'aux feuillets volants de la presse vite emportés et balayés par l'ouragan de la vie moderne.
Mais ce zèle et cette ferveur tendent à se consolider. Voici enfin un livre spécialement consacré à l'art de la cire sensible.
Ce livre, pour se faire pardonner son audace, se présente modestement comme un ouvrage utilitaire. Au seuil des contrées inconnues dont l'aiguille de votre phonographe dessine les frontières chaque jour agrandies, le livre de M. Charles Wolff se présente comme un guide, comme un Baedecker apportant aux voyageurs une documentation indispensable.
Pourtant, à côté du catalogue patiemment dressé qu'il offre à notre curiosité, l’auteur a placé un certain nombre de textes qui constituent un curieux échantillonnage de ce qu'il appelle la « littérature phonographique ». Cette littérature est née brusquement en trois tours de manivelle. La giration de la « plaque tournante » lui a donné immédiatement son rythme et son mouvement.
Cette littérature fut tout naturellement lyrique. Issue d'un miracle de la machine, elle gardait le reflet direct de sa féerie. Un critique musical n’emploie pas le même ton pour parler d'une audition directe dans une salle de concerts et d'une exécution à laquelle ont collaboré les génies mystérieux de l'électricité. En présence de ce « corps astral » d'un chef-d'œuvre, on éprouve un sentiment nouveau et une émotion inédite.
Nul artiste sensible ne peut résister à cette « magie noire » du disque dont les huit-reflets vous fascinent. Toute l'humanité d'aujourd'hui a les yeux fixés sur ces étonnants miroirs à alouettes qui sont les pièges les plus perfectionnés qui aient jamais été mis à la disposition des chasseurs d'idéal pour retenir et capter l'attention des hommes dont les pensées se dispersent au moindre souffle du vent.
Les mélodies ou les mots qui sortent de la bouche d'ombre d'une chambre acoustique acquièrent une force de persuasion irrésistible et c'est pourquoi tout le monde veut posséder aujourd'hui un de ces coffrets magiques où l'on enferme et où l’on conserve la force terrible des impondérables.
Demain, encouragés par cet exemple, les poètes et les historiens auront tous un livre à publier sur ce magnifique sujet. Mais nous devons saluer aujourd'hui le premier chapitre de la musicologie mécanique : celui qui expose très simplement le thème fondamental dont on ne manquera pas de tirer les plus brillantes variations.
Emile VUILLERMOZ
Quelques précurseurs méconnus de l'idée phonographique
On a lu, dans Pantagruel, l'histoire des paroles congelées de l'Isle Sonnante. Or il ne semble pas que Rabelais se soit livré là à de grosse farce. Jusqu'à quel point il envisagea de façon sérieuse la possibilité de conserver des mots, par moyen de congélation, ou par tout autre moyen physique, il ne nous appartient pas de le dire. Notons cependant que l'idée de « la parole conservée » se trouve là en germe.
Mais peu de gens savent qu'il y eut dès l'année 1589 un savant assez féru d'hypothèses pour affirmer d'un point de vue évidemment théorique, la possibilité d'emmagasiner la parole. Il s'agit du fameux Jean-Baptiste Porta. Voici une note extraite du volume seizième de sa Magia Naturalis qui, somme toute, contient la théorie de l'idée phonographique :
« Je crois qu'il est possible de capter les paroles humaines ; de les enfermer, aussi longtemps que bon me semblera, dans des tuyaux de plomb. De sorte que les paroles ressortiront, de ces tubes lorsque j'en ôterai les couvercles. »
Le célèbre astronome Jean Kepler écrivait en 1630 qu'il allait réaliser une machine parlante dont il serait possible de tirer « des bourdonnements et des paroles ».
Vint ensuite Cyrano de Bergerac dont la description étonnamment précise des « livres parlants » qu'il vit entre les mains des lunaires ne laisse pas d'être troublante :
« ... Mon Démon avait traduit ces livres en langage de ce monde ; mais, parce que je n'en ai point de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de ces deux volumes.
« A l'ouverture de la boîte, je trouvai, dans un je ne sais quoi de métal presque semblable à nos horloges, plein de je ne sais quelques petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est, un livre à la vérité ; mais c'est un livre miraculeux, qui n'a ni feuillets ni caractères ; enfin c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles : on n'a besoin que des oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande, avec grande quantité de toutes sortes de petits nerfs, cette machine; puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même temps il en sort, comme de la bouche d'un homme, ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage. »
Le nombre des savants et des poètes préoccupés par l'idée d'enfermer et de conserver la parole humaine devient considérable, après 1750. En 1682 parut la célèbre Folle Sagesse de J. Becher. L'auteur y parle d'un lunetier de Nuremberg, « qui se livrait à de curieux essais, consistant à enfermer dans une bouteille l'écho des paroles humaines, de sorte qu'on les pourrait conserver et transporter pendant bien une heure. » J'ignore, ajoute Becher, s'il est arrivé à un résultat concluant.
Le mathématicien Euler, membre de l'Académie prussienne sous Frédéric le Grand. écrivait en juin 1761 : « Ce serait certes une invention considérable que celle d'une machine capable de reproduire nos paroles, avec tous leurs sons, et leur articulation... je crois que la chose n’est pas impossible. »
Au XVIIIe siècle, un essai sérieux fut tenté par le physicien Kempelen, de Presbourg. Il construisit une machine, remarquable par ses dimensions gigantesques, qui devait « imiter le son de la voix humaine. » Ses premières expériences lui attirèrent un grand nombre de spectateurs, mais, en définitive, il ne fit faire aucun progrès à l'idée phonographique.
En l'année 1779 l'Académie de Saint-Pétersbourg organisa un concours universel qui devait primer les meilleurs ouvrages consacrés à l'origine du langage, et à la formation des sons qui le composent. Le jury demandait aussi qu'on lui soumît le plan d'une machine capable d'imiter le son de la voix, ou bien la reproduire. L'année suivante le Danois Kratzenstein présenta devant les savants pétersbourgeois une machine, compliquée de mille ressorts, véritable monstre mécanique, « capable de gémir ou ricaner presque à la façon d'un humain ». Cette machine faisant rire les lames d'acier qui lui servaient de cordes vocales, ne fit pas faire un pas en avant au problème de la reproduction des sons.
Après la « machine à bruits » du constructeur viennois Faber, se situe un dernier événement, avant que nous n'arrivions au fait capital que fut l'invention d'Edison. L'inventeur du téléphone, Graham Bell, présente à l'Académie des Sciences, en 1872, une machine « capable de dire correctement « papa » et « maman », et qui pouvait aussi imiter assez exactement les pleurs d'un enfant. C'était une mécanique bien compliquée pour aboutir au résultat que procurent les petits bonshommes en caoutchouc que l'on achète pour une somme dérisoire à la Foire du Trône.
Ce fut pourtant une invention de Graham Bell, le téléphone, qui devait permettre à Edison de découvrir le principe de la machine parlante. Un jour, le savant se livrait, dans son laboratoire d'Orange, à des expériences qui devaient lui donner la solution de la téléphonie à grande distance. Voulant vérifier sa sensibilité, il posa un doigt sur la membrane vibrante de son microphone. Il constata un léger picotement, qui provenait d'un stylet qui touchait la membrane, et entrait en vibration lorsque, par exemple, on chantait devant le microphone. Il pensa alors que, s'il était possible d'inscrire sur une matière molle les vibrations produites par le stylet, il suffirait que l'aiguille suive une deuxième fois la trace ainsi obtenue pour reproduire le son.
Le principe de la machine parlante était trouvé. Edison travailla pendant une année entière à créer l'appareil pratiquement utilisable pour la reproduction du son, qui devait s'appeler le phonographe. Le premier phonographe, créé en 1877, selon, les esquisses d'Edison, par son collaborateur Kreusi, utilisait des bandes de papier enduit d'une couche de paraffine. Lorsque le stylet reproducteur avait fouillé trois fois les sillons sonores, la bande était « morte ». Le papier paraffiné fut remplacé par une mince feuille d'étain, où un stylet d'acier gravait les spires sonores. Vint ensuite le cylindre de cire, avec le saphir arrondi à sa base, qui marqua une date dans l'histoire du phonographe.
Ce premier phonographe avait bien des défauts. Il reproduisait les voyelles et la plupart des consonnes. Mais il se refusait à restituer les « s » et les « z ». Il restait atteint de troubles de langage, et il fallut un certain courage pour lui consacrer une exposition grandiose comme celle qui eut lieu au « Crystal-Palace » de Londres, en mars 1888.
Ceux qui ont plaisir à écouter les irréprochables disques que Columbia nous a donnés du Messie de Händel, ne se doutent pas que, dès 1888, dans ce même « Crystal-Palace », on procéda à un enregistrement « grandiose » de Israël en Egypte. Un immense pavillon fut fixé au plafond de la salle pour capter les sons. L'oratorio fut rejoué en 1889, grâce aux cylindres de cire, devant le public de l'Exposition Universelle de Paris. A cette même exposition figuraient déjà 45 modèles différents de machines parlantes.
Voici donc ce qu'était devenue en dix ans cette invention qui avait tant fait rire. Charles Cros, qui avait déposé un projet de « phonographe » à l'Académie des Sciences, le 3 décembre 1877, était mort de misère. Son rival américain, plus heureux que lui, devait triompher facilement de tous les scepticismes. Se rappelle-t-on encore aujourd'hui que M. Bouillaud, membre de l'Institut en 1878, parla d'imposture lorsque Edison présenta sa machine parlante à Paris, et accusa l'inventeur... de ventriloquie ?
En 1889, Edison vendait son brevet, en Angleterre et aux Etats-Unis. Un grand pas était fait. Le phonographe apparaissait peu après dans le commerce, sous un volume maniable. Mais on n'osait encore trop lui demander. Qu'on en juge par la liste typique de « cylindres » que l'on trouvera dans l'annonce (parue dans l'Assiette au Beurre) que nous reproduisons ci-après.
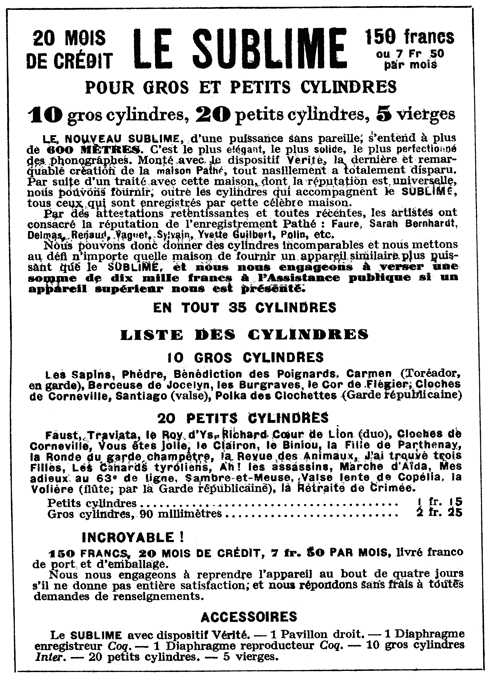
Voici enfin, pour achever de persuader le lecteur de cette annonce, quelques-unes des attestations que produisait le fabricant du « Sublime » :
« C'est ce que j'ai entendu de plus pur, de plus complet, je l'affirme.
Sarah BERNHARDT »
« J'ai entendu vos appareils, et pour la première fois, j'ai consenti à enregistrer quelques morceaux de choix de mon répertoire.
Que dire davantage ?
« Je suis heureux de vous signer cet autographe et d'affirmer, comme tous ceux qui ont pu entendre vos merveilleux instruments, qu'ils sont les plus parfaits, avec une extraordinaire sonorité, d'une beauté absolument incontestable.
Voilà qui est pour inciter à la prudence, et apprendre au public à se méfier du système des « témoignages » qui fit la fortune de l'aimable Mariani.
Le phonographe à rouleaux vécut ainsi, sans concurrence, pendant dix ans. Relégué à l'office, ou au café où son entonnoir trônait sur une vitrine, il emplissait l'air de fanfares, de pas redoublés, et de mélodies « qui s'entendaient à plus de 600 mètres. » Muni d'un moteur précaire (pour ce qui était des modèles bon marché), il toussait, avait des rumeurs d'estomac mal satisfait. Dans les morceaux « dolce », on entendait un véritable solo de papier d'émeri. Peu à peu la reproduction gagna en acuité ; on distinguait nettement les paroles. Ce fut l'ère de la romance, où triompha M. Bérard, de l'Eldorado.
C'est en 1891 enfin que l'inventeur allemand, Emile Berliner, découvrit le principe du disque qui devait détrôner le rouleau, et faire entrer dans une phase nouvelle la technique de la reproduction du son.
Les premiers phonographes à disques furent des phonographes à aiguilles. Les disques étaient enregistrés selon un procédé qui ressemblait à s'y méprendre au procédé de gravure des rouleaux. Le ou les musiciens étaient groupés autour d'un pavillon. Les sonorités faisaient entrer en vibration la membrane sensible du microphone où aboutissait le pavillon. Ces vibrations étaient transmises à un stylet ou « crayon graveur » fixé contre la membrane. Ce crayon les inscrivait dans une cire molle, dont on tirait un contre-type de métal. C'était l'enregistrement acoustique, que l'on appelle aujourd'hui l'« enregistrement ancien procédé ».
Ce fut ensuite, pendant longtemps, la guerre entre le saphir inusable et l'aiguille. L'enregistrement acoustique ne pouvait prétendre à saisir un grand volume de sons. Les orchestres étaient réduits à leur plus simple expression puisque - grands ou petits - le résultat était le même. On me montrait dernièrement une gravure du Rire datée de 1907 et qui montrait un studio de l'époque. Le speaker, coiffé d'un haut de forme annonce à son futur public : « Vous allez entendre l'Ouverture du Barbier de Séville, jouée par la Musique Royale du Danemark. » Et derrière lui une énorme matrone armée d'un trombone, un joueur de piston en bras de chemise, et un violoniste bossu se préparent à attaquer l'air célèbre de Rossini. La caricature exagérait un peu, mais elle exprimait les soupçons du public qui savait mensongères les étiquettes des disques et les catalogues lui annonçant des enregistrements sensationnels, réalisés avec de grands ensembles.
Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, grâce à cette révolution que fut la découverte de l'enregistrement électrique, et qui devait réconcilier avec le phonographe les nombreux ennemis qu'il s'était créés en quinze ans.
Il faut se garder néanmoins de condamner en bloc tout ce qui fut réalisé avant 1925. Dans la masse des enregistrements barbares qui faisaient fuir avec horreur les musiciens, on trouvait déjà des disques dont l'audition laissait prévoir le rôle généreux du phonographe d'aujourd'hui. On peut prendre un réel plaisir à écouter un « Kubelik » d'avant-guerre, un « Kreisler » de 1917, ou certains disques de chant, malgré leur sonorité mystérieuse et un peu voilée. Mais il y avait le nombre des œuvres pour ensemble choral ou grand orchestre qui restait banni des répertoires, et le tour des disques importants était relativement vite fait.
Dans ces vieux disques il s'en rencontre qui sont indéniablement plus agréables que les nouveaux enregistrements qu'on a donnés des mêmes œuvres, avec les mêmes artistes. Ecoutez, si vous en avez la possibilité, les deux versions du Chant du Roi qui part en guerre de Kœnemann, chantées par Chaliapine (DB 101 = ancien enregistrement - DB 1068 = enregistrement électrique), ou, mieux encore, les anciens disques de Maria Barrientos et ses Chansons espagnoles de Manuel de Falla, éditées, il y a quelques mois (Columbia D 11701). Nous disons plus loin combien il est regrettable que l'on ait supprimé des répertoires la presque totalité de ces disques anciens, et qu'il conviendrait de procéder à une révision sérieuse de tous les catalogues antérieurs à 1925. Les firmes qui tenaient alors le marché français étaient au nombre de trois (nous négligeons les marques secondaires) : La Compagnie Française du Gramophone, Pathé et Odéon-Lindstroem. Brunswick possédait un remarquable répertoire de danses américaines, avec des orchestres tels que les Mound City Blue Blowers, Isham Jones, Bennie Krueger, etc., qu'il est malheureusement difficile d'acquérir aujourd'hui. C'est en 1923 que la maison Couesnon devint l'agent exclusif de la marque Columbia pour la France.
C'est en 1924 qu'Émile Vuillermoz écrivit son retentissant article sur Maria Barrientos, dont il vantait les enregistrements cristallins et nets. De cet article date en fait l'histoire de la critique phonographique en France. L'enregistrement acoustique était à son apogée, et le disque séduisait déjà nombre de musiciens délicats. Mais l'édition musicale vivante ne devait remporter la victoire que beaucoup plus tard, en juin 1925. Sans mention spéciale, sans publicité tapageuse, parut le premier disque d'enregistrement électrique : Let it rain, let it pour (Columbia n° 3675), suivi de près par les premiers soli de piano de Percival Mackay, le Waiting for the moon de Layton and Johnstone, et le premier Tin Roof Blues de Ted Lewis.
Les sons, dans l'enregistrement électrique, au lieu d'être transmis directement par le pavillon au diaphragme enregistreur, sont recueillis par un microphone électrique, d'une sensibilité beaucoup plus fine. Au lieu de frapper tout droit la membrane sensible d'un diaphragme de leur jet sonore, ils arrivent au microphone-graveur filtrés par les lampes d'un amplificateur. Le microphoneoreille est dans la salle où se trouvent les chanteurs ou les musiciens. Il est relié par un fil électrique au microphone reproducteur, dont le stylet grave la cire vierge. Ce procédé supprime le « brouillard » dont se trouvaient voilés les enregistrements anciens ; l'enregistrement est plus net et fixe presque toute la gamme musicale. Les harmoniques graves apparaissent en équilibre très net avec les harmoniques élevées - résultat que n'avait jamais obtenu l'enregistrement acoustique.
Mais le volume et le relief qu'il donnait à la reproduction furent certes ce qui séduisit d'abord les auditeurs. En 1926, André Cœuroy disait, dans un de ses articles de Paris-Midi, à propos d'un nouvel appareil Columbia et de quelques disques réalisés selon le procédé nouveau : « L'impression de relief sonore est saisissante !... Vous avez le sentiment aigu que les sons traversent réellement l'espace qui, au concert, séparerait votre fauteuil de l'orchestre, les instruments s'installent d'eux-mêmes, à la place qu'ils occupent dans la réalité ; les vivantes sonorités émanent de foyers situés avec la plus parfaite précision, flûtes, clarinettes, hautbois sont perçus sur leur plan exact, intermédiaire entre le premier plan des cordes et l'arrière-fond que meublent les cuivres. Et voici que, de la boîte sonore, surgit d'un seul coup toute la perspective de l'orchestre. »
Après les premiers enregistrements électriques des disques de danse et de chant anglais, apparurent les premiers disques classiques. Ce fut, en octobre 1925, un Adeste fideles chanté par l'American Glee Club : 4850 voix fixées par un disque Columbia. C'est vers la même époque que parut ce disque-talisman qu'est le Ukelele Lady chanté par Vaughn de Leath. Gramophone, suivant de près, publia en septembre 1926 le Couronnement de Boris où la voix magnifique de Chaliapine apparut pour la première fois avec toute son ampleur, dominant les chœurs et le grand orchestre. Les premiers disques de piano vinrent ensuite, un peu moins précis toutefois que les enregistrements de chant et d'orchestre.
Puis vinrent les grandes séries de disques d'orchestre. L'ouverture de Tannhäuser paraissait simultanément chez Odéon et Columbia, dirigée par Mengelberg. Puis vint la Symphonie Fantastique de Berlioz. Ce fut le centenaire de Beethoven qui donna aux firmes l'occasion de rivaliser de zèle, et cela nous valut les 104 admirables disques des Symphonies, des Quatuors et des Sonates, chez Columbia, avec des chefs d'orchestre comme Mengelberg, Hamilton Harty et Felix Weingartner. Gramophone publiait trois Symphonies, des Quatuors, et cette merveille de technique et de sensibilité musicale qu'est le Concerto en ré majeur joué par Fritz Kreisler. Tous les disques nouveaux étaient des surprises. Combien de musiciens et d'amis furent conquis au phonographe par l'audition de l'Apprenti Sorcier enregistré par la Société des Concerts du Conservatoire ? L'histoire de la naissance du phonographe s'arrête là. La machine parlante apparaissait au public merveilleusement transformée, et capable de reproduire sans les trahir les chefs-d'œuvre de la musique. Son rôle social devenait important. Il s'agissait de lui donner régulièrement de bonne nourriture, pour qu'elle pût satisfaire aux désirs les plus exigeants. Les progrès s'ajoutèrent aux progrès. Le piano fut bientôt dompté de façon satisfaisante par le microphone. Les répertoires s'agrandirent avec une stupéfiante rapidité. Tous les noms importants de l'Histoire de la Musique y sont représentés aujourd'hui, et le Music-Hall y tient une bonne place, avec la musique de danse et les disques exotiques.
Ses ennemis durent s'avouer conquis. La machine parlante qui, hier encore conférait un brevet de mauvais goût à son possesseur, s'est installée à demeure, par un retour imprévu des choses, chez ceux qui hier encore l'exécraient et sont devenus ses partisans les plus convaincus.
Charles Cros, véritable inventeur du phonographe
On a beaucoup parlé de Charles Cros, l'an dernier, à propos du cinquantenaire de l'invention du phonographe. Ce fut, dans toute la presse, une belle flambée d'articles... sans lendemain. Peu de personnes savent, en effet, quelle fut l'exacte suite des événements au cours desquels le poète du Coffret de Santal fut frustré du bénéfice de son invention.
On a tendance à se défier des hommes, tels que Charles Cros, qui manifestent leur activité dans les domaines les plus divers. Les exemples ne sont pas rares de poètes savants, que les poètes jugent être des scientifiques, et que les savants repoussent sans indulgence, les croyant avant tout des « rêveurs ». Peu d'exemples sont à cet égard aussi frappants que celui de Charles Cros. Doué d'une vive sensibilité, érudit au point d'enseigner, dès l'âge de seize ans, l'hébreu et le sanscrit, Charles Cros était un rare type d'homme complet.
L'invention du phonographe, dans sa vie fiévreuse, ne fut qu'un épisode de courte durée. M. Guy-Charles Cros en retraça l'histoire dans une courte et brillante étude que publia le Mercure de France (1er mai 1927). Nous nous en fions à son honnête et exacte documentation pour retracer la suite des événements qui entourèrent ces faits assez mal connus, et dont ne peuvent témoigner que les intimes du poète.
Charles Cros déposait à l'Académie des Sciences le pli cacheté dont le texte suit, le 30 avril 1877. Sur sa demande, le pli fut lu en séance publique le 3 décembre de la même année, et reproduit in extenso dans le livre des Comptes rendus de l'Académie.
En voici le texte exact, tel que le cite M. Guy-Charles Cros :
PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES PHÉNOMÈNES PERÇUS PAR L'OUÏE
En général, mon procédé consiste à obtenir le tracé du va-et-vient d'une membrane vibrante et à se servir de ce tracé pour reproduire le même va-et-vient avec ses relations intrinsèques de durée et d'intensité sur la même membrane ou sur une autre, appropriée à rendre les sons et bruits qui résultent de cette série de mouvements.
Il s'agit donc de transformer un tracé extrêmement délicat, tel que celui qu'on obtient avec des index légers frôlant des surfaces noircies à la flamme, de transformer, dis-je, ces tracés en relief ou creux résistants, capables de conduire un mobile qui transmettra ces mouvements à la membrane sonore.
Un index léger est solidaire du centre de figure d'une membrane vibrante. Il se termine par une pointe (fil métallique, barbe de plume, etc.) qui repose sur une surface noircie à la flamme. Cette surface fait corps avec un disque animé d'un double mouvement de rotation et de progression rectiligne.
Si la membrane est en repos, la pointe tracera une spirale simple. Si la membrane vibre, la spirale tracée sera ondulée et ses ondulations représenteront exactement tous les va-et-vient de la membrane, en leurs temps et en leurs intensités.
On traduit, au moyen de procédés photographiques actuellement bien connus, cette spirale ondulée et tracée en transparence par une ligne de semblable dimension, tracée en creux ou en relief dans une matière résistante (acier trempé par exemple).
Cela fait, on met cette surface résistante dans un appareil moteur qui la fait tourner et progresser d'une vitesse et d'un mouvement pareils à ceux dont avait été animée la surface d'enregistrement. Une pointe métallique, si le tracé est en creux (ou un doigt à encoche, si le tracé est en relief), est tenue par un ressort sur ce tracé. D'autre part, l'index qui supporte cette pointe est solidaire du centre de figure de la membrane propre à produire les sons. Dans ces conditions, cette membrane sera animée non plus par l'air vibrant, mais par le tracé commandant l'index a pointé, d'impulsions exactement pareilles, en durées et en intensités, à celles que la membrane d'enregistrement avait subies.
Le tracé spiral représente des temps successivement égaux par des longueurs croissantes ou décroissantes. Cela n'a pas d'inconvénient si l'on n'utilise que la portion périphérique du cercle tournant, les tours de spire étant très rapprochés ; mais alors on perd la surfacé centrale.
En tout cas, le tracé en hélice sur un cylindre est très préférable et je m'occupe actuellement d'en trouver la réalisation pratique.
L'étude que nous citons fait état ensuite d'un document peu connu. C'est un article dont la publication se situe entre les deux dates du dépôt du pli de Charles Cros, et de sa lecture publique. Il parut le 10 octobre 1877, sous la signature de l'abbé Lenoir (alias Le Blanc) dans la Semaine du Clergé. M. Guy-Charles Cros remarque que de cet article date le baptême de la machine parlante ; le mot « phonographe » y est employé pour la première fois. (Charles Cros avait donné à son appareil le nom de « paléophone », voix du passé.) :
Par cet instrument que nous appellerions, si nous étions appelés a en être le parrain, le phonographe, on obtiendra des photographies de la voix, comme on en obtient des traits du visage, et ces photographies, qui devront prendre le nom de phonographies, serviront à faire parler, ou chanter, ou déclamer, les gens, des siècles après qu'ils ne seront plus, comme ils parlaient, ou déclamaient, ou chantaient, lorsqu'ils étaient en vie. Le phonographe ne reproduira pas sans doute toutes les déclamations, paroles, chansons, etc., de l'être pendant qu'il vivait, mais il reproduira tout ce qui aura été fixé par lui de ces discours, chants et autres sons. Ce seront des échantillons qui en seront conservés. Ne sera-ce pas là l'une des plus curieuses choses qu'on puisse imaginer : faire chanter, par exemple, pendant quelque temps, l'un des morceaux qui auront rendu célèbre tel chanteur, et faire ensuite répéter ce morceau avec une voix toute semblable, par un simple instrument de physique, qui se nommera le phonographe, lequel se servira mécaniquement d'un cliché fait pour cela, se conservant toujours, comme se conservent les clichés des gravures sur bois ou sur cuivre...
La suite de l'article de l'abbé Lenoir donne enfin une description de l'invention de Charles Cros telle qu'elle tranche définitivement, semble-t-il, la question de la priorité en sa faveur. Ce texte montre de façon précise comment on comptait réaliser, deux mois avant que l'inventeur américain ne prît position, le phonographe... d'Edison :
... On a pu conclure de notre explication, si insuffisante qu’elle fût, du téléphone, que le secret de cet instrument transmissif des sons, des musiques, des voix réside, au fond, dans un fil, qui reçoit, communique de proche en proche à ses molécules et transmet enfin à l'atmosphère du lieu d'arrivée la vibration ou ondulation convenable, ou plutôt l'ensemble des vibrations qui constituent tel discours ou tel chant. Supposons que cette vibration, ce bruissement, arrive au bout du fil, y soit communiqué à quelque chose de très mobile, comme un fil élastique d'acier de microscopiques dimensions, une barbe de plume, etc., et que le petit ressort ainsi vibré porte sur une surface métallique telle que celle d'un cylindre analogue à celui d’une serinette. Supposons encore que le cylindre soit enduit, à sa surface, d'une matière aussi légère que le serait du noir de fumée, et qui soit grasse assez pour empêcher un acide de mordre sur le métal. Supposons, enfin, qu'on traite la surface métallique, après qu'elle a reçu les impressions vibratiles du petit ressort, par un procédé délicat, analogue à celui au moyen duquel les aquafortistes exécutent les gravures à l'eau-forte.
Que résultera-t-il de tout cela ?
Il en résultera qu'on obtiendra un cliché, soit un cylindre, sur lequel seront tracées en creux ou en relief les ondulations du morceau qui a été chanté, et sur lequel ces ondulations seront aussi bien fixées que le sont, sur un cliché à gravures, les images des objets de la scène représentée.
Supposons maintenant que l'on fasse tourner le cylindre selon la mesure exactement convenable, et que, sur sa surface, soit traînée une aiguille correspondant avec un téléphone approprié. Les vibrations seront évidemment reproduites comme le sont les notes dans un orgue de Barbarie par le roulement même du cylindre tournant sous les touches. Par suite, l'instrument communiquera à l'air ambiant les ondulations, et ces ondulations elles-mêmes, se répandant dans l'atmosphère, seront les chants, les sons, les paroles du morceau dont on aura pris la phonographie.
L'invention, qui venait de voir le jour faisait enfin l'objet de la chronique scientifique de Victor Meunier, dans le Rappel du 11 décembre 1877. La parution de ces deux articles est de la plus haute importance, lorsqu'on considère que la Semaine du Clergé était fort lue en Amérique, et que la date de parution de l'article de l'abbé Lenoir est antérieure de deux mois à celle du brevet d'Edison. Ce n'est que le 19 décembre 1877 que l'inventeur américain déposa son brevet. Ce n’est que le 15 janvier 1878 qu'il y joignit une description du phonographe, identique en tout point à celle donnée par le chroniqueur de la Semaine du Clergé..., huit mois après le dépôt du pli de Charles Cros. Le phonographe d'Edison ne devait différer du « paléophone » que par un détail. Le cylindre où s'inscrivaient les sons, au lieu d'être couvert d'une couche de noir de fumée, était revêtu d'une feuille de papier d'étain. C'était un bien mince avantage, auquel Edison devait renoncer lui-même quelques mois plus tard, lorsque, construisant son premier appareil, il se rendit compte du peu de solidité de sa matière plastique.
M. Guy-Charles Cros annonce son intention d'étudier l'ensemble des travaux et des découvertes de son père. Cette publication contiendra sans doute d'autres documents capables de situer exactement l'invention de Charles Cros : La véritable invention du phonographe.
Loin derrière la place d'Italie, relégué au fond d'une cour, le studio construit en brique rouge ressemble à s'y méprendre à ces nombreux garages improvisés qui l'avoisinent. La cour franchie, vous tombez en arrêt devant l’œil rouge d'une lampe, allumée en plein jour, et vous lisez une pancarte qui vous dit : DÉFENSE D'ENTRER LORSQUE LA LAMPE ROUGE EST ALLUMÉE. Vous entendez, d'ailleurs, à l'instant même, le violon de Schéhérazade qui prélude, derrière la porte obstinément fermée, suivi des grosses rumeurs des cuivres.
C'est là. La lampe rouge s'éteint. Entrons. La salle est assez vaste, couverte de tapis de feutre, et les murs sont cachés par d'épaisses tentures. Les musiciens, une soixantaine environ, sont disposés dans un ordre peu coutumier. Les cordes et les bois au premier plan, les hautbois en sentinelles avancées. La grosse caisse, par contre se morfond, exilée au fond de la salle, près d'un cadavre de violoncelle...
Près du chef d'orchestre, sur un trépied, voici le microphone. Indifférent pour l'instant à tout le bruit de la salle, il semble une pendulette sans intérêt que le hasard aurait perché si haut. C'est lui pourtant qui tout à l'heure saisira toutes les nuances de l'orchestre, aussi habile que l'oreille humaine la plus exercée et la plus fine.
Le microphone est relié à la cabine d'enregistrement par un fil qui s'arrête à l'amplificateur. Les appareils sont disposés dans une petite cabine qui a vue sur le studio par un vasistas. Ici c'est le domaine des ingénieurs. Les ingénieurs sont au nombre de deux, habillés de blouses blanches comme des infirmiers. L'un surveille la bonne marche de l'amplificateur, et les nombreux « à-côtés ». L'autre s'occupe uniquement du « recorder », le microphone reproducteur dont le stylet gravera la cire, et du moteur à contrepoids qui met en mouvement le plateau porteur de la cire.
Trois coups de sonnette. Les ampoules rouges s'allument partout. Dans la salle, le chef d'orchestre lève la baguette et l'orchestre attaque une deuxième fois le premier mouvement de la célèbre suite de Rimski-Korsakov. La cire mue d'un mouvement double de rotation et de translation (ce dernier permet d'obtenir le sillon en spirale), se déplace sous la pointe graveuse. La morsure laisse un sillon dans la cire. Nouveau coup de sonnette. L'orchestre s'arrête net. La cire passe sur le plateau d'un phonographe ordinaire. On l'écoute, pour juger les défauts qui peuvent s'être glissés dans l'enregistrement. L'ingénieur les explique au chef d'orchestre, et l'on éloigne du microphone quelques cuivres qui résonnaient trop fort. Cette cire sacrifiée a servi à faire un « essai ». C'est ainsi que le profane peut suivre la marche d'un enregistrement, lorsque le hasard l'amène une première fois dans la mystérieuse cabine des ingénieurs.
Le profane que je suis toujours, malgré les nombreuses visites que j'ai eu l'occasion de faire au Studio de la rue Albert, ne peut manquer alors de poser, en toute humilité, un certain nombre de questions. Je transcris, dans toute leur clarté, les explications que me donna l'homme du « recorder », peu prodigue de paroles. On ne saurait prétendre, d'ailleurs, dans le cadre restreint d'un article de revue, donner d'une suite d'opérations aussi complexes autre chose qu'un schéma.

fabrication des disques : la salle des galvanos
I. Le disque
On utilise, pour enregistrer les vibrations sonores, le principe commun à tous les enregistreurs (tels le barographe, le sismographe) : le déplacement d'une surface sensible devant l'index mobile.
Les vibrations, ici, sont très rapides, et vont de 50 à 7000 par seconde. Il faudra donc un déplacement assez rapide de la matière sensible devant l'index pour que deux vibrations consécutives soient enregistrées de façon distincte, et non trop rapprochées. La vitesse de cette matière sensible est de 78 à 80 tours par minute (alors que celle du baromètre enregistreur, par exemple, n'est que d'un tour par 24 heures).
La ligne tracée par l'index (ici la pointe graveuse) est enroulée en spirale, pour en loger la plus grande longueur possible sur une surface donnée. On recourait, à l'origine de l'enregistrement sonore, à des cylindres doués d'un mouvement double de rotation et translation devant l'index, ainsi que dans la plupart des enregistrements usuels. Mais on a adopté, depuis 1895, le disque, où la spirale s'inscrit sur une surface plane, au lieu de tourner en pas de vis sur un cylindre.
L'enregistrement se fait sur une matière assez tendre pour n'entraver en rien le déplacement de la pointe vibrante. On utilise actuellement la cire minérale. Le disque destiné à la reproduction et qui n'est qu'une réplique fabriquée de cette cire première fécondée par les ondes sonores, sera fait d'une matière plastique aussi dure que possible, pour éviter l'usure, et d'un grain aussi fin que possible, pour diminuer le grattement (gomme laque).
II. L'enregistrement
Un volume d'air, atteint par un son, se met à osciller autour de sa position première. Ce mouvement d'oscillation est caractérisé par son amplitude, qui dépend de l'intensité sonore, et par sa fréquence ou hauteur du son.
C'est ce mouvement vibratoire de l'air qu'il s'agit d'enregistrer et, ensuite, de reproduire. Jusqu'en 1926, dans l'enregistrement « ancien procédé », les vibrations sonores venaient frapper de façon directe une membrane sensible fixée au bout d'un entonnoir, aux proportions assez vastes, destiné à capter le plus possible d'énergie sonore. Un stylet solidaire de la membrane sensible gravait directement les vibrations dans la cire, sans leur faire subir de filtrage. Parmi les nombreux inconvénients de l'ancien procédé, vient tout d'abord le fait que l'on ne pouvait enregistrer d'émission que très rapprochée du pavillon ; aucun ensemble important, chœur ou orchestre, ne donnait prise à l'enregistrement. Pour enregistrer un orchestre, même réduit à sa plus simple expression, il fallait conjuguer plusieurs pavillons (les pavillons secondaires étaient disposés devant les instruments dont les sonorités étaient étouffées, et qu'ils recueillaient de façon cloisonnée). Le pavillon lui-même enfin déformait les sons et changeait leur timbre. De là vient le nasillement spécial à la plupart des disques enregistrés selon ce procédé, et la reproduction confuse et sourde des pièces d'orchestre.
L'enregistrement électrique doit sa naissance à la T. S. F., qui amena d'abord une mise au point du microphone, qui peu à peu devint sensible à l'égal de l'oreille humaine la plus fine. « A côté de la finesse d'ouïe du microphone d'enregistrement électrique, l'ancien procédé apparaît comme un sourd à qui il fallait crier dans l'oreille », nous dit notre guide. Ensuite, toujours grâce à la T. S. F., l'usage se répandit des appareils dits « amplificateurs à lampes », qui sont capables d'amplifier considérablement les courants même les plus faibles, pratiquement, sans les altérer.
Contrairement à l'ancien procédé, qui était insensible aux sons placés au-dessous du milieu du registre du violoncelle, l'enregistrement électrique permet de fixer, de façon satisfaisante, tous les sons audibles, depuis la basse de l'orgue jusqu'à la petite flûte.
... Revenons maintenant au Studio où nous vous avons laissé tout à l'heure, après un « essai » de Schéhérazade. Voici, près du chef d'orchestre, l'oreille de tout ce réseau destiné à emprisonner le son, le microphone. Petit prisme de métal, qui contient la précieuse plaque vibrante, qui reçoit les vibrations de l'air, et les transforme en courants électriques. « Ces courants, ajoute l'ingénieur, sont de même fréquence que le son, et leur intensité proportionnelle à la sienne.
Nous quittons la salle où se trouve l'orchestre, pour rentrer au laboratoire.
Un fil amène ces courants dans l'amplificateur à lampes, qui les amplifie de façon considérable.
Le fil aboutit enfin au « recorder ». Le « recorder » ou graveur transforme ces courants en vibrations mécaniques, identiques aux vibrations de l'air, mais d'amplitude beaucoup plus grande. Il n'est autre qu'un moteur de haut parleur portant un style en saphir. C'est cette pointe qui appuie sur la cire et y inscrit l'image des vibrations sonores.
... Après l'essai, nous assistons au véritable enregistrement. Premier coup de sonnette. Depuis la lucarne du laboratoire, nous voyons se lever la baguette du chef. Deuxième, troisième coups. Les ampoules rouges s'allument : le microphone « écoute ». L'orchestre aussitôt attaque. L'ingénieur est penché sur la galette blonde de la cire qui tourne, et où le stylet grave la spirale sonore. Ses yeux clignotants ne la quittent pas un instant. La spirale s'avance vers le centré. L'orchestre s'arrête. Coups de sonnette. Le microphone redevient insensible, et les musiciens, dans le studio, bavardent. L'ingénieur examine la cire à la loupe. Cet examen permet de déceler la présence de vibrations trop fortes, qui risqueraient de rendre les sillons très fragiles.
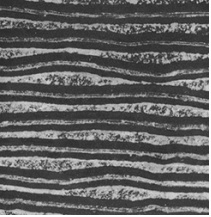 sillons
d’un disque vu au microscope
sillons
d’un disque vu au microscope
Un œil exercé arrive à reconnaître, dans les sillons de la cire, la véritable image des vibrations sonores :
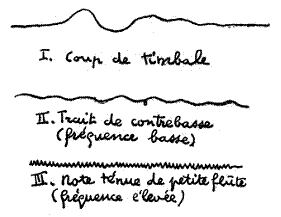
Tout apparaît de façon normale. La cite est posée dans une boîte ronde, et soigneusement empaquetée. L'enregistrement est terminé, et nous allons la suivre à l'usine.
La fabrication comprend deux phases qu'illustrent de façon précise les planches ci-contre.
La première comprend l'électrolyse, qui donne les matrices métalliques. La deuxième comprend l'utilisation de ces matrices (le pressage).
Les cires sont d'abord fixées sur des supports en bois, plongées dans un bain de sulfate de cuivre, et animées d'un mouvement de balancier. Sur la cire, rendue conductrice par une mince couche de graphite, se dépose une couche de cuivre, reproduisant en relief les sillons. Ce disque de cuivre constitue « l'original ».
« L'original », dont on argente d'abord la surface, est plongé à son tour dans un bain d'électrolyse. On obtient ainsi un contretype en cuivre, semblable à la cire. C'est ce qu'on appelle la « mère », véritable disque métallique, qui peut être jouée sur un phonographe. Il faut maintenant obtenir un nouveau négatif, celui dont on se servira enfin pour « imprimer » les disques. Pour la troisième électrolyse, la « mère » est plongée dans un bain de sulfate double de nickel. La feuille nickel qui se dépose sur le cuivre, extrêmement mince, s'appelle le « schell ».
Le « schell » est soudé sur un disque de cuivre qui augmente sa solidité et vissé enfin au fond de la presse.
 fabrication
des disques : le pressage
fabrication
des disques : le pressage
L'électrolyse donne donc successivement :
a) « L'original» en cuivre, réplique négative de la cire.
b) La « mère », réplique positive de l'original.
c) Le « schell », réplique négative de la mère.
Au cas où la première mère se détériorerait, l’« original » permet d'en tirer de nouvelles.
Voici donc le « schell » fixé au fond de la presse. Dans le cas usuel des disques double face, deux schells sont fixés en vis-à-vis, l'un dans le chariot horizontal (caché dans la photographie par la matière du disque que l'ouvrier vient de presser), l'autre dans le couvercle articulé à charnière. Le moule ouvert est parcouru par de la vapeur qui le chauffe. L'ouvrier dispose sur le plateau de la presse l'étiquette ronde où est inscrit l'état-civil du disque. Ensuite viennent un papier laqué (la laque étant naturellement tournée du côté du schell) un losange de matière plastique, le deuxième papier laqué, la deuxième étiquette. (Ce procédé d'une mince couche de gomme laque seule impressionnée par le schell, et collée sur de la matière plastique qui donne de l'épaisseur au disque, est le procédé « Columbia ».) La mâchoire retombe, et le chariot s'engage sous la presse. Le moule est refroidi automatiquement, et, une demi-minute plus tard, on retire le disque « fini ».
Les disques sortis de la presse sont vérifiés un à un. Ceux qui présentent des défauts de fabrication sont détruits. Les autres, soigneusement empaquetés, iront attendre chez le marchand que le hasard de la vente les tire du silence, et redonne vie à la musique endormie dans leurs spires.
Comment choisir votre appareil - Quels soins lui donner
Nous ne pouvons, dans le cadre de cet ouvrage où nous nous sommes astreints à une totale impartialité, étrangère à tout esprit publicitaire, donner une liste définie des meilleurs modèles d'appareils à acquérir. Disons seulement qu'à notre sens les deux types différents d'appareils que sont le VivaTonal Columbia 1929 et le « Voix de son Maître » Orthophonic sont les modèles types des meilleurs appareils. Les appareils Odéon ne sont certes pas à négliger, ni les « Parlophone » qui leur ressemblent d'ailleurs comme des frères. Les appareils Pathé, devenus en juin les « Olotonal », offrent depuis une satisfaisante série, dont nous préférons d'ailleurs les modèles portatifs. Quant aux appareils Polydor, leurs principes de construction sont tels que je n'arrive pas à établir quelle différence peut les séparer des « Gramophone » (ceci s'applique aux modèles portatifs).
Peu importe le modèle que vous ayez choisi. Les principes qui président à cette délicate opération qu'est le choix d'un phonographe sont toujours et partout les mêmes.
Riez si vous le voulez. Mais il vous faudra commencer par jeter un coup d’œil sur le meuble, le boîtier de l'appareil. Il faut que le phonographe soit bien campé sur ses pattes, qu'il ne claudique ni ne boite. Il faut que les planches qui composent le coffret soient jointes sans fissures. Il faut, dans le cas d'un portatif, que le couvercle ferme bien. Ce sont là des détails que ne laisse échapper d'ordinaire le service de contrôle des firmes, lorsque les appareils sortent des ateliers. Mais une longue exposition en vitrine, ou d'autres raisons, peuvent les détériorer.
Assurez-vous également que les volets du coffret jouent bien, car ils règlent l'intensité de l'audition.
Arrive la question la plus importante, celle du diaphragme. C'est un lieu commun phonographique que d'affirmer qu'il est « l'âme de l'appareil ». Et pourtant on a trop tendance à l'oublier, à saisir brutalement et à pleine main cet objet si sensible qui est, dans le phonographe, le laboratoire du son. Il y a dans le diaphragme cette fragile membrane dont les vibrations reproduisent les sons que le disque lui transmet par le chemin de l'aiguille. C'est de sa sensibilité que dépend la qualité MUSICALE de l'appareil.
Le défaut essentiel d'un mauvais diaphragme provient de ce que le stylet porte-aiguilles, cette tige dont le bout reçoit les aiguilles, est mal fixé au centre de la membrane vibrante. Il se produit alors des vibrations parasitaires très préjudiciables à la netteté de l'audition. Si ce défaut se produisait sur un appareil que vous possédez, confiez-le à la firme qui l'a fabriqué, et le mécanicien le réparera sans doute. Mais, pour vous assurer de ce qu'un appareil neuf n'est pas affligé de cette tare, essayez chez le marchand la série type de disques que nous vous indiquons ci-dessus :
l. Un solo d'orgue.
2. Un disque de danse contenant un solo de saxophone.
3. Un solo de piano, de préférence de la marque Pleyel (la marque du piano est toujours portée sur l'étiquette du disque, sous le nom du pianiste).
4. Un chœur, avec, si possible, des voix d'enfants.
5. Un chant « ténor » homme.
6. Un disque d'orchestre symphonique.
Si le diaphragme n'est pas impeccable, il vibrera au cours de l'un ou l'autre de ces morceaux. S'il les joue sans défaillance, soyez assuré que l'appareil que vous avez devant vous est un bon modèle.
Voilà un pluriel fait pour surprendre. Pour étonner ceux surtout qui savent combien l'Institut Phonétique de la Sorbonne dispose de moyens limités, et que les plus intéressants de ses enregistrements sont condamnés à n'aboutir qu'à une reproduction médiocre (puisqu'ils furent enregistrés selon le procédé ancien dit à « saphir »). L'activité et le dévouement de M. Hubert Pernot, le directeur de l'Institut, méritait d'être mieux soutenus. Parmi les voix nombreuses qui dorment dans les spires de ces disques infirmes, combien déjà se sont tues ! Il en est dont tous déploreront la perte, il en est d'autres que l'on devrait enregistrer sans retard.
Ceci ne signifie nullement qu'il faille tomber dans un excès contraire, et enregistrer jusqu'aux voix des moindres aides de laboratoire, et des plus lointains gouverneurs de colonies. Une épidémie de ce genre caractérisait l'industrie phonographique de l'immédiate avant-guerre. Les catalogues « Gramophone » de 1912 et 1913 fourmillent de titres de disques dits « des voix célèbres », dont un grand nombre ont chu dans l'oubli.
Mais dans la foule de ces noms oubliés il en est quelques-uns qui suffisent à justifier un système qui n'était condamnable que dans ses excès. Sait-on qu'il existe encore des disques de la légendaire Adeline Patti, de Tamagno, d'Eleonora Duse, de Sarah Bernhardt et d'Ellen Terry, la grande interprète de Shakespeare ? Que Léon Tolstoï enregistra, en 1907, un disque pour la « His Master's Voice » ?
La Compagnie française du Gramophone a retiré du commerce la presque totalité de ces disques que la firme anglaise a conservés.
Nous disons ailleurs combien nous déplorons que l'on ait condamné sans appel tous les disques d'enregistrement acoustique à disparaître. Il faudrait que l'on instituât un jury de critiques pour procéder à une révision des catalogues anciens. Ces séries rétrospectives viendraient compléter de façon fort heureuse nos répertoires actuels, et ajouteraient aux aspects si divers du phonographe moderne le pouvoir que Charles Cros lui-même attribuait à son invention : redonner vie aux voix du passé.
Le « Musée de la Parole », qui fut constitué au Théâtre national de l'Opéra en 1912, par la Compagnie du Gramophone, répond exactement à ce besoin. Encore qu'on l'ait voué à cent ans de silence. Voici, d'après « Comœdia », le compte rendu de sa fondation :
DANS LES SOUS-SOLS DE L'OPÉRA ON ENFOUIT DES VOIX CÉLÈBRES.
On se souvient que le 31 décembre 1907, il avait été procédé dans les sous-sols de l'Opéra, à l'enfouissement d'une vingtaine de disques de gramophone, sur lesquels étaient gravées les voix de quelques-uns de nos chanteurs les plus célèbres.
Parmi ces chanteurs on comptait : Tamagno, la Patti, Mme Calvé, MM. Plançon et Renaud.
Soigneusement enfermés dans d'épaisses urnes de fonte soudées, lesquelles sont elles-mêmes enfouies dans un caveau spécial dont M. Banès, bibliothécaire de l'Opéra a seul la clé, ces précieux disques ne doivent revoir le jour que dans cent années.
Ce sera là un instant de belle émotion pour nos petits-fils, et l'on peut supposer aisément celle que nous éprouverions s'il nous était donné d'entendre le clavecin de Mozart, le piano de Liszt, la déclamation de Talma et la voix de la Malibran.
Une cérémonie analogue eut lieu hier à la même place. A trois heures de l'après-midi, M. Bérard, suivi de son chef de cabinet, M. Maurice Reclus, arrivait à la bibliothèque de l'Opéra, lieu de réunion de tous les invités.
Le Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts devait, en effet, présider à cet enfouissement et sceller de sa propre main, avec le sceau de l'Etat, les deux urnes contenant les disques nouvellement gravés.
Dans l'assistance, assez nombreuse, on remarquait MM. Messager et Broussan, Marius Gabion, Pierre Soulaine, Maurice Lefèvre, Paul Vidal, Croze, Bozonet, Schneider, Ecorcheville et de Curzon...
... Puis, comme le cortège s'enfonçait dans les profondeurs du sol, M. Demange, chef électricien de l'Opéra, profita du passage du Sous-Secrétaire d'Etat devant l'immense installation électrique, pour lui en expliquer le minutieux fonctionnement ; ce qui parut l'intéresser prodigieusement.
Enfin, après de longs détours sous de sombres arcades, nous arrivâmes dans une sorte de caveau où plusieurs rangées de fauteuils avaient été installées. Il y régnait une fraîcheur humide qui glaça quelques crânes, aussi M. Bérard crut-il répondre au désir de plusieurs assistants en couvrant son chef ministériel. Il fut aussitôt imité.
Sur une table ornée d'un tapis rouge, les disques avaient été préparés. En face, la tombe attendait, grande ouverte, laissant deviner dans ses sombres profondeurs, les deux urnes déposées en 1907.
Voici les noms des artistes dont les voix allaient connaître l'honneur de se voir vouées à une postérité centenaire :
MM. Gémier, Journet, Mme Tetrazzini, MM. Campagnola, Beyle, Reynaldo Hahn, Vigneau, Mlle Brohly, Mme Auguez de Montalant, Mlle Korsoff, MM. Franz, Caruso, Amato, Chaliapine, Mlle Farrar, Mme Melba et M. Scotti.
Il y eut aussi des instrumentistes : MM. Kubelik, déjà enfoui en 1907 ; Kreisler également violoniste, et Paderewski.
Ne croyez pas que tout ceci se passât sans solennité, voire sans émotion. Avant de les enfermer à jamais - du moins pour nous - on mit sur un appareil installé exprès, le disque de M. Gémier. C'était une allocution au ministre. Puis, ou entendit la belle voix de M. Franz dans le « récit du Graal ». Elle était reconnaissable dans ses moindres inflexions. Mlle Brohly chanta « Samson et Dalila ». M. Kubelik termina ce concert. A près quoi, dûment enveloppés, cachetés et soudés, les disques disparurent.
« On ne les entendra plus qu'en 2012 » dit quelqu'un. Chacun se regarda. Personne ne souriait.
Le procès-verbal, sur parchemin, fut signé par tous les assistants, et le stylographe circulait de main en main comme un goupillon qui laisserait tomber de l'eau bénite sur une tombe encore ouverte.
L. BORGEX
(Comœdia du 14 juin 1912)
La première collection officielle de disques
C'est vers 1902 que fut fondée à l'Académie des Sciences de Vienne en Autriche la « Phonogrammarchiv », la première en date des collections officielles de disques.
C'est pendant la guerre que le professeur Doegen reprit l'idée de Exner, fondateur de la collection viennoise. Les événements voulaient que dans les camps de prisonniers se trouvassent des hommes des pays les plus divers du monde. Couvert de sarcasmes par la presse allemande, au début de ses travaux, Doegen s'efforça de fixer dans ses archives les idiomes les plus divers avec leur allure naturelle, leurs chutes de son, etc. Les principales langues européennes, leurs argots, leurs dialectes, leurs patois, sont enregistrées dans les archives du professeur Doegen. Avec les idiomes américains, asiatiques et africains, cette collection groupe des tests de 250 langues, dont 87 pour l'Afrique.
Les « Archives Sonores » de la Staatsbibliothek de Berlin
Les collections fondées sous ce nom à Berlin par le professeur Wilhelm Doegen, en correspondance avec l'« Académie des Sciences » de Vienne ne se proposent pas seulement de fixer sur le disque les voix des personnalités politiques ou artistiques de notre temps. Elles servent surtout, par leur commodité, à des études de phonétique comparée, à l'étude des langues dont nous n'avons encore que peu de notions précises (certains idiomes africains, par exemple), ainsi qu'à d'autres travaux scientifiques.
Le disque nous donne en effet une reproduction très fidèle de la langue parlée, il nous révèle les lois secrètes de la dialectique. Grâce à lui nous pouvons étudier l'allure mélodique d'un langage, la répartition des aspirations.
Les médecins y puisent des renseignements précieux sur les déformations vocales causées par certaines maladies.
Le psychologue y trouve des données qui le conduisent à des résultats rigoureusement exacts.
Cela est l'évidence même pour ce qui concerne les troubles du langage, concomitants reconnus de nombreuses affections. Mais il apparaît maintenant que certains indices vocaux, chez la personne normale, permettent de recueillir des données intéressantes sur la complexion psychique de l'individu. C'est la graphologie transportée dans le domaine du son.
Mais jusqu'à présent ce sont surtout les zoologistes qui ont profité des travaux du professeur Doegen. Le rugissement du tigre, enregistré alors que l'animal se trouve dans des situations diverses (sous l'empire de la faim, en colère, etc.), le barrissement de l'éléphant sont fixés par le disque. Il va sans dire que les enregistrements les mieux réussis jusqu'à ce jour sont ceux qui se rapportent aux oiseaux.
Les juristes même peuvent faire appel de façon inattendue à l'enregistrement phonographique. Wolke nous en cite un exemple amusant. Dans un procès, il se trouve que l'on attribue à un témoin un propos dont l'importance était décisive pour l'accusé. Or, le témoin habitait trop loin pour qu'on le pût convoquer. Le tribunal ordonna que la voix de ce témoin fut fixée sur un disque, et ce disque envoyé dans le plus bref délai. Les autres témoins reconnurent par serment la voix enregistrée comme étant celle qui avait prononcé les paroles libératrices, et l'acquittement fut prononcé.
Nombre de collectionneurs mettent un point d'amour-propre - quelque peu déplacé, à posséder quelques disques remarquables par un « raté » d'enregistrement ou tout simplement des disques idiots.
Les disques algériens enregistrés sur place offrent nombre d'impairs. Le microphone perçoit encore les dernières recommandations du chef d'orchestre (Gramophone K 2342). Un musicien laisse échapper un juron arabe (Gramophone K 2932).
On connaît le fameux enregistrement du Roi d'Ys chanté par le ténor Rogatchewsky où le chanteur, la mélodie terminée, lâche un « Et voilà » des plus satisfaits (Columbia).
Dans les Ânes du Caire (Columbia 7015), le ténor Thill fait une liaison des plus amusantes - bien involontairement.
On pourrait citer une foule d'exemples de ce genre. Mais que dire sil s'agissait de faire un
choix des disques idiots ? Soyons justes, néanmoins, et reconnaissons que la plupart de ces disques n'existent plus que sur les catalogues d'enregistrements anciens. Ce sont tout d'abord les disques grivois ou soi-disant grivois, où une pudique censure remplaçait par des silences les mots risqués.
Ce sont ensuite les « reconstitutions de scènes historiques ». Nous en sommes définitivement délivrés grâce aux récents enregistrements de musiques militaires anciennes. Que ceux qui, néanmoins, voudraient se procurer des disques sensationnels dans cet ordre d'idées puisent dans l'ancien catalogue général Odéon et recherchent le n° 97338 : Le Sacre de Napoléon 1er (Reconstitution historique d'après les documents littéraires et musicaux de l'époque).
Citons encore, pour finir, le « Qui Tollis » de la Messe en si mineur de Bach (Gramophone W 863) où l'on entend, au début, un choriste donner le la, - et le Prélude de l'Après-midi d'un Faune (Columbia), où l'on entend, au début de la première face, éternuer un musicien ; le « Ça y est ? » interrogateur qui termine le Ranz des Vaches de la Fête des Vignerons (Polydor). De tels exemples sont assez courants pour nous dispenser d'en établir une liste plus ample.
Ces prix sont ceux de la date de parution de l'ouvrage, et sont susceptibles de varier.
25 N (Danse : série 100) .......................... 18 »
25 Violet (Opéras : série 5000) ................. 18 »
25 Violet (Chant : série 10100 et 13000) ... 21 »
25 Or (Classiques : série 13000) ............... 25 »
25 Or (Classiques : série 15000) ............... 25 »
30 N (Opérettes : série 20000) .................. 25 »
30 Violet (Orchestres : série 25000) .......... 30 »
30 Or (Classiques, etc. : série 50000) ........ 45 »
Les disques Brunswick n'ont pas adopté le système du prix uniforme appliqué aux disques de même diamètre et de même couleur d'étiquette. Les numéros entre parenthèses qui suivent l'indication des caractéristiques du disque cherché se rapportent à son numéro de catalogue.
Par exemple, le disque de 25 cm. de diamètre, étiquette or, qui porte le numéro 15505 appartient à la série 15000, et coûte 25 fr.
25 N (25 centimètres, étiquette noire) ....... 18 »
25 M (25 centimètres, étiquette marron) .... 21 »
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 22,50
25 B (25 centimètres, étiquette bleue) ....... 25 »
25 Violet (25 centimètres, étiquette violette) 36 »
30 N (30 centimètres, étiquette noire) ....... 25 »
30 M (30 centimètres, étiquette marron) .... 35 »
30 R (30 centimètres, étiquette rouge) ....... 37 »
30 B (30 centimètres, étiquette bleue) ....... 40 »
30 Violet (30 centimètres, étiquette violette) 48 »
GRAMOPHONE
25 V ou G (25 centimètres, étiquette verte
ou grenat) .......................................... 18 »
25 N (25 centimètres, étiquette noire) ....... 25 »
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 37 »
25 Ch (25 centimètres, étiquette chamois) . 45 »
30 V ou G (30 centimètres, étiquette verte
ou grenat) .......................................... 25 »
30 N (30 centimètres, étiquette noire) ....... 40 »
30 R (30 centimètres, étiquette rouge) ....... 55 »
30 Ch (30 centimètres, étiquette chamois) . 62 »
30 Blanche (30 centimètres, étiquette blanche) 95 »
30 Vert pâle ............................................ 55 »
30 Blanche ............................................. 75 »
A chacune de ces catégories de disques correspond une lettre qui précède, sur les catalogues, le numéro du disque. La lettre K, par exemple, désigne les disques de 25 centimètres de diamètre, étiquette de couleur verte ou grenat. Nous jugeons utile de donner ici l'équivalence des lettres désignant les disques du Répertoire international de « Gramophone » :
B = K (25 V ou G), C = L (30 V ou G), D = W (30 N), P = E (25 N).
ODEON
25 B (25 centimètres, étiquette bleue) ....... 18 »
25 V (25 centimètres, étiquette verte) ....... 22,50
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 25 »
25 Mauve (25 centimètres, étiquette mauve) 30 »
27 Brune (27 centimètres, étiquette brune) 25 »
30 V (30 centimètres, étiquette verte) ....... 32 »
30 R (30 centimètres, étiquette rouge) ....... 40 »
30 Mauve (30 centimètres, étiquette mauve) 45 »
Chapelle Sixtine, 30 cm. (Série spéciale) .. 52 »
Les disques « Fonotipia » qui comprennent surtout des enregistrements d'opéras italiens, font l'objet d'une liste de prix spéciale.
PARLOPHONE
25 B (25 centimètres, étiquette bleue) ....... 18 »
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 18 »
25 M (25 centimètres, étiquette marron) .... 22,50
30 R (30 centimètres, étiquette rouge) ....... 32 »
30 M (30 centimètres, étiquette marron) .... 37 »
30 C (30 centimètres, étiquette bleu ciel) .. 40 »
PATHÉ
25 N (25 centimètres, étiquette noire) ....... 16 »
25 V (25 centimètres, étiquette verte) ....... 18 »
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 20 »
PATHÉ-ART
29 Orange (29 centimètres, étiquette orange) 25 »
30 cm. 5 multic., bord bleu (30 centimètres
1/2, étiquette multicolore, bord bleu) ... 35 »
30 cm. 5 multic., bord orange (30 centimètres
1/2, étiquette multicolore, bord orange) 35 »
Les numéros des disques à aiguille de la marque Pathé sont précédés d'un X, pour les différencier des disques à saphir qui portent les mêmes numéros.
POLYDOR
25 V (25 centimètres, étiquette verte) ....... 18 »
25 N (25 centimètres, étiquette noire) ....... 24 »
25 Violet (25 centimètres, étiquette violette) 24 »
25 R (25 centimètres, étiquette rouge) ....... 34 »
30 V (30 centimètres, étiquette verte) ....... 25 »
30 B (30 centimètres, étiquette bleue) ....... 40 »
30 N (30 centimètres, étiquette noire) ....... 40 »
30 Violet (30 centimètres, étiquette violette) 40 »
Choix de quelques-uns des meilleurs textes critiques consacrés au phonographe
(L'intransigeant.)
Le Disque et l'Opérette française
Peu de questions ont plus d'importance, dans l'exploitation des disques, que celle des disques d'opérettes. Ce sont les seuls qui peuvent actuellement, faire une concurrence sérieuse aux enregistrements d'opérettes d'outre-Atlantique, ou de danses de New York.
Cette opérette de chez nous, à laquelle le disque devrait faire une propagande si puissante et si utile, est mal défendue par nos disques. Ceux qui ont du goût pour elle seraient bien embarrassés de trouver deux enregistrements qui leur donnent satisfaction. Or, notre répertoire est considérable. Depuis Offenbach jusqu'à Yvain, en passent par Lecocq, Audran, Planquette, Messager, Terrasse, Szulc, Christiné, pour ne citer que les principaux, que d’œuvres charmantes, que d'airs populaires que tout le monde souhaiterait d'entendre. Les orchestres des brasseries le savent bien qui n’ont jamais plus de succès que lorsqu'ils offrent à leur clientèle les pots-pourris de la Fille de Madame Angot ou de la Mascotte. Il semble donc que dans une discothèque bien composée devraient prendre place, à côté des enregistrements d'opéras-comiques, ceux de ce genre qui fut, pendent si longtemps, si particulièrement nôtre. Pour cela que faut-il ? De bons chanteurs, un choix judicieux des morceaux. Les bons chanteurs nous les aurions, si nos artistes de théâtre voulaient bien se convaincre que le fait de chanter devant un appareil enregistreur n'est pas une tâche inférieure à leur talent, et s'ils étaient persuadés que ce n'est pas là une besogne supplémentaire et bien payée, mais un travail complémentaire et qui doit leur rapporter des bénéfices matériels sans doute, mais moraux aussi.
Le choix judicieux des airs, il est facile à faire, à la condition qu'on veuille bien ne pas disperser les efforts et donner sur un grand disque, comme cela se fait en Amérique, les trois ou quatre refrains principaux de l’œuvre.
Ainsi nous obtiendrons une anthologie de l'opérette française qui plaira non seulement aux Français, mais aux étrangers. Il faut que nos éditeurs pensent à l'avenir qui, avec le développement de la musique mécanique, avec le cinéma parlant, prendra pour eux un nouvel aspect. S'ils négligent de faire les efforts nécessaires, demain l'édition américaine contre laquelle ils luttent déjà si difficilement, sera maîtresse de tous les débouchés, dans le monde entier. Et l'art de chez nous en mourra.
(Paris-Soir, La Rampe, La Revue Mondiale.)
Les soins de Columbia disposent pour nous chaque mois leurs nouveaux disques, miroirs nègres où nous nous reconnaissons fraternellement.
Ils sont revenus avec Virginia et In the evening. Nous avons vu refleurir le sourire de Johnstone inclinant au clavier sa voix offerte à la voix de Layton. Grâce au disque, nous nous penchons à notre gré vers l'émotion de ces sonorités tendrement bourdonnées où éclot une diction précise et veloutée, vers le merveilleux exemple du soin que, sans rien qui pèse ou qui pose, ils appliquent à une prosodie rigoureusement logique. L'élégante sûreté de leur musicalité n'aura jamais épuisé les combinaisons polyphoniques où le rythme, insinué et pourtant incisif, s'ébroue comme en se jouant, ni appliqué, ni désinvolte, - et sans même l'afféterie dont parfois un certain snobisme serait tenté de souligner cette grâce-là.
En chair et en os, pour un soir, ou au disque pour vos meilleures heures d'intimité, ils sont chaque fois plus divers, et cependant toujours les mêmes. Nous aussi. Aujourd'hui comme hier, de Every Sunday ou de Some day you'll be sorry, nous pouvons écrire : « Quel est le secret de leur art incomparablement direct ? » Turner Layton, fils d'un professeur de musique réputé, se fit, avant ses tournées, une réputation de compositeur. Clarence Johnstone est docteur en médecine. Ils se rencontrent, chantent en Angleterre pour le Prince de Galles en 1924, et voici, foudroyant, le succès. Or, le secret de leur art ne peut-il être nommé : la vie ? De combien d'observations sont formés ces tableautins sonores qu'ils composent instantanément, par petites touches, avec le scrupule le plus délicat du détail et pourtant le soin constant de l'ensemble ! Leur adorable charme sans insistance, doux, fort et sain, polarise diversement, comme sans délibération, toute l'intelligence et toute la sensibilité autour du goût infaillible. »
...Ils n’emploient pas les mots des autres, quoique ne les reniant pas. De même que Reynaldo Hahn fit chanter du Lully à Fragson, n'a-t-on pas, quelque part, souhaité de les entendre interpréter des duetti du XVIIe siècle italien ? Mais, écoutez My heart stood Still, par exemple : C'est tout d'abord une voix seule qui barytone sans erreur, dans une sobre tendresse penchée qui affine et intensifie à la fois une sonorité exquisément vibrée; puis, avec une discrétion persuasive, insensiblement, mais infailliblement, nerveux sans rigueur, distingué sans dandysme, ce duo sacre le jazz, risque de notre romantisme à nous, exaltation de notre temps tout craquant de poésie.
- « Songez que jusqu'à quatre cent mille disques d'un même enregistrement peuvent être dispersés à travers le monde. Quel livre atteint ce tirage ? » - me disait un jour Jean Bérard, ce metteur en disques dont le discernement vaudrait une étude, à travers tant de formidables programmes où s'atteste sa culture en fonction du sens de la vie le plus sensible.
Et je songe ce qu'on peut fraternellement espérer des hommes qui, grâce au disque, se sont penchés à leurs heures sur l'art proche, équilibré et frémissant, de Layton et Johnstone.
(La Rampe.)
(L'Humanité.)
Le disque est cher, mais n est cependant pas un objet de luxe. En U. R. S. S., il est déjà utilisé très souvent dans les clubs comme moyen d'éducation. Dans sa dernière chronique de Monde, Henry Poulaille parlait de son utilisation dans les écoles pour l'éducation musicale, poétique, etc... Mais attention ! si certaines commissions officielles s'intéressaient à la chose avec diverses maisons, voyant là un nouveau débouché commercial, de quels textes littéraires ne farcirait-on pas encore la tête des gosses, nous n’ignorons pas à quelles fins !
Plus immédiatement, les camarades qui n'ont pas le moyen d'acheter personnellement cinq ou six disques par mois, ce qui est une forte somme dans le budget d'une famille, ne pourraient-ils se grouper pour se procurer des disques en commun ? Là où quelques groupements ouvriers existent déjà, avec salle de récréation, bibliothèque, etc... et dans les clubs sportifs, on ne manquerait pas ainsi, tout en s'instruisant agréablement, de s’attirer de nouveaux amis.
N'est-il pas utile par exemple de profiter de leur édition phonographique pour écouter et apprécier à leur juste valeur deux des cinq ou six grands chefs-d’œuvre de la musique française : la Symphonie Fantastique, de Berlioz, et les Nocturnes, de Claude Debussy ?
La Fantastique vient d'être enregistrée, excellemment chez Odéon, par l'orchestre Colonne, comme précédemment le Carnaval Romain et Roméo et Juliette, mais incomplètement, en commençant par la fin (Un bal, Marche au Supplice, Songe d'une Nuit de Sabbat) et en faisant occuper deux faces de disque à la Marche au Supplice en la coupant mal. Ce monument du Romantisme, qui décrit les rêveries et les aspirations vagues d'un adolescent, au milieu desquelles passe et repasse, cristallisée en une phrase musicale intensément et doucement expressive, une apparition féminine, puis son délire où il devient la proie d'un monde imaginaire se jouant sardoniquement de lui et de la douce apparition qui le hante, ce monument du Romantisme est vu d'aujourd'hui, d'une clarté, d'une vigueur de sang qui le placent aux plus hauts rangs de la musique et du lyrisme.
Et c'est remarquable maintenant que tant de romantisme échevelé nous parait de loin souvent ceux et stupide. Mais une œuvre d'une telle trempe, nous la voyons si significative du caractère de Berlioz si nous n'oublions pas que ce sauvage de la musique, en apprenant son art sans méthode et à coup de ratures, a vécu à Paris, sans parents ni amis, en pleine misère : certains jours, vivant en commun avec un étudiant, il se nourrit de quelques grappes de raisin ; le lendemain, leur dépense s’élève à « 43 centimes de pain et 25 centimes de sel ».
Au dos du dernier disque, on a eu la bonne idée d'éditer (orchestre Colonne) la Joyeuse Marche d'un des meilleurs musiciens français (un amateur) : Emmanuel Chabrier, dont l'España est si populaire. La Joyeuse Marche est une œuvre d'un brio très coloré qui, comme toujours chez Chabrier, frise jusque dans la vulgarité une élégance peu commune : Satie reconnaissait lui-même quelle influence il avait reçue de la musique de Chabrier.
***
Chez Gramophone, dont la qualité de disque semble s'améliorer légèrement, voici les Nocturnes de Debussy, dont j'ai déjà parlé de l'édition des « Nuages » par Columbia. L'exécution intégrale (3 disques) qu'en donne l'orchestre Coppola n'est pas une merveille : l'équilibre des sonorités en est même parfois bien discutable. Mais l'achat d'une telle œuvre est à conseiller. Les Nocturnes sont l'œuvre la plus typique de Debussy, sinon la plus intégralement parfaite. Joués en 1900 chez Lamoureux, ils restent l'impressionnisme dans toute sa pureté, sans littérature, en dépit de son caractère descriptif, sans subjectivisme vasouillard, sans une seule déliquescence orchestrale. Il est certaines œuvres où le génie de leur auteur nous parait incommensurable, sans commune mesure. Ainsi la 5eSymphonie de Beethoven, la Damnation de Berlioz, le Tristan, de Wagner, Socrate de Satie. Les Nocturnes sont de celles-là. Quoique venant en ligne droite, par leurs « nuages » de la conception musicale des Steppes de l'Asie centrale de Borodine, ils expriment le génie de Debussy dans toute son authenticité et sa nouveauté.
« Nuages, a écrit l'auteur de Pelléas, c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise doucement teintée de blanc. » Fêtes, c'est comme une poussière de fêtes, de lumières et de musiques, traversée par un cortège éblouissant. Et Sirènes (qu'on entend si rarement su concert (à cause des chœurs) « c'est, dit Debussy, la mer et son rythme innombrable, puis, parmi les vagues argentées de lumière, s'entend, rit, et passe le chant mystérieux des sirènes. »
Il y a trois œuvres françaises où les voix de femmes apportent brusquement une émotion considérable, une sensation d'humain surprenante : c'est le chœur de la Musique de Chabrier, les chœurs des Choéphores et des Euménides de Milhaud, et la voix des Sirènes de Debussy : là, soudain, après les chatoiements de l'orchestre, surgissent les sanglots, si heureux et charmeurs des voix féminines, musique d'ondes et de chevelures ; - et je songe aux premières lignes du poème de Lautréamont : Quand une femme à la voix de soprano émet des notes vibrantes...
Miracles du disque de cire...
(14 octobre 1928.)
ROBERT DESNOS
(Le Soir.)
Chez les brocanteurs, eu marché aux puces, ils gisent, blanchis par la poussière, écornés parfois...
Ce sont les vieux disques, ceux d'avant la guerre. Des gens les ont écoutés qui sont morts maintenant, ou qui sont vieux, et de jolies femmes qui sont devenues laides.
Achetez ces vieux disques et demandez au fantôme qu'ils abritent de chanter à nouveau pour vous la tendre romance ou le monologue ordurier (car nos pères qui font la sourde oreille aux admirables voix que nous aimons et qui parlent de pornographie au fur et à mesure que baissent leurs facultés, n’étaient pas des gens si difficiles.) Je recommande à ce propos le monologue intitulé « les pilules de Collardeau », gauloiserie, esprit français, ordure, clair génie, rien n’y manque. Nos pères ont aimé des cochonneries que la génération de jeunes mufles que nous sommes, au dire des pseudo moralistes, ne supporterait pas)... Demandez au fantôme qu'ils abritent de surgir à nouveau parmi le parfum rance des lilas de jadis, avec son arsenal de rubans, de corsets, de dessous en dentelles et de peignes côtoyant des lettres d'amour et des éventails.
Et ne vous attendrissez pas. Ces jours sont révolus, mais l'amour qu'exhalent ces voix défuntes survit à la vigueur des amants, à la beauté des maîtresses, à la forme des robes, au langage même. Et tant pis pour ceux-là qui n'auront considéré de l'amour que sa forme périssable et qui n'auront pas uni en leur âme comme au creuset d'un alchimiste l'esprit immatériel et la chair séduisante.
Tant pis pour ceux-là, dont la voix étouffée à jamais dans les alcôves poussiéreuses ne trouvera pas l'écho abyssal qui est un décevant mirage et une merveilleuse réalité.
Comme l'amour.
Ted Lewis
Il existe un jazz ennuyeux : Witheman, Jack Hylton ont produit des disques impardonnables, et cela dès que, grisés par on ne sait quelle stupide ambition, ils prétendaient faire de la grrrande musique. Il est juste de reconnaître qu'ils reviennent de cette lourde erreur et qu'ils abandonnent l'art pour la fantaisie et la poésie qui inspira le jazz à sa naissance.
Ted Lewis, le roi du jazz, n'est jamais ennuyeux. Ceux à qui il fut donné de l'entendre à l'Apollo savent que l'homme est digne de sa voix. Ce grand escogriffe si singulièrement élégant animait une bande de lascars possédés du démon du bruit, du rythme et du mystère. Et Ted Lewis disait des vers... Depuis la mort de de Max, il ne nous avait pas été donné d'entendre dire des vers d'aussi admirable façon. Il n'est pas un acteur français qui n'aurait de leçons à prendre de Ted Lewis, si la manière de dire les vers pouvait s'apprendre dans un quelconque Conservatoire. Il est vrai que nous avons la comédie française, qui dépasse en burlesque et en sottise tout ce que la fantaisie d'un humoriste pourrait imaginer.
Les qualités de Ted Lewis sont intégralement conservées par le disque, et je conseille à tous d'écouter un soir My own yione ou Good night.
(Les Nouvelles Littéraires, L'Art Vivant.)
Au temps des empereurs, Richard Strauss a connu une gloire que les temps nouveaux n'accorderont sans doute jamais plus à leurs vivants héros. Gloire de théâtre, toute couronnée de lauriers dorés au pinceau, de gerbes nouées aux couleurs des « Verein ». Mais combien grisante pour un musicien germanique, seul jugé digne de porter le sceptre et la cuirasse du dieu Wagner.
Sa confiance fut seulement ébranlée le jour où Paris lui fit connaître qu'on ne le conquiert point sans charme ni gentillesse. L'anecdote est connue : au pupitre de l'Académie nationale de musique, Strauss faisait répéter l'orchestre. Enervé par quelque imperfection, comme il se plaignait haut de l'indiscipline des Français tout en arrêtant d'un geste sec les musiciens, ceux-ci se levèrent tous ensemble et quittèrent les pupitres.
Une telle nervosité est tout au long de l’œuvre magnifique de Richard Strauss, soit qu'il sous-estime ses moyens, soit qu'il abuse témérairement de ses dons. Mais n'est-elle point fréquente chez les peuples germaniques, et le signe de leur inquiétude, moins constants qu'ils sont dans leurs passions que les Français, prétendus versatiles et légers ? L'influence d'un Frédéric Nietzsche perceptible dès les premiers livres de Maurice Barrès et d'André Gide, est présente encore jusque dans la technique et l'attitude des jeunes écoles littéraires, cependant que l'Allemagne relègue le philosophe dionysiaque dans le magasin de curiosités. Et voici que la Belgique et la France s'éprennent de Richard Strauss et lui tressent une couronne d'harmonies : à Bruxelles, on joue aux concerts du Conservatoire Zarathoustra et Don Juan ; à Paris, on peut entendre Till Eulenspiegel, le Chevalier à la Rose, et rien ne fut plus applaudi aux récents concerts de Mme Elisabeth Shumann, que les lieds où la cantatrice préférée du maître s'évertuait à faire revivre des sentiments que, prétend-on, elle a inspirés.
Ceux qui n'eurent point le bonheur d'être ses auditeurs découvriront cette chanteuse à sa perfection dans quelques lieds : Wiegenlied, Freundliche Vision, Stændchen, Morgen (Gramophone) et ceux qui l'entendirent devront avouer que le phonographe ne trahit point les qualités d'une voix assez peu puissante, mais conduite par une intelligence parfaite, intime, d'une remarquable musicienne.
Richard Strauss, s'il se montre disciple obéissant de Mozart, dans le Chevalier à la Rose, s'en est détaché totalement dans son Don Juan. Ce n'est plus le personnage bouffon et tragique, fils de Casanova, bien moins d'Espagne, où l'amour est sombre, si passionné, que d'Italie, et tout accompagné de masques, de fêtes bachiques et de duels de carnavals. A l'instant de son désastre, lorsque son palais s'effondre sous les flammes infernales, Don Juan est saisi, en plein jeu, en pleine farce. C'est que le Don Juan de Mozart a fait des délaissées et non des désespérées, même de Donna Anna, qui trouve en un cœur lyrique la ressource de chanter un bon quart d'heure sur le corps gisant de son père.
Richard Stratus a vu en Don Juan bien moins un amoureux qu'une idée-force, bien moins un séducteur qu'un conquérant. La femme n’est pour lui qu'une des formes de son enthousiasme. Il s’élance, implacable, et, s'il connaît le désespoir brutal et rapide, c'est d'avoir limité son rêve à une réalité trop aisément atteinte. Le musicien contemporain a construit son poème symphonique sur ce thème du désir, dans une atmosphère de fête d'où son héros sont triomphant. Mais à l'instant où il rêve de quelque conquête idéale comparable aux idéaux sublimes d'un Jacob Boehme et des grands mystiques allemands, sa conquête lui échappant, le livre définitivement au doute de lui-même, de sa force. Et, désormais, il est anéanti. Ce poème est excellemment traduit par l'Orchestre Symphonique du Gramophone, auquel nous préférons, cependant, pour cette exécution, l'Orchestre Royal Philharmonique, sous la direction de Bruno Walter (Columbia). Le chef de Paris acclamé, lors de la récente saison Mozart, possède non seulement une technique implacable, mais un charme qui lie tout l'orchestre et tout l'auditoire à la perfection de sa pensée.
Nul n'était plus capable de diriger Don Juan, car il vécut dans l'intimité de Richard Strauss, lorsqu'il partageait avec lui, en 1900, le pupitre de l'Opéra de Berlin. Enfin, Strauss, lui-même, a voulu mettre en valeur une sélection du Chevalier à la Rose(Gramophone), conventionnelle et décevante comme toute traduction de la voix humaine par l'orchestre, mais cependant bien illustrative...
(Les Nouvelles Littéraires.)
(L'Ere Nouvelle.)
La Muse des Mers n’a rien d'une sirène. C'est une rude fille qui a mis sac à bord, boit la double, et paumoie le filin en chantant. C'est elle qui, pour aider les gars, leur donner du cœur au ventre, a trouvé ces naïfs et sauvages refrains, que les longs courriers se passent de bouche en bouche, vieux airs nés sur les barques d'antan et qui ont à peine changé, pas plus que les gestes rituels des hommes hissant ou virant.
Chansons à hisser, chansons à virer, chansons de gaillard d'avant. Les premières, on ne les entend guère qu'aux heures de lutte avec le grain, quand le vent et les lames bordent la voix des hommes de leurs terribles basses. Un matelot chante, les autres répondent, le pont danse sur bord, et la grosse brise arrache les paroles aux bouches tordues, dispersant au large la complainte râlée.
C'est alors que s'élève Valparaiso, l'étrange refrain que nul d'entre nous n'a oublié s'il l'a chanté avec les camarades, quelque part du côté du Cap :
Nous irons Valparaiso,
Good bye farewell,
Good bye farewell !
Il y a plus de cent ans qu'elle traîne sur les eaux, la vieille, et sous tous les pavillons. D'abord, complainte d'adieu des baleiniers - ô vieille marine - elle a conquis peu à peu les autres hommes, comme ce cher Jean-François de Nantes, qui m'est aussi resté dans la mémoire, souvenir de mes naviguées, bateau dans sa bouteille, mélancolique chanson avec un Jean-François affalé à la fin de chaque strophe, tel un gars qu'on jette à l'eau. Tristesse des jours bouchés, dans les mers du Sud, quand le ciel est en bouillie, dureté du métier, regrets des joies de la terre lointaine, lourdes les bottes, trempé le « cirage », loin le beau temps.
Mais les matelots ne font plus de nouvelles chansons ; ils se contentent des anciennes. Et celles-ci, combien de temps encore les entendra-t-on ? Si les voiliers abattent un jour leurs mâts comme une forêt qui perd ses arbres, où iront se perdre ses volées d'oiseaux marins et le souvenir des anciens qui les chantèrent ?
Mais un homme, le capitaine au long cours, Armand Hayet, a eu l'heureuse idée de recueillir les plus belles images de ce folklore flottant. Comme le livre n'y suffisait pas, il a confié au disque la tâche de les transmettre aux années futures et déjà de les faire connaître aux terriens. Enregistrées par Columbia, quatre chansons déjà sont entrées dans la cire : Valparaiso, Margot, le Grand Coureur, les Pêcheurs de Groix. Sous l'aiguille fidèle, elles sont prêtes aujourd'hui à redire sans fin le secret de l'aventure marine, la peine des hommes, la résignation des longs courriers harassés, peinant, veillant, sous les durs coups de chien. Une voix, celle de Maguenat, lance, comme à bord, les premières paroles, puis le chœur s'élève, répond dans un rythme un peu pesant, pareil à celui qui scande l'effort des reins et des bras. Impression saisissante à laquelle il ne manque que les bruits de la mer, les rauques clameurs du vent, le coup de tonnerre des lames sur la coque et sur le pont, les gémissements du navire qui souffre et se plaint de toutes ses vergues secouées. Mais cette chanson-là, les longs courriers qui recréaient devant le microphone de Columbia un souvenir de leur vie, pouvaient-ils la donner ?
Tels qu'ils sont, ces deux disques sont singulièrement évocateurs. Ils démontrent aussi les ressources infinies du phono qui peut sauver tant de richesses populaires, dispersées encore ou mal connues, mais qui risquent de s'effacer un jour de la mémoire humaine. Darius Milhaud vient de lancer un émouvant appel en faveur de ces trésors du folklore. L'essai de Columbia nous laisse entrevoir d'heureuses réalisations.
Puissions-nous, un jour, retrouver toutes ces voix, comme je viens de retrouver la mer. Je pense à ceux qui furent mes compagnons de bordée et qui, peut-être, aujourd'hui, ancrés je ne sais où, ont la boîte magique sous les mains et ces deux disques. Dès que le chant jaillira des spires, ils reverront le trois-mâts barque, les nuits du Cap, les quarts bouillonnant de grains et d'eau malade, Ils fumeront leur pipe en se balançant doucement comme autrefois. Et si le vent frappe à leur fenêtre, si la pluie travaille la nuit, ils n’auront qu’à fermer les yeux pour se croire, au diable, vers les Malouines, ou plus bas encore, en train de paumoyer dur.
Peut-être l'un d'eux songera-t-il à moi qui pense à eux. Mais tous, j'en suis sûr, penseront à leurs frères de navigage qui furent de bons matelots et ils leur diront, comme Conrad aux hommes du Narcisse : « Jamais meilleurs ne gourmèrent avec des cris sauvages la toile battante d'une misaine alourdie, ni balancés dans la mâture, perdus dans la nuit, ne renvoyèrent plus bellement abois pour abois à l'assaut d'un grain d'ouest. »
Et quand le disque aura tourné, que la chanson se sera tue, ils auront les mots de Valparaiso aux lèvres, dédiés aux amis perdus et à la mer :
Good bye farewell,
Good bye farewell !
(La Revue Hebdomadaire, Le Journal.)
Si le Val-de-Grâce, vu de l'intérieur, vous tient sous autant de charme que Saint-Pierre de Rome dont il est la réduction, n’est-ce pas parce que Mansart, en réduisant les rapports des murailles aux fenêtres, a réussi une récapitulation purgée de la fameuse basilique ? La justesse élégante n'est pas fonction de dimensions, mais bien de rapports. Aussi l'amplification relative que l'on obtient par le microphone, comparable au grossissement cinématographique, n’est-elle recommandable que dans la mesure où elle agrandit proportionnellement tous les détails, dont certains ressortent mieux ou même nous sont révélés. Cette méthode prend toute sa valeur quand elle agit sur la voix de M. Reynaldo Hahn chantant le délicieux Devin de Village de Jean-Jacques, ou sur celle de M. Vanni-Marcoux chantant la Sérénade de Don Juan. Ces artistes retrouvent véritablement une seconde nature vocale. Elle nourrit de façon inattendue un art du chant qui apparaissait jusque-là comme un exercice presque formel.
C'est au contraire la technique inverse, celle de la réduction, qui parait favoriser les enregistrements de chœurs religieux.
Le miracle du disque, c'est bien de surprendre et de poursuivre le développement de l'écho, le retentissement des voix sous les voûtes. Il provoque une véritable résurrection mentale de la nef. La moindre résonance excessive de cet écho grossit l'effet plus que la cause, trahit la mécanique. Et voilà l'enchantement rompu, l'édifice en ruines ! Le département de l'irréel a donc plus d'exigences encore que celui du réel.
C'est ainsi que la Passion selon saint Jean, telle que viennent de l'enregistrer les trois cents chanteurs du Conservatoire de Bruxelles avec orchestre, dirigés par M. Defauw, est entachée d'un excès d'orgueil technique. Document important mais provisoire.
A ces disques trop puissants, comparez les enregistrements plus atténués de la Messe en si mineur chantée par la Royal Choral Society, notamment l'admirable Sanctus, et le Magnificat de la « Société Bach ». Les premiers surtout nous font participer plus intimement à cette pénombre d'église, toutefois un peu lointaine, à quoi s'intègre si discrètement l'éloquence directe de J-S. Bach.
Voici les enregistrements qui, à notre avis, réalisent le milieu exact entre les précédents. Un fragment de la Passion selon saint Mathieu, chanté par le célèbre Chœur Irmler avec une sereine et ferme douceur. D'autres fragments de la même Passion, la plus pathétique que Bach ait écrite, chantés par cet interprète sans doute inégalable des chants religieux : le Chœur de Bruno Kittel, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Là, comme dans la Messe solennelle de Beethoven, due aux mêmes exécutants, il faut bien convenir que l'art du disque touche à la perfection. L'intensité et la pureté de la reproduction chorale abolissent tout indice de musique mécanique. Le duo du contralto et du soprano dans le douloureux So ist mein Jesus nun gefangen et le chœur final atteignent à une exactitude aussi émouvante que l'exécution directe du drame sacré.
Voilà bien où le phonographe nous dispense ses plus forts et ses plus secrets avantages.
Déjà il nous procure des interprétations de Bach aussi variées et inattendues que celle d'Andrès Ségovia jouant sur une guitare vraiment surnaturelle une délicieuse Gavotte, celle de M. Woodhouse, qui rajeunit habilement sur un clavecin, le délicieux concerto italien, et celle aussi des chœurs d'enfants de l'Ecole ecclésiastique de Saint-Thomas, à Leipzig (J.-S. Bach, de son vivant, composa, paraît-il, spécialement pour cette phalange. Ecoutez deux de ses fugues et cantiques psalmodiés par ces voix fausses et fraîches, surprenantes de discipline.) Mais tout cela constitue le rare, l'accidentel. Tandis qu'avec des enregistrements aussi parfaits que ceux de l'Irmler ou du Knittelchor, notre privilège s'étend à tout l'essentiel et même à tout l'exceptionnel.
Ces disques nous découvrent les aboutissants extrêmes de l'inspiration de Bach ; son dessein profond, total : fusion anonyme des voix, des instruments, de l'ombre et de la nef ; participation du silence matériel de l'église et du grand silence spirituel, où vous entretient la magie de ces intérieurs de cathédrales surgis d'un modeste plateau de cire noire.
L'oreille recouvre ce sens qu'on lui refusait de la représentation et de l'imagination spatiales.
Tout l'Ordre, en somme, et tout le Luxe.
(Le Crapouillot.)
Nous atteignons - depuis quelques mois seulement - une singulière perfection dans la construction des appareils bons conducteurs de l'aventure, ou plutôt, ce qui est mieux, bons conducteurs du goût littéraire pour l'aventure qui pavoise la solitude avec les innombrables lumières par quoi les grandes villes du monde et les humbles villages animent le mystère de leurs nuits. Un poste récepteur de T. S. F., un phonographe, un ciné d'appartement, sont autant d'appareils à peu près mis au point qui mêlent l’aventure à notre vie, c’est-à-dire qui nous permettent d'imaginer et de recréer le monde selon nos besoins et selon la puissance de notre sensibilité. On n’entend jamais la fin d'un disque, la dernière parole d'un poste lointain ; on ne voit jamais la fin d'un film, car toutes ces auditions ou tous ces spectacles se prolongent indéfiniment dans l'esprit de celui qui les subit, comme l'arbre qui jamais n'entend la fin de la chanson du vent. L'aventure n'existe que dans l'imagination de celui qui la poursuit. Atteindre le but qu'elle fait miroiter comme un mirage saurait faire disparaître le plus beau film que chaque homme a déroulé dans la solitude ou la détresse morale pour son propre entendement et pour sa propre vue.
Il y a peu de temps encore, l'élite française se désintéressait du phonographe. Dès l'apparition de cet extraordinaire créateur de visions, nous avons, manqué de confiance. Et l'on peut dire qu'il y a un an nous ne connaissions pas, en France, le phonographe. Des appareils imparfaits, des disques mal enregistrés éloignèrent l'élite. La possession d'un phonographe conférait une sorte de brevet de mauvais goût. Aujourd'hui, des hommes de qualité ont entrepris la critique des disques comme on entreprend la critique des livres. Ils disent leur pensée, jugent, encouragent le choix du public, forcent en quelque sorte les maisons concurrentes à rechercher la perfection.
J'ai à peu près entendu tous les appareils à aiguille - je ne parle pas du saphir, qui est maintenant abandonné - et c'est avec enthousiasme que j’ai entendu, il y a quelques mois les premiers disques enregistrés électriquement. C'est une évolution formidable. Pour nous, hommes de 1927, quotidiennement blasés, elle peut encore créer cette émotion profonde qui donne à notre propre vie un élan que nous ne pouvons contrôler que longtemps après. J'ai chez moi une machine parlante qui ne trahit point, en qui j'ai confiance et qui pare la réalité d'un mystère que mon imagination peut développer dans le sens qui me plaît, au gré du jour ou de la nuit, au gré de l'heure.
Le chant, c'est-à-dire la chanson populaire, possède une puissance attractive singulièrement contagieuse. Les peuples s'attirent, sans se comprendre d'ailleurs, par l'extraordinaire sentimentalité nationale contenue dans les chansons chantées par les filles, les matelots, les ouvriers, les soldats, les enfants et quelquefois les désespérés, hors la loi de ce peuple. Quand je mets en marche mon appareil, ce n'est pas pour entendre la musique savante, c'est-à-dire le musique considérée comme un art, mais bien pour entendre la plainte qui vient de très loin comme le vent passe en gémissant le long des lignes de chemin de fer. Une voix anglaise qui chante une chanson populaire propage une émotion qui n’est pas celle qu'une voix française - celle si profondément émouvante de Mlle Mistinguett par exemple - peut nous procurer. Un chœur populaire russe possède sa qualité nationale, il exprime une mélancolie exclusivement russe comme la voix grave et chaude d'une femme de couleur éveille dans notre imagination une mélancolie d'une qualité particulière qui ne ressemble en rien à celle que la voix du gaucho nous apporte entre deux accords de guitare ou d'accordéon rythmés en tango.
Les livres lus s'associent étroitement à cet aspect le plus sincère de la sentimentalité d'une race. Tous les personnages d'Anton Tchekov évoluent dans le disque qui tourne en ce moment sur son pivot. Et la voix flamboyante de cette gitane évoque, comme un éclair de chaleur, une Espagne mordue par un soleil de civilisation catholique. La rêverie et l'aventure qui naît de cette rêverie, sont là, dans ce disque noir finement gravé. Un peuple naît, meurt, se prolonge, soit dans une plainte, soit dans un cri de joie inimitable. Toute la fantaisie sentimentale anglo-saxonne se trouve dans le chant des Revellers et Dinah, la fille noire, c'est encore les docks du Surrey et les West India Docks où tous les murs sentent le rhum. Dinah, fille de couleur, déracinée, regrette le pays natal, assise sur une balle de coton. Et cette douleur ne peut se confondre avec la nostalgie marine que la voix de Mlle Yvonne George lance à travers le monde avec la chanson célèbre des matelots de commerce : le Good bye, farewell que le poète Henry Jacques a chanté avec les autres Nantais, sur un cargo surchauffé.
Devant les images semées par le disque, l'imagination réalise des films d'une merveilleuse précision et comme la musique est un excellent révélateur, la plupart des hommes peuvent y découvrir, sinon la connaissance du monde, du moins une connaissance du monde conforme à leurs besoins sentimentaux. Et cela est suffisant. Tout ce qu'un voyageur peut dire ou écrire sur les pays qu'il a traversés est moins vrai que l'image componée par nous-mêmes grâce au courant poétique surgi d'un disque bien choisi.
Il faut choisir ses disques comme on choisit ses livres ; et comme il y a de bons et de mauvais livres, il existe de bons et de mauvais disques. M. Vuillermoz, qui depuis longtemps, fait la critique des disques, en musicien, et, ce qui est différent, en poète nettement situé dans son époque, aide profondément au développement d'un idéal social qui nous pénètre chaque jour davantage et qui est fait d'une curiosité internationale infiniment troublante. Il suffit de regarder un catalogue de disques nouveaux pour s’assurer de cet état d'esprit qu'il faut encourager. Un disque chanté par une voix qui émeut agit très vite sur la sensibilité. Il reste quelque chose de féminin, de très tendre dont l'empreinte est longue à s'effacer.
Je ne parle que des disques qui sont les reflets de la sentimentalité d'un peuple et dont la création littéraire est celle de la rue, de la savane, du steppe ou des docks.
(Extrait de Rue Saint-Vincent.)
J'avoue que j'exécrais les phonographes, de quelque marque, de quelque nature qu'ils fussent. On n’avait pas, jusqu'à ce jour, trouvé plus odieux ennemi du silence, qui est le bien le plus précieux et le dernier refuge de l'esprit. Dans un monde où - heureusement si l'on songe à ce que profèrent les humains - les animaux ne parlent pas encore, les machines, devançant illégitimement leur tour, tout à coup, par un renversement inouï et diabolique de l'ordre naturel, s'étaient mises à parodier la voix et le musique du roi de la planète, en leur enlevant ce qui leur restait d'âme, pour la remplacer par des bruits à peu près inavouables. De tous les triomphes de notre mécanique, c’était assurément le plus pernicieux et le moins tolérable. On eût dit une révolte des région inférieures, une propagation méthodique de tout ce qui est bas, accompagnée de ricanements métalliques, afin d'avilir l'homme et de précipiter sa démence. Jean de La Fontaine, aggravant son vieux plein de terreur panique, aurait dit :
« Et pour comble d'horreur, les machines parlèrent. »
Aujourd'hui je dépose mes préventions, mes armes et ma rancune. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles méthodes, grâce à ce petit coup de pouce que le génie innombrable de nos frères finit presque toujours par donner aux grandes inventions qui transforment les mondes, la voix de l'être humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus spécifiquement humain dans cet être, se fixe à jamais dans le temps, aussi vivante, aussi frissonnante qu'au sortir de ses lèvres. Et quand je parle de la voix, il va de soi que je parle en même temps de la musique qui n'est, en dernière analyse, qu'une voix qui dépasse ses limites, une voix d'outre-terre qui exprime déjà ce que le cœur et l'intelligence ne sont pas encore à même de faire entendre.
Elles vivent à présent dans leur « Double », aussi incorruptible que le « Double Egyptien » et ne peuvent plus se déformer, se dégrader ni se perdre. Et les plus hauts chefs-d’œuvre du génie de l'homme - car c'est incontestablement dans la musique qu'ils se trouvent - reposent désormais, à l'abri de la mort, dans quelques disques lourds de secrets spirituels, qu'un enfant de trois ans peut tenir dans ses petites mains.
(Texte inédit reproduit dans le programme du Gala Columbia, 15 décembre 1928.)
Qu'on enregistre la musique africaine
Trente ans séparent les tziganes du jazz, et quelles années ! Le violon est une arbalète, la mélodie un lasso; mais le jazz, c'est le coup de poing, le corps à corps. Repoussons le saxophone, charmant et plein d'humour nostalgique : c'est un instrument de compromis ; depuis mon séjour en Afrique, rien ne me satisfait que la percussion. Il est difficile de faire un livre sur les Antilles après avoir été en Afrique, tant l'Amérique est pâle et oubliable après la lumière du Soudan ou l'ombre de la Côte d'Ivoire : tout l'artificiel des accordéons de Harlem, des spirituels de Virginie, s'est évanoui : mes oreilles ne résonnent maintenant que des coups de tambours et des cris-cris de tam-tams. N'est-il pas injuste que tant d'argent, d'efforts soient dépensés pour nous donner ce qui n’est qu'imitation, qu'écho affaibli et que si peu soit fait pour nous initier à l'harmonie primitive, pour remonter aux sources africaines ? Assez de disques, même arrangés habilement au goût du jour par des Israélite galiciens ou des Russes de New York ; nous demandons désormais de l'authentique, Qu'on enregistre directement la musique africaine.
Batterie, percussions, détonations, ces termes d'artillerie viennent naturellement de la plume lorsqu'on parle d'elle. Le geste est une cadence, une détente musculaire que vient prolonger le son ; sons de bois et sons de fer, bruits d'ossements, calebasses pleines de graines sèches, bouteilles remplies de dons, soulignés par la matité des grands tambours.
Dans une remarquable étude sur les instruments de percussion, M. Michel Perron nous apprend que les tambours ont été apportés en Provence (galoubet et tambourins provençaux) par les Croisés, qui les tenaient des Arabes (en arabe, altambour), lesquels les avaient empruntés aux nègres. Joinville s'émerveille de leurs sons. Il faut attacher à ces tambours beaucoup d'importance. Sans parler ici des dessins symboliques qui les ornent (serpents : organes masculins ; tortues : organes féminins), il y a dans l'architecture du tambour une profonde signification religieuse. Après avoir convoqué les initiés, rempli son office de publicité divine ou diabolique, comme la cloche, qui n'est qu'un tambour de métal frappé de l'intérieur et originairement à la main comme en Asie (voir aussi les tambours de bonze shans), le grand tambour, posé verticalement, devient un autel et reçoit les objets du culte. On l'arrose de sang : sang humain chez les cannibales, sang d'agneau ou de volailles sacrées ailleurs. Amaury Talbot cite le cas d'un village nigérien qui avait l'habitude de sacrifier sur le tambour, comme première victime, l'artisan qui l'avait sculpté.
Certains tam-tams s'accompagnent de cris et de chants ; d'autres se passent en silence. Il faudrait recueillir ces curieuses déclamations hurlées, ces louanges criées des griots soudanais. Cette caste d'acteurs, d'historiographes accompagnent les chefs, les riches marchands, les étrangers de marque et, moyennant paiement, entonnent leurs louanges. C'est pourquoi un proverbe dit : « Les griots ne chantent que les louanges des vivants. » Mais celles-là, on les entend. Dans les entrevues politiques, les deux personnalités importantes qui sont appelées à se rencontrer commencent par rester face à face plus d'une heure, tandis que ces griots chantent leurs hauts faits, l'ancienneté de leur lignée et leur puissance. L'enregistrement de tout ce tintamarre héroïque, qui rappelle parfois l'Iliade, est à rapprocher du shouthing des congrégations noires, et ne manquerait pas de surprendre les Américains.
Cependant, je préfère les tam-tams où l'on n'entend plus que le sourd bombardement des peaux tendues sur leur cercle. Le tambour de bois évidé, en forme d'animal sacré et dont les plus beaux spécimens que je connaisse sont au Musée du Congo Belge à Tervueren, est surtout un instrument d'appel, en cas de danger, analogue à notre « générale ». Ces tonnerres creux, aux résonances infinies et profondes pourraient être admirablement inscrits dans la paraffine des disques. Ces crépitements, ces pets infernaux, ces explosions fulminantes satisfont en nous on ne sait quel besoin primitif de désordre et de destruction. A côté des tambours nègres, comme nos grosses caisses semblent peu de choses ! La vulgarité de leur son amorti, l'attaque de ce coup frappé latéralement et sans conviction et non asséné du haut en bas, tout vibrant des muscles de la main, montre assez que nous avons perdu le sens du rythme.
Que dire maintenant des chants, de tous les chants des Noirs qu'il faudrait enregistrer : gardeurs de troupeaux peulhs, bosos ou laptots pagayeurs ou pêcheurs du Niger, chasseurs d'ivoire. Kroumen de la côte, sorciers gouros, féticheurs baoulés, chez tous j'ai entendu des chants qui, souvent sont à peine de la musique, rien que des cadences d'effort (dès qu'un nègre souffre, il chante), des mesures de peine, dont la tradition va bientôt disparaître. La musique blanche la plus frelatée fait déjà son apparition en Afrique. Les nouveaux riches noirs de la Côte d'Ivoire, que la culture du cacao a comblés au-delà de tous besoins, font maintenant venir de la Gold Coast anglaise des professeurs de musique dont les vieux uniformes rouges de l'infanterie victorienne les éblouissent ; ces derniers montent des orphéons, font venir d'Allemagne des cornets à piston pareils à de monstrueux siphons nickelés et, accompagnés de leurs élèves, se livrent dans les rues à des parades bruyantes qui rappellent les plus beaux jours du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Le phonographe faillirait à son rôle de conservation, il ne serait plus cette mémoire mécanique, ce trésor de nos connaissances, ces archives artistiques que nous lui demandons d'être, parmi beaucoup d'autres choses, s'il ne prêtait à la musique d'Afrique toute l'attention qu'elle mérite.
(Arts phoniques, Nos 7-8, septembre 1928.)
(L'Edition Musicale Vivante.)
... Quelque chose glissa d'un dossier, quelque chose de dur, de plat, de rond, qui roula sur le tapis. C'était un disque de phonographe, un des plus vieux, sinon le plus vieux de ma collection, un Whiteman première manière. historique, préhistorique, et dont je ne me rappelais qu'une chose : que je l'avais cherché en vain, toute une soirée, pour en repaître un musicien de mes amis, au temps (préhistorique aussi !) de ma genèse gramophonique.
J'aime, comme tout le monde, la forme, la couleur, la matière du disque. Celui-ci, reprit, peu à peu, sous la manche de non chandail, sa noblesse comme dorée de médaille, le grain doux et irritant de sa spirale microscopique, la finesse de sa gravure, fossile, dirait-on, dans une plaque de charbon. Mais que cette monnaie, fruit d'un après-midi de fouilles, ait pu servir, naguère, aux échanges musiciens, que cette médaille ait pu, un jour, être sacrée, voire sacro-sainte, que cette fougère minérale ait frissonné, jadis, de sève et de souffles sonores, cela ne me venait pas à l'idée. Projetant de la faire encadrer, je tournais entre mes doigts cette pièce de musée. Et je songeais aux périodes du phonographe qui sont comme les âges du globe : à l'âge du Columbia, noir comme la houille, justement, primaire. Carbonifère, quand le son semblait jouer, au fond d'une souterraine caverne, sur des gneiss, sur des schistes, sur des coulées de lave, des filons de métal et des glacis de sel ; à l'époque végétale des premiers Brunswick, à ces boisages de violons, à ces lianes de clarinettes, à la poussée d'ébène du piano ; je songeais à l'âge de fer du « second jazz », métallurgique, cuivré, forgé, martelé, concassé ; à l’âge de pierre du saxophone, à la naissance de l'homme sur le globe gramophonique - ô Revellers, qui apparûtes sur le disque un peu comme Charlot sur l'écran - au paradis terrestre de la guitare hawaïenne, à cet éden un rien musqué et frelaté (à la Loti), d'ailleurs vite transformé en je ne sais quelle bastringue chaloupante (à la Carco). O tiède géographie, tendre géologie, ô histoire sainte du phonographe ! O Dinab, notre chère vieille mère Eve, ô terre promise qu’arrosèrent, aux premiers âges, Blue River et Slow River, ces fleuves idéaux mais dont nous tracerions le cours les yeux fermés.
Perdu dans tout cela, tiré de l'humus de cette immense jungle pourrie - et si féconde - mon premier disque me semblait, entre mes mains, étrangement sec et calciné, vidé de suc, veuf d'odeur, privé de sens. Et je ne sais vraiment pas d'où vint l'inspiration qui me poussa à le remettre « sur le tour ». Je le mis sur le plateau de velours, lui laissai prendre sa vitesse puis engageai dans le précieux petit sillon la pointe d'une aiguille neuve. Et le miracle fut.
Il n y a rien de comparable à la restitution de moi-même que ce disque oublié me donna. Restitution si absolue que l'adjectif l'amoindrit, que son nom même : « restitution », a trahi. L'instantané photographique le plus fidèle, l'odeur la plus tenace, la formule la plus constante, le fleuve tenez, ce fleuve Loire que je retrouve chaque année - et je ne parle pas de ses rives mais de son eau où je pêche à la ligne - ce fleuve au fond duquel je noue les vrais nœuds de ma vie, la borne kilométrique où je tape mes semelles avant de rentrer chez moi, tout cela n'est qu'apparences, mirages, trahisons auprès de l'identité merveilleuse de ce disque. Un instant de mon passé ? Non pas : tout moi depuis toujours et pour toujours, voilà ce que me donne ce rouage d'une machine à mesurer le temps, à abolir le temps. Essayez cela vous serez surpris. C'est amusant comme un tour de passe-passe, comme un jeu de glaces, comme une expérience de physique. Je sens qu'un mathématicien écrirait cela avec six lettres et douze chiffres.
Une date : 1er mars 1924, jaillit, en même temps, du disque et de moi-même. Je ne l'avais pas écrite mais je l'avais retenue. Elle n'était pas un chiffre, elle était nombre, selon Platon. Oui, divin nombre, ordre, harmonie, vie éternelle d'une journée apparemment défunte depuis bientôt cinq ans, mais que le disque avait mystérieusement captée, fixée, gravée... Quand je pense qu'il y a des gens, et même des musiciens, qui nient le phonographe !
(Monde.)
« Musique » et Musique savante
Je m'en étais douté, mais je ne pensais pas être accroché aussi vite. Le uns me crient : « Casse-cou », les autres me prennent à parti. Le grand argument est : « Vos jugements sur les disques sont de parti pris, donc, de ce fait, sans valeur. Cela dépend du point de vue où l'on se place. Puisque le mot « Parti-Pris » a été dit, profitons-en pour préciser notre position. Il est bien entendu que c'est exactement une critique partiale que je veux faire. Tout parti pris est acceptable s'il est sincère et s'il répond à une affirmation du tempérament de qui l'affiche. S'il exprime une réalité intérieure, il n’est qu'une manifestation honnête du sens critique. Parti pris ne veut pas dire paradoxe, je prie mes lecteurs de ne pas faire cette confusion. Si je dis : le disque est une marchandise au même titre que le livre, je n'y mets pas du tout d'ironie, c'est une constatation pure et simple. A mon avis, le disque devrait être regardé ainsi et étudié en tant que disque. Nous n'avons pas à disserter de musique, et c'est une erreur que de croire le servir en le prenant pour prétexte à théories musicales.
On semble croire que la musique est connue de chacun comme l'alphabet.
Que ceux qui reprochent au gros public son ignorance ne l'ont-ils éduqué ?
Que ne l'initient-ils ?...
La musique est un art, affirment-ils, et le peuple ne se soucie pas de l'existence de l'art. C'est vite dit. De plus, la musique, si elle est un art, n'est-elle que cela ? Ne répond-elle qu'à un besoin cérébral d'individualités d'élite ? Ne répond-elle pas plutôt à une nécessité vitale universelle ? On oublie que le peuple s'est nourri de musique avant même qu'elle ne soit devenue un art ? Les vrais musiciens, les maîtres de la musique, de Schumann à Grieg, n'ont jamais dédaigné de se pencher sur les thèmes musicaux du vieux fonds populaire. Cela devrait inciter à faire davantage confiance à la compréhension du peuple. Parce qu'il ne lui est pas permis de « comprendre » toute la musique, on lui nie tout droit à en jouir. La musique ce n'est pas pour lui. Il n'est que très vrai que toute la musique n'est pas pour lui. Mais n'est-ce pas la condamnation de toute une algèbre sonore qui à l'exemple d'une certaine poésie n'est accessible qu'à un petit nombre ? La musique est un moyen d'expression et en tant que moyen d'expression devrait tendre à être, le plus qu'il se peut, universel. Les maîtres véritables n'ont jamais perdu de vue cette destination de leur art. Écoutez les symphonies de Beethoven. La sixième en fa majeur (Pastorale), dirigée par F. Weintgartner ou la Neuvième avec chœurs de Bruno Knittel avec Oskar Fried comme directeur de l'orchestre ou la Symphonie de Bach. C'est par esthétique que les artistes ont engagé la musique dans des voies étriquées sous prétexte de virtuosité. Prenons (de parti pris) un exemple. Voir le disque Col. D. 1.459 - Hark, Hark, The Lark – où un thème très simple de Schubert, agréable et compréhensible pour tous, devient, arrangé par Liszt, un morceau que ne pourront savourer que quelques heureux. En quoi ce thème refondu est-il plus de la musique que le thème initial ? Parce qu'il est devenu de la musique savante ?
Pourquoi les quelques-uns qui sont susceptibles d'apprécier ce disque auraient-ils, eux seuls, droit à aimer la musique ? Parce que, techniquement plus forts que les gens du commun, ils savent admirer l'espèce de science qu'a montrée l'adaptateur. L'art véritable sait utiliser la virtuosité mais ne la considère pas comme un but à atteindre. Elle est une qualité secondaire. D'ailleurs trop souvent la virtuosité n'est qu'un artifice. Nous aurons certes à revenir sur ceci, car c'est la question du fond et de la forme que la discussion sur la virtuosité soulève. Pour aujourd'hui nous en resterons ici.
Il n'y a pas de raison de mettre la Rêverie de Schumann dans une autre catégorie que la Valse en la bémol de Chopin, me déclara un marchand de disques. Un disque représente des qualités de forme, d'interprétation et ne peut avoir de valeur qu'artistique, ajoutait-il. Qu'il faille plus d'effort à l'auditeur (et souvent en vain) pour comprendre telle œuvre plutôt que telle autre, cela lui était indifférent.
Or, à mon sens, c'est justement ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas mettre la musique savante sur le plan de l'autre musique. L'une convient à tous, l'autre n'atteint qu'un certain public. Or, le disque se propose de toucher le plus grand nombre de gens. C'est donc une simple politique de défense dont la musique ne peut souffrir que de mettre l'acheteur possible en garde quant à des déceptions qui l'écarteraient d'elle tout à fait.
Il n'est pas exact de dire que l'acheteur fera tourner son disque jusqu'à ce qu'il l'apprenne. S'il ne lui plaît pas, il le laissera de côté simplement. Si les déceptions se renouvellent, c'est le phono lui-même qu'il laissera dormir. Par contre, si tel disque qu'on lui aura donné comme susceptible de lui plaire, encore que non totalement destiné à lui, est en sa possession, il fera un effort pour le comprendre. Mis en garde, il l'étudiera avec attention. L'éducation musicale du profane doit être faite sans brusquerie. On ma dit encore : « Mais sur quoi vous basez-vous pour dire telle œuvre est trop difficile, telle autre l'est moins ? » … Je crois pouvoir répondre. Je me base sur mon expérience personnelle. Si je veux parler des disques surtout en m’adressant au profane, c'est que j’ai encore présentes à l'esprit les étapes de mon initiation musicale. Je n'ai pas oublié que je ne suis pas venu à Manuel de Falla et à Stravinski tout de suite. Je sais que nombre des œuvres musicales que j'aime beaucoup aujourd'hui me heurtèrent. Je sais quelle somme de volonté il me fallut pour essayer de comprendre telles pages, à l'audition desquelles tant de snobs bayent d'extase sans comprendre et uniquement parce qu'il faut se montrer à la page.
CHRONIQUE
A propos de quelques disques de « Musique instrumentale »
Quelle émotion pour les amis de Lucien Capet que d'entendre la série des disques qu'il avait enregistrée peu de temps avant sa mort, avec le concours de ses fidèles collaborateurs MM. Hewitt, Benoit, Delobelle. C'est le premier grand artiste disparu dont le phonographe transmet, sans l'altérer, la tradition.
Parmi les disques qui paraissent aujourd'hui chez Columbia nous trouvons quelques-unes des pièces capitales du répertoire du quatuor Capet.
C'est d'abord le quatuor en ré mineur de Schubert (la Jeune Fille et la Mort), le 7e et le 10e quatuors de Beethoven.
A tous les points de vue ces trois enregistrements me semblent les meilleurs. L'équilibre sonore est excellent et le moindre détail ressort avec une netteté parfaite.
Le Quatuor de Debussy est moins bien venu. L'andante est un peu mat et je n’ai pas l'impression que ce mouvement ait été enregistré à la même distance du microphone que les précédents. Si pour une raison quelconque on a dû s’interrompre en cours de l'enregistrement on aurait dû marquer à la craie l'emplacement des chaises.
Je n'aime pas beaucoup non plus la répartition des faces. Pourquoi commencer le Final à mi-disque alors que nous avons eu chez Gramophone la preuve qu'on pouvait éviter cet inconvénient ?
Le Quatuor de Ravel contient de bien jolis détails d'exécution. Le second mouvement et le Final sont merveilleux. La tessiture du premier temps convient moins à la transcription mécanique, les ingénieurs n'étant pas encore parvenus à supprimer la vibration de certains sons aigus.
Les disques de Francis Planté eux aussi sont de précieux documents. Dans un précédent article j'établissais, à propos de Paderewski, un parallèle entre l'école de piano du XIXe siècle et les tendances actuelles.
Jouez successivement un disque de Planté et un disque de Braïlowsky, vous verrez qu'un abîme sépare ces deux conceptions du piano. Les facteurs d'instruments ne sont pas étrangers à cette évolution. On ne peut jouer de la même façon un ancien Erard ou un actuel Steinway.
Parmi les meilleurs disques de Planté je citerai la Romance N° 2 de Schumann ; la Fileuse et le Printemps de Mendelssohn, au charme un peu suranné.
Pour Chopin j'avoue que je préfère le style de Braïlowsky.
Les disques remarquablement enregistrés par la maison Polydor connaîtront, j'en suis sûr, un éclatant succès. Voilà enfin du piano qui n'est pas défiguré par le microphone.
Claudio Arrau est également un pianiste de grande classe. Il joue parfaitement les deux études de Paganini-Liszt (Les Gammes - La Chasse) et Islamey de Balakirev.
Toujours chez Polydor, Joseph Hirt, pianiste suisse, rend hommage à son compatriote Arthur Honegger en donnant une bonne interprétation du Cahier Romand.
Chez Columbia, Trillat, qui avait à se faire pardonner certain enregistrement d'un Trio de Rameau, est très en progrès. Sa Sonate de Scarlatti est jouée dans un joli style.
Bon disque aussi : la Première Ballade de Chopin, par Robert Casadesus.
Le répertoire de musique de violon est assez pauvre.
Les enregistrements de M. Szigeti sont corrects mais un peu froids.
Celui de Jacques Thibaud n’a pas le charme qu'on pouvait espérer avec un tel interprète.
J'indiquerai aux amateurs de fou-rire deux duos de cornets à pistons, enlevés avec entrain par MM. Foveau et Vignal. A qui mène mieux est d'une incroyable cocasserie.
Notons pour finir le sublime Quintette avec deux violoncelles de Schubert, interprété par le London String Quartett et M. Horace Britt (disques Columbia).
Tous les musiciens qui ont déjà l'Octuor, le Quintette de la Truite, le Trio, etc..., doivent y joindre ces disques d'une excellente venue.
C'est peut-être le chef-d’œuvre de la musique de chambre de Schubert.
P.-S. - Pour avoir dit dans un précédent article que Fauré était maître mais un maître mineur, j'ai reçu plusieurs lettres surprises ou indignées.
Un musicographe falot, « meneur » de je ne sais quel « jeu », le diabolo peut-être, a même cru nécessaire de rédiger un article pour flétrir mon attitude.
Je pensais m'être exprimé clairement, mais puisqu'il n'en est rien, j'accepte volontiers de mettre les points sur les i.
Je reconnais qu'il y a dans l’œuvre de Fauré des pages émouvantes, poétiques et toujours d'une écriture parfaite, dignes d'un maître (Les Quatuors, le 1er acte de Pénélope, la Bonne Chanson et quelques autres mélodies), mais je ne leur donne pas l'importance de la plupart des œuvres de Debussy ou de Ravel, Pénélope n'est pas Pelléas et il n'y a pas dans toute l'œuvre de piano de Fauré une Isle Joyeuse ou un Gaspard de la Nuit.
(Arts Phoniques, N° 11, janvier 1929.)
Maria Barrientos et Manuel de Falla
Celui qui n'a pas entendu Barrientos, accompagnée par l'auteur, chanter les Sept Chansons populaires de Manuel de Falla, n'en peut connaître la parfaite beauté.
Ces admirables mélodies, jaillies des profondeurs de l'âme espagnole. Manuel de Falla les a faites siennes sans leur imposer la moindre déformation. Il a longuement, patiemment serti ces pierres précieuses nées de la terre d'Espagne. Il a enveloppé ces chants naïfs d'harmonies raffinées, de rythmes subtils, avec tant d'amour, tant d'adresse, un sens si profond de la nature des mélodies populaires, qu'ils ont passé du folklore dans le domaine de la musique savante, sans rien perdre de leur fraîcheur native, de leur spontanéité, de leur émotion.
Tout le monde aujourd'hui les chante, il n’est guère de piano sur lequel on ne les trouve, mais qu'il est rare de les entendre bien interprétés ! Traduits, ils perdent la plus grande partie de leur charme ; la moindre faute d'accentuation, de prononciation, la moindre erreur de temps ou de couleur choque dans ces œuvres parfaites, comme la malencontreuse retouche d'un barbouilleur sur un tableau de maître. La partie de piano est d'une difficulté diabolique et seul un Espagnol en peut exprimer la vie rythmique... Pour juger ce chef-d'œuvre il faut l'entendre chanter par Barrientos accompagnée par Manuel da Falla.
Barrientos est la vivante incarnation de l'Espagne. Personne au monde ne chante comme elle les airs de son pays. Sa science prodigieuse, qui fait merveille dans le « bel canto » italien, ne l'incite jamais à se faire valoir au détriment de l’œuvre. Elle s'en rend esclave, ne craignant pas ces rauques intonations du « canto jondo » qui vous prennent aux entrailles et font sourire bêtement les professeurs de chant. Elle chante avec un abandon de tout son être, comme le ferait une petite gitane amoureuse, une petite fille qui possédât un organe aussi pur, aussi souple, d'un timbre pareillement émouvant, d'une telle sûreté d'intonation.
Manuel de Falla l'accompagne. Est-ce le piano que l'on entend ? N'est-ce pas plutôt le bruissement lointain des guitares ? Il joue avec une ardeur tour à tour joyeuse, sombre ou frénétique. Le feu jaillit de cette musique. Dominé, fasciné, ensorcelé, on perd conscience ; les larmes montent aux yeux et l'on écoute dans un trouble quasi religieux, l'âme de la vieille Espagne murmurer ses confidences à notre âme extasiée.
(La Revue Musicale.)
(L'Action Française.)
…..
En écoutant tout à l'heure la Nuit dans les Jardins d'Espagne, de M. de Falla, interprétée par M. Piero Coppola, son orchestre, et une remarquable pianiste, Mme Van Barentzen, nous nous disions qu'assurément le jour est proche où les musiciens encore réfractaires devront abandonner leurs derniers retranchements et se rendre à l'évidence.
Voilà un enregistrement qui n'a rien de sensationnel. Il se contente d'être excellent, comme cinquante autres. Mais il nous tombe sous la main au lendemain de l'exécution de l'ouvrage aux Concerts-Colonne par M. Ricardo Vinès et M. Ruhlmann. Il appelle donc - inévitablement - la comparaison.
Or, que constatons-nous ? Que la version dite mécanique bat de loin la version de concert. Elle la bat non seulement parce que le tour de main de M. Piero Coppola, sa musicalité, et sa souplesse italienne sont mieux à leur place ici que la loyale carrure de M. Ruhlmann, mais pour bien d'autres raisons qu'on serait tenté de qualifier de mystérieuses si elles ne cessaient de l'être dès qu'on va au fond des choses, dès qu'on accepte de reconnaître de bonne foi qu'une transposition phonographique possède sa vertu propre, ses propriétés séduisantes et singulières, bref, oppose à l'original une réplique qui peut, à certains égards, lui être supérieure.
Au concert, l'arôme de la musique se dilue dans un vaste espace et l'auditeur subit passivement une sorte d'imprégnation. Celui au contraire qui, dans l'intimité, le silence et le recueillement de son cabinet de travail, écoute un disque, tient dans le creux de la main quelques gouttes d'une essence précieuse. Il enveloppe le chef-d’œuvre sonore, il le possède et en devient le maître, au lieu d'être enveloppé et envahi par lui. A son plaisir, sans qu'il s'en rende compte, se mêle quelque chose de l'orgueil lucide de la possession.
Si on en avait la place et le loisir, on s'amuserait à tirer quelques variations brillantes de ce thème : au Châtelet ou salle Gaveau, le mélomane est baigné, submergé, roulé par le flot qui déferle. Les plus raisonnables se défendent. Les autres s’abandonnent lâchement et prennent du plaisir à s'abandonner.
Au contraire, devant la musique qui jaillit du coffret magique, il conserve le contrôle de ses sensations et reconquiert les prérogatives de son sexe. Il est le maître du phénomène musical, il en tient à sa merci le secret et le mystère. Il ne faudrait pas nous pousser beaucoup pour nous faire dire que le phonographe n'eût pas été possible au temps de Chateaubriand et de Musset, ces génies féminins, ni sans doute Musset et Chateaubriand au siècle du phonographe. Et d'ailleurs, regardez si ce nouvel instrument tient aujourd'hui tant de place dans les préoccupations du musicien, la faute n'en est assurément pas aux femmes. Qu'elles aient les cheveux longs et courts, nos compagnes marqueront toujours une secrète préférence pour l'ambiance enveloppante du concert et laisseront volontiers à leurs frères, amis et maris les joies intellectuelles et masculines du phonographe.
Nous parlons de joies intellectuelles. Qu'on n'en conclue pas que la transposition du disque dépouille de sa fraîcheur et de sa sensibilité l'original vivant, pour n'en laisser subsister qu'un schéma desséché, une épure, une abstraction.
Lorsque le disque et l'appareil sont bons, c'est presque toujours le contraire. Cette pièce de Falla brille et séduit par une ardeur, un frémissement, une vie que nous cherchions vainement l'autre après-midi, au Châtelet, dans l'interprétation terne et compassée de M. Ruhlmann. Le disque emprisonne, puis libère l'âme d'une page de musique - et pas seulement son texte. Si ce miracle ne se réalisait pas, l'attention passionnée avec laquelle les musiciens surveillent aujourd'hui tout ce qui touche à la machine parlante ne pourrait se concevoir.
(L'Edition Musicale Vivante, Le Temps, L'Illustration.)
… Il faut bien reconnaître que les débuts de la machine parlante ne furent pas très encourageante. Ces boites à musique nasillardes d'où sortait un chant enroué de ténor affligé d'un coryza éternel, ont été si vite ridiculisées qu’elles paient encore aujourd'hui la rançon de leur jeunesse ingrate. Mais, depuis quelques années et, il faut bien le dire, depuis quelques mois surtout, les progrès des instruments reproducteurs ont été si rapides que les musiciens de métier n'ont plus le droit d'en parler à la légère. L'enregistrement électrique, en particulier, a fait faire au disque un bond prodigieux. Et ce n'est évidemment qu'un commencement. D'année en année, nous verrons se perfectionner cette technique encore incomplète, mais les résultats acquis sont déjà très suffisants pour nous permettre de discuter légitimement l'avenir de ces nouveaux moyens d'expression mis à la disposition de notre art.
Au point de vue purement esthétique, le machinisme nous assure, dès maintenant, des interprétations, des transmissions et des vulgarisations remarquables. L'instrument le moins perfectionné est, assurément, le haut-parleur radiophonique. Il n'a pas encore pu se débarrasser d'un nasillement fâcheux qui déforme souvent la son, en la privant de leurs harmoniques et, par conséquent, en modifiant leur timbre. Les pianos et les orgues exécutant de la musique perforée ont fait, par contre, de grands progrès dans le sens de la souplesse et de la fidélité de l'interprétation. Les uns offrent des possibilités de nuance et d'expression qui permettent à l'exécutant de faire intervenir, dans une traduction musicale, son coefficient personnel de goût, d'intelligence et d'émotion. D’autres enregistrements, au contraire, assurent une reproduction impeccable et immuable du jeu d'un artiste d'élite et en conservent le précieux témoignage.
Mais c'est le disque, fouillé par la pointe imperceptible d'une aiguille d'acier, qui a livré à la musique le plus de secrets nouveaux. Recueillies par microphone, purifié, par des lampes de T. S. F. et transmises électriquement à un appareil enregistreur, les sonorités que boit et que filtre le plateau de cire tiède qui s'en imprègne conservent toute leur pureté et tout leur éclat. Certains timbres se trouvent même singulièrement épurés et améliorés. Les cloches, les harpes, le célesta, le glockenspiel et, depuis peu, le piano y prennent une transparence cristalline d'une poésie insoupçonnée. Toutes sortes de « fondus » heureux et d'enveloppements délicats viennent apporter à une exécution normale une poésie inattendue. Il y a souvent quelque chose d'éolien et de céleste dans le sillage tracé dans les airs par le quatuor-sourdine ou par la voix étouffée des cuivres bâillonnés. Il se produit ici un sortilège, une sorte de miracle de la matière. C'est exactement ce que l’on observe au cinéma lorsque la pellicule sensibilisée poétise, embellit et transfigure un décor ou un visage. Tout le monde souscrit, aujourd'hui, à l'incompréhensible prodige de la « photogénie » : Il faudrait bien se décider à reconnaître celui de la « phonogénie ».
Mais il suffit d'avoir des oreilles et de la bonne foi pour se rendre compte du chemin parcouru. Est-il besoin d'ajouter que nous ne parlons pas ici des innombrables appareils populaires et des disques démocratiques répandus à foison dans les deux mondes par des usiniers qui n'ont d'autre idéal que de s'enrichir facilement à l'aide d'un nivellement par le bas et dont la technique démagogique consiste à livrer au meilleur prix possible des boîtes à musique puissantes et criardes, véritables distributeurs automatiques de chansons, de danses et de refrains de café-concert ? Nous ne parlons que des instruments perfectionnés, malheureusement déjà un peu coûteux, qui permettent l'exécution harmonieuse des œuvres les plus nobles de la musique de chambre et du répertoire lyrique et symphonique. Nous trouvons là de splendides possibilité, et déjà de consolantes réalisations. Malheureusement, les industriels qui ont créé cet art nouveau n'ont pu toujours une culture musicale suffisante et sont incapables de reconnaître, dans leur production, ce qui est bon, médiocre, détestable ou remarquable. Aveuglés - toujours comme leurs collègues du cinéma - par le culte de la vedette, ils se laissent hypnotiser par la gloire de virtuoses célèbre, qui leur donnent parfois des exécutions médiocres et méconnaissent la valeur exceptionnelle de certains interprètes anonymes. Seuls, les chercheurs patients arrivent, en écartant les suggestions tendancieuses du marchands, à se constituer une discothèque de choix qui répond victorieusement à toutes les objections du sceptique.
Mais, bien que les résultats actuels de cette industrie soient déjà fort encourageants, son présent est rien en comparaison de l'avenir qui lui est réservé. Et c'est dans ce sens que l'on peut légitimement affirmer que les artistes n’ont pas le droit de se désintéresser de l'évolution de le musique mécanique. Songez à la formidable influence éducatrice de la musique mise ainsi en conserve, transformée en tablettes, en pastilles, dont chacun peut remplir un harmonieux drageoir. Songez à l'intérêt de pouvoir réunir, dans le plus humble logis, les meilleurs orchestres symphoniques du monde, les sociétés chorales de tous les pays, les chanteurs et les instrumentistes qui ne se produisaient, jusqu'ici, que devant les parterres de rois. Songez à la valeur pédagogique de ces documents irréfutables qui contiennent la pensée exacte d'un maître et nous livrent l'enseignement technique des interprètes les plus respectés. Grâce à eux, tout le monde peut prendre pour professeur un empereur de l'archet, du clavier ou du chant. Certains de ces documents devraient être, pour tous les maîtres de musique, des outils professionnels indispensables. Les conseils d'une modeste répétitrice de province, qui s'efforce d'expliquer à ses élèves ce qu'est le rubato de Chopin, valent-ils l'audition d'un disque où nos plus grands pianistes donnent clairement la solution du problème et répétant leurs explications avec docilité, aussi souvent qu'on le désire ?
Quelle garantie précieuse pour la musique que l'enregistrement d'une œuvre exécutée par son compositeur ou par des interprètes soumis à son contrôle ! Quelle leçon de style et d'expression ! Entendre à son gré, sous une forme impeccable, les Préludes de Debussy, exécutés par leur auteur, comme lui seul savait le faire, entendre Liszt jouer du piano et Paganini du violon, ne serait-ce pas, pour les générations actuelles et futures, un incomparable privilège ? Imaginez notre joie si l'on découvrait miraculeusement un instrument reproducteur, datant du dix-septième siècle, nous permettant de connaître enfin le style et le vocabulaire exacts de la musique ancienne, sur lesquels les musicologues dissertent à perte de vue sans avoir pu nous donner des précisions indiscutables.
Nous vivons au siècle du moteur. Aucune forme de notre activité ne peut se passer de ce prolongement et de cet accroissement de notre force insuffisante. Lorsque, grâce au film, des industriels ont branché l'art théâtral sur une prise de courant électrique, les artistes ont déjà eu le tort de se désintéresser dédaigneusement de cette technique, dont la découverte représentait pourtant un événement d'une importance sociale qui a été comparée à celle de l'imprimerie. Les musiciens sont en train de commettre exactement la même faute en traitant par le mépris les instruments de transmission et de diffusion basés sur un principe mécanique. Automatisme ne veut pas dire insensibilité et raideur. Le moteur a appris la subtilité, la souplesse et la délicatesse. En musique, il peut faire merveille. Mais il est nécessaire de soigner son éducation esthétique et de lui assigner son véritable rôle. Les artistes qui ne le comprennent pas commettent une grave imprudence. Le moment est venu pour eux de surveiller attentivement, de contrôler et de diriger un mouvement irrésistible qui les écrasera s'ils ne s'en rendent maîtres.
(L'Illustration, 17 décembre 1927.)
L'ouvrage que nous proposons aujourd'hui aux amis de la musique enregistrée ne saurait être complet, tant s'en faut. Notre répertoire ne porte que sur une période donnée de la production des éditeurs français et il nous faut dès à présent envisager le moyen, par des suppléments périodiques, de le mettre sans cesse à jour.
Nous avons, ainsi que l'indique la note qui précède notre répertoire, procédé à une révision critique des disques figurant sur les catalogues des firmes françaises, depuis 1925 environ, jusqu'à la date limite du 1er juin 1929. Un supplément régulier, précédé d'un éditorial viendra mettre à jour ce répertoire, en attendant qu’une nouvelle édition lui succède. Ce édition successives formeront, à notre sens, un véritable annuaire de la musique enregistrée.
En attendant, nous donnons ici quelques indications permettant à nos lecteurs de se documenter de façon régulière sur les nouvelles parutions. Nous avons, dans la troisième partie de notre ouvrage, donné quelque échantillons de critiques et de textes signés par des écrivains qui s’intéressent de façon suivie à l'édition musicale enregistrée. Le manque de place nous a obligé à limiter le nombre de ces texte, de sorte que certains, tels que ceux de Pierre Scize, André Cœuroy, etc., qui nous sont parvenus trop tard, n'ont pu y être ajoutés.
Les revues consacrées exclusivement au phonographe ne sont pas nombreuses : Phono-Radio-Musique, la Revue des Machines Parlantes sont des revues de documentation, s'adressant uniquement aux professionnels. Il y a par contre deux revues critiques qui sont destinées à renseigner les amateurs sur l'actualité.
La première en date est l'Edition musicale vivante, dont les numéros mensuels offrent régulièrement une copieuse critique des disques nouveaux par Emile Vuillermoz, Maurice Bex, P. O. Ferroud.
La deuxième de ces revues commença à paraître peu après celle de M. Vuillermoz : Arts Phoniques paraît tous les mois. La critique des disques nouveaux y est répartie entre plusieurs collaborateurs : Musique instrumentale, par Francis Poulenc, Musique Symphonique, par Claude Aveline, etc.
On suivra avec profil les chronique des disques nouveaux que publient, dans la plupart de journaux et revue importants, des critiques tels que ceux dont cet ouvrage offre des échantillons, dans sa troisième partie.
Il convient de signaler enfin la place importante qu'attribuent à la critique de disques certains quotidiens et périodiques, tels qu'Excelsior, l’Intransigeant, avec sa page du dimanche, et enfin Monde où notre ami Henri Poulaille publie de longues et ferventes chroniques.
Ainsi le phonographe possède ses critiques, en attendant le jour prochain où il aura ses romanciers et ses poètes, qu'annoncent déjà la Chronique Sentimentale de la Vie Contemporaine de Mac-Orlan, et le dernier livre de Blaise Cendrars.
[Ce livre contient également un catalogue de disques, mais seuls les textes ont été reproduits ici]