
Xavier DEPRAZ

Xavier Depraz dans Faust (Méphistophélès)
Xavier Marcel DELARUELLE dit Xavier DEPRAZ
basse française
(Albert, Somme, 22 avril 1926 – Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Isère, 18 octobre 1994)
Fils de Louis Félicien DELARUELLE (Lyon 3e, 27 mars 1898 – Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 21 octobre 1974), ingénieur aéronautique [fils d'Alphonse Henri DELARUELLE (Nîmes, Gard, 28 mars 1866 – ap. 1915), chef de gare], et de Marie-Louise BUGNON (Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 15 août 1897 – Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 18 août 1982).
Epoux de Danielle Anita dite Danièle LUCCIONI (Paris 16e, 29 mars 1936 – Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 02 août 2023) [fille de José LUCCIONI, ténor] ; parents d'Anne DELARUELLE.
En 1947, il entre au Conservatoire de Paris où il a pour professeurs Fernand Francell pour le chant, Louis Musy pour la scène, et René Simon pour le théâtre. Trois ans après il obtient trois prix en présentant Boris Godounov, Don Carlos et Don Quichotte. Il créé à l'opéra de Mulhouse en 1951 le Rire de Nil Halerius de Marcel Landowski (de qui il créera également le Fou). Il débute dans l'opérette à Bobino (les Pieds Nickelés), mais est vite appelé à l'Opéra. Il entre à la R.T.L.N. en 1952, et chante cette année-là le Barbier de Séville (Basile) avec succès à l'Opéra-Comique. Ses dons s'épanouissent. Artiste conscient, travailleur, discret, il possède un large répertoire. Il chante sur nos deux scènes nationales. A la Radio, il reprend l'Œdipe d'Enesco en 1955. Il chante aussi à Lyon (les Troyens, Pelléas et Mélisande), à Bordeaux, à Monte-Carlo, à Marseille (Don Giovanni). Invité au Festival de Glyndebourne, il y chante le Comte Ory, et à Venise, Œdipus-Rex. A partir de 1971, il a commencé une carrière de comédien au cinéma et à la télévision (Ursus dans l'Homme qui rit, 1971 ; Jacques de Molay dans les Rois maudits, 1972). Il a tenu une classe d'opéra-comique au Conservatoire de Paris de 1973 à 1991.
Il est décédé en 1994 à soixante-huit ans.
 Xavier Depraz en 1953 |
 Xavier Depraz en 1956 |
|
Sa carrière à l'Opéra de Paris
Il a débuté le 03 février 1952 dans Thaïs (Palémon).
Il a chanté Rigoletto (Sparafucile, 1952) ; les Maîtres chanteurs de Nuremberg (Pogner, 1952) ; l'Aiglon (Maréchal Marmont, 1952) ; les Indes galantes (Osman, 1952) ; Boris Godounov (Pimen, 1953) ; Faust (Méphistophélès, 1954) ; la Flûte enchantée (2e Homme armé, 1954 ; Prêtre, 1955).
Il a créé le 15 avril 1955 Numance (Marquin) d'Henry Barraud.
Il a participé aux premières suivantes : le 21 juin 1957 de Dialogues des Carmélites (le Marquis de La Force) de Francis Poulenc ; le 21 avril 1968 du Prisonnier (le Prisonnier) de Luigi Dallapiccola [version française de Jean-Marie Martin]. |
Sa carrière à l'Opéra-Comique
Il a débuté le 06 février 1952 dans le Barbier de Séville (Basile).
Il a chanté la Bohème (Colline) ; Falstaff (Pistolet) ; Louise (le Chiffonnier) ; Madame Bovary (Abbé Boursien) ; Roméo et Juliette (Frère Laurent) ; la Femme à barbe (le Sultan) ; le Jongleur de Notre-Dame (le Prieur, 1954).
Il a participé aux premières de : le 18 juin 1953 le Libertin (Nick Shadow) d'Igor Stravinsky [version française d'André de Badet] ; le 12 mai 1955 Eugène Onéguine (Prince Gremmin) de Piotr Ilitch Tchaïkovski [version française de Michel Delines] ; le 08 octobre 1959 le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók [version française de Dimitri Calvacoressi].
Il a créé le 18 janvier 1961 Dolorès ou le Miracle de la femme laide (l'Ermite) d'André Jolivet ; le 21 octobre 1963 le Dernier Sauvage (Scatergood) de Gian Carlo Menotti [version française de Jean-Pierre Marty]. |

Xavier Depraz en 1959

|
[le Libertin d'Igor Stravinsky] L'artiste atteint la plénitude de son talent – sa plénitude à lui, qui est de mouvement, de hargne et d'ironie – dans toutes les scènes où Nick Shadow intervient. Le rôle du diable est une réussite exceptionnelle et significative dans sa continuité, alors que toutes les autres réussites semblent et sont de rencontre. Je veux bien croire que M. Xavier Depraz, qui est étonnant de force et de vie, y soit pour quelque chose. Mais c'est là aussi que la partition « chante » le plus, que les recherches formelles se simplifient ou deviennent invisibles, sans que pour autant on ait envie de dire que l'auteur témoigne moins de maîtrise. (Marc Soriano, la Pensée, décembre 1953)
|

Xavier Depraz dans Faust (Méphistophélès)

Xavier Depraz dans Faust (Méphistophélès)

Xavier Depraz (Méphistophélès) et Andrée Gabriel (Siebel) dans l'acte II de Faust à l'Opéra en 1956

Xavier Depraz dans Faust (Méphistophélès) à l'Opéra en 1956
|
Xavier Depraz dans le Barbier de Séville (Basile)
Dans sa loge, avant la représentation du Barbier de Séville, j’ai interviewé Xavier Depraz.
Oui, à dix-huit ans, vocation théâtrale. Mais pas lyrique — dramatique ! En 1942, dans mon institution, à Saint-Germain-en-Laye, notre professeur de Lettres nous a fait jouer la Jeanne d'Arc de Péguy. Rien que des garçons... Là, j'ai eu le coup de foudre : j'ai senti que je serai acteur... Le rôle qui m'était dévolu ? Ne le répétez pas : j'étais... le souffleur. Depuis ce temps-là, j'ai souvent repris ce rôle, d'ailleurs...
Ensuite ? Là, ça devient plus sérieux : le rôle du maître à danser dans le Bourgeois gentilhomme. Je décide alors de préparer le Conservatoire... pour entrer à la Comédie-Française, évidemment. Mais c'est alors que je fais connaissance de deux camarades, les fils de Georges Thill : Raymond et Albert, qui m'ont parlé de leur père. Et j'ai pensé alors à la scène lyrique... Par ailleurs, notre professeur d'Histoire, Olivier Alain (le frère de Jehan Alain, le compositeur), m'a initié à la musique de Bach, au chant choral. Désormais, ma voie — ma voix aussi — était toute trouvée.
Ah ! non, pas tout de suite. Mes parents ont exigé (et ils avaient bien raison !) que je finisse d'abord mes études. Ce n'est qu'après mon service militaire que j'ai étudié le chant — avec Fernand Francell. Quatre mois de cours avant de me présenter au Conservatoire, où j'ai été reçu en octobre 1947. Comme professeurs ? D'abord, Fernand Francell. Puis, Panzéra pour le chant ; et Louis Musy, dans la classe de mise en scène. Au bout de trois ans : deuxième prix de chant, deuxième prix d'opéra-comique, premier prix d'opéra.
La quatrième année a été plutôt... agitée. J'ai travaillé en province : Nancy, Tunis, Marseille. Et surtout à Paris, à... Bobino, où je jouais dans les Pieds Nickelés (je remplaçais Armand Mestral)... Le music-hall : une excellente école pour les chanteurs-comédiens. Cela vous fait, vous brise, et vous apprend terriblement le métier ! Là, j'ai fait la connaissance des Frères Jacques : quels excellents artistes ! — A la fin de cette quatrième année, mes maîtres — Panzéra et Musy — m'ont demandé de me représenter au Concours du Conservatoire. J'ai alors obtenu le premier prix d'opéra-comique (dans Don Quichotte), et le prix d'Honneur de chant. Aussitôt, j'ai été engagé à l'Opéra, par M. Hirsch.
Oui, je joue à l'Opéra et à l'Opéra-Comique. Le répertoire que je préfère ? Vous le savez bien : celui de la Salle Favart. Avec la comédie lyrique, on « joue ». Bien plus intéressant, comme travail...
Remarquez-le, je n'ai jamais touché à la grande manifestation lyrique de l'Opéra. Et mon rêve, c'est toujours la grande tragédie. Aussi, est-ce un grand bonheur, pour moi, de me voir attribuer le rôle d'Œdipe — dans l’Œdipe d'Enesco, que l'Opéra va monter.
Mes rôles préférés ? En tout premier lieu, le rôle de don Basile dans le Barbier de Séville. Ensuite, le rôle de Colline dans la Vie de Bohème. Puis, le Nick Shadow, de Rake progress, œuvre de Stravinsky. J'aime beaucoup, aussi, le Chiffonnier, de Louise. Et aussi, ma récente création, dans Eugène Onéguine... Oh ! j'oubliais : le rôle du Sultan dans la Femme à barbe : nous nous y amusons tellement !
Ah ! les mélodies... Je regrette bien de n'avoir pas le temps d'en chanter davantage. Mon cœur va d'abord à Schubert. Et à Fauré aussi — évidemment...
A la Radio, on me demande surtout le répertoire lyrique. De nombreuses créations : Œdipe, d'Enesco, que je vais créer à l'Opéra — l'Ange de feu, de Prokofiev ; et, du même auteur, l'Amour des trois oranges, le Joueur — le Château de Barbe-Bleue, de Bartók — Hécube, de J. Martinon — le Joueur de cornemuse, de Weiberger — Peter Grimes, de Britten — la Duchesse de Padoue, de Maurice Le Boucher...
Sur le plan de la musique pure, je reste indéfectiblement attaché à Jean-Sébastien Bach. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai... appris la musique. Et c'est lui qui m'a conduit à la musique moderne... J'ai aussi un culte pour les Russes — oui, les « Cinq », naturellement ; en particulier pour Moussorgski et Borodine... Dans les modernes ? Honegger est un de mes préférés, avec Enesco, et Bartók. Enfin, je vous le déclare sans ambages, je suis un féru du grand Jazz symphonique (le bon, évidemment...).
Auteurs préférés ? Les classiques... Il n'y a qu'eux pour vous enrichir l'esprit... En tête, je place le théâtre de Musset : fraîcheur, clarté, poésie... Sur le même plan, les Fables de La Fontaine... Dans les modernes, Cocteau : l'un de ceux qui m'ont entraîné vers le théâtre. Et Apollinaire... Dans la production contemporaine ? Un grand merci à Sartre qui, avec ses Chemins de la liberté, m'a profondément déçu, et, par là, m'a guéri de ma tendance au surréalisme, de mon désir de ne pas faire comme les autres... Don Basile remis dans le droit chemin par Sartre : de quoi faire un sketch excellent... Mais... sur quelle musique ?
Ah ! une anecdote — pour finir... Je veux bien. A Bobino, à mes débuts. J'avais un rôle de « mauvais garçon ». Le troisième et dernier acte se terminait sur les toits, où j'étais poursuivi par la police. Au moment d'être pris, je sortais mon « pétard », pour descendre les flics. Mais voici qu'alors se dresse devant moi une jeune fille — très pure, de caractère très noble — et qui, en dépit de la noirceur morale de mon personnage, m'aimait éperdument... Elle essaie de m'empêcher de tirer. Furieux, je lui crie : « Barre-toi, ou je te brûle ! » Alors, de la « poulaille », une voix, étranglée par l'émotion, se fait entendre : « Salaud ! Tu vas pas faire ça... » — Voyez-vous, la plus grande satisfaction d'un homme de théâtre, c'est d'arriver à faire oublier la fiction, pour la transformer — dans l'esprit du spectateur — en réalité vivante...
(Propos recueillis par Henri Gaubert, Musica, juillet 1956)
|

Xavier Depraz dans le Barbier de Séville (Basile) en 1956
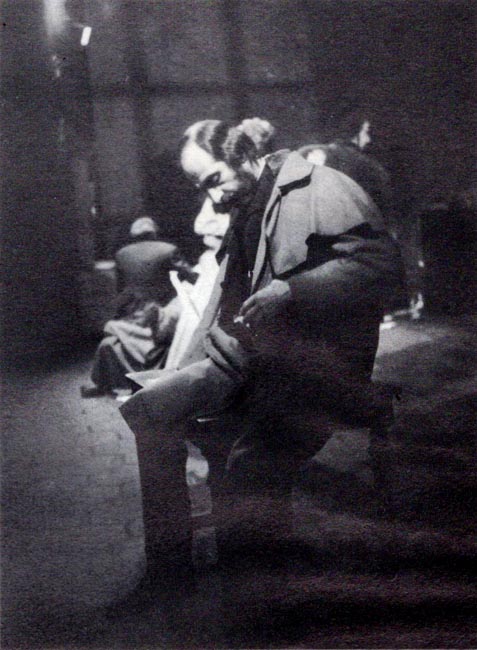
Xavier Depraz dans la Bohème (Colline) à l'Opéra-Comique [photo Michel Petit]
|
Le Château de Barbe-Bleue à l’Opéra-Comique
En 1905, un jeune musicien hongrois. compositeur et pianiste, fit le voyage de Paris pour y participer au concours de piano et de composition instauré à l'enseigne d'Antoine Rubinstein. Quant à son but immédiat, ce voyage devait se solder par un demi-échec : le jeune musicien — il s'appelait Bela Bartók — ne fut même pas nommé au concours de composition ; et au concours de piano, il dut se contenter de la deuxième place, la première ayant été attribuée à Wilhelm Backhaus. Mais sur le plan de sa formation et de son évolution générale, Bela Bartók devait tirer, de son séjour à Paris, des enseignements décisifs. Né en 1881, il avait été élevé, au Conservatoire de Budapest, dans la tradition du romantisme allemand, et, plus précisément, dans l'atmosphère du postromantisme alors tout-puissant. Par son maître Ernst von Dohnany, Bartók entra en contact direct non seulement avec la musique de Liszt et de Wagner, mais aussi avec celle de Brahms et du jeune Richard Strauss. Toutes ses premières œuvres — et parmi elles sa « Première Rhapsodie » pour piano et orchestre, apportée à Paris se ressentent de ces influences, qui, sans le voyage à Paris, auraient peut-être continué longtemps à marquer le travail créateur de Bartók. Pourtant, la « Rhapsodie » en question recelait également les premiers signes des préoccupations du jeune Bartók concernant le folklore, la musique populaire, non seulement celle de son pays, mais aussi celle — pour commencer — des pays voisins de la Hongrie. En effet, peu de temps avant le voyage de Paris, Bartók avait commencé à parcourir méthodiquement la campagne hongroise, dont la partie orientale, sous l'empire austro-hongrois, était également peuplée d'une importante minorité roumaine. Il y recherchait des mélodies populaires authentiques, qu'il opposait résolument à la musique des tziganes établis en Europe centrale, et que d'illustres musiciens et musicologues — Liszt en tête ! — avaient longtemps confondue avec la musique « hongroise ». En allant patiemment à la recherche de cette musique populaire authentique. Bartók fit une découverte capitale : à savoir que cette musique, loin de se contenter des tonalités majeures et mineures de la musique classique et romantique de l'Europe centrale, utilisait abondamment les modes anciens, tels qu'ils ne s'étaient conservés, par ailleurs, que dans la musique grégorienne de l'Eglise. Or, quel ne fut l'éblouissement de Bartók lorsque, à l'occasion de son séjour à Paris, il découvrit que la musique des maîtres français qui se nommaient Debussy et Ravel faisait, elle aussi, appel aux modes anciens, leur donnant la préférence sur les tonalités classiques ! Bartók salua bientôt, dans la musique française, — comme devait le faire, deux ans après lui, l'Espagnol Manuel de Falla — la véritable libératrice des jeunes écoles musicales nationales de la tyrannie du romantisme allemand, et du système mélodique et harmonique, à cette époque encore en honneur dans cette école. Toutes les œuvres composées par Bartók après son retour en Hongrie, et jusque vers 1918, devaient se ressentir de l'influence française, que le jeune maître combinait avec l'influence parallèle du folklore redécouvert de sa propre patrie. Après la « Deuxième Suite » pour orchestre, les « Bagatelles » pour le piano, le « Premier Quatuor » et les quatre chants funèbres pour piano, intitulés « Nenies », l'œuvre la plus importante de cette période, achevée en 1911, est incontestablement l'opéra en un acte « le Château de Barbe-Bleue ». Depuis longtemps. cette œuvre devrait faire partie du répertoire de nos théâtres lyriques nationaux. Elle vient seulement d'y être inscrite. et c'est là un mérite incontestable de la nouvelle équipe de direction. En effet, « le Château de Barbe-Bleue » s'inscrit dans la descendance immédiate du prodigieux essor du théâtre lyrique français au début du XXe siècle, et du renouveau d'écriture et d'esprit qui l'a caractérisé. Zoltan Kodaly. le compagnon de route de Bartók, devait dire que « le Château de Barbe-Bleue » était le « Pelléas et Mélisande » de la Hongrie. Autant qu'à cette œuvre, « le Château de Barbe-Bleue » fait irrésistiblement penser à « Ariane et Barbe-Bleue » de Paul Dukas, que le librettiste de Bartók, Bela Balasz, a très probablement vu, lors de sa création à Paris. en 1907. On sait que les deux œuvres s'inspirent directement, pour le livret, du drame « Ariane et Barbe-Bleue », de Maurice Maeterlinck. Certes, l'originalité du style musical de Bartók reste entière, dans son œuvre, par rapport à celui de ses grands devanciers français. Il n'en est pas moins vrai, cependant, qu'il s'y rattache par des fils multiples. Le premier, c'est celui de l'écriture modale, que j'ai évoquée au début de cette. étude. Un autre, c'est celui de la déclamation lyrique c'est encore Kodaly qui nous apprend que le récitatif mélodique de Bartók « colle » à la langue hongroise avec la même fidélité que le récitatif de Debussy à la langue française. Enfin, sur le plan orchestral, les parentés entre Bartók et Dukas sont souvent étonnantes, mais remontent, elles, à une origine commune, qui n'est pas spécifiquement française : c'est celle, précisément, du postromantisme allemand, dont Dukas a tenté, dans son « Ariane et Barbe-Bleue », la synthèse avec l'harmonie modale et le style mélodique de la nouvelle musique française.
Berthe Monmart et Xavier Depraz, les interprètes du Château de Barbe-Bleue
L'acte de Bartók a une puissance monolithique qui contraste étrangement avec la variété et la subtilité des symboles dont il est porteur. Barbe-Bleue introduit sa nouvelle femme, Judith, dans la grande salle de son château. Leur mariage est le fruit d'un rapt, mais d'un rapt auquel Judith a consenti, au sujet duquel elle a été la complice de Barbe-Bleue contre sa propre famille. A l'amour de Barbe-Bleue a donc répondu l'amour conscient et volontaire de Judith. Lorsque, au début de l'unique grande scène qui les oppose, Barbe-Bleue demande à Judith pourquoi elle l'a suivi, elle lui répond, en substance, que c'est pour introduire la vie et la lumière dans le vieux château de Barbe-Bleue, dont les murs gris sombre suintent et répandent une indicible tristesse. Mais voilà ; malgré la volonté de renouveau que Judith apporte avec elle, elle doit bientôt se rendre compte que le passé d'un homme, que la somme de ses expériences et de ses souvenirs, de ses hauts faits comme de ses actes inavouables ne s'effacent pas comme peut s'effacer la trace d'un crayon sur une feuille de papier. Elle comprendra aussi autre chose : que l'âme d'un homme a des secrets que personne, même et surtout pas sa femme, n'a le droit de pénétrer. Cette prise de conscience s'opérera dans l'œuvre de Bartók par le symbole de l'ouverture successive des sept lourdes portes que Judith remarque dans le mur de la grande salle, presque aussitôt après son entrée. Ce sont, on l'a deviné, les portes qui donnent accès à l'âme de Barbe-Bleue et à ses secrets. Celui-ci consent à ouvrir, pour sa femme, les trois premières portes successivement, celle-ci voit un assemblage d'instruments de torture, puis des armes guerrières, puis un amas extraordinaire de bijoux, de couronnes et de métaux précieux. Et des instruments de torture, comme des armes, comme des pierres et des métaux précieux, le sang ruisselle. A présent, Barbe-Bleue lui-même engage Judith à ouvrir la quatrième porte, derrière laquelle se montrent de splendides jardins enchantés ; puis la cinquième, qui laisse voir d'immenses domaines merveilleusement fertiles. Judith, au comble de la curiosité — une curiosité à la fois féminine et métaphysique —, de l'angoisse, aussi, et de la passion, demande la permission d'ouvrir la sixième et la septième portes. Barbe-Bleue la supplie d'y renoncer ; mais plus il supplie, plus elle s'obstine, et on sent déjà qu'à vouloir fracturer ainsi les tiroirs les plus secrets de l'âme de son mari elle court immanquablement à sa perte. Barbe-Bleue finit par sentir lui-même qu'il y a là une fatalité à laquelle ni l'un ni l'autre ne peut échapper. Judith ouvre la sixième porte : et c'est une mer de larmes qui se montre à ses yeux, à son âme de plus en plus angoissée. Enfin, elle réclame l'ouverture de la septième porte ; dans un dernier sursaut, Barbe-Bleue essaie de résister ; et Judith, instinctivement. comprend que derrière cette septième porte se trouvent enfermées les anciennes épouses de son mari. Elle l'ouvre, enfin, et les trois femmes que Barbe-Bleue eut avant Judith se montrent ; « la femme du matin, la femme de midi, la femme du crépuscule » dira Barbe-Bleue. Et il continuera : « et toi, Judith, tu es la femme de ma nuit ». Richement parée, recouverte d'un précieux manteau et la tête ceinte d'une couronne, Judith ira rejoindre celles qui sont autant ses devancières que ses compagnes, dans les profondeurs de l'abîme que la septième porte recèle, c'est-à-dire dans les profondeurs de l'âme de Barbe-Bleue. Et tandis que les quatre femmes disparaissent, et que la salle du château s'assombrit. Barbe-Bleue reste seul, une fois de plus, avec le souvenir de ses richesses, de ses guerres, de ses amours, d'où suintent éternellement, en son âme, les gouttes de sang de ceux qu'il a torturés, qu'il a conquis, qu'il a aimés. On voit, par le simple récit de ce qui se passe au cours de cet acte extraordinaire, combien la mise en scène de l'œuvre est difficile à réaliser. Comme je l'ai déjà signalé dans une brève note parue dans cette revue, sur le plan musical, la représentation de l'Opéra-Comique a été fort belle ; les deux seuls personnages de l'œuvre ont été incarnés scéniquement et vocalement par Xavier Depraz et Berthe Monmart, de remarquable façon. Tous deux ont compris profondément l'importance et la signification symbolique de leurs rôles, et ont su mettre cette importance pleinement en relief. Au pupitre, Georges Sébastian a été un animateur de tout premier ordre ; il est vrai qu'il avait bénéficié de quinze répétitions d'orchestre. Par contre — et cela aussi, je l'ai déjà signalé — le décor de Félix Labisse était une profonde erreur, car c'était un essai de traduction réaliste, et donc forcément mesquine, des puissants symboles des portes et de leurs secrets. Seule, une présentation fortement stylisée et entièrement transposée par rapport à la réalité aurait pu rendre justice à l'événement scénique et à son incomparable traduction musicale.
(Antoine Goléa, Musica disques, février 1960)
Judith (Berthe Monmart) demande à Barbe-Bleue (Xavier Depraz) de lui ouvrir les dernières portes
|
|
Xavier Depraz parle de Chaliapine.
Il y a un fait : Chaliapine est un « monstre sacré ». Tout ce qu'on a pu raconter sur lui, en bien ou en mal, on l'a dit parce que c'est une personnalité, et une personnalité exceptionnelle. L'erreur serait de chercher à l'imiter. Il a une richesse et une puissance que nous ne possédons pas. Laissons-lui sa manière d'interpréter, et surtout n'essayons pas de faire le quart de ce qu'il faisait.
En son temps, il a amené une révolution. Il a donné une vérité à ses personnages. On a, avec lui, abandonné le « théâtre de salon » profit d'une conception plus exigeante : le drame lyrique. Pour nous, qui vivons à l'heure du cinéma et de la télévision, nous nous devons d'aller plus loin en ce sens, et de faire de plus en plus du vrai théâtre.
Monstre sacré, Chaliapine l'était. Il fut aussi, bien sûr, une vedette internationale. Mais qu'est-ce qu'une vedette internationale ? c'est en quelque sorte un phénomène, un « numéro ». De nos jours, cela ne peut plus exister. C'est une notion anachronique qui ne peut se concilier avec l'idée d'un véritable théâtre lyrique tel que nous devons le concevoir.
L'exemple de Chaliapine ne doit pas nous mener à rechercher le vedettariat mais à retrouver cet enthousiasme, cet amour du théâtre et aussi cette simplicité qui l'habitaient. Car l'essentiel est là : amour du théâtre et simplicité.
Pour un artiste lyrique, le véritable objectif n'est pas d'obtenir la consécration d'une quelconque renommée internationale, mais de parvenir à incarner le personnage correspondant à chaque rôle. A cet égard, l'exemple de Chaliapine constitue pour nous une leçon. Il ne montait pas sur les planches pour chanter un air, mais pour créer un personnage. Il n'y avait pas Chaliapine dans Méphisto, Chaliapine dans Boris, Chaliapine dans Basile. Non. Il y avait sur scène Méphisto, il y avait Boris, et il y avait Basile. Chaque fois, c'était une composition différente. Et s'il a marqué si profondément ses rôles, c'est parce qu'il était avant tout un homme de théâtre.
(Jean Goury, Fedor Chaliapine, 1965)
|

|
Sérénade extrait de l'acte IV de Faust de Gounod Xavier Depraz (Méphistophélès) et Orchestre Symphonique (musiciens de l'Opéra) dir. Jean Laforge enr. à la Schola Cantorum en avril/mai 1958
|
Duo-Sérénade extrait de l'acte I de Don Quichotte de Massenet Denise Scharley (Dulcinée), Xavier Depraz (Don Quichotte) et Orchestre Symphonique (musiciens de l'Opéra) dir Jean Laforge enr. à la Schola Cantorum en avril/mai 1958
|
la Mort de Don Quichotte extrait de l'acte V de Don Quichotte de Massenet Xavier Depraz (Don Quichotte), René Bianco (Sancho) et Orchestre Symphonique (musiciens de l'Opéra) dir Jean Laforge enr. à la Schola Cantorum en avril/mai 1958
|
|
le Barbier de Séville de Rossini [version française de Castil-Blaze] Renée Doria (Rosine), Marguerite Legouhy (Marceline), Carlo Baroni (Almaviva), Jacques Jansen (Figaro), Louis Musy (Bartholo), Xavier Depraz (Basile), Charles Daguerressar (Pédrille), Paul Payen (l'Officier), André Noël (le Notaire), Le Prin (l'Alcade) Chœurs et Orchestre de l'Opéra-Comique dir. Jean Fournet enr. en public à l'Opéra-Comique le 19 juin 1955
|
Air de la Calomnie "C'est d'abord rumeur légère" extrait de l'acte II du Barbier de Séville de Rossini [version fr. de Castil-Blaze] Xavier Depraz (Basile) et Orchestre de l'Opéra-Comique dir Jules Gressier enr. en 1956
|
|
"Dans ce séjour tranquille" extrait de l'acte III de la Flûte enchantée de Mozart [v. fr. de Prod'homme et Kienlin] Xavier Depraz (Sarastro) et Orch de l'Ass. des Concerts Colonne dir Louis de Froment enr. en 1960
|
Air des Prêtres "O Isis, Osiris" extrait de l'acte III de la Flûte enchantée de Mozart [v. fr. de Prod'homme et Kienlin] Xavier Depraz (Sarastro) et Orch de l'Ass. des Concerts Colonne dir Louis de Froment enr. en 1960
|
|
les Marchés de Provence (par. Louis Amade / mus. Gilbert Bécaud) Xavier Depraz et le grand Orchestre de Raymond Lefèvre ORTF, 08 juin 1966
|
voir également les enregistrements de Faust (anthologie 1962 Guiot)